lundi, 21 septembre 2009
Naissance de Béraud
Un 21 septembre comme celui-ci, presqu'un dernier jour de l'été, celui de 1885, naissait à Lyon Henri Béraud. Ses parents, boulangers rue Ferrandière dans la paroisse de Saint-Nizier, avaient tous deux une ascendance dauphinoise qui inspirera grandement le futur romancier de la "Conquête du Pain", cycle de trois romans (Le Bois du Templier Pendu, Les Lurons de Sabolas, Ciel de Suie)
Voici pour le plaisir de ceux qui connaissent un peu cet auteur, ou de ceux qui souhaitent le découvrir, un bref extrait de sa prose poétique, du plus beau roman jamais écrit sur cette chienne de ville de Lyon :
A l'époque où il advint ce que je vais raconter, le quartier de la soie à Lyon était à peu près ce qu'il est aujourd'hui. De hautes maisons couleur d'averse et d'avarice y traçaient déjà ce gluant labyrinthe où, pour mieux se cacher, la fortune emprunte le visage de la misère.Chez nous, rien ne change, ni le ciel, ni la pierre, ni les âmes. Sur les pavés toujours gras, qui semblent renvoyer au ciel plus de clarté qu’ils n’en reçoivent, le jour tombe à plomb comme une pluie de cendres. Sans relâche, un relent de latrines s’exhale des cours et des impasses, où les gens glissent en silence, comme des noyés. C’est le Griffon. C’est le quartier des millionnaires.
L’étranger que l’aventure égare en ces lieux se demande s’il ne rêve point. Il se frotte les yeux, il se bouche le nez : « Quoi ! les plus riches commerçants de la terre vivraient là, dans cette ombre et ces odeurs ? – Ils y vivent. Et ils y meurent. »
C’est au fond de ces taudis que, poursuivant de père en fils la tâche séculaire, ils s’acharnent à la besogne. De génération en génération, l’usure des meubles leur a renvoyé le reflet de visages plus durs et plus tristes. Lyon leur appartient. Vingt mille immeubles leur suent des rentes ; leurs châteaux déserts règnent sur des lieues de vignes, de blés, d’étangs, et de bois ; leurs coffres regorgent ; ils pourraient dominer le monde et vivre comme des princes, et ils sont là, chaque jour, souvent seuls, dès l’aube et tard dans la nuit, même le dimanche. Ils ignorent la joie. Ils se refusent le moindre plaisir. Une seule passion les dévore, la plus ardente et la plus opiniâtre, celle qui ferme dans l’effort d’une suprême convoitise les doigts crochus de leurs moribonds.
A première vue, rien ne distingue le pays des canuts du pays des fabricants : mêmes bâtisses lombardes aux portiques enfumés, mêmes bruissements de ruches, mêmes puanteurs. Mais, sur son roc, l’homme de la Croix-Rousse domine la cité. Son faubourg, dont chaque rue semble conduire dans le ciel, en boit toute la lumière. On y retrouve des avenues, des arbres, des jardins. Mais à mesure qu’on descend, le réseau se resserre. A mi côte, déjà, c’est le dédale ; au Griffon, ce ne sont plus que ruelles de coupe-gorge.
D’une enjambée on barre le chemin. Les habitants ne circulent qu’en se frôlant du coude. On dirait que, pour cerner le vieux monde des ouvriers, les soyeux ont cimenté là ce barrage de murailles et de grilles. Labeur et révolutions, tout ce que charrient les pentes torrentueuses du vieux faubourg vient s’y drainer. En silence, depuis trois siècles, le ruissellement des velours, des satins, des brocarts, traverse cette écluse, avant d’aller se répandre en fleuve sur le monde ; depuis le même temps, la peine des pauvres et la colère des affamés viennent s’y jeter en vain.
Ces grosses portes, ces lourdes murailles, ces grilles de forteresses, on s’explique leur durée quand on sait ce qui s’est passé là. Quel fabricant, tirant, à nuit close, la porte de son magasin, n’a vu parfois, dans les ténèbres du vieux carrefour, remuer l’ombre d’un drapeau noir ? Lequel n’a tremblé qu’ils ne redescendent quelque jour, ceux des cayennes et des mutuelles, les blêmes insurgés de 31 et de 34, les Voraces, cette canaille de canuts qu’on n’a jamais fini de fusiller ?
Dur et tenace comme un cœur de maître, Le Griffon guette la Grande Côte. Tant qu’il restera chez nous de la soie et des soyeux, le sombre rempart tiendra bon – jusqu’au jour où le pic et la pioche en viendront à bout quand, à force d’égoïsme, les Crésus de la fabrique auront achevé la misère de ceux qui les ont faits ce qu’ils sont.
(Ciel de Suie - 1933)
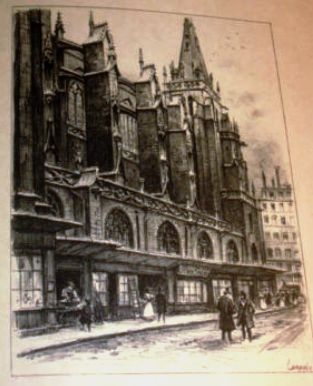
Chevet de l'église Saint-Nizier, vers 1896 Dessin de Joannes Drevet
in - Lyon pittoresque, d'Auguste Bleton.
On trouvera ci-dessous divers liens avec des billets concernant ses œuvres :
- une biographie commentée :
http://solko.hautetfort.com/archive/2009/01/22/henri-bera...
- une critique de la Gerbe d'Or :
http://solko.hautetfort.com/archive/2009/01/25/la-gerbe-d...
- une critique du Plan Sentimental de la Ville de Paris :
http://solko.hautetfort.com/archive/2009/02/27/plan-senti...
- une critique de son roman Lazare :
http://solko.hautetfort.com/archive/2009/09/08/c3066770e1...
- plusieurs commentaires de la première période de Béraud, dite "lyonnaise" (avant 1914) :
http://solko.hautetfort.com/archive/2008/06/19/comment-pe...
- un commentaire de trois grands reportages de Béraud (Moscou, Rome, Berlin) :
http://solko.hautetfort.com/archive/2009/03/02/1925-berau...
20:29 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : henri béraud, littérature, lyon, saint-clément les baleines | 
vendredi, 18 septembre 2009
Mademoiselle de Maupin
Mademoiselle de Maupin ? Qui connait, qui a lu ?
Pour ma part, j’avoue que je n’ai jamais même tenter d’entrer dans le tissu de ce roman, même si (GF Flammarion n° 102) il est là, sur un rayon de ma bibliothèque. En quatrième de couverture, cet avis de Baudelaire : « Avec Mademoiselle de Maupin, apparaissait dans la littérature le Dilettantisme qui, par son caractère exquis et superlatif, est toujours la meilleure preuve des facultés indispensables en art. Ce roman, ce conte, ce tableau, cette rêverie continuée avec l’obstination d’un peintre, cette espèce d’hymne à la Beauté, avait surtout ce grand résultat d’établir définitivement la condition génératrice des œuvres d’art, c'est-à-dire l’amour exclusif du Beau, l’Idée fixe » Bon.
Il y a cependant un extrait de la préface de Mademoiselle de Maupin que j’aime tout particulièrement, que je connais bien, que j’ai souvent expliqué en cours à des élèves. Etonnant, ces quelques lignes d’une préface d’un roman jamais lu, qui traîne néanmoins dans beaucoup de manuels scolaires, ilôt flottant, savoir morcelé…
Et comme il se peut (c’est un moment de l’année, l’automne débutant, propice à l’étude de ce type de textes) que je le ressorte – comme on dit – cette année encore, je me suis dit ce soir que, si j’avais du courage, et malgré ce paragraphe peu engageant de Baudelaire, j’essaierai de lire le roman, histoire quand même de....
En attendant, voici cet extrait de la préface, magnifique page d’anthologie :

14:42 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : mademoiselle de maupin, théophile gautier, esthétique, beauté, art pour l'art | 
vendredi, 11 septembre 2009
Pourquoi j'écris des satires
 Tu veux réussir ? Ose un coup digne du bagne, du cachot.
Tu veux réussir ? Ose un coup digne du bagne, du cachot.
On loue la probité, mais elle crève de froid. C’est au crime
Que l’on doit jardins, palais, tables, argenterie d’époque,
Ce bouc ciselé sur une coupe. Qui peut dormir, dites,
Quand on voit un père payer sa bru pour l’enfiler,
Des fiancées paillardes, un gamin qui se tape une matrone ?
A défaut de génie, c’est l’indignation qui fait les vers.
Tout ce qui travaille les hommes, vœux, crainte, colère, volupté,
Joies, intrigues, oui, tout cela vivra dans mon livre mêlé.
Et quand donc le torrent des vices fut plus impétueux ?
Plus béante la poche de la rapacité ? Plus tyrannique
La passion du jeu ? Ce n’est pas avec quelques bourses
Que l’on court tenter le hasard, ou joue coffre-fort sur la table !
Ah, les jolies batailles où le croupier fournit les munitions …
Juvénal, Satire 1 (traducton de Pierre Feuga)
Quelque chose de proprement étonnant à se dire que ces vers ont presque vingt siècles d’âge. Certains justifieront grâce à eux une coïncidence entre la décadence romaine et celle de l’Occident ; d’autres une permanence du mal dans la nature humaine. D’autres, que sais-je…
On peut aussi tout simplement s’étonner. Comme devant de très vieilles pierres, de très vieux sarcophages, d’anciens bijoux.
Stupéfié, par la sidérante puissance de la littérature.
20:27 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : littérature, juvénal, satires, littérature latine | 
mardi, 08 septembre 2009
Lazare et les petites patries dans le temps
« Je n’écrirai pas de roman sur la guerre ; la guerre n’est pas un sujet de littérature »
Alors que Lintier, Barbusse, Dorgelès, pour parler de proches de Béraud, publient très vite leur témoignage ou leur roman de guerre, curieusement dès 1917, Béraud s’y refuse, au nom même de la littérature ou du moins, de la conception qu’il s’en fait. Il tiendra parole.
A une exception près : celle de ce curieux roman, dont la parution suit de peu l’attribution du Goncourt pour le Martyre de l’Obèse (1922)
Dans ce roman, Béraud éclipse avec une grande pudeur l’événement collectif (la guerre, sa guerre, cette guerre sans gloire) de son récit pour n’en retenir que l’événement intime, particulier : Son héros, un civil, est un ancien pianiste qui a été victime d’un accident de voiture en 1906. Il n’aura donc pas eu, lui, l’occasion de la faire : Il a perdu conscience pour sombrer dans une folie, qui l’a coupé du monde entièrement. Il est devenu un autre et cet autre se « réveille » dans une clinique psychiatrique, seize ans plus tard, en 1922 :
« Se retrouver sans savoir ni comment ni pourquoi dans une chambre d’hôpital n’était-ce donc que cela ? une impression de repos, l’élasticité d’un lit de malade, un subit déploiement de blancheurs, rien de plus. Il acceptait avec tranquillité son aventure ; ce qui le surprenait et l’effrayait, c’était plutôt, singulière réversion, de n’être ni surpris ni effrayé »
« La guerre ? Eh bien oui, la guerre ? - et puis après ? », dit Jean Mourin, lorsqu’on lui en apprend l’existence. Le héros de Lazare était le seul être humain à n’en avoir, à aucun moment, ressenti la réalité. « A quoi bon ? Il acceptait tout en bloc. »
Et, un peu plus loin : « Qu’était-ce, en définitive, que la métamorphose du monde, comparée au prodige de sa résurrection ? »
Lazare, chacun le sait, est une parabole.
Or, pour qu’un simple revenant devienne un véritable ressuscité, il y faut la volonté de Dieu. Il y faut toute la force du miracle.
La mesure de l’écart entre l’avant et l’après-accident, tel est l’argument du récit qui inflige à son héros une rude épreuve : Car si le Lazare biblique pouvait ré-susciter les contours d’un individu dans le temps historique des mortels, c’est qu’il était devenu, cet individu, la manifestation de l’action de l’Eternel, ni plus ni moins, au sein de ce temps historique des mortels. Tel quel, l’autorité du miracle témoignait en sa faveur. Qu’est devenu Jean Mourin ? De quoi sa résurrection est-elle la manifestation ? De quelle autorité ?
Un miracle… La société des hommes est-elle capable d’en produire un ?
Cette paix étrange, cette France des années 20 en constante crise politique, ce règne de l’argent, un miracle ? Peut-on y ressusciter ? Cela vaut-il le coup ?
Telles sont les douloureuses questions posées par cet étrange et beau roman.
Lazare sera donc vraiment en premier lieu le roman de ces enfants humiliés dont parle Bernanos, « perdus dans la paix comme le moine dans le siècle » : La Victoire ne les aimait pas.
« Ce qui l’entoure, ce sont les hommes de son temps, qui sont morts tandis qu’il était lui-même hors de l’humanité, aussi mort qu’un mort, errant dans l’ombreuse contrée de la folie, d’où le voyageur, s’il revient, ne rapporte pas plus de souvenirs qu’un trépassé, s’élevant du limon, n’en rapporterait du monde aveugle et sourd où les fossoyeurs l’avaient englouti » (chapitre II)
Hors de l’humanité … Aussi mort qu’un mort … L’expérience de la guerre : un coma.
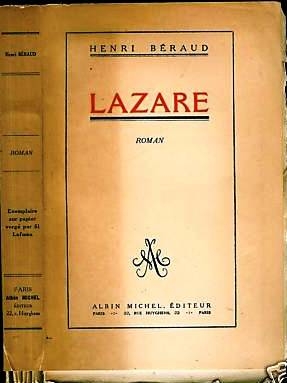
07:27 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : henri béraud, lazare, rentrée littéraire, littérature, écriture, romans, guerre de quatorze, lucien dubech | 
vendredi, 04 septembre 2009
Palante et l'individualisme
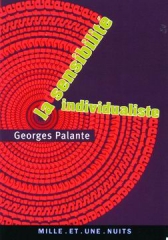 On doit à Stéphane Beau, la réédition chez 1001nuits (octobre 2007) de deux petits essais de Georges Palante, La sensibilité individualiste et Anarchisme et individualisme. Georges Palante, tous les lecteurs de Louis Guilloux le savent, fut le philosophe qui lui inspira le personnage de Cripure du Sang Noir. La rencontre des deux hommes date d’octobre 1916 : Louis Guilloux, alors pion dans le lycée de Sant-Brieuc, lisait la Fin du voyage de Romain Rolland quand le professeur de philosophie, Georges Palante, s’approche et demande au jeune homme s’il consentirait à lui prêter le volume.
On doit à Stéphane Beau, la réédition chez 1001nuits (octobre 2007) de deux petits essais de Georges Palante, La sensibilité individualiste et Anarchisme et individualisme. Georges Palante, tous les lecteurs de Louis Guilloux le savent, fut le philosophe qui lui inspira le personnage de Cripure du Sang Noir. La rencontre des deux hommes date d’octobre 1916 : Louis Guilloux, alors pion dans le lycée de Sant-Brieuc, lisait la Fin du voyage de Romain Rolland quand le professeur de philosophie, Georges Palante, s’approche et demande au jeune homme s’il consentirait à lui prêter le volume.
Le lendemain, Guilloux porta lui-même le livre chez le professeur. L’amitié naquit.
« Je considère Palante comme mon premier maître ». « Je ne puis imaginer ma personnalité distincte de la sienne » : Dans ses Souvenirs sur Georges Palante et dans L’Herbe d’oubli, Louis Guilloux a souvent rendu compte de sa dette : lui et Palante avaient des «vues communes sur la vie sociale». Dans un dialogue intérieur plein de sérénité, il avoue à celui qui fut le modèle de Cripure : « Ce personnage, ce n’était pas lui, mais nous, lui et moi », ajoutant à l’adresse de son ami suicidé : « tes ennemis ont toujours été les miens ».
Ceux qui se sentent également floués par le socialisme délétère des années quatre-vingts, l'écologie bavarde et électoraliste ainsi que le libéralisme planétaire qu’il aura contribué à mettre sur le trône depuis le début du vingt-et-unième siècle, ceux que ne satisfont ni l’égalitarisme aussi démagogique que nauséeux de la « gauche » ni l’affairisme marchand et revanchard de la « droite », et qui se demandent de quelle façon, tirer leur individu du naufrage collectif verront une planche de salut dans la philosophie individualiste prônée par Palante.
Cet individualisme, le philosophe en dessine les contours dans une résistance de chaque instant aux idéologies dominantes, un vif besoin d’indépendance, un amour pour la culture et la paix, un pragmatisme lucide devant la nature humaine et la société des hommes. Il n’est à confondre ni avec l’égoïsme primaire, ni avec la défense de ses seuls intérêts, ni avec l’anarchisme utopique, ni avec le volontarisme syndical.
C’est avant tout, affirme Palante qui cite abondamment Amiel, Constant et Stendhal, une sensibilité qui affirme l’unicité du moi et se déjoue de toutes les utopies susceptibles de le corrompre. Ces deux textes courts et lisibles de tous, pour la modique somme de 3 euros, constituent donc une introduction accessible à tout lecteur désireux de pénétrer l’œuvre et la pensée de ce philosophe injustement mis à l’index durant tout le vingtième siècle. Merci à Stéphane Beau, dont le site le Grognard est en lien ici, pour cette ré-édition dont la rentrée 2009 doit garder le souvenir.
Liens à suivre : Georges Palante, un précurseur oublié de la sociologie de l'individu, par Stéphane Beau
19:51 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : georges palante, stephane beau, philosophie, littérature, la sensibilité individualiste | 
mercredi, 02 septembre 2009
Saint-Exupéry
Articles sur Saint-Exupéry publiés sur ce blog :
Solitudes de Saint-Exupéry :
http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/07/la-solitud...
La toile souveraine :
http://solko.hautetfort.com/archive/2008/12/18/la-toile-s...
Saint-Exupéry côté jardin :
http://solko.hautetfort.com/archive/2009/07/31/les-etres-...

23:55 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : saint-exupéry, littérature, billets français, écrits de guerre | 
Henri Béraud
Les articles consacrés à l'oeuvre Henri Béraud consultables sur ce blog sont des extraits d’un essai non publié, La Force du Temps.
- une biographie commentée :
http://solko.hautetfort.com/archive/2009/01/22/henri-bera...
- une critique de la Gerbe d'Or :
http://solko.hautetfort.com/archive/2009/01/25/la-gerbe-d...
- une critique du Plan Sentimental de la Ville de Paris :
http://solko.hautetfort.com/archive/2009/02/27/plan-senti...
- une critique de son roman Lazare :
http://solko.hautetfort.com/archive/2009/09/08/c3066770e1...
- plusieurs commentaires de la première période de Béraud, dite "lyonnaise" (avant 1914) :
http://solko.hautetfort.com/archive/2008/06/19/comment-pe...
-une lecture de son roman Le Vitriol de Lune
http://solko.hautetfort.com/archive/2007/06/21/la-prose-poetique-de-beraud.html
- un commentaire de trois grands reportages de Béraud (Moscou, Rome, Berlin) :
http://solko.hautetfort.com/archive/2009/03/02/1925-berau...
- François Mauriac et Henri Béraud :
http://solko.hautetfort.com/archive/2010/01/03/francois-m...
- document video :
Lyon, mon pays (enregistrement)

23:32 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, henri béraud, la force du temps, roland thevenet | 
lundi, 17 août 2009
Gabriel Chevallier
Né à Lyon en mai 1895, mort à Cannes le 4 avril 1969, Gabriel Chevallier est surtout connu du grand public pour un roman au ton sarcastique, Clochemerle (1934) et ses suites, dont Clochemerle Babylone. Il l'est d'un public plus restreint pour son témoignage courageux sur la première guerre mondiale, La Peur (1930); des amateurs de littérature intimiste, enfin, pour son récit de souvenirs en deux tomes, Chemins de Solitude et Carrefour des hasards.
A Vaux en Beaujolais, Gabriel Chevallier, qui est devenu un véritable héros, possède son musée depuis 2006. Sur la place du village, on a installé une maquette grandeur nature de la fameuse pissotière qui à elle seul cristallise les passions dans le roman. Plusieurs fois réédité en livre de poches, Clochemerle, « la truculente épopée beaujolaise » a assuré la gloire et sa fortune de son auteur, en étant par ailleurs plusieurs fois adapté pour le ciné et la télé (dernière adaptation en date, 2003, avec Bernard-Pierre Donnadieu et Macha Méryl). En 1947, Chevallier avait signé le scénario de la première, Clochemerle, par Pierre Chenal, qui sortit interdit aux moins de seize ans. Dix ans plus tard, il signe celui de la suite (Clochemerle Babylone), qui devient sur la toile Le Chômeur de Clochemerle. Fernandel y excelle, entre Maria Mauban et Ginette Leclerc. C'est dans ce film qu'aux côtés de sa mère Jacky Sardou, Michel fait ses débuts à l'écran dans le rôle d'un petit gamin.
La saga Clochermerle se déroule donc dans cette France où curés et libres penseurs se font face à la bonne franquette, c'est à dire au son des cloches et des trinquées de bouteilles. Le romanesque désuet de ce qu'on a longtemps appelé « les Deux-France » fonctionne à plein régime. Les démêlés comiques du clan des laïcards (représenté par Barthélémy Piéchut, le maire de la commune et Ernest Tafardel, l'instituteur) avec le clan des cathos (composé de Mme la baronne Alphonsine de Courtebiche, du curé Ponosse et du notaire Girodot), autour de la construction d'une pissotière au centre du village et sous le regard de la grenouille de bénitier bien nommée Justine Putet, forment un ensemble de cinq cent pages qui a fait date.
Dans son autobiographie, Chevallier raconte qu'il composa Clochermerle à partir des souvenirs d’un « bourg mi-agricole et mi-industriel du Charollais où il avait passé quelques vacances de jeunesse, à vingt-cinq kilomètres de Paray le Monial » (Il s'agit probablement de La Clayette). Mais, précise-t-il, pour se distinguer de Joesph Jolinon qui plaçait dans son charollais de naissance ses paysanneries, il le situa dans le Beaujolais, et céda rétrospectivement aux pressantes sollicitations des habitants de Vaux, qui crurent reconnaitre leur village dans son roman-chronique devenu best-seller : « J’ai dit ce qu’il en était ; que le véritable Clochemerle est de pure invention. Mais devant tant de gentillesse, je ne peux guère disputer à Vaux (cliquer pour suivre le lien) la gloire qu’il s’attribue.»
La Peur dépeint l'expérience de son auteur, simple soldat blessé à la bataille d'Artois et renvoyé, après un bref passage à l'hôpital, sur les Chemin des Dames, puis dans les Vosges. Gabriel Chevallier relate la peur, la déchéance, le cafard, l'atroce souffrance de ces hommes terrés parmi les cadavres dans la boue, ainsi que la stupidité criminelle des « stratèges » du haut commandement, planqués à l'arrière. Ce récit, contemporain de celui de Jean Giono (Le Grand Troupeau) s'inscrit donc dans la tradition de dénonciation de la guerre, et dans le sillon de Galtier Boissière et du 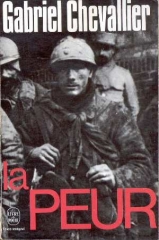 Crapouillot, de Béraud, de Lintier. On est loin des plaisanteries rabelaisiennes de Clochemerle, le ton est caustique, voire cynique. La Peur n'est pas n'importe quel chef-d’œuvre en péril.
Crapouillot, de Béraud, de Lintier. On est loin des plaisanteries rabelaisiennes de Clochemerle, le ton est caustique, voire cynique. La Peur n'est pas n'importe quel chef-d’œuvre en péril.
« C'est l'un des plus grands livres sur la guerre des tranchées, un livre d'une liberté, d'une honnêteté et d'une lucidité imparables. On avait lu Céline, Barbusse et Dorgelès, il faut lire maintenant Gabriel Chevallier qui savait bien en matière de peur de quoi il retourne. » écrit Eric Dussert dans Le Matricule des Anges, lors de la réédition en 2002 au Passeur.
« A cette date, (1929) confiera Chevallier, je croyais fermement qu’on pouvait déshonorer la guerre et ainsi éviter le retour d’un fléau dont j’avais vu de près l’inanité. Déshonorer la guerre, je m’y employais de tout mon cœur pendant quelques mois, en pensant aux camarades morts sous mes yeux, des garçons de vingt ans qui portaient en eux de grandes espérances, qui avaient représenté pour des mères un long passé de dévouement et d’affection. Je pensais réellement faire œuvre utile. Si l’on était venu me dire que je reverrais une guerre de mon vivant, certainement, je ne l’aurais pas cru. »
Avec beaucoup de finesse et de goût, les Chemins de solitude s'inscrivent dans un genre : le récit d'enfance. Ils seront suivis de Carrefour des hasards : Dix ans après Béraud, son ainé, Chevallier y raconte les premières années de sa vie, toutes lyonnaises, dans le cinquième arrondissement, "fils d'une bourgeoisie un peu déclinante, qui avait eu des revers depuis une trentaine d'années" et qui dut grandir « au plus épais des brouillards » . Pour ces deux livres il choisit ce titre général : Souvenirs apaisés :
« Cette époque de mon enfance avait assurément, outre ses inconvénients, des travers et des ridicules. Cependant, aux jeunes hommes trop imbus de mécanisation et d’accélération, qui la diraient déplorablement arriérée, je demanderais s’ils croient que les commodités modernes ont engendré un fier relèvement de l’intelligence et coïncidé avec des événements bien fameux pour l’humanité. L’époque désuète que j’évoque, si elle manquait d’éclairages nocturnes, de baignoires, d’ondes et d’un confort devenu courant, ne manquait pas d’une certaine tenue. A l’âge du pétrole, qui succédait à celui de la dentelle, on avait le loisir d’être aimable et de se plaire à son sort. Une certaine ultime lenteur, dont on ne soupçonnait ni le prix ni l’utilité, présidait encore à la vie, à la veille que les hommes se ruassent à l’assaut des distances, croyant le bonheur caché aux antipodes. La tache accomplie tenait lieu de diplôme à des citoyens estimés, qui s’efforçaient de leur mieux, à tous les échelons de la confuse condition sociale. Faire plaisir était une obligation aussi élémentaire que celle de dire merci ou pardon. » (ICI la suite de ce texte)
Sur ce temps de l’immédiat après-guerre (années folles ?), sur le temps de sa jeunesse (Belle Epoque ?), époque qu'il mythifie, Chevallier jette un œil rétrospectif également assez lucide.
Les aspects négatifs : « Il s’agit d’une histoire provinciale, on le comprend. Nous cherchions notre voie dans une époque incertaine, entre un monde englouti par la guerre, et un monde qui naissait sous les auspices de l’inflation. Les changements ne nous concernaient qu’à demi. Alors que la prospérité s’entamait, nous étions fort ignorants et maladroits en matière d’argent, mal placés dans la société. Nous convoitions une richesse absurde, sous la forme d’une estime que nous nous décernions les uns aux autres, dans un petit clan parfaitement ignoré du monde et, à peu près ignoré de la ville. Ce clan était notre seul tremplin. »
Les aspects positifs : « Tout était facile en ce temps-là. Les villes n’étaient point surpeuplées, les appartements ne faisaient pas l’objet de folles surenchères. On voyait un peu partout des pancartes de locaux à louer, que des propriétaires, point dédaigneux du moindre revenu, louaient même à des mineurs. Le billet de cent francs valait cinq louis, qui tintaient clair et représentaient une immensité de plaisir. La pièce de cent sous, la thune, avait un pouvoir d’achat considérable. Avec une seule de ces pièces en poche, on pouvait emmener une mignonne plus loin que l’Ile-Barbe, et tout un jour, sur les bords de Saône, la régaler de campagne, de fleurs et d’horizons, de saucisson et de fritures, de promesses et de caresses, la gaver d’enchantements ».
 On le sait moins, mais Chevallier fut également un peintre, proche des Ziniars et de Marius Mermillon, client fidèle de la Brasserie du Nord, qui laisse derrière lui plusieurs tableaux importants, notamment des paysages et des natures mortes : Lyon, écrit-il, est une ville de peintres. Son ciel, ses perspectives, ses fleuves et ses environs prédisposent à l’expression plastique. Il rencontre le splendide Jacques Martin « seigneur de la peinture opulente et de l’art sans contrainte », Adrien Bas, peu avant sa disparition prématurée, Charles Sénard, Philippe Pourchet.
On le sait moins, mais Chevallier fut également un peintre, proche des Ziniars et de Marius Mermillon, client fidèle de la Brasserie du Nord, qui laisse derrière lui plusieurs tableaux importants, notamment des paysages et des natures mortes : Lyon, écrit-il, est une ville de peintres. Son ciel, ses perspectives, ses fleuves et ses environs prédisposent à l’expression plastique. Il rencontre le splendide Jacques Martin « seigneur de la peinture opulente et de l’art sans contrainte », Adrien Bas, peu avant sa disparition prématurée, Charles Sénard, Philippe Pourchet.
Sur ce petit monde règne Henri Béraud, alors dans la toute puissance de sa prodigieuse carrière parisienne. Les souvenirs de Gabriel Chevallier, dont le premier tome est publié en 1946 et le second en 1956, sont intimement calqués sur ceux, antérieurs, de Béraud (La Gerbe d’Or, Qu’as-tu fait de ta jeunesse). Une façon de construire le récit, le choix des thèmes (les gones des rues, les noyés du Rhône, Lyon la ville ingrate, la bohême adolescente, la beauté des collines, l’avarice des marchands, la rupture de Quatorze …). Gabriel Chevallier sait pourtant se démarquer du maître qu’il imite, et raconter son originalité propre : un milieu social différent, une retenue plus grande, moins d’empathie et plus de distanciation, une verve et une création moindre, davantage « d’analyse » ou d’intériorité.
Contrairement à d’autres, on peut reconnaitre au passage à Gabriel Chevallier ce mérite : la gratitude. Alors que des gens comme Marcel Pagnol, Marcel Achard, et d’autres imitateurs dont Béraud avait lancé la carrière, non seulement ne bougèrent pas le petit doigt pour le tirer d’embarras lors de son procès, mais se bouchaient quasiment le nez dès qu’on prononçait son nom avec une belle veulerie de notables indignés, Gabriel Chevallier écrivait, lui, en 1946 :
« Je publiais mes premières pages dans une petite revue locale. Je faisais pour vivre, un métier obscur. J’étais hésitant et seul. Un homme vint, un soir, de Paris, qui était dans tout le fracas de sa propre gloire. Vous avez du talent mon petit ! L’homme qui me faisait cet éblouissant présent se nommait Henri Béraud. Puis-je l’oublier ? Quelques-uns, s’ils s’interrogent, peuvent-ils ne pas se souvenir que le condamné d’aujourd’hui leur fut parfois de bon conseil, aida au démarrage de leur carrière ? Que cela, du moins, ne lui soit pas retiré.»
En suivant ce lien, il est possible de voir quelques séquences (ou le fim le film en entier, du Chômeur de Clochemerle, avec Fernandel au mieux de sa forme
Dans cette suite de Clochemerle, ce qui divise la commune n'est donc plus la construction d'une pissotière, mais l'indémnisation chômage que le maire doit accorder à un braconnier insolent et joyeux drille, Baptiste (dit Tistin), interprété par Fernandel.
"Je ne fais rien, pour dix mille francs par mois" peut-il dès lors affirmer bravement à tout un chacun dans le village, éveillant suffisamment de jalousies et de ragots pour lever l'intrigue.
07:57 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : gabriel chevallier, clochemerle, la peur, chemins de solitude, carrefour des hasards, littérature, lyon | 
samedi, 01 août 2009
Saint-Exupéry, côté jardin
Antoine de Saint-Exupéry a écrit cette lettre à Mme François de Rose quelques trois mois tout juste avant de disparaître en vol, le 31 juillet 1944. Elle est publiée dans l’édition folio des Ecrits de guerre, n° 2573.
Je vous remercie, chère Yvonne, pour beaucoup de choses. Je ne sais pas dire lesquelles (les choses qui comptent sont invisibles…) mais j’ai sans doute raison puisque j’ai envie de vous remercier.
Ce n’est d’ailleurs pas tout à fait ça. On ne remercie pas un jardin. Et moi, j’ai toujours divisé l’humanité en deux parties. Il y a les Etres-jardin et il y a les Etres-cour. Ils promènent leur cour avec eux, ceux-là, et vous font étouffer entre leurs quatre murs. Et on est bien obligé de parler avec eux pour faire du bruit. C’est pénible, le silence, dans une cour.
Mais dans les jardins, on se promène. On peut se taire et respirer ; On est à l’aise. Et les surprises heureuses viennent tout simplement au-devant de vous. On n’a rien à chercher. Un papillon, un scarabée, un ver luisant se montrent. On ne sait rien sur la civilisation du ver luisant. On rêve. Le scarabée a l’air de connaître où il va. Ca, c’est étonnant et l’on rêve encore. Puis le papillon. Quand il se pose sur une large fleur, on se dit : c’est pour lui comme s’il se posait sur une terrasse de Babylone, un jardin suspendu qui se balancerait… Puis on se tait à cause de trois ou quatre étoiles.
Non, je ne vous remercie pas du tout. Vous êtes comme vous êtes. Simplement, j’ai envie de me promener encore chez vous.
J’ai aussi pensé à autre chose. Il y a les gens route nationale et il y a les gens sentiers. Les gens route nationale m’ennuient. Je m’ennuie sur le macadam parmi les bornes kilométriques. Ils marchent vers quelque chose de bien précis. Un gain, une ambition. Le long des sentiers, au lieu de bornes kilométriques, il y a des noisetiers. Et l’on flâne pour croquer des noisettes. On est là pour être là. A chaque pas, on est là pour être là, non pour ailleurs. Mais il n’y a absolument rien à tirer des bornes kilométriques. (…)
Je me fais vieillard à barbe blanche qui hoche la tête. Comme si je regrettais une jeunesse vécue sur les chars à bœufs. J’ai dû être, autrefois, roi mérovingien. Cependant j’ai couru toute ma vie. Mais je suis un peu las de courrir. (Peut-être qu’il n’y a qu’un r à courir ?) Je comprends aujourd’hui seulement un certain proverbe chinois « Trois choses ruinent l’ascension de l’esprit. Primo le voyage … » Et ce mot que m’a dit vingt fois Derain : « Je n’ai connu que trois grands hommes véritables. C’étaient trois illettrés. Un berger savoyard, un pêcheur, un mendiant. Ils n’étaient jamais sortis de chez eux. Ce sont les trois seuls hommes qui, de toute ma vie, ont forcé mon estime… »
Et puis ce mot ravissant de la pauvre José Laval, retour des Etats-Unis, qui me disait : Je suis contente de revenir. Je ne suis pas à l’échelle des gratte-ciel, moi. Je suis à l’échelle des ânes.
Et moi, j’ai une indigestion des bornes kilométriques. Et ça ne mène à rien. Il serait tout de même temps de naître.
En attendant la vocation de Solesmes (c’est bien beau le chant grégorien) ou du monastère tibétain, ou du métier de jardinier, je recommence à tirer des manettes de gaz et, à six-cents kilomètres heure, de n’aller nulle part.
Saint-Exupéry, « Lettre à madame François de Rose » (mai 1944)

02:30 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : écrits de guerre, madame françois de rose, littérature, solesmes, ligthning, saint-exupéry | 









