lundi, 20 avril 2009
Roger Caillois et la lecture
Le fleuve Alphée est une sorte d'autobiographie fantasmée que Roger Caillois publia en mars 1978, quelques mois avant de recevoir le Grand Prix de l’Académie Française pour l’ensemble de son œuvre, quelques mois avant de mourir (21 décembre 1978). Toujours perspicace, toujours belle causeuse, la critique de l’époque vit alors dans Le Fleuve Alphée une sorte d’annonce par l’écrivain lui-même de sa fin à venir. Roger Caillois aura passé un peu plus de soixante-cinq ans sur Terre. Son enfance qui s’écoula dans les décombres de Reims bombardée, son enfance, dit-il, « la guerre en avait complété l’isolement ». Le choix du titre pour ce bref récit le confirme : Caillois fut un fleuve. Un solitaire.
Il y a dans la brève biographie qu’Odile Felgine lui consacre en introduction des paragraphes étonnants. Je relève, par exemple, celui-ci, qui m’a fait rêver un moment hier soir, alors que je sortais tout juste du manuscrit de Madame Bovary (voir billet précédent) :
1959
Mai. Roger Caillois achète en son nom propre un appartement 34, avenue Charles-Floquet, près du Champ-de-Mars et de l’Unesco. Il va le peupler, au fil du temps, d’objets magiques chinés à Paris, rapportés de ses voyages, de tableaux, de livres d’artistes, d’insectes dans des boites et de plus en plus de pierres, exposées sur des grilles de boulanger. Son intempérance (et celle de sa femme) s’accentue, à mesure que progressent son goût de l’accumulation et sa tendance à la pétrification.
Caillois fut un grand collectionneur de minéraux. Un bref aphorisme, afin de s’en bien expliquer : « Dédaigneux des Annales, le sage contemple en silence ses archives de silice, où aucun mot ne relate aucun événement »
Je retiendrai surtout de lui cette autre formule, pour qualifier l’espèce humaine : l’espèce épisodique. Cela a sans doute quelque rapport avec la conscience glanée en sa prime enfance, celle de cet enfant « jouant dans les décombres » (de très belles pages là-dessus, dans Le fleuve Alphée). Quelque rapport. Mais c’est aussi un bel acte de lucidité, oui, comme en témoignent ces quelques lignes :
« L’histoire montre que, dans le monde proprement humain, nul n’est à l’abri de la menace invisible et symétrique de l’aubaine rencontrée. Une mesure politique qui ne paraissait pas mettre en péril les institutions, un changement dans les mœurs qu’on estimait anodin aboutissent à long terme à la chute d’un empire. Une décision monétaire fâcheuse ouvre une cascade d’échecs, puis de désastres, qui conduit à l’écroulement d’une économie. Dans le domaine de l’art, une innovation estimée seulement plaisante ou ingénieuse amène de surenchère en surenchère la ruine de l’idée même de l’art. Les circonstances ou les engrenages qui sont à l’origine des réussites les plus complexes et les plus admirables de la vie ou de la technique sont aussi capables de défaire, sans que l’intelligence, la volonté, l’obstination y puissent grand-chose, ce qui fut édifié par une continuité bien tempérée. »
Caillois fut un insatiable lecteur. Jeune écrivain au sein d'une génération - l'une des dernières - que ne dominaient pas encore les empires de l'instant, faits d'images et de sons. L'une des dernières générations à bénéficier d'un environnement encore relativement calme, malgré l'Histoire qui s'emballait - et donc capable de produire quelques véritables écrivains : les temps d'avant la catastrophe médiatique. « A partir du moment où un enfant sait lire, son esprit, comme les eaux du fleuve Alphée, est mêlé et livré à l’immensité des eaux marines… Il lui est très difficile, sinon impossible d’en sortir. (…) Un beau jour, je fus brusquement transporté de la campagne dans un monde entièrement nouveau, un de ceux où la somme inépuisable des connaissances et des expériences humaines est conservée, archivée, répertoriée, qui plus est : aisément disponible, pourvu qu’on ressente la curiosité d’en tirer quelque chose. Il suffisait alors de savoir lire. Aujourd’hui, ce n’est même plus nécessaire : lire demande un apprentissage : il n’en est pas besoin pour regarder et entendre. Hier était encore le temps de la lecture souveraine. »

05:42 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : le fleuve alphée, roger caillois, littérature, reims bombardée, lecture | 
mercredi, 01 avril 2009
Avec un cri sauvage
Vous aimez vous, les gens qui font des farces un premier avril ? Ils sont un peu comme ceux qui font des cadeaux à Noël, hein, ou qui éteignent leur chez-soi quand tout le monde le fait à l’heure du passage à l’heure d’été, « pour la planète », comme ils disent. Bref. Cette habitude de se comporter en troupeau, après tout, rien ni personne ne nous y contraint et donc, pas de farces sur Solko aujourd’hui. Pas de farces. Mais comme le premier avril est malgré tout un petit événement, j’invite tous les visiteurs à le saluer en se recueillant pieusement la croisée de ces quatre chemins orientés en direction de ces quatre points bloguesques & cardinaux que voici, vers lesquels très souvent j’aime à me lancer. Et pour commencer, le Vaste Blogue du sieur Tanguy, à qui sont dédiées avec beaucoup de reconnaissance ces quelques lignes du caustique, fort nuancé et si délicat Alexandre Vialatte : « Il pleut, il neige, il fait soleil, l’agneau bondit à côté de sa mère, la poule pond déjà des œufs de pâques, les épinards sont magnifiques ; c’est le mois d’avril. Il surexcite l’esprit humain. C’est en avril que l’homme inventa La Marseillaise, le pôle Nord, le système métrique, l’hélicoptère et la Légion d’honneur. Le merle et le corbeau couvent leurs œufs verts. Jamais les prés n’ont entendu tant de chants d’oiseaux : l’aigle glatit, l’alouette turlute, le merle siffle et le pinson lance des fanfares, l’auvergnat appelle d’une voix rauque, le coucou coucoule et le ramier roucoule au loin. » (1) Un autre avril, bien plus ancien dans le siècle, et comme flottant en apnée au-dessus de tous les autres (à tel point qu’il n’est pas daté) est celui des Petits poèmes en prose de Léon Bloy. Je ne peux le dédier, celui-ci, qu’à l’un de ces esprits que j’ai rencontré par sa grâce (celle de Léon), par la vertu incomparable de la jouissive et spirituelle copie, j’ai cité Monsieur Pascal Adam de Theatrum Mundi : « C’est le mois de Pâques, le mois des arbres en fleurs, le mois des renoncules et des pamoisons de l’adolescence. Autrefois, il y a trente ou quarante ans, je me roulais sur l’herbe tendre en bramant vers l’Infini. Depuis, je n’ai rien trouvé dans le plat monde extérieur qui valût cela. Le Mont-Blanc m’a paru un trou et je me suis dégoûté des océans que tout imbécile peut franchir. Le Paradis Terrestre, l’Eden perdu, dont la récupération est l’effort de tout être humain, je ne puis le concevoir autrement qu’ainsi : une prairie de l’Annonciation pleine de pissenlits et de boutons d’or, sous de très humbles pommiers qui ressemblent à des confesseurs, et dont les rameaux chargés de calice ont l’air de baiser la terre ».(2)
Un troisième avril, situationniste, celui-ci, fut celui de 1951 ; à l’occasion du 4ème festival international du film à Cannes, Guy Ernest Debord taguait les murs de la ville du nom d’Isidore Isou, le réalisateur du Traité de bave et d’éternité présenté hors programme et soutenu par Jean Cocteau. Voici donc un extrait d’une lettre de Guy Debord de ce mois d’avril-là, dédié évidemment – comment pourrait-il en être autrement - à la dame agile et toujours décalée de Certains Jours, aussi intriguée par le nouveau monde que non-oublieuse de l’ancien, j’ai nommé Frasby : « J’ai appris qu’Isidore Isou bataillait pour faire passer un film lettriste (durée de projection : 5heures) qui doit révolutionner le cinéma, et que le Festival refuse. Il s’intitule : Traité de bave et d’éternité. Isou en a été réduit à faire appel à Maurois. Il y a quelque espoir. Hier au soir, Fillon et moi sommes repassés à l’offensive – avec de la chaux – inscrivant ISOU en de nombreux points de la ville et sur quatre bancs de la Croisette ». Albert Thibaudet (vous me voyez venir ?) signe ses articles pour la NRF le 1er de chaque mois. Il est donc relativement aisé de repérer ceux du 1er avril dans le gros volume in quarto dans lequel il réside. A la dame dont les mots sont tombés de l’éventail, et elle seule, je ne peux que dédier – car c’est justice - ces quelques considérations d’Albert sur le style, datée du 1er avril 1923, et tirées d’une réflexion sur Renan et Taine: « Mais un homme comme Renan n’est pas seulement attaché à son temps. Il faut aussi qu’il se détache sur son temps et qu’il se détache de son temps. L’originalité de l’homme, la valeur unique de l’artiste sont à ce prix. Cette originalité et cette valeur, elles se définissent par le style. Style personnel, cela constitue presque un pléonasme ; là où il n’y a pas personnalité irréductible un temps et, par un certain côté, étrangère à un temps, il n’y a pas de style. »
Il se trouve que depuis le début de l’année (scolaire s’entend), de ces quatre points, bloguesques et cardinaux comme en leur direction, Vaste Blogue, Theatrum Mundi, Certains Jours, Tombés de l’éventail, un vent amical et complice a souvent soufflé. Mais comment cette chronique sans évoquer les cochons mélomanes et devins de l’ami Porky qui, du fond de son tiroir, obstinément, revisite les opéras du temps jadis, les éclats de dire, coups de gueule et critiques théâtrales de Simone Alexandre, le lointain exil polonais des mots toujours justes de Bertrand Redonnet, les poèmes à la fixité vertigineuse de GMC, les billets à rebrousse poil de Lephauste sur Humeur Noirte, les analyses généreuses de Feuilly sur Marche Romane et les voyages historiques de Marcel Rivière dans les rues de Lyon. Bon je sens que si je continue, ça va finir par faire soirée protocolaire et on va croire pour le coup que c’est un poisson d’avril. Je n’oublie pas non plus Zabou, Rosa, la Zélie, Michèle Pambrun, tous ceux, toutes celles dont les commentaires tissent des liens, nouveaux ou anciens, réguliers, passagers ou épisodiques, Le Photon, Marc, Christophe, Antoine, Nénette… A tous je souhaite donc bonne pêche, bonne friture… Et bonne lecture par tous les chemins croisés qu’avril sèmera à foisons.
21:46 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : tadeusz kantor, théâtre, dada, kurt schwitters | 
samedi, 21 mars 2009
Péguy parlant du peuple
Je cherchais un autre passage de lui. Mais je suis tombé sur celui-ci, que j'avais surligné, il y a bien longtemps :
« De mon temps, tout le monde chantait. Excepté moi, mais j'étais déjà indigne d'être de ce temps-là. Dans la plupart des corps de métiers, on chantait. Aujourd'hui, on renâcle. Dans ce temps-là on ne gagnait pour ainsi dire rien. Les salaires étaient d'une bassesse dont on n'a pas idée. Et pourtant tout le monde bouffait. Il y avait dans les plus humbles maisons une sorte d'aisance dont on a perdu le souvenir. Au fond on ne comptait pas. Et on n'avait pas à compter. Et on pouvait élever des enfants. Et on les élevait. Il n'y avait pas cette espèce d'affreuse strangulation économique qui à présent d'année en année nous donne un tour de plus. On ne gagnait rien. On ne dépensait rien. Et tout le monde vivait.
Il n'y avait pas cet étranglement d'aujourd'hui, cette strangulation scientifique, froide, rectangulaire, régulière, propre, nette, sans une bavure, implacable, sage, commune, constante, commode comme une vertu, où il n'y a rien dire, et où celui qui est étranglé a si évidemment tort.
On ne saura jamais jusqu'où allait la décence et la justesse de ce peuple ; une telle finesse, une telle culture profonde ne se retrouvera plus. Ni une telle finesse et une telle précaution de parler. Ces gens-là eussent rougi de notre meilleur ton d'aujourd'hui, qui est le ton bourgeois. Et aujourd'hui, tout le monde est bourgeois. »
( Charles Péguy, L'Argent - 1913)
22:31 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : charles péguy, littérature, common decency | 
mercredi, 18 mars 2009
De l'autorité
« Puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de violence. Pourtant l'autorité exclut l'usage de moyens extérieurs de coercition : là où la force est employée, l'autorité proprement dite a échoué. L'autorité, d'autre part, est incompatible avec la persuasion qui présuppose l'égalité et opère par un processus d'argumentation. Là où l'on a recours à des arguments, l'autorité est laissée de côté. Face à l'ordre égalitaire de la persuasion, se tient l'ordre autoritaire qui est toujours hiérarchique. S'il faut vraiment définir l'autorité, alors ça doit être en l'opposant à la fois à la contrainte par la force et à la persuasion par arguments. La relation autoritaire entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose ni sur une raison commune ni sur le pouvoir de celui qui commande : ce qu'ils ont en commun, c'est la hiérarchie elle-même, dont chacun reconnait la justesse et la légitimité, et où tous deux ont d'avance leur place fixée »
Hannah Arendt, "Qu'est-ce que l'autorité", La Crise de la culture
22:23 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : hannah arendt, autorité, école, enseignement | 
lundi, 16 mars 2009
La dédicace au Duce
Après Moscou et Berlin, Henri Béraud publie en 1929 le troisième volet de ses témoignages, « Ce que j'ai vu à Rome ». Il travaille cette fois-ci pour Le Petit Parisien d'Elie Blois. En 1922, il avait déjà couvert, comme on dit à présent, l'événement de la Marcia su Roma. C'est la troisième fois que Béraud interviewe Mussolini. A un an près, ils ont le même âge (43 & 44 ans). Le Français jauge l'Italien, et son "français plein de coquette nonchalance". Il observe aussi un pays dont "les murs parlent" : « Mussolini est partout, en nom comme en effigie, en gestes comme en paroles - et plus encore que Kemal en Turquie, et plus même que Lénine à Moscou » Il est venu prendre la température, « l'air fasciste », comme il le dit lui-même. L'ensemble des vingt sept articles d'abord publiés dans Le Petit Parisien sortent en volume aux Editions de France, fort ironiquement dédicacé à Benito Mussolini :
« Vous m'avez, monsieur le Président, honoré d'une mesure extraordinaire. A cause de mon enquête et par votre ordre, le plus grand journal du monde s'est vu arrêté à la frontière. Aurai-je l'orgueil de penser que mes critiques donnaient à votre dictature assez d'ombrage pour justifier ce terrible vietato ? »
L'enquête romaine faite par le très français Henri Béraud, adjointe à celles conduites précédemment aussi bien à Moscou qu'à Berlin, formerait une trilogie de premier choix pour illustrer les thèses d'Hannah Arendt et de son essai sur le Totalitarisme. Voici, tels quels les mots de Béraud lui-même dans l'avertissement liminaire placé entre la dédicace au Duce et le premier reportage : c'est stupéfiant, et presque désespérant, comme un certain nombre de remarques sont encore d'actualité !
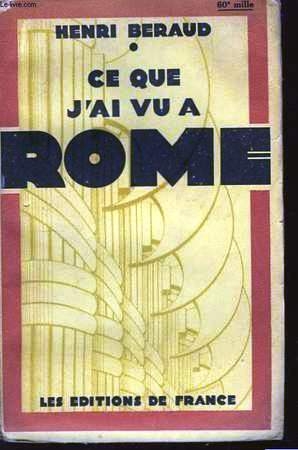
AVERTISSEMENT
« Ce livre, relation sincère d'un voyage au pays fasciste est l'œuvre d'un républicain. L'auteur tient la liberté pour le bien le plus précieux. Il n'a donc pu trouver bon un régime qui, par la voix de son chef, se flatte hautement « de fouler au pieds le cadavre pourri de la déesse Liberté »
Je déteste l'oppression. Et je le dis. Ayant de mes yeux vu ce que le culte de la violence a fait d'un peuple naguère jovial, tolérant et heureux, je souhaite à notre pays d'autres emblèmes que les cordes, les verges et la hache. Je suis antifasciste. Une autorité forte, oui. Mais la discipline peut se concilier avec la liberté. Et même, il n'y a de vraie liberté que dans l'obéissance à des justes lois. On m'a appris cela dès l'enfance, et rien ne m'a montré depuis que le maître d'école s'était trompé.
Cependant on aurait tort de chercher sous mes critiques du Fascisme une approbation plus ou moins déguisée de ce qui se passe chez nous. Rien n'est plus loin de ma pensée. Ni éloge, ni satisfecit ! L'idéal républicain est une chose ; l'état des institutions en est une autre. Ce qu'ont fait de la République l'usure politicienne, la faiblesse des classes dirigeantes, la bassesse des intérêts de clocher et - par la suite de la désaffection à peu près totale de nos élites à l'égard du régime électoral - l'incroyable médiocrité du recrutement parlementaire, la plupart des Français l'aperçoivent, et quelques-uns se dévouent à y remédier.
Si je m'en tiens à mes expériences, l'oligarchie des Chemises noires (non plus d'ailleurs que la dictature du prolétariat) ne me semble pouvoir apporter aux misères des temps un remède meilleur que le mal. Si d'ailleurs la France devait, tôt ou tard, modifier ses institutions, elle en chercherait le progrès dans son histoire et son génie. La grande Inventeuse ne se mettra pas à la remorque. Quoi qu'il advienne, nos fils vivront libres comme nous. Et nous avons dans l'avenir assez de foi pour espérer que jamais notre pays ne devra demander son salut à l'abolition de droits humains sans lesquels la vie ne vaut pont d'être vécue. »
05:42 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature, henri béraud, mussolini | 
samedi, 14 mars 2009
Henri Béraud : Ce que j'ai vu à Berlin
Le second grand reportage d'Henri Béraud publié en volume fut, en octobre 1926, Ce que j'ai vu à Berlin. Après la jeune et inquiétante URSS, donc, la non-moins jeune, et non-moins inquiétante République de Weimar. D'une incertitude, l'autre. «De Paris à Berlin, les trains vont vite. C'est l'affaire d'une petite journée. A peine le voyageur a-t-il perdu de vue l'Arc de Triomphe qu'il aperçoit la Porte de Brandebourg. » Trois ans plus tôt, été 23, c'était l'inflation, celle qui, dit-il ironiquement « fit en Allemagne 60 millions de milliardaires » et « transforma en compteurs toute une nation, et mit une règle à calculs dans le crâne du plus humble balayeur public. » On a, dit-il cent fois décrit « cette époque démente qui rendit le crédit soluble et vit fondre comme du sucre le blockhaus de la fortune bourgeoise ». Ce qui restait de morale, ajoute-t-il, de pudeur et de sentiment fut emporté : «Pour un million de marks, le touriste aux dollars achetait indifféremment une boite d'allumettes ou une nuit d'amour. L'argent, qui n'était plus qu'un signe, avait, chose étrange, acquis un pouvoir irrésistible. Ce papier avili, les gens en avaient plein leurs poches et, ne sachant qu'en faire, ils le convoitaient toujours. Les banques elles-mêmes ne pouvaient prendre au sérieux cette comptabilité astronomique. On ne comptait plus. On ne pouvait plus compter. Un jambon valait 5 trillions 300 milliards de marks. Le fameux boucher de Hanovre tuait pour un complet usagé et faisait manger aux bourgeois ses victimes dépecées... Un beau jour, tout cela prit fin. On brûla la planche à billets sous la chaumière du rentenmark qui s'appelle à présent le mark tout court, et le pays se trouva retourné comme un gant.»

11:15 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : reportage, henri béraud, allemagne, littérature | 
lundi, 02 mars 2009
1925 : Béraud chez les soviets
A tout seigneur, tout honneur : Albert Londres n'aura attendu ni André Gide ni Henri Béraud pour lancer, en 1917, déjà ce cri à Edouard Helsey : "Qu'est-ce que nous fichons ici ? Nous sommes correspondants de guerre et l'on ne cherche qu'à nous empêcher d'aller à la guerre. Hier encore, on m'a refusé les moyens de me rendre à Berry-au-bac où l'on se bagarre tous les jours. J'en, ai assez de délayer les topos des services d'information. D'ailleurs ces combats de tranchée sans issue, ces coups de main localisés vont vraisemblablement se prolonger toute l'année. Et pendant ce temps-là, des événements gigantesques se produisent ailleurs. Un cataclysme est en train de creuser un abîme dans l'histoire du monde, et nous n'essayons pas d'en être les témoins. Il faut aller en Russie. Viens-tu avec moi ?" (1)
Même inquiétude, même questionnement, quelques années plus tard, de la part d'un autre professionnel du grand reportage, Henri Béraud : « On part pour ce pays, qui semble le plus lointain du monde, avec tant de notions contradictoires. On est aux portes de l'énigme : Est-ce Icarie ou Paestum ? Eldorado ou Gomorrhe? L'imagination travaille, la curiosité vous ôte le sommeil. »(2)
Albert Londres avait été le premier à accomplir le voyage en 1920, pour L'Excelsior. En juillet 1925, Béraud le suivit pour le Journal. Le succès de ce reportage (3), publié en octobre et dédié à Joseph Kessel, tient du vertige : « A l'époque, certains prétendirent que jamais succès de presse n'avait égalé celui-là (...) Les lettres de lecteurs arrivaient par milliers. Les plus grands journaux du monde traduisirent, mot pour mot, mes trente articles. En quelques jours, mon nom atteignit à la grande célébrité », peut noter Béraud, trente ans plus tard dans Les Derniers beaux Jours, dernier volet de son autobiographie
Qu'y révélait-il de si sensationnel ?
Deux choses.
Tout d'abord, la fin du communisme dans la dictature bolchévique. Entre le fascisme mussolinien et le bolchévisme, aucune différence : «Rien, extérieurement, ne ressemble plus la vie moscovite que la vie romaine : cortèges, emblèmes, crainte, silence. C'est à dire que la réaction et la révolution n'ont, après elles, laissé aux hommes déconcertés qu'un être sombre et masqué, le Dictateur inconnu, qui ne saurait subsister sans l'adhésion de certains groupes, nécessairement avantagés au détriment des autres. A parler brutalement, il s'agit de deux fascismes. » Et ailleurs : « ce ne fut pas la fin de la Révolution russe. Ce fut la faillite du Communisme au profit d'un régime nationaliste et même xénophobe, d'un impérialisme qui s'essaie dans l'ombre aux gestes arrogants, et que nous aurons, conclue-t-il, à démasquer ». De quoi se faire de bons amis parmi les intellectuels bourgeois du Parti Communiste Français, où l'on aura la mémoire vive, en temps et heures.
Ensuite que le régime soviétique ne se dirigeait pas vers le capitalisme d'état. Il était déjà dedans. En plein. Il n'y avait donc plus rien à attendre de la Révolution russe à Levalois Perret. Rien. Le recueil des articles s'ouvrait par un avertissement solennel « au peuple »: Après avoir rappelé ses origines populaires, n'ayant pas besoin « d'aller au peuple comme certains fils à papa qui, pour arriver plus vite dans les milieux populaires, s'y rendent en automobile, il précisait : «Le devoir était de dénoncer la faillite de l'égalité économique telle qu'on l'avait promise aux insurgés d'Octobre ; il fallait dire comment, au cœur même de la capitale prolétarienne, les pauvres subissent plus que n'importe où l'insolence de la fortune et l'immonde assouvissement des profiteurs.» Les travailleurs, chez nous, écrivait-il « ont fait la seule révolution qui compte, celle des salaires. Ils n'ont rien attendre du bolchévisme. »
Suivait, en une trentaine de chapitres et 250 pages reprenant tous les articles du Journal une démonstration impeccable : la propagande qui s'abat sur le peuple russe, le silence dans les rues, les circuits organisés (déjà !) pour touristes occidentaux, les miséreux et les millionnaires, l'interview hilarante du camarade Kamenev, au fait de sa puissance en 1925, la NEP (nouvelle politique économique), les disparus de 1918 et les exécutions qui se poursuivent, la xénophobie des dirigeants russes, la presse inexistante hormis l'omniprésente Pravda, la « novlangue » (avec, notamment deux exemples sur lesquels il s'arrête longuement : la prison, rebaptisée « institut de la privation de liberté », et le contremaître devenu «ouvrier aîné»...). La littérature dite "de reportage" d'Henri Béraud est très fournie. De 1919 à 1934 passant de L'œuvre au Petit Parisien, puis au Journal, de quoi remplir huit recueils de reportages aux éditions de France : Ce que j'ai vu à Moscou (1925), Ce que j'ai vu à Berlin (1926), Le Flâneur salarié (1927), Rendez-vous européens (1928), Ce que j'ai vu à Rome (1929), Emeutes en Espagne (1931), Le feu qui couve (1932), Vienne, clef du monde (1934). Ces ouvrages, comme d'ailleurs ceux d'Albert Londres, ont connu à l'époque un succès qu'on ne peut imaginer. Ceux de Londres furent, à juste titre, ré-imprimés. Ceux de Béraud, non. Il faudra bien qu'un éditeur quelque peu entreprenant, un jour, dans ce pays aux habitants emplis d'amnésie, répare ce préjudice.
A tout seigneur, tout honneur : Albert Londres n'aura attendu ni André Gide ni Henri Béraud pour lancer, en 1917, déjà ce cri à Edouard Helsey : "Qu'est-ce que nous fichons ici ? Nous sommes correspondants de guerre et l'on ne cherche qu'à nous empêcher d'aller à la guerre. Hier encore, on m'a refusé les moyens de me rendre à Berry-au-bac où l'on se bagarre tous les jours. J'en, ai assez de délayer les topos des services d'information. D'ailleurs ces combats de tranchée sans issue, ces coups de main localisés vont vraisemblablement se prolonger toute l'année. Et pendant ce temps-là, des événements gigantesques se produisent ailleurs. Un cataclysme est en train de creuser un abîme dans l'histoire du monde, et nous n'essayons pas d'en être les témoins. Il faut aller en Russie. Viens-tu avec moi ?" (1)
Même inquiétude, même questionnement, quelques années plus tard, de la part d'un autre professionnel du grand reportage, Henri Béraud : « On part pour ce pays, qui semble le plus lointain du monde, avec tant de notions contradictoires. On est aux portes de l'énigme : Est-ce Icarie ou Paestum ? Eldorado ou Gomorrhe? L'imagination travaille, la curiosité vous ôte le sommeil. »(2)
Albert Londres avait été le premier à accomplir le voyage en 1920, pour L'Excelsior. En juillet 1925, Béraud le suivit pour le Journal. Le succès de ce reportage (3), publié en octobre et dédié à Joseph Kessel, tient du vertige : « A l'époque, certains prétendirent que jamais succès de presse n'avait égalé celui-là (...) Les lettres de lecteurs arrivaient par milliers. Les plus grands journaux du monde traduisirent, mot pour mot, mes trente articles. En quelques jours, mon nom atteignit à la grande célébrité », peut noter Béraud, trente ans plus tard dans Les Derniers beaux Jours, dernier volet de son autobiographie
Qu'y révélait-il de si sensationnel ?
Deux choses.
Tout d'abord, la fin du communisme dans la dictature bolchévique. Entre le fascisme mussolinien et le bolchévisme, aucune différence : «Rien, extérieurement, ne ressemble plus la vie moscovite que la vie romaine : cortèges, emblèmes, crainte, silence. C'est à dire que la réaction et la révolution n'ont, après elles, laissé aux hommes déconcertés qu'un être sombre et masqué, le Dictateur inconnu, qui ne saurait subsister sans l'adhésion de certains groupes, nécessairement avantagés au détriment des autres. A parler brutalement, il s'agit de deux fascismes. » Et ailleurs : « ce ne fut pas la fin de la Révolution russe. Ce fut la faillite du Communisme au profit d'un régime nationaliste et même xénophobe, d'un impérialisme qui s'essaie dans l'ombre aux gestes arrogants, et que nous aurons, conclue-t-il, à démasquer ». De quoi se faire de bons amis parmi les intellectuels bourgeois du Parti Communiste Français, où l'on aura la mémoire vive, en temps et heures.
Ensuite que le régime soviétique ne se dirigeait pas vers le capitalisme d'état. Il était déjà dedans. En plein. Il n'y avait donc plus rien à attendre de la Révolution russe à Levalois Perret. Rien. Le recueil des articles s'ouvrait par un avertissement solennel « au peuple »: Après avoir rappelé ses origines populaires, n'ayant pas besoin « d'aller au peuple comme certains fils à papa qui, pour arriver plus vite dans les milieux populaires, s'y rendent en automobile, il précisait : «Le devoir était de dénoncer la faillite de l'égalité économique telle qu'on l'avait promise aux insurgés d'Octobre ; il fallait dire comment, au cœur même de la capitale prolétarienne, les pauvres subissent plus que n'importe où l'insolence de la fortune et l'immonde assouvissement des profiteurs.» Les travailleurs, chez nous, écrivait-il « ont fait la seule révolution qui compte, celle des salaires. Ils n'ont rien attendre du bolchévisme. »
Suivait, en une trentaine de chapitres et 250 pages reprenant tous les articles du Journal une démonstration impeccable : la propagande qui s'abat sur le peuple russe, le silence dans les rues, les circuits organisés (déjà !) pour touristes occidentaux, les miséreux et les millionnaires, l'interview hilarante du camarade Kamenev, au fait de sa puissance en 1925, la NEP (nouvelle politique économique), les disparus de 1918 et les exécutions qui se poursuivent, la xénophobie des dirigeants russes, la presse inexistante hormis l'omniprésente Pravda, la « novlangue » (avec, notamment deux exemples sur lesquels il s'arrête longuement : la prison, rebaptisée « institut de la privation de liberté », et le contremaître devenu «ouvrier aîné»...). La littérature dite "de reportage" d'Henri Béraud est très fournie. De 1919 à 1934 passant de L'œuvre au Petit Parisien, puis au Journal, de quoi remplir huit recueils de reportages aux éditions de France : Ce que j'ai vu à Moscou (1925), Ce que j'ai vu à Berlin (1926), Le Flâneur salarié (1927), Rendez-vous européens (1928), Ce que j'ai vu à Rome (1929), Emeutes en Espagne (1931), Le feu qui couve (1932), Vienne, clef du monde (1934). Ces ouvrages, comme d'ailleurs ceux d'Albert Londres, ont connu à l'époque un succès qu'on ne peut imaginer. Ceux de Londres furent, à juste titre, ré-imprimés. Ceux de Béraud, non. Il faudra bien qu'un éditeur quelque peu entreprenant, un jour, dans ce pays aux habitants emplis d'amnésie, répare ce préjudice.
22:39 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : henri béraud, le petit parisien, littérature, moscou, soviets, communisme, russie | 
vendredi, 27 février 2009
Plan Sentimental de Paris
Années vingt... La guerre, ses souvenirs font mine de s'estomper de la mémoire des Français. Font mine. Après la Belle Epoque, donc, les Années Folles... Les fractures générationnelles n'ont jamais été si vives, dans ce vieux pays. Les idéologies ressurgissent, les financiers sortent de l'ombre. Paris, certes, Paris... Paris sera toujours Paris, ses boulevards, ses enseignes lumineuses, ses théâtres... version bien frenchie de the show must go on... Alors, soit ! Pigalle et ses bars... Montmartre et sa colline. Le caf-conc'. Le Moulin Rouge... ! «Paris ! Paris, proclame Béraud dans le Plan sentimental de la ville de Paris, on ne le voit et on ne l'aime bien qu'à travers une triste vitre ! ».
Quel lecteur, aujourd'hui, s'intéresserait à ce vieux livre oublié, le premier de la collection « Les Images du temps », publié en 1927 chez un éditeur disparu, du nom de Lapina ? L'édition de tête comporte une centaine d'unités. Suivent mille exemplaires, sur Vergé de Rives pur chiffon, pas un de plus, chacun dans son étui en carton vert marbré de jaune. La couverture du livre, d'un vert plus pâle, est marbrée de rouge. Titre et marques de l'éditeur sont imprimés en rouge ; Sur la page de garde, un portrait de l'auteur exécuté en pointe sèche par un certain L. Madrassi, puis en double page, un fac similé d'un fragment manuscrit signé Henri Béraud. Le Plan Sentimental de Paris est dédié à Marise Dalbret, sa secrétaire, sa maîtresse, sa compagne d'alors.
Le texte se donne à lire comme un jeu, un pari : Prenant pour référence le temps où Jules Laforgue - encore le dix-neuvième, le monde d'hier - s'exclamait : « Je viens de gagner une gageure. En plein Paris, j'ai passé trois journées sans adresser la parole à mes semblables, sans ouvrir la bouche, seul. Essayez. Vous m'en direz des nouvelles. », le narrateur fait mine de relever le défi : Huit nuits, huit nocturnes parisiens, huit errances ambiguës à la manière des Promenades d'un Nerval désinvolte, dans ce Paris des années folles. Huit promenades tout emplies de ce que Béraud appelle, avec une ironie désabusée, un romantisme rhumatismal.
« Les théâtres, les music-halls, les phonos, les cinémas et les bars populaires se jettent à la face, comme des provocations, les feux de leurs enseignes. C'est, chaque soir, une fête violente et gaillarde comme un carrousel forain. Or cette liesse, je l'ai dédaignée pour entrer sous un porche plein d'ombre, où l'on voyait une à une s'engager des personnes à la contenance grave et méditative. »
C'est le porche du concert Touche, où des instrumentalistes à la vieille mode jouent les compositeurs des siècles précédents : « Ils jouent. Les sonorités frappent les murs comme les parois d'un tombeau. Les auditeurs écoutent pieusement. En passant au contrôle, n'ont-ils pas acheté du rêve ? N'ont-ils pas acquitté le péage de l'oubli ? » La musique suscite en cascade des images intérieures : « Wagner et Berlioz lâchent à pleines brides leurs coursiers. Schumann passe avec une langueur apprêtée sur sa barque de deuil. Franck apparaît dans un clair-obscur flamand, les mains sur le clavier, les yeux fouillant le clair-obscur violet ; et c'est Mozart, souriant à son destin mélancolique ; et c'est le vieux Moussorgsky, enluminé et dévotieux, errant sous la neige devant les portes de Kiew ; et c'est Schubert, dans le petit cabaret viennois, fumant sa pipe, tenant un bouquet de fleurs maladives ; et c'est Duparc, égaré devant un miroir où son passé merveilleux l'entoure comme un fantôme ; et c'est Debussy, le front dans sa main fine, et murmurant l'immortel poème de Mallarmé»
Mais sitôt dans la rue, le beau drame intérieur s'évanouit devant un autre spectacle : Un film qu'on tourne, un peu plus tard, place Pigalle. Se déroule là comme un surplus inutile et accablant de bruits, de lueurs, une surenchère de mouvements, détachés de tout sentiment profondément ressenti, tel celui que la musique, par exemple, vient de procurer : La lumière électrique, assimilée à la foudre meurtrière, crée une sorte de cercle magique et brûlant où s'agitent des acteurs, assimilés à des ombres illusoires et morbides et d'où les vivants, simples spectateurs endeuillés, réduits en cendres, sont exclus :
« La foule en cercle noir, entourait un espace d'où, vers le ciel et les toits, montait une lueur de foudre. C'était, tout ensemble, aveuglant et lugubre. Tout ce qui ne vivait pas dans la blanche fournaise semblait pétri de suie. Les badauds avaient quelque chose de spectral. D'un porte voix jaillissaient sans relâche les ordres d'un metteur en scène. Alors surgissaient au milieu de l'espace enchanté, des simulacres de noctambules, tous en grand arroi de noces, avec des visages si fardés qu'ils semblent momifiés. Et l'on croyait suivre, en pleine rue, sous les quolibets de Montmartre, un blafard épisode de Pirandello. Quand j'eus assez longtemps joué mon rôle dans ce décor de folie, je partis le long des trottoirs. Au-dessus de ma tête, je voyais le ciel où passaient quelques nuages d'un impassible bleu »
17:37 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : henri béraud, littérature, plan sentimental de paris, musique, concert touche | 
mercredi, 25 février 2009
Un révolté raffiné
Le jeune lion dort avec ses dents : Cela nous ramène à l'année 1974. Dans l'une des Radioscopies de Jacques Chancel, Michel Lancelot (1938-1984) était venu présenter un nouveau livre. Ce titre, disait-il alors, il l'avait tiré d'un proverbe d'une tribu bantou. Il l'avait choisi parce que ce sommeil du jeune lion évoquait, pour lui, «une menace positive ou négative ». Non, ce n'était pas forcément lui, « le jeune lion », répondait-il à Chancel. Mais c'était une partie de la jeunesse, disait-il, de la jeunesse de l'époque, celle qui en avait marre « des falsifications culturelles et des salades éhontées ». Le propos du livre, toujours d'après son auteur, c'était la tension, la guerre même, que se livrent la culture et la contre culture. « A trente-six ans, lui demandait alors Chancel, avec sa gueule de faux ingénu, «êtes-vous sorti de votre jeunesse ? » Lancelot éludait : « C'est chez eux que se produisent les créations les plus constructives » C'est pour eux qu'il avait écrit ce livre, parce que les jeunes étaient placés devant les génies et les faussaires de la contre culture. Et qu'il fallait faire le tri. « La véritable culture, c'est le pragmatisme de l'intelligence, qui peut prendre les choses, les exploiter, les dominer et les rejeter. »
Depuis 1974, la controverse est terminée parce que, comme toujours, c'est les faussaires qui ont gagné, et les génies qui se sont tus. Un exemple : Cohn-Bendit est député européen, Debord est mort. Vous n'aurez aucun mal à en trouver d'autres. Depuis 1974, les frontières entre mode, publicité, couture, cuisine, football, talk-shaw et culture sont tombées. Œuvre d'un certain Jack Lang, fossoyeur ministériel de la contre culture. Œuvre relayé par un certain Pivot, aujourd'hui académicien. Ainsi, dans le galimatias de ce qui définit ce qu'est la culture, à présent, on range tout ce qui a un peu de notoriété, et qui parait capable de fidéliser un public. Depuis Tonton qui fait déjà partie de l'ancienne France, (celle où l'on confondait les divinités et les grenouilles) les insoumis et les notables ont impunément partout partouzé ensemble. Témoin la vente Bergé, mécène de Ségolène, et le prix atteint par la Belle Haleine de Marchel Duchamp. Les insoumis et les notables, guidés par Julia Kristeva et Philippe Sollers, ont fait la révolution culturelle dans les Garden party de l'Elysée que chaque Quatorze Juillet a fait, que le président fut de droite ou de gauche. Michel Lancelot n'aura jamais assisté à ça. Il est, dira-t-on, "mort à temps". Et nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de sa disparition. La politique (Nicolas) et la culture (Carla) ont passé leur nuit de noces « à la Lanterne », résidence des premiers ministres à Versailles. A Versailles ! Les aristocrates, sait-on s'ils auront été pendus ? Ils auront été, en tous cas, bien b..... Depuis, Julien Clerc et sa voix de chèvre bêlante, a repris du service dans les box office. Michel Lancelot n'aura jamais vu cela. Julien Clerc remplaçant Line Renaud dans les cortèges officiels des chanteurs de la République ayant leurs entrées l'Elysée. Julien Clerc sera-t-il un jour ministre de la culture ? La chèvre de monsieur Lang, un beau conte à dormir debout, pour le coup...
Michel Lancelot est mort un 25 février, le 25 février 1984, précisément (l'année fatidique d'après Orwell) ! Dans ces années encore cruciales, Lancelot fut l'un des derniers agitateurs à tenter de démêler le vrai du faux et le faux du toc dans le bazar culturel de l'époque; où en est la jeunesse d'aujourd'hui, livrée aux mains seules des faussaires des désirs d'avenir et des ensemble tout est possible ? Pendant plusieurs années, la jeunesse de France écoutait Campus en douce, l'émission qu'anima Michel Lancelot de 20h 30 à 22h30 sur Europe1, de 1968 à 1972. Une telle émission serait aujourd'hui, sur une chaîne comme Europe1, carrément impensable. La roue a tourné, et c'est Drucker qui a placé sa nièce à la télé. C'est Drucker qui reçoit Besancenot à Vivement Dimanche, une belle affiche de plus après Rama Yade. J'écoutais Campus. Je me souviens d'un concert de Barbara, enregistré en direct le 28 novembre 1969 à l'Alhambra de Bordeaux. Je me souviens d'un long entretien avec Brassens, lorsque sortit en 1972 « Le roi des cons ». Je me souviens d'une prise de bec avec Ferré, sur l'argent du show-business gagné sur le dos de l'anarchie. Ferré se défendant : « il vaut mieux vendre de l'anarchie que de vendre de la merde comme j'en écoutais l'autre soir à la télévision, c'est plus noble ». Lancelot, ne disant rien. J'ai retrouvé les paroles d'une chanson que le vieux Léo fit au jeune Michel, peu après sa mort :
Ce qu'il ne faut pas dire en fait toi tu le dis Michel
Ce qu'il ne faut pas faire en fait toi tu le fais Michel
Chaque soir à Campus
Avec dans l'œil et dans l'oreille
Les chants perdus du bout d'la terre
Et de Nanterre
Rappelle-toi là-bas chez les hippies
J'y étais moi aussi
Comme ceux de Nanterre et de Campus
Michel
Ce qu'il ne faut pas dire en fait toi tu l'as dit Michel
Ce qu'il ne faut pas faire en fait toi tu l'as fait Michel
Chaque soir à Campus
Après ce mec tout noir
Avec dans l'œil les chants perdus du bout d'la terre
Et du boulevard Saint-Michel Michel
Rappelle-toi là-bas chez les hippies
Nous y étions nous aussi
Comme ceux de Nanterre et de Campus
Michel
Michel Lancelot avait dans les veines du sang irlandais. « Quand on parle de sang irlandais, disait-il, on oublie de raconter le massacre des Irlandais par les Britanniques. » Et du sang autrichien : « Dans l'univers germanique, les Autrichiens, c'est le raffinement face à l'oppression ! » Michel Lancelot était au final français. Et donc, concluait Chancel « un révolté raffiné. » Michel Lancelot est mort il y a pile vingt-cinq ans. Le temps de faire ce qu'on appelle à présent un jeune. Une citation de Bernanos, à l'intention de ce jeune : « Quand la jeunesse se refroidit, le monde entier claque des dents. » Et une question, legs d'outre-tombe de ce bel esprit hélas oublié : Dans le pays de France, dort-il toujours avec ses dents, le jeune lion ?
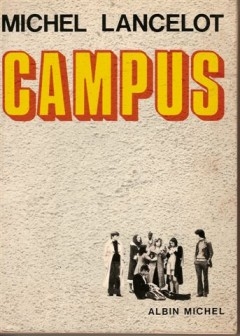
00:06 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : campus, michel lancelot, culture, contre-culture, littérature, europe1 | 









