dimanche, 19 décembre 2010
Lucide et disparue
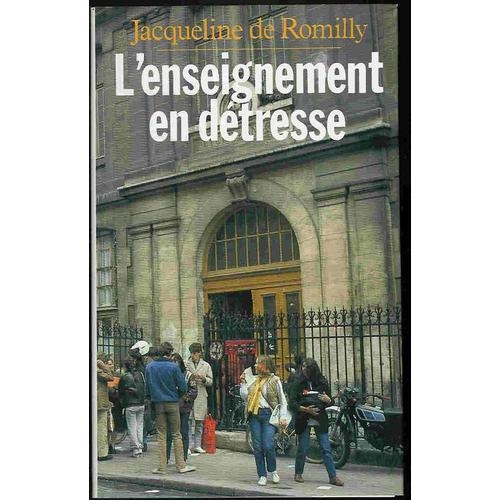
Le monde actuel est complexe, changeant. L'idée du législateur semble être qu'il faut donc faire à ces complexités et à ces changements la plus grande place possible, afin d'y habituer les jeunes en leur enseignant les données : les données sociales, en premier lieu, évidemment, et aussi les données politiques, techniques – en bref, l’actualité. Cela leur plaira plus, les intéressera plus, dans la mesure où l'enseignement rejoindra la presse, la télévision, les débats de la table familiale ou du groupe syndical. Ils ne seront pas désorientés, parce qu'ils seront immédiatement insérés, jetés dans le bain.
Je voudrais plaider, de toute mon âme, pour une démarche exactement inverse. Je crois que la force de tout enseignement par rapport aux « événements qui font l'histoire du monde » est d'imposer aux esprits un détour. Si l'on veut s’orienter convenablement, dans une promenade au cours de laquelle on doit retrouver son chemin, il faut prendre, en pensée, du recul. Il faut se retourner, voir d'où vient le chemin que l'on est en train de parcourir et où sont les repères, recourir à une carte, sur laquelle le paysage confus, masqué de buissons et d'arbres, d'ombres et de creux, se ramène à un tracé schématique, couvrant un horizon bien plus étendu et qui soudain rend compte du paysage. Il en va de même dans les choses de l’esprit.
Complexe, notre société ? Ô combien ! Mais dans ce cas, pour l'appréhender, pour la comprendre, pour en comprendre les problèmes et les tendances, il faut précisément faire le détour et apprendre à connaître d'autres sociétés plus simples. Je crois que, dans l'ordre des conduites humaines, les problèmes peuvent être posés avec une force accrue, lorsque se découvre, au niveau de la famille ou de la cité, le premier exemple éclatant d'un dilemme humain : la mort d'Antigone et la mort de Socrate aident à comprendre l'héroïsme et à le sentir sans sa simplicité absolue.
Ecole vient d'un mot grec signifiant loisir. L'étude doit être à la pause féconde et enrichissante où l'on s'arme pour la vie et pour la réflexion, et où l'on entre en possession de tout un trésor humain, que plus tard on n'aura plus, en général, ni le temps ni l'occasion de découvrir. Peu importe que les jeunes, au sortir de l'université, soient un peu hors du temps, un peu trop entourés d'amis tels que Socrate ou Descartes, Antigone ou Ruy Blas, Virgile ou Rimbaud : la télévision, la radio, le cinéma, rétabliront, toujours bien assez vite, l'équilibre.
Mais si ce sont juste de petits énarques ou de petits syndiqués bien au courant des dernières réglementations et du cours des monnaies, qui rétablira l'équilibre ? Pour tout, il faut du temps, et des exercices austères. Il est besoin de ce qui paraît être inutile et inactuel. C'est cela que l'on appelle la culture, au sens actif du terme.
Jacqueline de Romilly (1913-2010) L'Enseignement en détresse 1984)
18:49 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jacqueline de romilly, enseignement, hellénisme | 
vendredi, 16 avril 2010
A propos de Jacques Seebacher
Je place en ligne l'article de Francis Marmande (Le Monde, 24 avril 2008), en hommage à Jacques Seebacher (10 avril 1930 - 14 avril 2008), ainsi que le billet que j'avais édité sur ce blog le mardi 22 avril 2008 lorsque j'avais appris son décès. A l'attention de tous ceux qui, comme moi, ont eu la chance d'être l'un ou l'une de ses étudiants et de croiser les lumineuses explications de ce très grand professeur. ICI, l'hommage que lui rend Guy Rosa dans la Revue d'histoire littéraire. Et ICI, une biographie détaillée.
J’apprends avec beaucoup de tristesse la mort de Jacques SEEBACHER. Dans le tintamarre médiatique, les grandes intelligences et les beaux esprits s'en vont fort discrètement. Jacques Seebacher a été mon professeur à Paris VII pendant plusieurs années. Je lui dois, comme beaucoup d'autres de ses étudiants, des centaines d'heures d'un plaisir exquis, rare, indicible : celui de comprendre un grand texte auquel on consacre, pour rien, quelques heures de sa vie. Et cela chaque semaine. Et cela durant plusieurs années. Jacques Seebacher qui prit la succession de Pierre Albouy était un spécialiste de Victor Hugo (il dirigea l'édition du centenaire dans la collection Bouquins).
 C'était un dix-neuvièmiste complet, si une telle expression a du sens, un homme réellement cultivé, attaché à la transmission comme un paysan à sa terre. Je me souviens d'explications de lui de Michelet, de Renan, de Sainte-Beuve, de Musset, de Baudelaire, de Lamartine ou de Sand, bien sûr, mais également de Ronsard, de Racine, De Pascal, de Montesquieu, d'Apollinaire, de Valéry... Des explications scrupuleuses et lumineuses, au sens propre. Des explications généreuses, qui donnaient à leur auditeur l'impression d'être intelligent... Il était un professeur à la fois plein d'humour, de rigueur et d'intégrité, capable d'être cassant lorsqu'il se trouvait devant une personne qu'il jugeait malhonnête sur le plan intellectuel, heureux lorsqu'il apprenait qu'un de ses étudiants avait réussi quelque chose. La dernière fois que j'ai parlé avec lui, c'était de Béraud, par téléphone, il y a quelques années déjà. Je n'ai eu que très peu de véritables professeurs dans toute ma scolarité, déjà ancienne. J'en dénombre trois, tous de lettres : il était l'un deux. Il était parti à la retraite au tout début des années quatre-vingt dix.
C'était un dix-neuvièmiste complet, si une telle expression a du sens, un homme réellement cultivé, attaché à la transmission comme un paysan à sa terre. Je me souviens d'explications de lui de Michelet, de Renan, de Sainte-Beuve, de Musset, de Baudelaire, de Lamartine ou de Sand, bien sûr, mais également de Ronsard, de Racine, De Pascal, de Montesquieu, d'Apollinaire, de Valéry... Des explications scrupuleuses et lumineuses, au sens propre. Des explications généreuses, qui donnaient à leur auditeur l'impression d'être intelligent... Il était un professeur à la fois plein d'humour, de rigueur et d'intégrité, capable d'être cassant lorsqu'il se trouvait devant une personne qu'il jugeait malhonnête sur le plan intellectuel, heureux lorsqu'il apprenait qu'un de ses étudiants avait réussi quelque chose. La dernière fois que j'ai parlé avec lui, c'était de Béraud, par téléphone, il y a quelques années déjà. Je n'ai eu que très peu de véritables professeurs dans toute ma scolarité, déjà ancienne. J'en dénombre trois, tous de lettres : il était l'un deux. Il était parti à la retraite au tout début des années quatre-vingt dix.
L'époque, déjà, n'était plus trop littéraire, et avec son départ, j'eus l'impression, oui, qu'un siècle, qui jusqu'alors avait été mien, avait été nôtre, commençait à s'en aller aussi. Voici quelques lignes de lui que je tire de la préface qu'il avait alors rédigée pour Victor Hugo ou le calcul des profondeurs (PUF écrivains, 1991) :
« Voilà un peu plus d'un demi-siècle, en un Noël de guerre, un enfant de neuf ans commettait sa première inconvenance littéraire en demandant qu'on lui offre Les Misérables, pour en avoir lu un fragment dans ce merveilleux livre de lecture de l'école publique qui s'intitulait Une heure avec... Ce fut un couple d'Anglais, que l'invasion nazie allait bientôt contraindre à l'exil dans leur propre pays, qui consentit à ce caprice, avec les quatre volumes de la collection Nelson. « De l'Angleterre, tout est grand », dit l'auteur de L'homme qui rit. Peu importe de combien d'exils se compose toute pairie et de combien d'escarpements se conquiert le plain-pied quand on a compris comme Romain Gary et Ajar réunis qu'avec Hugo, l'éducation européenne consiste à avoir la vie devant soi ».
Le jour où Le Monde annonce la mort de Césaire, 18 avril 2008, on enterre Jacques Seebacher (1930-2008) du côté d'Amboise (Le Monde du 23 avril). Jacques Seebacher était un professeur de littérature de ce style disqualifié par la vulgarité qui règne : flamboyant, magnifique, contestataire, consentant à tous ses désordres et à toutes ses fidélités, amoureux du plaisir, désinvolte sur la forme et d'une exigence terrible sur les principes, dandy très capable de remplir la nuit des milliers de fiches érudites. Pour qui, ces fiches ? Certainement pas pour sa gloire, non : pour les groupes, les bandes, les tribus qu'il aimait susciter. Découvrant de très précieux secrets touchant à un manuscrit de Victor Hugo, assez en tout cas pour bétonner trois carrières universitaires et toute sorte de livres inutiles, il en fit des petits paquets soigneusement annotés de sa main, qu'il offrit en partage aux hugoliens de ses amis.
Il pratiquait l'amitié, la musique, le jardin, la conversation avec ce soin dilapidateur que d'autres mettent à naviguer sur MySpace. Jouait-il d'un instrument ? J'ai oublié de le lui demander. Il jouait de sa voix, sa voix grave, sa voix de viole de gambe, sa voix suave soudain cassante, sa voix aussi riche d'harmoniques que les vins dont il savait d'un coup de nez identifier les arômes. D'une intelligence féroce, soudain insupportable, cinglant, drôle, charmeur, méprisant, communiste et puis plus communiste sans en faire tout un plat mais sans se renier, constant de l'inconstance, il parlait sans notes, ne laissait jamais une phrase cul-de-jatte, ses mains alors semblaient des mésanges, un étudiant lui avait dit : « Nous, nous écrivons comme nous parlons, vous, vous parlez comme sont écrits les livres. » Ah oui !, Seebacher laissait tomber sans même y songer : « L'intelligence, ça s'apprend. »
Voilà, adieu berceau, cuillère en or dans la bouche en naissant, sapin de Noël, non, la vérité, c'est que l'intelligence, ça s'apprend. Ça ne tombe jamais du ciel. D'ailleurs, sauf pour les vélivoles et Galilée, le ciel n'existe pas. L'intelligence n'a rien d'un don, c'est une pratique.
Quels points communs entre Seebacher et Césaire, en dehors de ce 18 avril, jour de la Saint-Parfait ? Intermittents du communisme ? Bonne piste. Violemment autonomes ? Pas mal. Normaliens ? Soit. Mais l'Ecole normale, c'est bien joli, y entrer est à la portée de tous, le seul point qui compte, c'est de savoir en sortir. Ne pas s'y enterrer, il sera toujours temps au soir de la vraie mort. Ah oui, leur point commun : Hugo, la langue, le peuple, tout Hugo, le tendre comme le Hugo de La Bouche d'ombre. La langue, la farouche exactitude de la langue, seul accès à soi, au désir, donc aux autres, à la règle, à l'Histoire.
Seebacher, inconnu de tous, sauf de ces chercheurs aux mains nues en voie de disparition, et Césaire, le cri noir, la révolte, l'éloquence de la Révolution mâtinée de palabre, sortaient du peuple et s'en trouvaient gaillards. La colère noire chez Césaire, rien de cet "humanisme", cette "tolérance" dont se gargarisent tous les couteaux châtreurs de la classe politique (droite de droite et droite de gauche pour le coup confondues), répond à voix haute à l'intransigeance de Seebacher. La colère poétique. La colère théâtrale du Nègre. Nègre ou juif, disait-il, on ne naît pas nègre, on le devient. Nègre, ça sonne péjoratif ? Mais c'est pas nous qui l'avions inventé. La négritude, c'était une réponse à la provocation." Aujourd'hui, on veut imposer la sale habitude de mettre une feuille de vigne au racisme ambiant en disant "black".
Décidément, Guy Rosa, professeur lecteur de Hugo, Césaire et Seebacher, a raison : « Il est des morts qui meurent plus que d'autres. »
Francis Marmande, Le Monde,24 avril 2008.
00:23 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (28) | Tags : jacques seebacher, littérature, paris7, enseignement, université | 
jeudi, 04 juin 2009
Les impuretés de Pécresse
Trouvé cette perle de Pécresse dans le "Métro" d'aujourd'hui : "Il est très difficile de convaincre 57 000 enseignants chercheurs que nos intentions sont pures, surtout quand tant de fausses informations circulent sur les blogs ".
"Sur les blogs": première généralité, premier lieu commun. Tous les blogueurs sont donc des menteurs. Dans le même genre, madame la Ministre, je vous propose d'autres aphorismes dignes de votre hauteur d'esprit : tous les fonctionnaires sont des faineants, tous les ministres sont corrompus, tous les élèves sont nuls, tous les commerçants sont des voleurs, tous les financiers sont des salauds et toutes les blondes sont des imbéciles. A méditer, n'est-ce pas ?
" de fausses informations circulent sur les blogs" : Vous nous livrez là, implicitement, votre curieuse conception du blog. Jusqu'à preuve du contraire, un blog, de quelque bord politique (ou apolitique) qu'il soit, n'est pas un organe d'information, non ? Ne confondons pas ce qu'est un blog et ce que sont ces "gratuits" dans lesquels vous et vos congénères faites votre propagande au ras des paquerettes et dans les rames du métro.
"nos intentions sont pures" : J'avoue que les bras m'en tombent. Prenez-vous à ce point les gens pour des crétins ? Sans doute, oui... Remarquez... vous avez peut-être bien raison. Tout passe, dans ce discours tissé de lieux communs qui est celui de la propagande politique. Le pire, voyez-vous, c'est qu'il ne rencontre plus d'opposition, Ségolène et Besancenot tenant le même discours à leur manière : Nous sommes purs. La vie politique est pure. Nos intentions sont bonnes. Nous vivons tous une grande histoire d'amour dans le paradis retrouvé de nos engagements dévoués à la cause commune... n'est-ce-pas ?
"Qui fait l'ange fait la bête", pourtant. La grosse bête, même. Il est vrai que les Pensées de Pascal ne sont plus de mise, dans un pays où La Princesse de Clèves est un livre subversif...
20:21 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : pécresse, éducation nationale, enseignement, politique, presse gratuite, universités, réforme | 
mercredi, 27 mai 2009
La littérature constitutionnelle
Danielle Sallenave s’était, à la fin du siècle dernier ( !), placée à la pointe du mouvement Sauvons les lettres avec notamment deux ouvrages qui avaient fait date : Lettres mortes (1995) et A quoi sert la littérature (1997). Dans le dernier essai qu’elle consacre au sujet, Nous on n’aime pas lire (janvier 2009) elle raconte un séjour effectué dans un collège difficile, et sa rencontre avec des « jeunes » d’aujourd’hui. Le livre m’est tombé hier entre les mains, un peu par hasard, je dois dire. Dans un chapitre où Sallenave souligne à mi-voix la nécessité d’enseigner à la fois des grands textes mais aussi des "œuvres dérangeantes", elle entrouvre une drôle de porte en écrivant ceci :
« La Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, hélas, nous engage quand elle assigne à l’éducation la tache de favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux »
J’avoue que dans ma pratique de classe et le choix des œuvres que je propose à des élèves, je ne me suis jamais senti « engagé » par la Déclaration des Droits de l’Homme. Ni désengagé d’ailleurs. Je n’ai jamais fait appel qu’à mon jugement littéraire, et ma culture universitaire. Jugement & culture : voilà deux termes à remettre au goût du jour.
Car ce paragraphe de Sallenave, qui choisit le verbe «engager» pour évoquer le lien tissé entre un projet constitutionnel et l’enseignement de la littérature française (verbe aussitôt modalisé par l’adverbe hélas, mais lien cependant affirmé), m’a fait jeter sur la dame un regard soudain très soupçonneux. D’autant plus qu’un peu plus loin, feignant de donner des conseils à de jeunes professeurs, elle glisse un ironique et fort habile « je vous laisse le choix de quelque indignité littéraire»… On appréciera. Dans l'empire droit-de-l'hommiste, on n'enseigne donc plus la littérature qu'à l'aune du dogme officiel : cela n'avait jamais été dit aussi explicitement.
La littérature française, qui brilla des mille feux de la libre-pensée, du sentiment et du style, est donc bel et bien morte. Dans les centres de distribution d'objets culturels indéterminés, j'ai vu d'ailleurs qu'on ne disait plus littérature française, mais littérature francophone. Cela fait plus ouvert sur le monde, sans doute. Sans aucun doute. Si l'agrégation n'est pas supprimée dans les mois qui viennent, les gens passeront bientôt une agrégation de littérature francophone, vous verrez... Avec Nancy Huston en présidente du jury.
Quant à son enseignement, il est rendu impossible : la morale cul-béni des droits-de-l’hommistes et le catéchisme euro-républicain auront réussi à l’étrangler, bien plus surement que l’Inquisition, beaucoup plus efficacement que n’importe quelle église. Beau travail. Où l'on voit que les Tartuffe ne sont pas à l'endroit où on les imagine
Un professeur de Lettres doit faire face, aujourd’hui, non seulement à la déflagration linguistique qui est en train d’ébranler une génération entière, à l’inculture immodeste d’une génération de parents désormais dressée au bon goût par les medias (genre : pourquoi vous n’aimez pas amélie nothomb, vous ? Ou encore : Il vaut mieux lire harry potter que rien du tout, hein ? hein ?), mais également à ce moralisme institutionnalisé et revendiqué même par ceux qui passent pour des défenseurs de la littérature et de son enseignement. Rajoutez à cela le pragmatisme économique prôné par l’OCDE, qui voit dans l’enseignement des Lettres un surcoût financier à évacuer progressivement des budgets, rajoutez l'image totalement caricaturale que deux films (Entre les murs, L'année de la jupe) viennent de donner du cours de littérature (je poserai inlassablement la même question : pourquoi, s'il ne s'agissait de ne parler que de l'école et ses "problèmes", ainsi que du désormais tarte à la crème - élève de banlieue, ne pas prendre un prof de maths ? ou de gestion ?). Rajoutez tout ça et, avant de passer au four, rendez vous aux assises internationales du roman.... On y rencontre des auteurs et des auteures vivants. C'est bath.
Bienheureux les quelques-uns, les happy few, vraiment, qui passeront à travers les mailles du filet.

07:41 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : danielle sallenave, europe, éducation nationale, enseignement, politique | 
samedi, 02 mai 2009
Des programmes en littérature
Il y a, dans la notion pourtant indispensable de programmes scolaires, quelque chose qui doit glacer le sang de chacun dès lors qu’il s’applique à ce qu’on appelle sans plus trop savoir de quoi il s’agit à la littérature française. Car un programme a pour premier objectif, quel que soit son contenu, d’être compréhensible et assimilable par tous. Et pour second, qu’il l’avoue ou non, de satisfaire les enjeux idéologiques de ceux qui l’ont conçu: ainsi l’OCDE a-t-elle averti dans l’une de ses brochures déjà ancienne (1998) que désormais, le classicisme, jugé par elle « trop français » devrait être progressivement retiré des programmes au profit de l’Humanisme et des Lumières, mouvements culturels plus nettement européens. Les réformes des programmes de français de lycée adoptées dans la foulée ont vu dès lors une révision significative : on mettrait l’accent en classe de seconde sur le romantisme et le naturalisme, en classe de première sur l’humanisme et sur les Lumières, évacuant sans trop le dire le classicisme et ses auteurs soudainement considérés comme subversifs autant que réactionnaires pour avoir eu le malheur de vivre au siècle de Louis XIV.
Il faut se rappeler que le contenu d’un programme, lorsqu’il est question de littérature, ce sont les œuvres, les auteurs. Or il se trouve qu’une œuvre, un auteur, c’est exactement ce qui échappe de façon irréductible aux programmes et aux objectifs plus ou moins sains qui les gouvernent. La plupart du temps, dès lors, le sale boulot du prof de français, c’est d’une part de ramener à du commun ce qui n’est pas commun et à du systématique ce qui échappe au système (afin de remplir la première formalité – rendre une œuvre assimilable par tous), et d’autre part d’adapter à l’idéologie des temps présents ce qui appartient à celles des temps passés, et qu’importent les multiples contresens. Cette double entreprise de simplification et de travestissement des œuvres littéraires est ce qui sous-tend depuis toujours l’élaboration d’un programme de lettres. C’est ainsi, par exemple, que Montaigne se retrouve dans la peau de l’homme qui doute, Montesquieu dans celle du penseur ironique, Voltaire dans celle du tolérant de service (ce qui est assez comique), tandis que Rousseau endosse la défroque du paranoïaque officiel. De ces quatre-là ne seront commentés que quelques textes devenus les timbres postes d’une République aphone et paradoxale, dont les élites refusent avec un aveuglement stupéfiant d’admettre qu’elle a cessé d’être un modèle pour le reste du monde.
Le plus regrettable dans tout cela, c’est que la langue et la littérature françaises, faites l’une pour être parlée, l’autre lue, toutes deux pratiquées, s’échappent de nos mémoires et de notre pratique. J’en veux pour preuve un fait assez étonnant : deux films, coup sur coup, prétendent de manière fort péremptoire poser « les problèmes de l’école » devant le public : L’Entre les Murs de Bégaudeau, et L’Année de la Jupe de Lilienfeld. Ces deux films ridicules sont censés poser (pour l'enrichir) le débat sur l’école, les élèves des cités, leur insertion, l’autorité des adultes, la conduite d’un cours, blablablabla… Qu’ils posent, qu’ils posent. Et que leurs producteurs gagnent au passage quelques millions d’euros. Je remarquerai néanmoins une chose, que tout le monde semble oublier : c’est dans les deux cas au cours de Lettres qu’on s’en prend, sans ménagement, comme s'il était, ce malheureux cours de lettres, un simple prétexte d’une part, et puis l’affaire de tous, d'autre part… Je ne dirai pas à quel point Bégaudeau et sa démagogie obscène me répugne, je l’ai déjà fait savoir publiquement. Je pose cette simple question : pourquoi est-ce le nom de Molière, cette fois-ci encore, que Sophie Marceau (1) demande à l’immigré de service, un flingue au poing ? Pourquoi Molière et pas la formule du sodium ? Pourquoi prof de lettres, et pas de maths ou de gestion ?
Voilà que par deux fois - pour mettre en scène le malaise qui a gagné l'école depuis que libéraux puis socialistes, socialistes puis libéraux, n'ont cessé de lui faire subir les réformes préconisées par des instances internationales -, on montre, sans le dire vraiment, que l'enseignement d'une "matière" (la littérature) est bien mal adaptée aux délectables temps post-modernes dans lesquels nous croupissons : Qu’on ne s’étonne pas, dès lors, que les professeurs de lettres soient, comme le disent certains, pessimistes, comme le disent d’autres, réactionnaires. Je veux bien endosser ces deux défroques, dès lors que mon métier est de permettre aux élèves qu’on me confie de lire aussi bien Louis Guilloux, président des écrivains anti fascistes, que Henri Béraud, prétendument collaborateur. Jules Valles que Charles Péguy. Diderot que Bossuet. André Gide que Maurice Barres. Nous parlons bien de littérature française, n’est-ce pas ?
(1) : On me fait remarquer en commentaire que, par inadvertance, j'ai confondu Adjani et Marceau. Je précise que c'est un vrai lapsus. Si, pour céder à un freudisme de bas étage, j'analysais son "rapport avec l'inconscient", je crois pouvoir dire qu'il est révélateur de la grande estime dans laquelle je tiens ces deux dames; en tout cas de la manière dont je les trouve, comme tous ces êtres aussi étranges qu'erratiques qui flottent sur nos écrans, interchangeables : donnez quelques kilos à l'une, vous obtenez l'autre. Notez bien que ce que je dis des dames est tout aussi vrai des messieurs : on passe de dutronc père à dutronc fils, de delon père à delon fils, de bruno masure à laurent delahousse avec la même consternante facilité que de claire chazal à laurence ferrari; ce monde désolant fait de copies m'en fait oublier les majuscules...
20:19 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : éducation nationale, littérature, année de la jupe, enseignement, programmes des lycées | 
mercredi, 18 mars 2009
De l'autorité
« Puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de violence. Pourtant l'autorité exclut l'usage de moyens extérieurs de coercition : là où la force est employée, l'autorité proprement dite a échoué. L'autorité, d'autre part, est incompatible avec la persuasion qui présuppose l'égalité et opère par un processus d'argumentation. Là où l'on a recours à des arguments, l'autorité est laissée de côté. Face à l'ordre égalitaire de la persuasion, se tient l'ordre autoritaire qui est toujours hiérarchique. S'il faut vraiment définir l'autorité, alors ça doit être en l'opposant à la fois à la contrainte par la force et à la persuasion par arguments. La relation autoritaire entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose ni sur une raison commune ni sur le pouvoir de celui qui commande : ce qu'ils ont en commun, c'est la hiérarchie elle-même, dont chacun reconnait la justesse et la légitimité, et où tous deux ont d'avance leur place fixée »
Hannah Arendt, "Qu'est-ce que l'autorité", La Crise de la culture
22:23 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : hannah arendt, autorité, école, enseignement | 
jeudi, 05 février 2009
Une affaire de goût
Beaucoup de gens disent que leur goût est naturel. Et de ce goût prétendument naturel, ils font la mesure de tout jugement esthétique, parfois même éthique. "J'aime, j'aime pas", variante assez stupéfiante du médiatique "pour ou contre", qui structure de plus en plus leurs opinions. Impression que demeure ainsi un choix, que ce choix relève d'un goût, et que ce goût est naturel. Et de ce goût prétendument naturel, ils font l'étalon absolu, la mesure exacte de ce qu'ils voient, de ce qu'ils rencontrent. "J'aime, j'aime pas" : Sorte de pensée magique, de crédo mystique, la référence en matière de sapes, objets, livres, films, tableaux, people, manifestations, festivals et parfois même, idées ... Jamais nous n'aurons vécu aussi loin de la nature, jamais, nous ne l'aurons mise à autant de sauces : c'est naturel, disent-ils de tout et n'importe quoi... mais comment peut-on sérieusement penser que le goût est naturel alors qu'on vit dans une société où, précisément, plus rien ne l'est ?
La nature, elle-même, Séjour des dieux chez les Grecs, Mère providentielle chez les humanistes, Asile miséricordieux chez les romantiques, chez nous, & par la grâce de notre sémantique, n'est plus qu'un simple environnement. Voilà à quoi nous avons réduit la représentation que, collectivement, nous nous en faisons. Cela n'empêche pas quelques-uns d'entre nous de l'admirer, certes : mais toujours de très loin; mais comment, loin de cette nature qui nous environne, aurions-nous pu conserver un goût naturel, lequel serait passé à travers tous les filtres de l'éducation, du conditionnement, de l'idéologie, des affects... pour toutes les saloperies que la grande distribution, commerciale ou culturelle, nous refile à digérer ? Froissés, sans doute, de n'être pas le centre réel de l'univers comme l'avaient cru les Antiques, nous, modernes, nous nous sommes en quelque sorte configurés un centre. Et de là, de ce centre où les notions d'inné et d'acquis ne sont même plus identifiables, éloignés de la tradition du goût, nous prenons la mesure de ce tout qui nous entoure. Combien de gens pensent-ils encore qu'en matière esthétique, le goût est avant tout une affaire d'éducation ? Combien de gens ont-ils encore l'humilité de se dire qu'ils pourraient, qu'ils devraient éduquer leur goût ? Combien de gens en ressentent-ils encore la nécessité, dans cette étrange et partout régnante confusion ?
20:53 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : goût, culture, enseignement | 









