dimanche, 27 novembre 2011
Retour à Killybegs de Sorj Chalandon
Journaliste et romancier, Sorj Chalandon propose avec Retour à Killybegs un texte dense, dont le style cible le lecteur d’aujourd’hui en ne quittant que par à-coups le récit des événements, tout au long d’une narration croisée s’étendant sur presque un siècle. L’intrigue s’inspire de l’histoire de son ami, le militant et combattant Denis Donaldson (déjà héros de Mon traître, publié en 2008) ? Cet agent double irlandais fut assassiné à 56 ans en avril 2006. (Lire l’article annonçant sa mort ICI).
Vieilli pour les besoins romanesques de quelques années, Denis Donaldson prend donc le patronyme du seul personnage fictif du livre, Tyrone Meehan, héros et traître à la fois de la cause qu’il porte devant les siens et devant le monde. De retour dans la maison de son père, ce dernier s’improvise narrateur de ses Confessions ou Révélations, pour retracer son parcours chaotique à travers le Sinn Fein et l’IRA, la gloire et la trahison, avant d’y être abattu.
La trahison pourrait ainsi apparaître comme le motif premier de ce livre – comme la dramaturgie tissée entre les personnages le laisse entendre, et ce jusqu’au dénouement. D’un épisode à l’autre, et part le biais du je narrateur, ce traître que le lecteur suit de près lui apparait en effet, non pas sympathique mais plus prosaïquement humain, comme dans cette page où on pourrait le confondre avec un fonctionnaire terne et paisible :
« Un jour que je buvais des bières avec Sheila au Thomas Asher, un militaire britannique s’est approché de notre table et m’a demandé mon nom. Son officier s’est approché de moi en souriant :
-Laisse tomber, Meehan cotise à la retraite à présent.
Et Sheila a posé sa main sur la mienne. » (p 217)
Un traître, au fond, ce n’est qu’un type dont le combat prend de l’âge et qui vieillit comme un autre, sensible à sa réputation et soucieux de ne pas écorner l’image que le monde-et plus profondément lui-même - a de lui : tel semble être le discours de fond par lequel Chalandon explique le geste de son ami. La manière dont les services britanniques font tomber le personnage est de ce point de vue significative : en le menaçant de révéler le meurtre d’un de ses frères d’armes commis accidentellement de longues années auparavant, ce n’est pas sa cause qu’ils mettent en danger, mais la légende qu’il est devenu parmi les siens. Or le romancier laisse entendre que dans une existence aussi tragiquement et constamment marquée par la défaite politique de son camp, la seule victoire de Meehan aurait été au fond la construction de cette légende. Les années passant, le souvenir gardé vivace et secret de la mort de Dany Finley était devenu à son regard une faute. Les Britanniques jouent ainsi de la culpabilité de leur proie au cœur même du mythe qu’il est devenu dans la résistance à leur impérialisme. C’est ainsi que le personnage entre dans le double-jeu, et le lecteur avec lui. En creux s’amorce ainsi une méditation sur la société libérale et mondialisée qui se construit en marge du vieux nationalisme et de ses idéaux héroïques : quelle dignité, quelle grandeur, quelle gloire ce nouveau monde laisse-t-il aux individus ? Le récit de la terrible grève de l’hygiène menée dans les cachots de Margaret Thatcher (« un mélange de morgue, de chiotte et d’hôpital » – p 166), laquelle déboucha sur la grève de la faim et la mort en 1981 de Bobby Sands, Francis Hugues, Pasty O’Hara et Ray Mac Creesh, constitue de ce point de vue l’épicentre romanesque dans lequel le héros, au sens le plus pur du terme, n’a d’autre choix que de trahir ou mourir.
Ce que cette biographie romancée a de complexe et sensible, c’est la façon dont elle met en lumière la défaite programmée de la cause républicaine dans un siècle promis dès 1940 à la mondialisation. Sont-ils ainsi traîtres à eux-mêmes ou trahis par l’Histoire, ces héros dont l’idéal semble une cause perdue qu’ils se refilent à leur insu comme une boule de poison, de père en fils ? Dès lors, un autre motif sous-tend plus gravement ce livre, celui de l’héritage, celui de la filiation.
Au commencement de la tragédie de Tyrone Meehan était un père, dont les premières pages narrent rapidement les combats et la mort : « Avant d’être méchant (il faut lire rendu alcoolique par ses défaites), mon père était un poète irlandais et j’étais accueilli comme le fils de cet homme. » (p 16). Engagé dès 1921 contre le cessez-le-feu imposé parles Britanniques et la partition de son pays en deux, ce père, condamné à mort, puis gracié, devient très vite paria dans son propre pays : « Pat Meehan n’était plus un homme mais une défaite » (p18). Pourtant, comme le souligne Tyrone : « L’IRA, c’était la chair de mon père, sa vie entière, sa mémoire et sa légende ». Une défaite historique et un combat à poursuivre : lourd héritage, ciment romantique dans lequel les héros n’ont d’autres choix que se forger un héroïsme, à moins de devenir des vaincus ou pire, des traitres. La passation de cet héritage à son fils Jack est le fil conducteur par lequel chemine toute l’intrigue. Epouser l’échec du père est ainsi le prix à payer pour garder vivante la légende nationale. Dans un monde où ce qu’on doit à filiation est décisif pour l’estime qu’on a de soi, la radicalité du combat condamne ainsi au sacrifice.
On peut ainsi parler de l’hérédité de cette défaite qui, sur trois générations, abat une lignée d’hommes : Jack Meehan, fils de Tyrone et petit-fils de Pat, finira barman dans un pub irlandais de Christchurch en Nouvelle Zélande, confirmant le destin familial : « Nous n’étions plus une famille, à peine un troupeau blême ». (p 25)
Retour à Killybegs peut ainsi se lire comme une méditation sur une filiation rompue par l’Histoire. C’est lorsqu’il voit son propre fils épouser – pour son malheur - la cause irlandaise et être condamné à la perpétuité à son tour que Tyrone Meehan avoue pour la première fois sa lassitude. Une cause noble et héroïque, certes, mais sans issue devant l’indifférence de l’opinion, la marche du monde. Stupéfait d’apprendre la trahison de son père à sa sortie de prison, Jack le retrouve une dernière fois dans la maison de Killybegs au cours d’une scène où se joue un drame qui les dépasse tous deux, celui de leurs aïeux :
« -J’ai eu un père pendant 20 ans, et puis il est mort
Je regardais Jack. Il y avait tellement de Meeham en lui. J’ai failli sourire de lassitude. Je me suis dit qu’il était tout ce qui me restait.
-Comment peux-tu me regarder en face, hein ? Comment fais-tu ?
-Je regarde mon fils.
-Je t’interdis. Ne prononce jamais ce mot. Jamais : » (p 146)
Après avoir consacré deux livres à cette histoire, dont celui-ci que l’Académie Française a couronné, Sorj Chalandon affirme qu’il écrira encore sur l’Irlande, « mais plus jamais sur cette histoire de trahison » . A Mathieu Menoss qui, dans un entretien publié dans La peau sur les mots après la parution du premier livre, Mon traitre, lui demandait s’il était parvenu aujourd’hui à considérer Denis Donaldson comme »une victime de cette putain de guerre », Sorj Chalandon répondait :
« Oui, tout à fait. Des combattants de l'IRA sont tombés les armes à la main. Des civils sont morts sous les bombes. De jeunes Anglais, la vingtaine tout juste, se sont retrouvés face à la mort dans les rues hostiles de Belfast. Des grévistes de la faim se sont sacrifiés. Et je pense que Denis Donaldson fait partie de cette humanité que la guerre a saccagée. Le leader révolutionnaire irlandais Michael Collins disait :
- Je n'en veux pas aux Anglais pour nous avoir combattus. Pour nous avoir emprisonnés, torturés ou tués. Je leur en veux pour avoir fait de moi un tueur.
Et moi j'en veux aux Anglais d'avoir fait de Denis Donaldson un traître. Je le vois encore sur la photo au camp de prisonniers de Long Kesh, la main sur l'épaule de Bobby Sands. Si ce dernier fut enterré avec les honneurs militaires dans le cimetière de Milltown, où reposent tous les héros de la République, Donaldson fut enterré dans le cimetière des oubliés, de l'autre côté de la rue. »
Ce roman, Retour à Killybegs, est d’une certaine façon son autre et ultime tombeau.
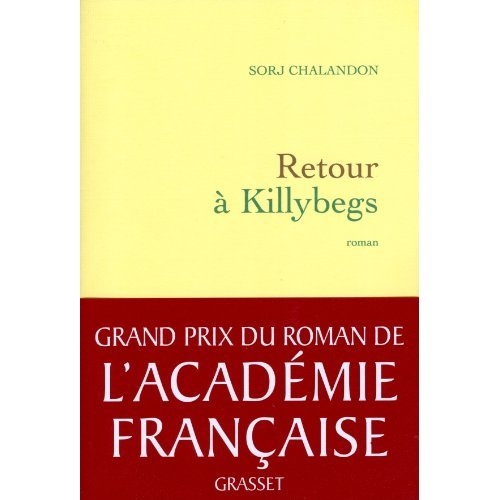
RETOUR À KILLYBEGS de Sorj Chalandon. Grasset, 336 p., 20 €.
22:04 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, sorj chalandon, retour à killybegs, sinn fein, ira, denis donaldson, politique, société | 











Commentaires
Je suis en train de finir "Le rabaissement" de Philip Roth, de belles pages sur la désaffection de soi, le désamour de soi, la soixantaine venue (ici un grand acteur qui ne sait plus que se dire "je suis un menteur") ; pas une réflexion philosophique, non, la consignation sans état d'âme de ce phénomène aussi subit que subi : la perte de toute compétence, de tout talent, à commencer par celui de vivre.
Et aussitôt fini, j'attaque "Retour à Killybegs" acheté vendredi. J'en cite l'exergue :
"Savez-vous ce que disent les arbres lorsque la hache entre dans la forêt ? Regardez ! Le manche est l'un des nôtres !"
Un mur de Belfast
Je me souviens des grévistes de la faim, ces républicains irlandais dont les visages faisaient, semaine après semaine, la une du quotidien que je lisais. Bobby Sands fut-il le dernier, je ne sais plus. Ils mouraient les uns après les autres, au bout de quarante, soixante, soixante-dix jours de grève de la faim...
Écrit par : Michèle | dimanche, 27 novembre 2011
Quant au livre de Roth, si vous avez quelque chose en bien ou en mal à en dire, Solko sera ravi de vous ouvrir ses colonnes (Patrick m'a donné une idée).
Écrit par : solko | dimanche, 27 novembre 2011
Écrit par : Vinosse | dimanche, 27 novembre 2011
Écrit par : solko | dimanche, 27 novembre 2011
J’ai hâte de lire la critique sur le dernier bouquin de Roth, car moi je l’ai trouvé très décevant. Certes, il est bien écrit dans ce style très souple cher à Roth, certes le cas de Simon Axler, comédien en perte de vitesse, est intéressant et ouvre les portes à la réflexion, mais le roman est très court (120 pages), trop peut-être, et ce volet aurait mérité d’être plus développé à mon sens. Enfin, et là aussi je dois être honnête, la complaisance récurrente de Philip Roth pour le sexe, et là en poussant le bouchon un peu loin, un type de plus de soixante ans qui se tape une lesbienne, avec une scène de triolisme et accessoires consacrés pour pimenter le quotidien, ça devient un peu ridicule, sans même l’excuse de l’humour.
Philip Roth est un grand écrivain, c’est certain. Il commence à prendre de l’âge et avoir des fantasmes dont il se sert pour nourrir ses romans, c’est logique, mais j’ai l’impression qu’il commence à flirter avec le n’importe quoi sur la forme, même si le fond reste particulièrement intéressant et jubilatoire. La critique professionnelle semble trouver tout cela très bien, aveuglée par l’œuvre passée et de haute qualité de l’écrivain, mais moi qui suis entièrement libre de mes propos je trouve que ce roman de Philip Roth rabaisse son talent. D’où le titre du livre ?
Écrit par : Corboland78 | lundi, 28 novembre 2011
Je partage entièrement votre point de vue.
J'ai beaucoup apprécié la 1ère des trois parties du livre : 1."Dispersés dans l'air léger" : j'étais intéressée par l'approche inédite de cette perte de soi où l'auteur s'ingénie à refuser toutes les pistes faciles et je me demandais avec gourmandise comment il allait faire évoluer tout ça. A ce stade de la lecture, je ne doutais pas que ce fût étonnant jusqu'au bout. D'autant que la conduite du récit était enlevée, avec des changements de focale, et cette belle ellipse de la p.30 ("et le mariage de la danseuse sans emploi et de l'acteur sans emploi se termina par un divorce, ajoutant un cas de plus aux millions d'histoires d'hommes et de femmes qui connaissent une union malheureuse").
Au début de la 2e partie, je ne me suis pas méfiée (même si elle s'appelle bêtement "La transformation") car Roth prend les choses de loin pour ensuite opérer un recentrement sur le personnage qui va alors occuper tout l'espace.
Jusque là, la lectrice que je suis est toujours acquise. Ce 2e personnage est au début assez insolite pour que.
Sauf que.
Vous l'avez dit et je ne saurais mieux dire, on tombe de Charybde en Scylla.
Passée à la trappe la belle interrogation sur l'effondrement de cet acteur, qui pouvait ouvrir une voie inédite et donnait au texte toute sa tension.
On entre dans la convention la plus éculée : notre sexagénaire veut se refaire une jeunesse. Ben oui, pourquoi pas. Mais plus besoin alors d'écrivain. Exit le beau questionnement du début. Exit Roth.
C'est d'autant plus dommage que, vous l'avez dit, c'est un bel écrivain et je trouvais son écriture particulièrement dépouillée et incisive dans ce trentième roman.
Qui nous laisse, hélas, par une sorte de "rabaissement", pléonastique oui, sur notre faim.
Écrit par : Michèle | lundi, 28 novembre 2011
Écrit par : solko | lundi, 28 novembre 2011
Je sais que la copie ça ne se fait pas :
-------
P219
Bobby Sands est mort le 5 mai 1981, après soixante-six jours de grève de la faim. Agonisant il venait d’être élu député à Westminster, mais cela n’a pas suffi. Francis Hughes est mort le 12 mai, à vingt-cinq ans et après cinquante-neuf jours de grève de la faim. Pasty O’Hara et Ray McCreesh sont morts ensemble le 21 mai, à vingt-trois et vingt-quatre ans, après soixante et un jours de grève de la faim.
P241
Martin Hurson est mort le 13 juillet 1981, à vingt-cinq ans, après quarante-six jours de grève de la faim. Kevin Lynch le 1er août, vingt-cinq ans lui aussi, au soixante et onzième jour. Et Kieran Doherty le lendemain, à vingt-six ans, au soixante-treizième jour de jeûne.
P263
Thomas McElwee est mort le 8 août 1981, à vingt-quatre ans, après soixante-deux jours de grève de la faim. Micky Devine, le 20 août, après soixante jours de jeûne. Il avait vingt-sept ans.
P264
C’est alors que la famille d’un gréviste a demandé que cesse le martyre. Père, mère, au chevet de douleur, réchauffant de leurs mains les mains de leur gisant. Leur fils était tombé dans le coma. Ils ont donné l’autorisation de le nourrir. Puis une autre mère a cédé. Et une autre. Et une autre. Et huit mères encore, qui ont renoncé à perdre leur enfant.
La grève de la faim a officiellement cessé le 3 octobre 1981 à 15h30. Une centaine de volontaires attendaient de rejoindre la protestation. Certains, en secret, avaient remonté leur nom sur la liste pour commencer plus vite.
Quelques jours plus tard, les détenus ont eu l’autorisation de porter des vêtements civils, mais pas de se revendiquer prisonniers politiques.
Margaret Thatcher n’a jamais cédé.
-------
Écrit par : Michèle | samedi, 03 décembre 2011
P258
Et puis j'ai regardé ses lèvres, leur mobilité extrême, cette façon particulière qu'ont les Français de mâcher largement leurs mots. Il parlait bouche ouverte, comme les gens sans secrets.
Écrit par : Michèle | samedi, 03 décembre 2011
Les commentaires sont fermés.