mardi, 23 février 2010
Les transformations de l'homme
La première vertu de ce livre au sujet austère, c’est son aspect narratif. « Son œuvre entière est traversée par une immense sollicitude envers les réalités vivantes. » disait Jacques Dufresne de Lewis Mumford (1895-1990). Avec justesse. Et raison : Mumford est un conteur né et cela transparait dans ses livres qui pourtant ne sont pas des récits. Je viens d’achever « Les transformations de l’homme » (lequel date de 1956), dans une nouvelle traduction de Bernard Pécheur, que l’excellente maison l’Encyclopédie des Nuisances a éditée en 2008.
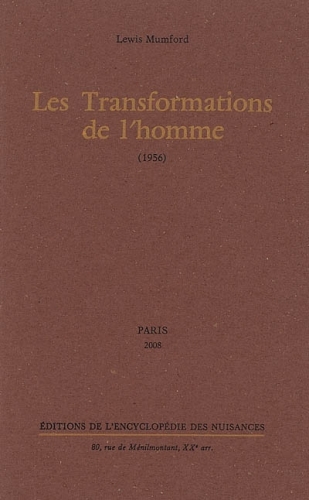 Le titre The transformations of man, donne déjà le ton. Lewis Mumford, contrairement aux progressistes béats applaudissant à tout rompre toute innovation technologique rompt avec ce terme imbécile d’évolution, qui postule implicitement l’idée d’une transformation forcément positive. Car s’il est vrai qu’il est des transformations aux effets positifs, il en est de nombreuses aux effets négatifs : Mumford est l’un des pionniers de la critique moderne du machinisme industrielle et de la société technique, et pour sûr des gens comme Marcuse ou Ellul l’ont lu avec attention.
Le titre The transformations of man, donne déjà le ton. Lewis Mumford, contrairement aux progressistes béats applaudissant à tout rompre toute innovation technologique rompt avec ce terme imbécile d’évolution, qui postule implicitement l’idée d’une transformation forcément positive. Car s’il est vrai qu’il est des transformations aux effets positifs, il en est de nombreuses aux effets négatifs : Mumford est l’un des pionniers de la critique moderne du machinisme industrielle et de la société technique, et pour sûr des gens comme Marcuse ou Ellul l’ont lu avec attention.
Tout exposé d’ensemble du développement humain court bien sûr le risque de l’extrapolation ou celui de la généralité. L’axe que suit Mumford est cependant rigoureusement posé : au vu de la gouvernance technique du monde, gouvernance assurée de plus en plus par des machines, quelles illusions peut encore se faire le bipède humain sur le sort de sa propre liberté sans être ridicule ?
Dans le développement du monde, Lewis distingue plusieurs périodes. Au vrai, il les « raconte » (j’en reviens à l’art du récit, comme chez la Fontaine) :
Celle de « l’homme archaïque », en compagnie duquel nous restons quelques dizaines de pages. C’est l’occasion d’évoquer aussi bien des cueillettes de Neandertal que les Travaux et les Jours d’Hésiode, occasion de rappeler aussi quelles traces, du bon sauvage rousseauiste au sapiens middle class parti ramasser des champignons en famille, ce lointain souvenir nous a laissé. Avec la naissance des premières civilisations survient la première transformation de l’homme, dont l’effet principal (s’il fallait n’en retenir qu’un seul) par rapport au sujet qui nous intéresse fut la création de « l’homme partiel ».[1] Invention de l’écriture, naissance du politique, apologie et systématisation de l’art de la guerre, règne de l’utilitarisme, chef ou pharaon déifiés, développement du « panem et circenses » et des nombreux anesthésiques dont l’alcool ou la prostitution :
« Au fond, les bienfaits de la civilisation ont été pour une large part acquis et préservés – et là est la contradiction suprême – par l’usage de la contrainte et l’embrigadement méthodique, soutenus par un déchainement de violence. En ce sens, la civilisation n’est qu’un long affront à la dignité humaine ».
Mais la civilisation pousse aussi celui qu’elle met en esclavage au dépassement de soi, elle devient un leurre ou un mal nécessaire à une transformation par lequel l’homme grégaire trouve sécurité et protection et surtout parvient à une émancipation et à une domination collective sans précédent. Nous revisitons rapidement, avec Mumford, les grandes épopées, celle de Gilgamesh, le Mahâbhârata, l’Iliade. Pour à nouveau aboutir à ce cul de sac antique, celui où se trouvait Saint-Augustin lorsqu’il commença La Cité de Dieu.
Avec les religions, les philosophies et les maîtres de la pensée axiale, nous entrons dans un nouveau processus qui tente d’humaniser cet homme civilisé sans cesse menacé d’être reconduit à sa barbarie initiale. Débute alors la première phase des temps modernes, celle qui, contestant les apports purement techniques de la civilisation, fonde, de la Chine à l’Europe en passant par le Proche Orient, ce qu’on pourrait en un mot appeler l’Humanisme du vieux monde. « La civilisation, écrit Mumford, cesse d’être un but pour devenir un moyen ». L’écrivain recense tous les apports des religions axiales (qu’on peut assimiler aux religions monothéistes), la principale étant l’invention de la liberté individuelle qui, jusqu’alors, était le privilège du seul souverain. Il n’oublie pas les inconvénients, le principal étant de n’avoir su éradiquer la guerre et d’avoir échoué à créer un réel universalisme.
Nous arrivons peu à peu à l’homme moderne, soumis à des forces de plus en plus hasardeuses et contraignantes. Nous sommes en 1956 : « Jamais auparavant l’homme n’a été aussi affranchi des contraintes imposées par la nature, mais jamais non plus il n’a été davantage victime des sa propre incapacité à développer dans leurs plénitudes ses traits spécifiquement humain ». Et Mumford étudie la manière dont les mécanismes du pouvoir et de l’ordre, censés libérer l’homme moderne, ont contribué finalement, avec une efficacité redoutable à créer de la désorganisation et de la violence, tant dans la société que dans le cœur des hommes. C’est un homme de soixante et un an qui compose le livre, et qui vient de vivre – et c’est au fond toute l’histoire de sa génération – deux guerres mondiales. Les enjeux de la culture mondiale et les perspectives qu’elle ouvre à ce qu’il appelle l’homme post-historique sont-elles réjouissantes ?
Ce livre, écrit à peu près au moment où je naissais, ne donne, à dire vrai, qu’à moitié envie de naître. Mumford conclut par une réflexion cependant positive, concernant la génération à venir (il se trouve que, c’est la nôtre, au sens large, celle des vivants actuels) : « la génération à venir dispose encore d’une autre possibilité de choix, la plus ancienne pour l’homme : celle de cultiver consciemment les arts qui humanisent l’homme ».
Je n’étais pas loin de penser comme lui à dix-huit ans, lorsque je pris fort naïvement mon sac à dos, en partance pour le monde. J’avais déjà vu les rivières de mon enfance, là où nous péchions goujons et brochets à cœur joie, comme des Neandertal, polluées une à une, j’avais constaté l’inévitable assujettissement de chacun à l’impuissance politique que masque en réalité le grand progrès démocratique auquel avait cru l’homme moderne. Avais-je sincèrement, comme lui, la possibilité de croire « aux arts qui humanisent l’homme » ?
Hmmmm...
Ce billet commence à être bien long.
La suite au prochain numéro.
15:18 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : lewis mumford, littérature, société, politique | 










Commentaires
Écrit par : Zabou | mardi, 23 février 2010
Écrit par : Feuilly | mardi, 23 février 2010
Écrit par : Marie-Hélène | mardi, 23 février 2010
Les rivières sont polluées et taquiner le gougeon devient de plus en plus dangereux. Nous mangeons une nourriture qui est nourrie de nos déchets.
Écrit par : Sylvaine | mercredi, 24 février 2010
@ Feuilly : Pari permanent = inconscience permanente. Et l'individu n'a guère d'autre choix que de se faire une place au sein de cette inconscience.
@ Marie-Hélène : L'homme moderne a-t-il même une vérité ?
@ Sylvaine : Le temps de Pangloss et de Panurge n'est plus que littéraire. A-t-il jamais été autre chose, de toute façon, y compris pour maître Alcofribas ?
Écrit par : solko | mercredi, 24 février 2010
En attendant, vivons heureux en attendant la mort...
Écrit par : nauher | mercredi, 24 février 2010
Écrit par : Pascal | samedi, 27 février 2010
Les commentaires sont fermés.