lundi, 21 novembre 2011
D'un Nikolaï, l'autre : un certain Pétrovitch de Fabrice Lardreau
Le long et beau commentaire de Michèle Pambrun, qui a lu Un certain Pétrovitch, m'incite à republier ce billet sur le roman de Fabrice Lardreau. Les lecteurs de Solko bénéficient ainsi de deux chroniques pour le prix d'une...
Sympathique: de nos jours, cela signifie normal, pire même, banal. Des types sympas, notre monde en est rempli : la Fête des voisins que Fabrice Lardreau met à l’honneur durant deux pages de son roman, Un certain Pétrovich, publié chez Léo Scheer, en témoigne. Ce petit roman s’articule autour d’un syndrome dont nous serions tous plus ou moins victimes : le symptôme de Peter. Ce dernier, qui appliqué aux cols blancs s’est révélé terriblement juste, peut-il aussi s’appliquer aux héros de fiction ? Telle est la question inattendue que pose le romancier et sur laquelle il fonde son intrigue en opposant deux héros de fictions : le premier forgé dans le dix-neuvième siècle et l’Est lointain, Akaki Akakievitch, le personnage principal du Manteau, la nouvelle de Gogol. Le second fabriqué dans l’Ouest des sixties, le héros des comics récemment remanié, Spiderman. Deux héros, deux fabriques de héros et deux époques, l’ancienne Russie tsariste et les Etats Unis de Kennedy.

Nikolaï Gogol

Couverture de Spiderman
A ces deux héros, le personnage principal, le narrateur lui-même, « quadragénaire effacé au physique quelconque » (p 23), chef comptable dans une fédération sportive, s’identifie tour à tour, comme si se jouait en lui une micro-guerre des contenus culturels : la culture Maintream, pour paraphraser Frédéric Martel celle qui plait à tout le monde, et l’autre, officielle et rébarbative, celle qui s’enseigne au lycée.
On découvrira plus tard « une zone atypique dans son cerveau » (p 95). Est-ce cette zone qui pousserait ce quidam effacé, au nom lourd à porter (Patrick Platon Pétrovitch) à commettre une succession habilement graduée d’actions de plus en plus autoritaires, de la reconquête d’une affirmation de soi perdue sur ses collègues de travail et ses voisins indélicats à des actes héroïques devant des loubards de banlieue et des terroristes ? « Qu’il s’agisse de voyous de banlieue, d’agents d’Al Quaïda, cet usager de la ligne B a lutté » lit-on dans l’article de presse qui relate ses exploits. Cette geste postmoderne, racontée sur un ton enjoué, s’effectue à la vitesse d’un téléfilm sans qu’on comprenne tout d’abord où le romancier veut nous emmener. Elle vaut à son personnage un séjour à l’hôpital, un passage au 20 heures, et une réception par le Président de la République. Sans compter une formation à l’Académie new-yorkaise des super-héros, dans laquelle il est accueilli par Stan Lee, vêtu d’un vieux pyjama de l’Hôtel-Dieu parisien.
A travers cette intrigue fantaisiste, Lardreau interroge donc la valeur de la fiction dans laquelle la culture Mainstram nous trempe en permanence, les modèles qu’elle propose, les comportements qu’elle induit, tant ceux liés à l’inhibition que ceux liés à l’exhibition. C’est de ce point de vue une satire sociale réussie, qui met à jour avec ironie les limites de cette culture du stéréotype : en effet, pour les gens ordinaires que nous sommes («mes concitoyens ont plus ou moins le même manteau, la même obsession matérialiste » -p 109- ou encore « nous allons de manteau en manteau, bronzés, câblés et insouciants jusqu’au précipice -p139-) le super-héros peut apparaître, le temps d’une illusion, comme une solution narcissique idéale, parce qu’il conjugue à la fois service à autrui et success-story. Avec habileté, malice, Lardreau invite son lecteur à suivre son personnage dans cette illusion, jusqu’au quart d’heure de notoriété prophétisé ou promis par Andy Warhol, jusqu’à la consécration finale, la réception par l’hôte de l’Elysée, qu’il trouve sympathique. Ce mot, attribué à l’actuel président, sonne pour le moins paradoxal, surtout par les temps qui courent. C’est que ce dernier, que le scrutin a placé au sommet d’une pyramide sociétale en cartoons, se révèle finalement aussi mainstream que n’importe quel quidam : comme les grands manitous du divertissement made in USA prenaient Gogol pour un écrivain soviétique (la pique est assez savoureuse), le président qui ne l’a pas non plus lu, si « impossible, inouï, grotesque » que celui puisse paraître à notre personnage, croit qu’il l’insulte lui-même en prononçant le nom de l’écrivain.
La France que Lardreau met ainsi ludiquement en scène à travers le président comme à travers les passagers du RER, le personnel de la fédération, les voisins, et son personnage principal s’est ainsi, en choisissant des fictions tragiquement manichéennes et pour le moins simplifiées, élevée en la matière à son niveau historique d’incompétence : le super héros hanté par Spiderman se révèle à la toute fin n’être qu’un bel arnaqueur, et notre personnage se retrouve pour de bon sans manteau. Ce petit livre est une satire sociale attrayante et bien ficelée, qui après avoir posé la question des modèles culturels dominants dans lequel nous sommes englués y répond par un joli tête-à-queue : car c’est au final vers le fantôme de Gogol et vers ceux de ses Nouvelles de Saint-Petersbourg que le lecteur a envie de retourner en le fermant, loin des présidents à élire ou à réélire (le narrateur glisse au passage ne pas avoir voté en 2007), et loin des électeurs sympas qui se nourrissent des contenus simplistes de leurs story-tellings, ici mis à mal avec un caustique plaisir.
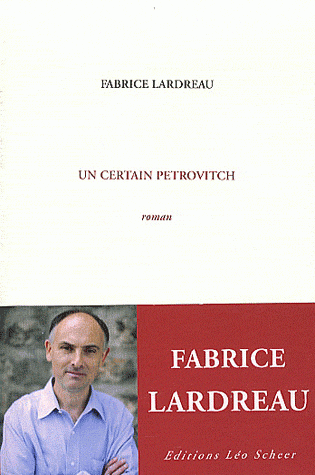
06:23 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : fabrice lardreau, un certain petrovitch, littérature, mainstram, gogol | 










Commentaires
Chapeau bas, Solko, pour cette chronique, sur laquelle je reviendrai...:)
Écrit par : Michèle | vendredi, 28 octobre 2011
(Merci pour cette chronique savoureuse, le livre semble l'être !)
Écrit par : Sophie K. | samedi, 29 octobre 2011
Je relis maintenant (là oui c'est relire, une première lecture étant toujours naïve :) Un certain Pétrovitch, avant d'en dire qques mots...
Écrit par : Michèle | mardi, 01 novembre 2011
Relecture car la 1ère fois qu’on lit, c’est depuis sa place de lecteur et elle va se trouver d'autant plus chahutée, cette place, que le texte est fort.
Et le texte ici est très fort. C’est de main de maître que Fabrice Lardreau tisse sa toile d’araignée.
Il y a du travail pour qui veut regarder comment c’est fait. Et suivre ensuite une piste ou l’autre.
Celle de la cinétique. Ou celle de la machine à rire inventive et loufoque avec son corollaire, la vision noire.
Celle de la « gogolisation » (du narrateur /du texte /de l’auteur) : tous les échos que l’on retrouve du « Manteau » et de Gogol lui-même, jusqu’à cette dissertation que fait notre personnage-narrateur à l’académie des super-héros, où on lui demande de décrire New-York, la ville de l’homme-araignée, et qu’il compare la Grosse-Pomme à Saint-Pétersbourg, comme Gogol avait comparé Pétersbourg à Moscou, dans un article anonyme publié en 1836 dans la revue « Le Contemporain » de Pouchkine.
Ou bien la piste de la Ville, (« l’Outre-Périphérique, avec Belle-Epine (Thiais, Val-de-Marne), premier centre commercial français avec ses 140 900 m2. »p.111).
La piste de la verticalité (pouvoirs, habitat, images).
Ou la piste de l’onomastique (science qui étudie les noms propres), en écho encore avec la nouvelle de Gogol (dans « Le Manteau », devant la kyrielle de prénoms impossibles présentés à l’accouchée, on baptise l’enfant du nom du père , «Acace », « celui qui ne connaît pas le mal » et cela donnera « Akaki l’innocent » ; dans le roman de Lardreau, notre super-héros a du mal à se trouver une filiation autre que banalement hexagonale.
De multiples pistes, et celle qu’il me plaît de suivre ici (brièvement), sera celle du cerveau et de ses deux hémisphères :
A la page 231 du roman, le docteur Marlboro qui a commenté la cartographie cérébrale de notre super-héros, PPP (Patrick Platon Pétrovitch), conclut :
« Pétrovitch est la preuve, la première, que le cerveau humain, comme l’avance notamment Elkhonon Goldberg, n’est pas un ensemble statique, figé, mais une somme de processus dynamiques évoluant sans cesse… »
D’abord, le plaisir de rappeler les récentes découvertes des neurosciences : notre cerveau, comme le vin, se bonifie avec l’âge (quand il n’a pas de pathologie). Sous l’influence de nos pensées et de nos multiples activités, le cerveau se reconfigure en permanence.
En trois endroits du roman, (p. 83, p. 186, p. 231), il est question de côté droit et de côté gauche.
P. 83, c’est pour décrire la configuration d’un studio d’enregistrement où un jeune batteur doit boucler des parties rythmiques : face droite, le jeune homme ; face gauche, la salle de commande. (scène d’anthologie digne d’un « Brazil » de Terry Gillian)
P. 186 et 231, il s’agit des hémisphères du cerveau de notre super-héros, une tache suspecte s’apprêtant à passer de l’hémisphère gauche (qui gère le temps, le langage, le calcul, la pensée analytique, les savoir-faire, les procédures) à l’hémisphère droit (qui gère l’espace, l’intelligence globale, l’intuition, le sens artistique, les informations nouvelles).
D’autre part, notre narrateur fut un fou de batterie.
Il dormait (p.11, quand débute le roman) à la perpendiculaire de « l’épaule gauche » de Spiderman, l’affiche de cinéma collée sur le flanc de son immeuble.
C’est encore l’épaule gauche quand Sonia l’embrasse : « elle fend la foule des collègues, s’approche lentement et, après avoir posé une main sur mon épaule gauche, vient m’embrasser.» (p.100)
Où veux-je en venir ? A ceci, que nous dit Pascal Quignard, dans « Lycophron et Zétès » :
*
Platon a écrit dans Phèdre 244 que la prophétique, la poétique, la mantique, ne sont qu’une seule et même chose. Une voix délirante irrésistible possède l’âme, érotise le corps, fascine le logos. La lettre tau, ajoute Platon, qui distingue mantikè (divination) et manikè (démence) n’est qu’un « ajout moderne ».
Les dieux qui surgissent à tout instant à leur côté, au moindre conflit intérieur, tiennent lieu de conscience aux héros de l’«Iliade ».
*
Ils leur soufflent patience, colère, retrait, ruse, fuite, assaut, désir, jalousie, tristesse.
Sur les vases les plus anciens on voit ces petites figures délinéées se tenir auprès de la tête des héros, sur leur gauche.
Les voix involontaires dans les mythes, viennent de l’hémisphère gauche.
Voix en écho sonore de l’hémisphère droit.
Voix écholaliques, hallucinatoires.
*
Dans les temps non subjectifs, versifiés, chaque humain était l’esclave des voix qui procédaient du logos qui s’était mystérieusement « levé » dans les hommes.
A un moment donné la nature humaine se divisa en deux : une partie qui commandait appelée « Les dieux » (prenant ses assises dans l’hémisphère droit), et une partie qui obéissait appelée « Les hommes » (logée dans l’hémisphère gauche). Aucune de ces parties n’était consciente. Chacune avait sa maison.
*
Les dieux vivaient comme les morts dans les rêves : mangeant, buvant, se vêtant, dormant. Crânes hallucinogènes. Montagnes hallucinogènes.
Sur-crânes ou sur-cavernes céphaliques où le logos habitait royalement.
La nature était l’horloge des comportements végétaux et animaux. Mais les travaux que requérait la domestication de la nature (sa culture) déclenchaient des voix hallucinantes, sidérantes, commandantes, recommandantes, légiférentes. Mars et la taille, avril et la floraison, mai la sortie des chevaux, juin la fenaison, juillet la moisson, août le battage, septembre le foulage, octobre les semailles, novembre la glandée, décembre l’abattage des porcs.
Autant de voix relayées par les hommes, déclenchées par les astres, apprises par les enfants. Rites dans toutes les mains, proverbes dans toutes les bouches. C’est ce double régime, mental et social, ce sont ces deux chambres que Jaynes désigna comme l’existence bicamérale.
*
Il me plaisait d’entendre, avec « Un certain Pétrovitch », ce rappel de nos âges caverneux, dans nos sociétés où chaque humain ne représente plus qu’une « voix » pour élire des parlementaires dans des « parlements » qui ne « parlent » plus. Dans nos sociétés où « chacun n’escompte plus que le bénéfice de ses spéculations et n’hallucine sa réalité que sous la forme de biens meubles et immeubles. »
Écrit par : Michèle | dimanche, 20 novembre 2011
Les commentaires sont fermés.