lundi, 21 novembre 2011
D'un Nikolaï, l'autre : un certain Pétrovitch de Fabrice Lardreau
Le long et beau commentaire de Michèle Pambrun, qui a lu Un certain Pétrovitch, m'incite à republier ce billet sur le roman de Fabrice Lardreau. Les lecteurs de Solko bénéficient ainsi de deux chroniques pour le prix d'une...
Sympathique: de nos jours, cela signifie normal, pire même, banal. Des types sympas, notre monde en est rempli : la Fête des voisins que Fabrice Lardreau met à l’honneur durant deux pages de son roman, Un certain Pétrovich, publié chez Léo Scheer, en témoigne. Ce petit roman s’articule autour d’un syndrome dont nous serions tous plus ou moins victimes : le symptôme de Peter. Ce dernier, qui appliqué aux cols blancs s’est révélé terriblement juste, peut-il aussi s’appliquer aux héros de fiction ? Telle est la question inattendue que pose le romancier et sur laquelle il fonde son intrigue en opposant deux héros de fictions : le premier forgé dans le dix-neuvième siècle et l’Est lointain, Akaki Akakievitch, le personnage principal du Manteau, la nouvelle de Gogol. Le second fabriqué dans l’Ouest des sixties, le héros des comics récemment remanié, Spiderman. Deux héros, deux fabriques de héros et deux époques, l’ancienne Russie tsariste et les Etats Unis de Kennedy.

Nikolaï Gogol

Couverture de Spiderman
A ces deux héros, le personnage principal, le narrateur lui-même, « quadragénaire effacé au physique quelconque » (p 23), chef comptable dans une fédération sportive, s’identifie tour à tour, comme si se jouait en lui une micro-guerre des contenus culturels : la culture Maintream, pour paraphraser Frédéric Martel celle qui plait à tout le monde, et l’autre, officielle et rébarbative, celle qui s’enseigne au lycée.
On découvrira plus tard « une zone atypique dans son cerveau » (p 95). Est-ce cette zone qui pousserait ce quidam effacé, au nom lourd à porter (Patrick Platon Pétrovitch) à commettre une succession habilement graduée d’actions de plus en plus autoritaires, de la reconquête d’une affirmation de soi perdue sur ses collègues de travail et ses voisins indélicats à des actes héroïques devant des loubards de banlieue et des terroristes ? « Qu’il s’agisse de voyous de banlieue, d’agents d’Al Quaïda, cet usager de la ligne B a lutté » lit-on dans l’article de presse qui relate ses exploits. Cette geste postmoderne, racontée sur un ton enjoué, s’effectue à la vitesse d’un téléfilm sans qu’on comprenne tout d’abord où le romancier veut nous emmener. Elle vaut à son personnage un séjour à l’hôpital, un passage au 20 heures, et une réception par le Président de la République. Sans compter une formation à l’Académie new-yorkaise des super-héros, dans laquelle il est accueilli par Stan Lee, vêtu d’un vieux pyjama de l’Hôtel-Dieu parisien.
A travers cette intrigue fantaisiste, Lardreau interroge donc la valeur de la fiction dans laquelle la culture Mainstram nous trempe en permanence, les modèles qu’elle propose, les comportements qu’elle induit, tant ceux liés à l’inhibition que ceux liés à l’exhibition. C’est de ce point de vue une satire sociale réussie, qui met à jour avec ironie les limites de cette culture du stéréotype : en effet, pour les gens ordinaires que nous sommes («mes concitoyens ont plus ou moins le même manteau, la même obsession matérialiste » -p 109- ou encore « nous allons de manteau en manteau, bronzés, câblés et insouciants jusqu’au précipice -p139-) le super-héros peut apparaître, le temps d’une illusion, comme une solution narcissique idéale, parce qu’il conjugue à la fois service à autrui et success-story. Avec habileté, malice, Lardreau invite son lecteur à suivre son personnage dans cette illusion, jusqu’au quart d’heure de notoriété prophétisé ou promis par Andy Warhol, jusqu’à la consécration finale, la réception par l’hôte de l’Elysée, qu’il trouve sympathique. Ce mot, attribué à l’actuel président, sonne pour le moins paradoxal, surtout par les temps qui courent. C’est que ce dernier, que le scrutin a placé au sommet d’une pyramide sociétale en cartoons, se révèle finalement aussi mainstream que n’importe quel quidam : comme les grands manitous du divertissement made in USA prenaient Gogol pour un écrivain soviétique (la pique est assez savoureuse), le président qui ne l’a pas non plus lu, si « impossible, inouï, grotesque » que celui puisse paraître à notre personnage, croit qu’il l’insulte lui-même en prononçant le nom de l’écrivain.
La France que Lardreau met ainsi ludiquement en scène à travers le président comme à travers les passagers du RER, le personnel de la fédération, les voisins, et son personnage principal s’est ainsi, en choisissant des fictions tragiquement manichéennes et pour le moins simplifiées, élevée en la matière à son niveau historique d’incompétence : le super héros hanté par Spiderman se révèle à la toute fin n’être qu’un bel arnaqueur, et notre personnage se retrouve pour de bon sans manteau. Ce petit livre est une satire sociale attrayante et bien ficelée, qui après avoir posé la question des modèles culturels dominants dans lequel nous sommes englués y répond par un joli tête-à-queue : car c’est au final vers le fantôme de Gogol et vers ceux de ses Nouvelles de Saint-Petersbourg que le lecteur a envie de retourner en le fermant, loin des présidents à élire ou à réélire (le narrateur glisse au passage ne pas avoir voté en 2007), et loin des électeurs sympas qui se nourrissent des contenus simplistes de leurs story-tellings, ici mis à mal avec un caustique plaisir.
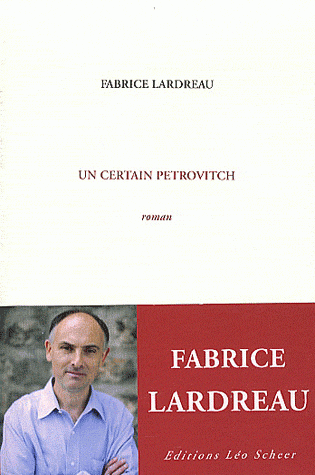
06:23 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : fabrice lardreau, un certain petrovitch, littérature, mainstram, gogol | 









