lundi, 14 février 2011
Comment gagner sa vie honnêtement

Souvent, Jean Rouaud parle à l’imparfait. Souvent, aussi, il utilise le mode infinitif ou le participe présent. C’est ainsi que, par étages, il se réapproprie un vécu retrouvé, afin de le tendre au lecteur, sur une partition oscillant sans cesse entre ce que pourrait être une imitation de Proust et ce que pourrait être une imitation de Chateaubriand. Mais qui, en février 2011, est du pur Rouaud : dans le paysage littéraire désenchanté français, un écrivain qui, à travers son écriture, revendique aussi ses lectures, et donc, une histoire de la littérature en laquelle il prend place ; ce qu’est, à mon sens, un écrivain.
Le sous-titre de son dernier roman, « la vie poétique I », annonce déjà un prolongement. Ce sous-titre pointe aussi une phrase de la troisième partie : « il était entendu que ma vie serait poétique ou ne serait pas ». En ces quelques mots, le narrateur nous dit son mode d’être au monde: quelque peu passif, quelque peu nonchalant à cause de son éducation où il a appris « à raser les murs », et qui se retrouve « recueilli par une communauté de Haute-Loire », puis « embarqué avec eux sur le plateau du Larzac ». Une façon de traverser la France pompidolienne à la François-René, d’enregistrer les traits d’une époque « où le travail n’était pas la valeur dominante » (p 175), où même « la question de gagner sa vie honnêtement ne semblait plus d’actualité » (p 150)
Jean Rouaud a souvent dit qu’il avait appris à parler à travers l’écriture. C’est de la part la plus silencieuse de lui-même qu’il nous entretient dans ce récit de formation ; la part qui passe à travers les espaces et les durées, faite de perceptions développées par le verbe, dont il entretient son lecteur. Ce livre se veut la mémoire de quelques années précises, situées quelque part entre le plein emploi et les temps de crise, celui « d’un brouillage de l’entendement», années qui furent aussi celles de l’adolescence de l’auteur. Ce personnage qui erre, auteur-stoppeur de routes en routes, intermittent de petit boulot en petit boulot, dans sa généalogie d’orphelin de français moyen plus ou moins livré à lui-même, dans sa condition d’étudiant en lettres déclassé « démuni, prétentieux, rural, sans fantaisie, sans force », dans une société française en plein séisme et déjà en décomposition, apparaît souvent comme un hologramme littéraire de tous ceux de sa génération, coincé entre un mai 68 déjà classé et un mai 81 qui tordrait le cou aux espérances, « patrouilles perdues » que l’époque lança « sur les chemins de traverse », puis abandonna à leur sort. « L’échouage de ces années a été une grande tristesse », disait Rouaud au salon du livre à Bron, évoquant ce camarade de faculté dont, dans son récit, il apprit la mort « aux abords de la cinquantaine » (sans qu’il y ait le moindre rapport, je songe à Didier Gabilly et à sa destinée si théâtrale, si marginale).
Si ce livre ressuscite en effet toute cette période enfouie, une époque qui, voyant s’affronter deux blocs, fut sans nuances et pourtant emplie de subtilités disparues, il ne faudrait pas le réduire à un récit générationnel comme la critique autorisée semble déjà encline à le faire. Comment gagner sa vie honnêtement est aussi le récit d’une vocation en germe, et qui se demande, engluée dans l’étroitesse et la veulerie d’une France intellectuelle en train de rompre avec sa tradition littéraire, si elle parviendra un jour à éclore. Ce livre est, d’une certaine façon, la réponse à la question qu’il pose.
Plusieurs fois, Rouaud y évoque en effet la difficile position dans laquelle le place sa vocation naissante, qu’il erre parmi les routards, « candidats déclarés à la route des Inde » ou parmi les derniers ouvriers dont le rêve se bornait à rajouter une balançoire pour enfant au jardin : « je n’avais pas envie d’être pris pour l’un d’eux. Et je veillais à m’en démarquer » (p 106) «Cette tension entre l’idéal communautaire qui était la figure imposée du temps et l’affirmation d’une singularité qui vous classait aussitôt parmi les ennemis du peuple n’était pas non plus évidente à vivre » (p171-172) « Les temps n’étaient vraiment pas faits pour moi. Et je n’étais pas au bout de mes peines »
Comment gagner sa vie honnêtement brille par la poigne de son style. « Tu sais, interroge Rouaud, ce qu’on demande à un auteur, aujourd’hui ? (…) D’écrire vite, précipité, haché, tout en ellipse et en suspension, factuel et concentré »
Parvenu à sa maturité, Jean Rouaud fait tout le contraire. Il reconstruit avec malice le phrasé proustien que lui avaient interdit ses ainés, ces illustres soixante-huitards qui, après avoir proclamé la mort de l’auteur avaient dit non à la littérature, oui à l’idéologie, et plongèrent au final leurs cadets dans une double impasse : existentielle et narrative.
Ce phrasé proustien, cette syntaxe « aux grands chevaux » qu’il applique dorénavant non plus à Charlus, mais à un simple routier, non plus à Swann, mais aux clochards célestes des communautés improbables d’alors, non plus à Françoise, mais à sa propre mère, ce phrasé proustien tient réellement du phénix, dans la France étriquée d’à présent, dont la langue s’est diluée dans tout autre chose que le fait littéraire, dans le commerce et le marketing, le spectacle et les nouvelles technologies, le parler télévisuel et le parler banlieue. On ne sait donc si Rouaud fait partie des derniers prophètes d’une littérature française parvenue au terme de son désenchantement, ou s’il s’inscrit, à sa façon modeste et discrète - toujours un peu voyou, comme il le dit lui-même - dans le redéploiement de ses énergies, comme l’annonciateur d’un temps qui serait enfin nouveau.
20:42 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, jean rouaud, comment gagner sa vie honnêtement, gallimard | 









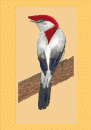
Commentaires
Écrit par : Sophie K. | lundi, 14 février 2011
Ce sont des questions auxquelles j'ai beaucoup réfléchi
A un moment. Et en vain.
Écrit par : solko | lundi, 14 février 2011
Écrit par : Marie-Hélène | lundi, 14 février 2011
Rien ne se désenchante
Si ce n'est les yeux
Déliés par le sortilège
Métamorphosés en pinceaux
Illustrant de leur fresques
Le profil des nuages
Rien ne se désenchante
Disent les épées brillantes
En mal d'adversaire
Pour un duel ensoleillé
Sous les arches flottantes
Des palaces de la révolution
Tout n'est qu'enchantement
Pour qui peuple son scénario
De chimères et de fées
De tueurs aux yeux fous
Et d'un baiser aussi amer
Qu'une larme sucrée
Écrit par : gmc | lundi, 14 février 2011
Écrit par : patrick verroust | lundi, 14 février 2011
Oui, tracer un tel chemin n'est pas si simple.
Jusqu'aux déconstructeurs des temps récents, les écrivains étaient tous soucieux de leur postérité. Ou de la postérité de la littérature.
Le renouveau serait de réintroduire ce souci en littérature. Il y a de ça chez Rouaud
Écrit par : solko | lundi, 14 février 2011
La littérature a toujours été et sera toujours portée par une minorité.
Écrit par : Rosa | mardi, 15 février 2011
Écrit par : Pascal | mardi, 15 février 2011
Écrit par : solko | mardi, 15 février 2011
Je n'ai pas encore acheté « Comment gagner sa vie honnêtement », mais je compte bien le faire, moi qui connais tous les romans de Jean Rouaud presque « par cœur » (sourire).
J'ai été profondément marquée par sa suite romanesque, initiée avec « Les Champs d'honneur » et dont il avait, au 4e roman, « Pour vos cadeaux », changé la donne en rétablissant la vérité des noms. (Contrairement à un autre exemple illustre où Combray reste Combray). Écrivant sur sa mère six mois après la disparition de celle-ci, rester dans « les allégations fausses et de fiction » de ses trois premiers romans n'avait plus eu de sens pour lui. Il avait dû en quelque sorte rendre son identité à sa mère, qui lui permettait en retour d'écrire « en vérité ». Et je me rappelle comment, avec beaucoup d’humour, il racontait que sa mère, à ses clients de la boutique « Pour vos cadeaux », disait, à propos de tel ou tel des romans de son fils : « Il se trompe, ça ne s’est pas passé comme ça ».
Il n'a, depuis, cessé de creuser son travail d'invention littéraire et chacun de ses romans est un nouveau dévoilement de ce "système de rapprochements, de substitutions et d'échanges".
Après la suite romanesque (Les Champs d’honneur, Des hommes illustres, Le Monde à peu près, Pour vos cadeaux, Sur la Scène comme au ciel), j’ai lu (et j’ai sur mes étagères), « Les Très Riches Heures » (théâtre), « Le paléo circus », « Carnac ou le prince des lignes », « La Désincarnation », « Cadou Loire intérieure », « Régional et drôle », « La Belle au lézard dans son cadre doré » (Jeunesse), « Pierre Marie Brisson », « Sage passage à Tanger », « Les Corps infinis », « L’Invention de l’auteur », « L’Imitation du bonheur ».
Je les cite tous parce que chacun est important dans l’ensemble de l’œuvre. Lire Rouaud, c’est cheminer dans l’infinie complexité du processus d’écriture.
(J'avais écrit ce commentaire dimanche soir très tard, mais il n'a pas été enregistré. Je l'ai donc reconstitué).
Écrit par : Michèle | mardi, 15 février 2011
Et que dire "Des hommes illustres", sinon que l'hommage au père, dans l'ambiguïté même que cache désormais, dans une société ouverte sur l'affect individualisé et questionné, la relation à l'ascendance et à la descendance, que cet hommage prend le détour des virées mi-professionnelles mi-rêveuses de ce représentant de commerce ; que le remembrement dont il est question est bien le pendant de la remembrance; c'est l'une des beautés de Rouaud : démembrer, remembrer, "remember" et donc mentir (comme il le faut en littérature : mâcher, digérer, cracher. Loin des petits récits nombrilistes d'une littérature qui croit avoir vécu parce que son origine sociale lui permet d'exister (Que Rouaud ait été, au moins à ses débuts, si peu parisien n'est pas un hasard et que certains le gardent à distance n'est pas étonnant. L'extraordinaire qu'il propose a une telle assise sur le prosaïsme du quotidien, sur l'insignifiance de la vie impensée (rien à voir avec le goût des choses et de l'objet à la Delerm, évidemment) que c'est un exercice de magie que son écriture. Il présente le passé comme un alignement de Carnac, d'une certaine manière, c'est-à-dire que le mot alignement (la netteté de la perspective) n'est jamais qu'un leurre. On voit tout ce qu'il y a entre chaque borne. Rien d grec chez lui, d'architectural. Bref, à lire...
Il y a sur cet auteur un "Lire Rouaud" au PUL avec des contributions fort intéressanteS...
Écrit par : nauher | mardi, 15 février 2011
Donc, cette idée, avec le remembrement, qu'on avait gardé ce geste guerrier mais sans que la guerre ait dit son nom.
Comme le dit Rouaud, quand on s'intéresse à l'histoire du XXe siècle en France, on s'aperçoit que l'idée même de la République, c'est une idée qui a mis du temps à entrer dans la normalité. En 58, c'est un coup d'état quand même, c'est encore une logique militaire.
Donc le XXe siècle est à la fois un siècle d'une modernité extrême, affolante, en même temps qu'on est encore dans une mythologie ancienne, ce que dit "La Route des Flandres" de Claude Simon.
Cette idée d'une empreinte de la guerre, on la retrouve dans le 3e roman de Rouaud "Le Monde à peu près", qui est un livre burlesque sur tout ce qui touche à l'après 68. C'est-à-dire à "ce simulacre de révolution", pour une génération qui n'avait pas eu de guerre (nous sommes une génération de fils sans guerre) et qui donc, "comme il ne se présentait rien, s'est refait une petite guéguerre", avec évidemment un enjeu radicalement différent et des conséquences radicalement différentes.
Écrit par : Michèle | mardi, 15 février 2011
Écrit par : solko | mardi, 15 février 2011
Les commentaires sont fermés.