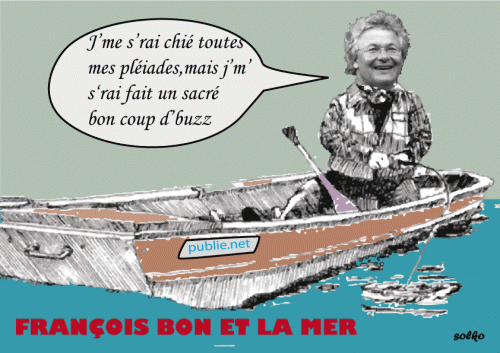samedi, 06 octobre 2012
La théorie de l'information
L’idée de La Théorie de l’information était pourtant alléchante : à travers l’itinéraire d’un de ces golden boys de l’informatique, ces «garçons solitaires qui s’étaient faits peu d’amis pendant leur scolarité et qui avaient finalement révolutionné le monde sans vraiment sortir de leur chambre d’enfants » (p 94) écrire le roman de ces trente dernières années, du désir et de l’ambition qui parcoururent ses principaux dirigeants, qui virent l’échec du Minitel français et l’avènement du Web 2.0. : « Grâce au Web 2.0., l’homme, être égoïste et borné était devenu un animal intrinsèquement social » (p 364).
Aurélien Bellanger, son auteur, a déjà été comparé ici ou là à Houellebecq, voire même à Balzac. Dans les colonnes des Inrocks, lui-même s’avoue scientifique contrarié : « A 8 ans, j’étais abonné à Science et vie junior ; à la bibliothèque, j’empruntais toujours des livres sur les robots, et plus tard, j’ai envisagé un deug de physique. J’ai toujours été pris dans une opposition très forte entre le champ artistique et le champ scientifique. D’un côté, je rêvais d’écrire de longs poèmes en prose remplis de métaphores, et de l’autre, je m’intéressais à des questions mathématiques ou épistémologiques. La Théorie de l’information est né de l’idée qu’avec la forme romanesque, je pouvais enfin concilier la poésie et les sciences dures. »
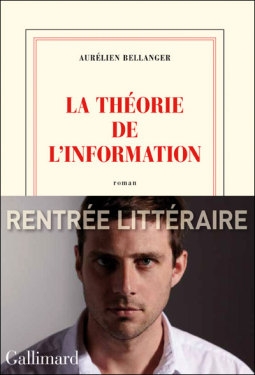
Manque pas d'air, le bonhomme ! Bien de son temps, qui postule comme il le dit lui-même que « dans le monde de l'information, la copie pouvait valoir beaucoup plus cher que l'original» (p. 178) Son écriture besogneuse rappelle plutôt celle du terminal et ennuyeux Zola qui commit le docteur Pascal, théorisant avec fatuité sa théorie de l’information comme l’auteur des Rougon Macquart théorisa celle sur l’hérédité. On s'y ennuie ferme, et l'on finit par se demander si la science et le roman, dès lors que ce dernier se borne à raconter une histoire sur le ton du magazine, sont capables de faire bon ménage.
Pour que cela fonctionne, il y faut une science du roman, au sens balzacien du terme : de la création, du style. En racontant la Comédie Humaine, Balzac (auquel le jeune Aurélien dans un élan de mythomanie furieux se compare) inventait le réalisme et ses principes structurants, dont le fameux retour des personnages. Ou alors il y faut de l'imagination, de l'audace, une fiction véritable, comme dans la science-fiction, précisément
Bellanger, lui, ne créée rien, n’invente rien. Il ne parvient pas même à imiter Houellebecq, auquel certains critiques héberlués l’ont comparé, Houellebecq dont les personnages - si typés soient-ils - existent réellement dans une trajectoire, quand son Pascal (non, pas le docteur, l’informaticien) Ertanger (anagramme loufoque et maladroit ?) n’existe que sous la forme d’un prétexte à une laborieuse dissertation sur le sort de l’humanité livrée aux dures lois de la pornographie facile et de l’entropie.
Au mieux, ce pavé indigeste de 485 pages servi par Gallimard cette rentrée est-il, comme certains critiques l'ont suggéré, un document éclairant sur cette France mitterrandienne puis chiraquienne déclinante, qui se dilua dans un rêve proprement venu d’ailleurs ? Même pas. Car l'échec du Minitel n'est qu'un épiphénomène ici surévalué. Ce n'est que l'échec d'une technique, quand le mal profond demeure depuis ces années là, comme Finkielkraut l'établit alors, et comme ce long roman donné comme une révélation littéraire en témoigne, la défaite de la pensée. Ce qui est bien plus dérangeant.
Le plus captivant, et c’est triste à dire, demeurerait presque les intermèdes de vulgarisation durant lesquels l’auteur rappelle à son lécteur assoupi les grandes dates de la théorie de l’information et de son développement chaotique, des suppositions du botaniste Robert Brown observant des grains de pollens aux nombres oméga de Grégory Chaitin, en passant bien sûr par le trop fameux article de Claude Shannon. Pas besoin d’avoir lu la Peau de Chagrin ni les Particules Elémentaires pour comprendre que cela ne suffit pas à faire le commencement même d'un véritable roman. Car nulle théorie, pas plus celle de l'hérédité que celle de l'information, sans le génie de l'invention et la technique qui créée le style, n'est en soi romanesque. Un siècle après Zola, Bellanger en administre ici la preuve à ses dépens.
15:53 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : minitel, la théorie de l'information, aurélien bellanger, gallimard, inrocks, littérature, france | 
dimanche, 02 septembre 2012
De la normale anormalité et de l'anormale normalité de l'Eloge gallimardeux
Fnac de Lyon Part-Dieu, vers 18h30 : survol rapide des livres en piles, quelques vendeuses plaisantent. Pardon mesdemoiselles, le dernier Millet dont tout le monde parle ?… « En rupture, monsieur, en rupture de stock, l’Eloge littéraire d’Anders Breivik ». Escalator du dessus, Decitre : tu apprends là que l’ouvrage déjà sulfureux est en réimpression.
Comme l’a ahané Antoine Gallimard, « la liberté d’expression personnelle ne gène pas son travail d’éditeur ». Un truisme, ça. Derrière lequel miroite la préservation de la poule aux œufs d’or. Car enfin si un éditeur, aujourd’hui, c’est un type qui sait vendre, alors Antoine en est un excellent. La preuve : allez vous enquérir du fameux Eloge en librairie, vous allez voir.
Tout ça finit par interroger sur l’air du temps de ce pays « normal » dans lequel presque tout le monde parait-il aurait perdu le moral, et dans lequel Millet serait un soudain « anormal » (c’est vrai, ça, faire l’éloge d’Anders Breivik au lendemain de son procès tsss !)…
S’interroger sur tous ces éditeurs normaux qui se donnent le droit d’éditer des auteurs anormaux, tout en désavouant leurs anormales idées entre deux réimpressions. Et sur tous ces gens normaux lecteurs de livres anormaux dont bien sûr l’auteur et le contenu leur paraissent ignobles mais visiblement pas la lecture. Le plus comique demeurant la réaction des bons collègues de la maison : Annie Ernaux ou Tahar Ben Jalloun sont normalement indignés, était-ce autrement possible ?
On notera pour finir la courageuse réaction d’Alexis Jenni, lequel doit à Millet son Goncourt de l’an passé, et qui a déjà tout compris d’une carrière normale en république des Lettres hollandaise : « Les choses sont claires, je comprends ce qu’il dit, mais je ne suis pas de son avis ». Prochain roman normal, garanti...
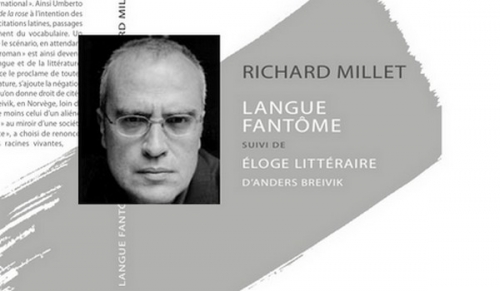
00:02 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : richard millet, éloge littéraire d'anders breivik, gallimard, alexis jenni, littérature | 
mardi, 21 février 2012
François Bon et la mer
06:24 | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : publie.net, françois bon, gallimard, hémingway, éditions | 
jeudi, 03 novembre 2011
Jenni et l'art français du roman
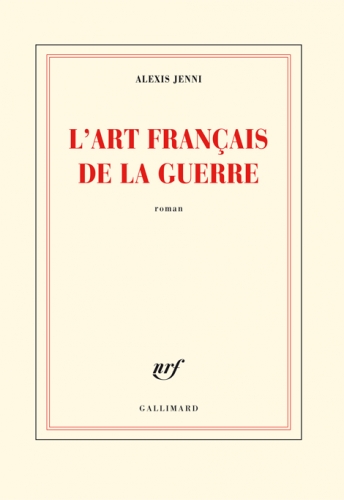
Comme il y eut un art français de la guerre, il y eut un art français du roman. C’était au temps où télévisions, ordinateurs et radios n’occupaient pas toute la place, le temps des grandes fresques héroïques, chroniques historiques et romans à thèses des années trente. C’est vers cet art que le pavé de plus de six cents pages d’Alexis Jenni tente, avec autant de bonheur que de malheur, de revenir.
Bonheur, parce qu’une telle entreprise rompt de façon radicale avec l’autofiction narcissique et les récits convenus du moi je de la culture du narcissisme, tels que les définit Christopher Lasch dans un chapitre désormais fameux sur le déclin du sens historique : «Vivre dans l’instant est la passion dominante –vivre pour soi-même et non pas pour ses ancêtres ou la postérité. Nous sommes en train de perdre le sens de la continuité historique, le sens d’appartenir à une succession de générations qui, nées dans le passé, s’étendent vers le futur » (1)
En recherchant le fil de cette continuité historique éclipsée qui conduisit le pays d’une guerre à l’autre, des monuments de 14 aux tortures d’Algérie, L’Art français de la guerre veut réfléchir, construire « un miroir » (p 583) dans lequel scruter notre façon de vivre ensemble en République. Mais chercher à saisir à travers le prisme d’un seul personnage (Victorien Salagnon) la complexité d’une cinquantaine d’années d’histoire, privilégier à ce point le regard d’un seul, n’est-ce pas prendre le risque d’en faire un donneur de leçons et d'aboutir à une extrême simplification du propos ? Prendre le parti d’une narration somme toute chronologique qui s’étale sur treize chapitres (6 de romans, 7 de commentaires), n’est-ce pas céder plus à la démonstration qu’à la dramatisation ? In fine, cette volonté de revenir à un discours qui serait collectif s’enlise trop souvent dans la répétition et le lieu commun pour réellement captiver son lecteur.
L’Art français de la guerre s’écrit à la croisée de deux personnages, le premier devenant l’héritier, (pour ne pas dire le fils spirituel) du second : deux existences, celle du narrateur à partir de 1991, celle de son héros principal à partir de 1943 s’y récitent, toutes deux façonnées par les morsures successives de l’Histoire :
La crise pour le premier qui, malgré son appartenance à cette « classe moyenne éduquée, volontairement aveugle aux différences » (p 245), occupée à pousser son charriot le samedi à l’hypermarché « dans une foule d’autres couples joliment vêtus »(p 115), ne parvient plus à assurer, au sens traditionnel du terme, une quelconque stabilité psychologique à son existence dans le chaos postmoderne. La crise l’a plongé de dérive en dérive dans « un état social désagrégé » (p 490) : « Quand l’homme perd son travail et n’en retrouve pas, on lui prend sa maison et sa femme le quitte » (p 111) ; aussi devient-il, ce narrateur, une sorte d’épave d’Epinal occupée à hanter les bistrots et tout juste bonne à écrire des romans : « J’exerçais mon parasitisme avec un bonnet sur la tête » (p 31) « quand j’émergeais de mes siestes éthyliques, je lisais des livres, je voyais des films » (p 36) « La dégradation sociale mène à la solitude » (p 491)…
La guerre pour le second qui, de la Résistance aux guerres coloniales, a forgé son destin de paria militaire et de peintre du dimanche : « Les gens sont leur environnement », écrit Jenni p 217. C’est un retour, au sens le plus romantique du terme, au personnage historique : celui dont le physique, la psychologie, la cohérence narrative dépendent entièrement du moment du pays dans lequel il est inscrits, et dans lequel se joue le destin national : l’Occupation Allemande, les guerres d’Indochine puis d’Algérie, la 1ère République de Gauche et « son Leviathan doux, embarrassé par sa taille et son âge » (p 111 et 194), l’hexagone d’aujourd’hui et son communautarisme libéral : « Nous mourons à petits feux de ne plus vouloir vivre ensemble » (p 483).
La deuxième caractéristique de ce que Gaétan Picon appelait « le roman traditionnel » (2), et dont Jenni cherche à réactiver la formule, c’est le déploiement de grands thèmes humanistes.
Le principal, c’est évidemment la guerre. Il surgit habilement du désœuvrement du narrateur, lequel rencontre dans un bar de la banlieue de l’Est lyonnais « un homme au journal qui occupe toute la place, un ancien d’Indochine. Et là-bas, il en a fait, des trucs… » (p 33). A la faveur d’un dimanche au marché aux Artistes des bords de Saône, tous deux se découvrent un point commun : l’un narre, l’autre peint. Un deal s’opère, une sorte d’échange : le plus vieux apprendra à peindre au plus jeune qui remettra en forme le récit de ses exploits guerriers d’un autre siècle (« je suis le narrateur, il faut bien que je narre »-p 51).
C’est ainsi que la matière du roman parvient jusqu’au lecteur comme une pièce oubliée, une chambre obscure (p 46) : ce seront ces guerres qui se succédèrent durant vingt ans, et « chacune épongeant la précédente, les assassins de chacune disparaissant dans la suivante » (p 471) ont fractionné pays ; ce sera la lente décomposition de la tradition militaire de l’armée française, saisie à travers le regard d’un soldat quelque peu excentrique (excentrée) puisqu’également peintre. Ce sera la « pourriture coloniale » qui « nous infecte, nous ronge, revient à la surface » (p 191)
De page en page et malgré le final assez lourdement allégorique du roman (Faites l’amour, pas la guerre), Jenni confirme le fait que la guerre, comme le souligna astucieusement La Bruyère, « a pour elle l’Antiquité ». D’une part parce qu’elle parait conforme à la nature humaine, car si « l’art de la guerre ne change pas » (p 255), c’est que l’obéissance est une vertu naturelle de l’humanité : « En suivant les principes de l’art de la guerre, je peux faire manœuvrer tout le monde comme à la guerre » (p 63). « Tu sais pourquoi la guerre est éternelle ? Parce qu’elle est la forme la plus simple de la réalité. Tout le monde veut la guerre, pour simplifier » (p 322).
Il arrive heureusement que la guerre croise des causes justes, en l’occurrence les grands mythes, eux aussi éternels, de la Résistance ou de la Libération. C’est par ces causes ambigües qu’on entre dans la guerre. C’est alors pour ne plus en sortir : « Vous faites la guerre. Je fais la guerre. Peut-on faire autre chose quand on a appris ça ? (p 427). Cependant, «la guerre change » (p 504) : Il arrive que d’une guerre à l’autre, le héros du Bien (la Résistance contre les Allemands) se métamorphose en un héros du Mal (la torture sur les Algériens) « Pour se battre, on sait faire. Pour ce qui est du pourquoi, j’espère qu’à Paris, ils savent » (p 431). « Ordre et contrordre, marche et contremarche, c’est la routine militaire » (571). C’est alors que la sécheresse de son art apparaît comme un crime.
Demeure malgré tout le risque du mensonge intrinsèque à tout récit de guerre, puisque pour parler d’elle, on ne dispose que de survivants triés par le hasard : «Survivre, c’est prendre la bonne décision, un peu au hasard, et cela demande d’être tendu comme une corde. Sans cette tension, le hasard est moins favorable. » (p 421) Or « les survivants d’une fuite peuvent être décorés comme des vainqueurs » (p 427) : ainsi, la guerre appartient au domaine de l’histoire souvent contrefaite, pas à celui de la vérité. Et le récit de guerre n’est qu’une feinte : « On croit à les entendre que l’on peut s’en sortir, qu’une providence vous protège et qu’on voit la mort du dehors s’abattre sur les autres. On en arrive à croire que mourir est un accident rare » (p 455). « Je suis las de cette immortalité, confie le héros fatigué. Je commence à trouver cette solitude pesante. » (p 456)
De ce premier thème en découle un deuxième qui touche l’actualité : l’identité française dans la France postcoloniale (« Le corps social tremble de mauvaise fièvre » – p 172 ; « La situation en France est tendue » - p 173). Dans « le chaudron urbain qui mijote » (p 606) l’identité des hommes a beau ne pas se dire, mais se croire, se faire, voire se regretter (p 616), en digne héritier de De Gaulle, Janni ne cesse d’affirmer qu’elle se définit par la langue qu’ils parlent : « La langue nous comprend, et c’est elle qui dit ce que nous sommes ». « La seule langue qui vaille est celle que l’on comprend avant de réfléchir » (p 37), voilà pourquoi « La France est l’espace de la pratique du français » (155 « La France est l’usage du français » (197), « la langue de l’Empire des idées », c’est pourquoi « la France est la terre d’accueil de tous les inexistants » (p 228).
S'ensuit une interrogation récurrente sur l’usage et la signification du pronom nous pour définir celui qui est français et celui qui ne l’est pas : « nous est performatif, nous à sa seule prononciation crée un groupe » (p 36) : Mais « personne n’est d’accord sur ce que nous veut dire » (p 277 ) et « l’on peut jouer des pronoms sans jamais rien préciser » (p 194) « Nous se définit par eux ; sans eux nous ne sommes pas. Eux se constituent grâce à nous ; sans nous, ils ne seraient pas » (p 567) Mais jouant de quel groupe, jouant de quelle ressemblance, c’est-à-dire de quelle race ?
D’où également cette insistance à voir en De Gaulle essentiellement un bâtisseur de fiction, un Romancier à l’image du César antique dont le jeune héros traduisait des passages sous l’Occupation (« César par le verbe créait la fiction d’une Gaule qu’il définissait et conquérait d’une même phrase, du même geste. César mentait comme mentent les historiens, décrivant par choix la réalité qui leur semble la meilleure » (p 59. De façon comparable, De Gaulle, « écrivain militaire » (p 556) exista avant tout par la langue et par le verbe : « Qui, sinon De Gaulle, peut dire sans rire qu’il pense à la France ? De Gaulle est le plus grand menteur de tous les temps, mais menteur il l’était comme mentent les romanciers. Il construisit par la force de son verbe, pièce à pièce, tout ce dont nous avions besoin pour habiter le XXè siècle (…) La France est le culte du livre Nous vécûmes entre les pages des Mémoires du Général, dans un décor de papier qu’il écrivit de sa main ». (p 161) « De Gaulle satisfait à lui tout seul notre goût de l’héroïsme » (p 481). « Il avait du souffle, le grand général sans soldats qui manœuvrait les mots, il avait le souffle romanesque » (p 556). Fonder l'ordre national, c'est donc fonder le verbe. Résister, donc c'est maîtriser le discours. L'art français de la guerre rejoindrait-il, ici, l'art français du roman ? Au risque de l'Histoire ? «Nous nous sommes mis hors l’Histoire en suivant les sages préceptes du Romancier. » (p 617)
Le dernier des grands thèmes abordés serait la représentation du Réel, qui ne s’envisage et ne se considère ici que sur le mode du figuratif. Narrer, peindre : « Il y a plein de débuts dans une mémoire (…) Vous pouvez vous faire naître quand vous voulez. On naît à tout âge dans les livres », assure le narrateur (p 51), et le peintre : «Tout peut faire sujet. Les Chinois peignent depuis des siècles les mêmes rochers qui n’existent pas, la même eau qui tombe sans être de l’eau, les quatre mêmes plantes qui ne sont que des signes ; la vie de la peinture est non pas le sujet mais la trace de ce que vit le pinceau ».(p 406). Comme l’écriture est l’art de la formule, le dessin serait donc cet art du trait devant la réalité, un art simplificateur mais susceptible de rendre les événements supportables : « les gestes du pinceau lui suffisaient à réduire la pesanteur, à se libérer de la douleur et à flotter », écrit le narrateur de Salagnon (p432). Pour y exceller vraiment, escompter d'y trouver un véritable soulagement, il y faut beaucoup d’indifférence : C’est pourquoi le peintre idéal serait la neige, qui « sait sans rien savoir suivre le fil à la perfection, elle souligne sans trahir l’élan de sa courbe, elle montre ce fil mieux qu’il ne peut se montrer lui-même. » (p 318). « Je suis jaloux de la neige », risque Salagnon : « Je suis incapable de faire en le voulant ce que la neige réalise par son indifférence ».
La dernière caractéristique de cette forme de roman, c’est sa dimension intellectuelle Dans le contexte des années trente, lesquelles furent précisément des années d’entre-deux-guerres, de grands romans idéologiques inventèrent ainsi une parole militante moderne traversée par de vrais combats politiques ; je pense aux romans de Malraux, d’Aragon ou de Louis Guilloux : « Le roman, note Gaétan Picon, devient le moyen que l’écrivain choisit pour exprimer sa vision des choses, sa vérité intérieure, les mythes qui l’exaltent : l’équivalent de la confession, de l’essai, du traité de morale, du poème » (3) C’est par là que le roman de Jenni révèle avec le plus de cruauté le vide de l’époque. Lui-même l’affirme : « les événements posent une question infinie à laquelle raconter ne répond pas » (p 51). Or quelle idée forte, quel engagement, quelle réflexion politique émergent de la profusion et de l’enchainement des tableaux ? « Rien dans la République ne peut justifier que vivent sur le même sol des citoyens et des sujets » (p 568). La perplexité nous gagne. Est-ce finalement pour aboutir à une si pauvre exégèse qu’un si long texte fut écrit ? Entre la complexité narrative et la simplicité du propos, quand le combat militant se résume à du politiquement correct, et la parole poétique à du lieu commun, un tel fossé se creuse entre la réalité évoquée et le simple vœu pieux prononcé…
Avec son parti-pris d'une narration sagement ordonnée, d'un propos normé, cet ouvrage à la fois intéressant mais si peu innovant révèle bien le mal dont souffre notre époque dans le consensus de la société du spectacle. Parce qu'il n'embrasse au fond qu'une réalité passée, le souffle idéologique ne peut que s'échouer dans le discours didactique des manuels d’histoire, et la fresque lyrique s’affadir dans le documentaire culturel du type d’Arte. Cela vaut bien un Goncourt, me direz-vous.
1 – Christopher Lasch – La Culture du narcissisme, Climats – 2000, p 31
2 et 3 – Gaétan Picon – Panorama de la nouvelle littérature française, Tel, Gall n° 138 –p 53
05:39 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : prix goncourt, alexis jenni, l'art français de la guerre, gallimard, littérature | 
vendredi, 17 juin 2011
Gallimard & les gallimerdeux
Gallimard, rue Sébastien-Bottin ; je ne sais pas vous, mais je trouve quand même que ça sonne mieux que le tautologique Gallimard, rue Gallimard. Et Solko, rue Solko, vous imaginez ?
La modification de deux numéros de la rue Sébastien Bottin (les 5 et 7) en rue Gaston Gallimard, qui agite le landernau éditorial me parait malgré tout d’un intérêt digne d’une sous-préfecture. Des éditeurs numériques indignés (Numerikkivres, Actualitte.com, Publie.net) en ont pourtant profité pour se faire un coup de com’ et ont lancé avec emphase un « appel du 15 juin », croyant sans doute tenir là un débat ou/et un combat de haute résistance, susceptible d’intéresser le chaland franchouilleux.
Non à la Gallimardisation du quartier crient certains. Au 9 de la rue Sébastien Bottin, que précèdent les 5 et 7 de la rue Gaston Gallimard, il paraît que les riverains ne savent plus trop quelle est leur adresse. Cela me rappelle la polémique humoristique de Béraud avec ceux qu’il nomma les Gallimardeux – Gide, Claudel, Suarès, Romain Rolland, à l’époque…
On nage en pleine controverse de type Troisième République.
Pauvre France ! Le 15 au soir, Jonathan Littell, Jean-Marie Rouart, Chantal Thomas, Philippe Djian, Alain Mabanckou, Philippe Sollers, Jean d’Ormesson, Philippe Labro, et toute l’écurie était donc là, d’après notre envoyé spécial, pour trinquer à la garden party en l’honneur de Gaston, après le discours du maire de Paris qui change les noms des rues un peu comme on change de chemises…
Pendant ce temps, la Grèce coule et le Japon devient, c'est le mot, de plus en plus inhabitable…
centrale de Fukushima, nuit du 10 au 11 juin 2011
08:32 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : fukushima, rue sébastien-bottin, gallimard, noms de rueséditions, littérature | 
lundi, 14 février 2011
Comment gagner sa vie honnêtement

Souvent, Jean Rouaud parle à l’imparfait. Souvent, aussi, il utilise le mode infinitif ou le participe présent. C’est ainsi que, par étages, il se réapproprie un vécu retrouvé, afin de le tendre au lecteur, sur une partition oscillant sans cesse entre ce que pourrait être une imitation de Proust et ce que pourrait être une imitation de Chateaubriand. Mais qui, en février 2011, est du pur Rouaud : dans le paysage littéraire désenchanté français, un écrivain qui, à travers son écriture, revendique aussi ses lectures, et donc, une histoire de la littérature en laquelle il prend place ; ce qu’est, à mon sens, un écrivain.
Le sous-titre de son dernier roman, « la vie poétique I », annonce déjà un prolongement. Ce sous-titre pointe aussi une phrase de la troisième partie : « il était entendu que ma vie serait poétique ou ne serait pas ». En ces quelques mots, le narrateur nous dit son mode d’être au monde: quelque peu passif, quelque peu nonchalant à cause de son éducation où il a appris « à raser les murs », et qui se retrouve « recueilli par une communauté de Haute-Loire », puis « embarqué avec eux sur le plateau du Larzac ». Une façon de traverser la France pompidolienne à la François-René, d’enregistrer les traits d’une époque « où le travail n’était pas la valeur dominante » (p 175), où même « la question de gagner sa vie honnêtement ne semblait plus d’actualité » (p 150)
Jean Rouaud a souvent dit qu’il avait appris à parler à travers l’écriture. C’est de la part la plus silencieuse de lui-même qu’il nous entretient dans ce récit de formation ; la part qui passe à travers les espaces et les durées, faite de perceptions développées par le verbe, dont il entretient son lecteur. Ce livre se veut la mémoire de quelques années précises, situées quelque part entre le plein emploi et les temps de crise, celui « d’un brouillage de l’entendement», années qui furent aussi celles de l’adolescence de l’auteur. Ce personnage qui erre, auteur-stoppeur de routes en routes, intermittent de petit boulot en petit boulot, dans sa généalogie d’orphelin de français moyen plus ou moins livré à lui-même, dans sa condition d’étudiant en lettres déclassé « démuni, prétentieux, rural, sans fantaisie, sans force », dans une société française en plein séisme et déjà en décomposition, apparaît souvent comme un hologramme littéraire de tous ceux de sa génération, coincé entre un mai 68 déjà classé et un mai 81 qui tordrait le cou aux espérances, « patrouilles perdues » que l’époque lança « sur les chemins de traverse », puis abandonna à leur sort. « L’échouage de ces années a été une grande tristesse », disait Rouaud au salon du livre à Bron, évoquant ce camarade de faculté dont, dans son récit, il apprit la mort « aux abords de la cinquantaine » (sans qu’il y ait le moindre rapport, je songe à Didier Gabilly et à sa destinée si théâtrale, si marginale).
Si ce livre ressuscite en effet toute cette période enfouie, une époque qui, voyant s’affronter deux blocs, fut sans nuances et pourtant emplie de subtilités disparues, il ne faudrait pas le réduire à un récit générationnel comme la critique autorisée semble déjà encline à le faire. Comment gagner sa vie honnêtement est aussi le récit d’une vocation en germe, et qui se demande, engluée dans l’étroitesse et la veulerie d’une France intellectuelle en train de rompre avec sa tradition littéraire, si elle parviendra un jour à éclore. Ce livre est, d’une certaine façon, la réponse à la question qu’il pose.
Plusieurs fois, Rouaud y évoque en effet la difficile position dans laquelle le place sa vocation naissante, qu’il erre parmi les routards, « candidats déclarés à la route des Inde » ou parmi les derniers ouvriers dont le rêve se bornait à rajouter une balançoire pour enfant au jardin : « je n’avais pas envie d’être pris pour l’un d’eux. Et je veillais à m’en démarquer » (p 106) «Cette tension entre l’idéal communautaire qui était la figure imposée du temps et l’affirmation d’une singularité qui vous classait aussitôt parmi les ennemis du peuple n’était pas non plus évidente à vivre » (p171-172) « Les temps n’étaient vraiment pas faits pour moi. Et je n’étais pas au bout de mes peines »
Comment gagner sa vie honnêtement brille par la poigne de son style. « Tu sais, interroge Rouaud, ce qu’on demande à un auteur, aujourd’hui ? (…) D’écrire vite, précipité, haché, tout en ellipse et en suspension, factuel et concentré »
Parvenu à sa maturité, Jean Rouaud fait tout le contraire. Il reconstruit avec malice le phrasé proustien que lui avaient interdit ses ainés, ces illustres soixante-huitards qui, après avoir proclamé la mort de l’auteur avaient dit non à la littérature, oui à l’idéologie, et plongèrent au final leurs cadets dans une double impasse : existentielle et narrative.
Ce phrasé proustien, cette syntaxe « aux grands chevaux » qu’il applique dorénavant non plus à Charlus, mais à un simple routier, non plus à Swann, mais aux clochards célestes des communautés improbables d’alors, non plus à Françoise, mais à sa propre mère, ce phrasé proustien tient réellement du phénix, dans la France étriquée d’à présent, dont la langue s’est diluée dans tout autre chose que le fait littéraire, dans le commerce et le marketing, le spectacle et les nouvelles technologies, le parler télévisuel et le parler banlieue. On ne sait donc si Rouaud fait partie des derniers prophètes d’une littérature française parvenue au terme de son désenchantement, ou s’il s’inscrit, à sa façon modeste et discrète - toujours un peu voyou, comme il le dit lui-même - dans le redéploiement de ses énergies, comme l’annonciateur d’un temps qui serait enfin nouveau.
20:42 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, jean rouaud, comment gagner sa vie honnêtement, gallimard | 
samedi, 14 novembre 2009
L'indécence Ndiaye
Il y a une véritable indécence à prolonger une polémique sur « la France de Sarkozy, pays monstrueux», alors qu’on vient d’empocher un Goncourt et qu’on mène, de Berlin, une carrière d’écrivain à Paris somme toute assez fructueuse. Une indécence de baronne parvenue, à provoquer ainsi la victimisation. Une indécence d'imbécile.
« Je regrette » dit la dame « que le Ministre de la Culture ne prenne pas position sur le sujet ». (le sujet = ses propos) Mais qu’est-ce que c’est, encore, que cet ego surdimensionné ? La dame, qui a bien l’air d’appartenir à son temps tout de lieux communs tissé, ne me donne guère envie de fréquenter sa prose, à vrai dire. En ai quand même feuilleté quelques pages, tout à l’heure, dans le coin best-sellers d’une grande surface. Rien de bien neuf visiblement. Rien que du très convenu, du très bobo- banlieusard, dont seuls les medias comme les inrockuptibles ou Libé sont encore friands. Rien que du très bête, chez cette dame, à vrai dire. Et j’ai laissé tout ça sur le rayon best-seller d’une grande surface. Comment ne pas voir qu'ici encore, comme toujours, l'indécence et le commerce se rejoignent ?
Hélas, l’indécence est devenue dans ce pauvre pays un argument de vente. Depuis longtemps. Et chez certains, ça fonctionne et ça tourne comme la planche à billets en période de faillite.
Jusqu’où la littérature va-t-elle dégringoler entre les mains de ces gens ?
Jusqu’où l’esprit ?
La pensée ?
16:29 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : édition, marie ndiaye, prix goncourt, littérature, gallimard |