lundi, 05 novembre 2012
Goncourt 2012 : Jérôme et Joël, la part d'Edmond et celle de Jules...
Le gros lot de Drouant va se jouer cette année entre un Jérôme et un Joël ; un polar à la corse et un thriller à l’américaine ; deux cent cinquante pages et sept cents ; Actes Sud et de Fallois ; in fine, entre un nommé Dicker et un nommé Ferrari. (1)
Je ne sais pas si ces deux là sont des écrivains hors pairs. Ils sont en tous cas de bons techniciens. Chacun de leurs bouquins propose un cocktail bien dosé et faussement léger d’une intrigue susceptible de séduire le grand public et d’une mise en récit visant à draguer un lectorat prétendu intello.
Dans les deux cas, le discours qui accompagne pas à pas la progression de l’intrigue fait de celle-ci une sorte de métaphore : les aventures de Mathieu et Libero dans leur village corse, celles de Marcus Goldman et de Harry Québert dans leur ville américaine sont ainsi censées être des paraboles de la chute de la civilisation pour l’un, de la création littéraire en cours pour l’autre. Rien que ça.
Dans les deux cas également, un travail d’écriture qui s’exhibe de manière presque scolaire : En technicien appliqué, Ferrari pastiche le phrasé proustien à l’attention de son public lettré, pour mieux y mêler des répliques au ton fort commun pour un public plus mainstream. J’ai renoncé à compter le nombre de fois que ses personnages prononcent gratuitement le terme enculé. Trop fastidieux. Quant à Dicker, étudiant studieux qui a bien lu son Genette, il bricole sa progression narrative de prolepse en analepse, de mise en abime en variations de points de vue. Du style d’un côté, donc, de la complexité narrative de l’autre. Du labeur, certes.
Pourtant, ni l’un ni l’autre ne convainc. Comme s’il y manquait le plus important, un truc démodé sans doute, le souffle. Une certaine ampleur qui, au-delà du raconté, donne réellement sens au projet, et le place en résonance avec du Réel.
Ainsi, l’encre peine sur le papier chez l’un comme chez l’autre. Trait d’époque ou marketing d’écriture ? La recherche d’un lectorat consensuel et tous publics tient-elle de l’effet de mode ou du coup éditorial ? Ces deux récits sont finalement assez similaires dans leurs ambitions, leurs intentions, leurs exigences. Pas de quoi s’étonner, donc, qu’ils se retrouvent au coude à coude pour le Goncourt. Cela en dit long sur la mission assignée à la littérature aujourd’hui par les medias qui assurent sa promotion, et qui pourrait se résumer à ceci : divertir les classes moyennes par le haut.
Mais une littérature de simple divertissement qui cherche à se faire passer pour autre chose court le risque de paraître bien vaine. Et c’est ce qui arrive.

Félix Nadar portraits d'Edmond et de Jules Goncourt
Je serais membre du jury, je refilerais donc à chacun une moitié de Goncourt. A l'un la part d'Edmond, à l'autre celle de Jules. Un joli boulot de style pour l’un, un job satisfaisant de narration romanesque pour l’autre. Là-dessus, parce qu’il n’y a ni chez l’un ni chez l’autre de quoi s'attarder non plus pendant des heures, j’irais fêter ça avec mes copains journalistes dans le salon du premier étage où se trouvent de bonnes bouteilles, en laissant derrière soi - et à d’autres - les mornes considérations sur la chute de l’Empire comme celles sur les lois de la création littéraire en société libérale.
(1) Joël Dicker : La vérité sur l’affaire Harry Québert - (De Fallois) et Jérôme Ferrari : Le sermon sur la chute de Rome - (Actes Sud)
06:47 | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : prix goncourt, jérôme ferrari, le sermon sur la chute de rome, actes sud, fallois, joël dicker, la vérité sur l'affaire harry québert, littérature, france, société, goncourt2012 | 
jeudi, 03 novembre 2011
Jenni et l'art français du roman
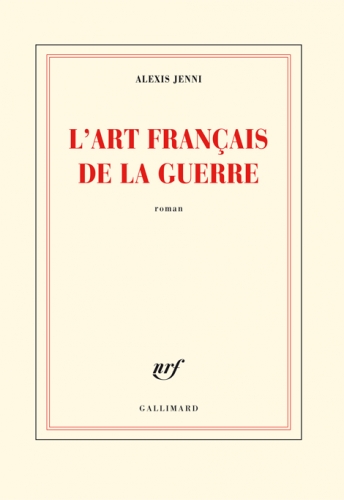
Comme il y eut un art français de la guerre, il y eut un art français du roman. C’était au temps où télévisions, ordinateurs et radios n’occupaient pas toute la place, le temps des grandes fresques héroïques, chroniques historiques et romans à thèses des années trente. C’est vers cet art que le pavé de plus de six cents pages d’Alexis Jenni tente, avec autant de bonheur que de malheur, de revenir.
Bonheur, parce qu’une telle entreprise rompt de façon radicale avec l’autofiction narcissique et les récits convenus du moi je de la culture du narcissisme, tels que les définit Christopher Lasch dans un chapitre désormais fameux sur le déclin du sens historique : «Vivre dans l’instant est la passion dominante –vivre pour soi-même et non pas pour ses ancêtres ou la postérité. Nous sommes en train de perdre le sens de la continuité historique, le sens d’appartenir à une succession de générations qui, nées dans le passé, s’étendent vers le futur » (1)
En recherchant le fil de cette continuité historique éclipsée qui conduisit le pays d’une guerre à l’autre, des monuments de 14 aux tortures d’Algérie, L’Art français de la guerre veut réfléchir, construire « un miroir » (p 583) dans lequel scruter notre façon de vivre ensemble en République. Mais chercher à saisir à travers le prisme d’un seul personnage (Victorien Salagnon) la complexité d’une cinquantaine d’années d’histoire, privilégier à ce point le regard d’un seul, n’est-ce pas prendre le risque d’en faire un donneur de leçons et d'aboutir à une extrême simplification du propos ? Prendre le parti d’une narration somme toute chronologique qui s’étale sur treize chapitres (6 de romans, 7 de commentaires), n’est-ce pas céder plus à la démonstration qu’à la dramatisation ? In fine, cette volonté de revenir à un discours qui serait collectif s’enlise trop souvent dans la répétition et le lieu commun pour réellement captiver son lecteur.
L’Art français de la guerre s’écrit à la croisée de deux personnages, le premier devenant l’héritier, (pour ne pas dire le fils spirituel) du second : deux existences, celle du narrateur à partir de 1991, celle de son héros principal à partir de 1943 s’y récitent, toutes deux façonnées par les morsures successives de l’Histoire :
La crise pour le premier qui, malgré son appartenance à cette « classe moyenne éduquée, volontairement aveugle aux différences » (p 245), occupée à pousser son charriot le samedi à l’hypermarché « dans une foule d’autres couples joliment vêtus »(p 115), ne parvient plus à assurer, au sens traditionnel du terme, une quelconque stabilité psychologique à son existence dans le chaos postmoderne. La crise l’a plongé de dérive en dérive dans « un état social désagrégé » (p 490) : « Quand l’homme perd son travail et n’en retrouve pas, on lui prend sa maison et sa femme le quitte » (p 111) ; aussi devient-il, ce narrateur, une sorte d’épave d’Epinal occupée à hanter les bistrots et tout juste bonne à écrire des romans : « J’exerçais mon parasitisme avec un bonnet sur la tête » (p 31) « quand j’émergeais de mes siestes éthyliques, je lisais des livres, je voyais des films » (p 36) « La dégradation sociale mène à la solitude » (p 491)…
La guerre pour le second qui, de la Résistance aux guerres coloniales, a forgé son destin de paria militaire et de peintre du dimanche : « Les gens sont leur environnement », écrit Jenni p 217. C’est un retour, au sens le plus romantique du terme, au personnage historique : celui dont le physique, la psychologie, la cohérence narrative dépendent entièrement du moment du pays dans lequel il est inscrits, et dans lequel se joue le destin national : l’Occupation Allemande, les guerres d’Indochine puis d’Algérie, la 1ère République de Gauche et « son Leviathan doux, embarrassé par sa taille et son âge » (p 111 et 194), l’hexagone d’aujourd’hui et son communautarisme libéral : « Nous mourons à petits feux de ne plus vouloir vivre ensemble » (p 483).
La deuxième caractéristique de ce que Gaétan Picon appelait « le roman traditionnel » (2), et dont Jenni cherche à réactiver la formule, c’est le déploiement de grands thèmes humanistes.
Le principal, c’est évidemment la guerre. Il surgit habilement du désœuvrement du narrateur, lequel rencontre dans un bar de la banlieue de l’Est lyonnais « un homme au journal qui occupe toute la place, un ancien d’Indochine. Et là-bas, il en a fait, des trucs… » (p 33). A la faveur d’un dimanche au marché aux Artistes des bords de Saône, tous deux se découvrent un point commun : l’un narre, l’autre peint. Un deal s’opère, une sorte d’échange : le plus vieux apprendra à peindre au plus jeune qui remettra en forme le récit de ses exploits guerriers d’un autre siècle (« je suis le narrateur, il faut bien que je narre »-p 51).
C’est ainsi que la matière du roman parvient jusqu’au lecteur comme une pièce oubliée, une chambre obscure (p 46) : ce seront ces guerres qui se succédèrent durant vingt ans, et « chacune épongeant la précédente, les assassins de chacune disparaissant dans la suivante » (p 471) ont fractionné pays ; ce sera la lente décomposition de la tradition militaire de l’armée française, saisie à travers le regard d’un soldat quelque peu excentrique (excentrée) puisqu’également peintre. Ce sera la « pourriture coloniale » qui « nous infecte, nous ronge, revient à la surface » (p 191)
De page en page et malgré le final assez lourdement allégorique du roman (Faites l’amour, pas la guerre), Jenni confirme le fait que la guerre, comme le souligna astucieusement La Bruyère, « a pour elle l’Antiquité ». D’une part parce qu’elle parait conforme à la nature humaine, car si « l’art de la guerre ne change pas » (p 255), c’est que l’obéissance est une vertu naturelle de l’humanité : « En suivant les principes de l’art de la guerre, je peux faire manœuvrer tout le monde comme à la guerre » (p 63). « Tu sais pourquoi la guerre est éternelle ? Parce qu’elle est la forme la plus simple de la réalité. Tout le monde veut la guerre, pour simplifier » (p 322).
Il arrive heureusement que la guerre croise des causes justes, en l’occurrence les grands mythes, eux aussi éternels, de la Résistance ou de la Libération. C’est par ces causes ambigües qu’on entre dans la guerre. C’est alors pour ne plus en sortir : « Vous faites la guerre. Je fais la guerre. Peut-on faire autre chose quand on a appris ça ? (p 427). Cependant, «la guerre change » (p 504) : Il arrive que d’une guerre à l’autre, le héros du Bien (la Résistance contre les Allemands) se métamorphose en un héros du Mal (la torture sur les Algériens) « Pour se battre, on sait faire. Pour ce qui est du pourquoi, j’espère qu’à Paris, ils savent » (p 431). « Ordre et contrordre, marche et contremarche, c’est la routine militaire » (571). C’est alors que la sécheresse de son art apparaît comme un crime.
Demeure malgré tout le risque du mensonge intrinsèque à tout récit de guerre, puisque pour parler d’elle, on ne dispose que de survivants triés par le hasard : «Survivre, c’est prendre la bonne décision, un peu au hasard, et cela demande d’être tendu comme une corde. Sans cette tension, le hasard est moins favorable. » (p 421) Or « les survivants d’une fuite peuvent être décorés comme des vainqueurs » (p 427) : ainsi, la guerre appartient au domaine de l’histoire souvent contrefaite, pas à celui de la vérité. Et le récit de guerre n’est qu’une feinte : « On croit à les entendre que l’on peut s’en sortir, qu’une providence vous protège et qu’on voit la mort du dehors s’abattre sur les autres. On en arrive à croire que mourir est un accident rare » (p 455). « Je suis las de cette immortalité, confie le héros fatigué. Je commence à trouver cette solitude pesante. » (p 456)
De ce premier thème en découle un deuxième qui touche l’actualité : l’identité française dans la France postcoloniale (« Le corps social tremble de mauvaise fièvre » – p 172 ; « La situation en France est tendue » - p 173). Dans « le chaudron urbain qui mijote » (p 606) l’identité des hommes a beau ne pas se dire, mais se croire, se faire, voire se regretter (p 616), en digne héritier de De Gaulle, Janni ne cesse d’affirmer qu’elle se définit par la langue qu’ils parlent : « La langue nous comprend, et c’est elle qui dit ce que nous sommes ». « La seule langue qui vaille est celle que l’on comprend avant de réfléchir » (p 37), voilà pourquoi « La France est l’espace de la pratique du français » (155 « La France est l’usage du français » (197), « la langue de l’Empire des idées », c’est pourquoi « la France est la terre d’accueil de tous les inexistants » (p 228).
S'ensuit une interrogation récurrente sur l’usage et la signification du pronom nous pour définir celui qui est français et celui qui ne l’est pas : « nous est performatif, nous à sa seule prononciation crée un groupe » (p 36) : Mais « personne n’est d’accord sur ce que nous veut dire » (p 277 ) et « l’on peut jouer des pronoms sans jamais rien préciser » (p 194) « Nous se définit par eux ; sans eux nous ne sommes pas. Eux se constituent grâce à nous ; sans nous, ils ne seraient pas » (p 567) Mais jouant de quel groupe, jouant de quelle ressemblance, c’est-à-dire de quelle race ?
D’où également cette insistance à voir en De Gaulle essentiellement un bâtisseur de fiction, un Romancier à l’image du César antique dont le jeune héros traduisait des passages sous l’Occupation (« César par le verbe créait la fiction d’une Gaule qu’il définissait et conquérait d’une même phrase, du même geste. César mentait comme mentent les historiens, décrivant par choix la réalité qui leur semble la meilleure » (p 59. De façon comparable, De Gaulle, « écrivain militaire » (p 556) exista avant tout par la langue et par le verbe : « Qui, sinon De Gaulle, peut dire sans rire qu’il pense à la France ? De Gaulle est le plus grand menteur de tous les temps, mais menteur il l’était comme mentent les romanciers. Il construisit par la force de son verbe, pièce à pièce, tout ce dont nous avions besoin pour habiter le XXè siècle (…) La France est le culte du livre Nous vécûmes entre les pages des Mémoires du Général, dans un décor de papier qu’il écrivit de sa main ». (p 161) « De Gaulle satisfait à lui tout seul notre goût de l’héroïsme » (p 481). « Il avait du souffle, le grand général sans soldats qui manœuvrait les mots, il avait le souffle romanesque » (p 556). Fonder l'ordre national, c'est donc fonder le verbe. Résister, donc c'est maîtriser le discours. L'art français de la guerre rejoindrait-il, ici, l'art français du roman ? Au risque de l'Histoire ? «Nous nous sommes mis hors l’Histoire en suivant les sages préceptes du Romancier. » (p 617)
Le dernier des grands thèmes abordés serait la représentation du Réel, qui ne s’envisage et ne se considère ici que sur le mode du figuratif. Narrer, peindre : « Il y a plein de débuts dans une mémoire (…) Vous pouvez vous faire naître quand vous voulez. On naît à tout âge dans les livres », assure le narrateur (p 51), et le peintre : «Tout peut faire sujet. Les Chinois peignent depuis des siècles les mêmes rochers qui n’existent pas, la même eau qui tombe sans être de l’eau, les quatre mêmes plantes qui ne sont que des signes ; la vie de la peinture est non pas le sujet mais la trace de ce que vit le pinceau ».(p 406). Comme l’écriture est l’art de la formule, le dessin serait donc cet art du trait devant la réalité, un art simplificateur mais susceptible de rendre les événements supportables : « les gestes du pinceau lui suffisaient à réduire la pesanteur, à se libérer de la douleur et à flotter », écrit le narrateur de Salagnon (p432). Pour y exceller vraiment, escompter d'y trouver un véritable soulagement, il y faut beaucoup d’indifférence : C’est pourquoi le peintre idéal serait la neige, qui « sait sans rien savoir suivre le fil à la perfection, elle souligne sans trahir l’élan de sa courbe, elle montre ce fil mieux qu’il ne peut se montrer lui-même. » (p 318). « Je suis jaloux de la neige », risque Salagnon : « Je suis incapable de faire en le voulant ce que la neige réalise par son indifférence ».
La dernière caractéristique de cette forme de roman, c’est sa dimension intellectuelle Dans le contexte des années trente, lesquelles furent précisément des années d’entre-deux-guerres, de grands romans idéologiques inventèrent ainsi une parole militante moderne traversée par de vrais combats politiques ; je pense aux romans de Malraux, d’Aragon ou de Louis Guilloux : « Le roman, note Gaétan Picon, devient le moyen que l’écrivain choisit pour exprimer sa vision des choses, sa vérité intérieure, les mythes qui l’exaltent : l’équivalent de la confession, de l’essai, du traité de morale, du poème » (3) C’est par là que le roman de Jenni révèle avec le plus de cruauté le vide de l’époque. Lui-même l’affirme : « les événements posent une question infinie à laquelle raconter ne répond pas » (p 51). Or quelle idée forte, quel engagement, quelle réflexion politique émergent de la profusion et de l’enchainement des tableaux ? « Rien dans la République ne peut justifier que vivent sur le même sol des citoyens et des sujets » (p 568). La perplexité nous gagne. Est-ce finalement pour aboutir à une si pauvre exégèse qu’un si long texte fut écrit ? Entre la complexité narrative et la simplicité du propos, quand le combat militant se résume à du politiquement correct, et la parole poétique à du lieu commun, un tel fossé se creuse entre la réalité évoquée et le simple vœu pieux prononcé…
Avec son parti-pris d'une narration sagement ordonnée, d'un propos normé, cet ouvrage à la fois intéressant mais si peu innovant révèle bien le mal dont souffre notre époque dans le consensus de la société du spectacle. Parce qu'il n'embrasse au fond qu'une réalité passée, le souffle idéologique ne peut que s'échouer dans le discours didactique des manuels d’histoire, et la fresque lyrique s’affadir dans le documentaire culturel du type d’Arte. Cela vaut bien un Goncourt, me direz-vous.
1 – Christopher Lasch – La Culture du narcissisme, Climats – 2000, p 31
2 et 3 – Gaétan Picon – Panorama de la nouvelle littérature française, Tel, Gall n° 138 –p 53
05:39 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : prix goncourt, alexis jenni, l'art français de la guerre, gallimard, littérature | 
vendredi, 03 décembre 2010
La "gallaire" Houellebecq
Florent Gallaire, le blogueur juriste qui avait mis à la disposition des internautes une version numérique de La Carte et le territoire de Houellebecq l’a finalement retirée, suite aux injonctions de Flammarion, tout en maintenant pourtant la "pertinence" de son analyse juridique sur la première page de son blog. Pour lui, le fait que Houellebecq ait inclus dans son texte plusieurs articles de wikipédia transformait ipso facto le texte entier (428 pages) en œuvre libre, par conséquent téléchargeable à volonté.
Le roman aurait été téléchargé plusieurs milliers de fois.
A y regarder de près, ces quelques milliers d’exemplaires qui se baladent dans la nature virtuelle auront surtout constitué un double instrument de promotion :
-pendant une dizaine de jours, on aura ça et là continué à parler du Goncourt 2010.
-ceux qui l’ont téléchargé l’auraient-ils acheté ?
Il me semble que Florent Gallaire, qui vient d’accéder à une éphémère notoriété grâce à sa confusion (sans doute volontaire) entre « libre de droits » et « licence libre » pourrait être un personnage de cette comédie décomposée, de ce monde où on survit par à-coups médiatiques, et qui constitue le monde romanesque de Houellebecq.
Je ne suis ni houellebecquophile ni houellebecquophobe. Il est cependant clair que Houellebecq avait les moyens de masquer ses quelques emprunts en soignant les raccords narratifs avec le reste du texte. Pourquoi a-t-il pris grand soin, au contraire, de les rendre visibles en créant même un effet de rupture de ton assez saisissant ?
A la première lecture du texte, il m’a semblé évident que Houellebecq se situait davantage dans une volonté de collage et de parodie que dans un souci de plagiat : ces interventions, qui miment assez lourdement (1) les interventions d’auteurs des vieux narrateurs omniscients du temps des Goncourt, n’amènent rien au roman, sinon un effet comique et un certain discours en creux sur la culture en toc d’aujourd’hui, lequel rejoint d’ailleurs le propos global de l’œuvre entière du romancier. Comme Houellebecq lui-même s’invite dans son roman en tant que personnage, il y fait entrer Frédéric Nihous et quelques autres notices de wikipédia. Manière d'évoquer la pauvreté et la tristesse du réel dans lequel évolue Jed Martin et ses comparses.
Florent Gallaire, ainsi qu’Eric Cantonna et ses déclarations aussi fracassantes que vaines sur la révolution du 7 décembre, pourraient tout aussi bien devenir les particules élémentaires d’un prochain roman. On voit bien, in fine, qu'ils ne valent guère mieux que ça. Personnages de leur temps, emblématiques de son dérisoire.
Une question, cependant, demeure pendante :
Ce roman, quel romancier aura à coeur de se donner encore la peine de l’écrire ?
(1) Voir le billet consacré au roman ICI

12:38 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : florent gallaire, michel houellebecq, prix goncourt, littérature, société, wikipédia | 
mardi, 09 novembre 2010
Les cartes postales de Mathias Enard
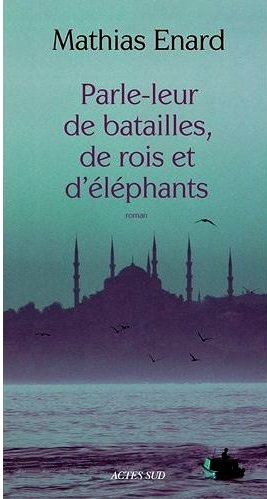 « Le plus beau du monde assurément », affirme Gérard de « l’éblouissant spectacle du port de Constantinople » qu’il découvre à bord d’un paquebot autrichien en provenance de Beyrouth, le 25 juillet 1843. (1) Stamboul, comme Nerval l’appelle, la porte fortifiée de Galata, la Corne d’or, Balik-Bazar, Sainte-Sophie, le sérail, les derviches, le grand champ des morts, autant de lieux, d’images, de termes, de clichés par lequel la littérature du dix-neuvième siècle aura accouché d’un Orient imaginaire, initié par Chateaubriand (2), Lamartine (3), Gautier (4), Loti (5) … La littérature d’abord, puis tout le reste par la suite, les tableaux, les chromos, les photos, les films, les affiches d’agences de voyage ou les posters de compagnies aériennes…
« Le plus beau du monde assurément », affirme Gérard de « l’éblouissant spectacle du port de Constantinople » qu’il découvre à bord d’un paquebot autrichien en provenance de Beyrouth, le 25 juillet 1843. (1) Stamboul, comme Nerval l’appelle, la porte fortifiée de Galata, la Corne d’or, Balik-Bazar, Sainte-Sophie, le sérail, les derviches, le grand champ des morts, autant de lieux, d’images, de termes, de clichés par lequel la littérature du dix-neuvième siècle aura accouché d’un Orient imaginaire, initié par Chateaubriand (2), Lamartine (3), Gautier (4), Loti (5) … La littérature d’abord, puis tout le reste par la suite, les tableaux, les chromos, les photos, les films, les affiches d’agences de voyage ou les posters de compagnies aériennes…
Lorsqu’il entreprend Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants, c’est dans le creuset de cette imagerie de magazines devenue business de tour-operators que s’inscrit Mathias Enard. Le titre, avec cet étrange impératif, une citation de Kipling, se réfère aux traditions du récit d’aventure, du roman de voyage, du conte oriental, la bataille, le roi et l’éléphant en étant les trois tropismes d’Epinal. Peut-être promet-il aussi une narration simple, celle de l’oralité au présent, histoire de rompre avec les expériences faussement joyciennes de la longue phrase devenue récit qui encombrait les pages de l’interminable Zone (6).
Constantinople, donc, comme toile de fond, comme première carte postale.
Une deuxième, tout aussi éculée, celle de Michel-Ange, puisque c'est lui le héros de l'histoire. Il faut écouter l’auteur, dans une interview à Médiapart, affirmer : « Affronter un personnage comme Michel-Ange, c’était un vrai défi, quoi ! », avec le ton incroyablement fat de celui qui croit l’avoir mené à terme. Mais Michel-Ange n’est hélas, dans ce récit, qu’un personnage tristement contemporain, à peine plus incarné qu’un Michel-Ange de documentaire ou qu'une figurine en platre de boutique de musée, une convention institutionnelle qui ne trouve à aucun moment ni chair, ni souffle, ni parole. Comme Constantinople, un alibi culturel.
Il est heureux dès lors que le pont que ce personnage fade tente de construire sur la corne d’or s’effondre en épilogue sous les coups du tremblement de terre du 14 septembre 1509, et que ses gravats soient « charriés vers le Bosphore par les eaux que le séisme a rendues furieuses », et que l’on n'en parle plus.
Pour demeurer jusqu’au bout dans le poncif, le convenu, il faut voir comment Mathias Enard use et abuse de la symbolique du pont, troisième carte postale : le pont qui serait enfin jeté entre l’Orient tentateur et l’Occident déconfit, entre les hommes et les femmes, les hommes et les hommes, les mécènes et les artistes, les puissants et les démunis… Relisons à ce sujet ce paragraphe inspiré : «Vous ajouterez de la beauté au monde, dit Mesihi. Il n’y a rien de plus majestueux qu’un pont. Jamais aucun poème n’aura cette force, ni aucune histoire. Quand on parlera de Constantinople, on mentionnera Sainte-Sophie, la mosquée de Bayazid et votre ouvrage, maestro. Rien d’autre. » Et puis, cette idée lourde sur lequel Michel-Ange revient lourdement, que le pont à construire est un pont politique, le ciment d'une cité, un morceau d'urbanité qui doit être pétri de la matière de la ville. Bref, un pont inoffensif, qui ait toutes les caractéristiques du littérairement correct.
Voilà qui nous amène à la quatrième carte postale, l’homosexualité et le goût pour les paradis artificels, définis comme signes distinctifs de l’artiste de génie, de l'homme multiculturel : les journées, les arts et les désirs de Michel-Ange et les journées, les arts et les désirs du poète turc Mesihi de Pristina ne cessent en effet, de chapitre en chapitre, d’inlassablement s’entrecroiser, jusqu’au meurtre aussi ridicule que grandguignolesque de la malheureuse qu’un tiers a glissée entre eux.
Faute de talent, ce qu’on peut reconnaître à Mathias Enard, c’est du métier : on partira de l’idée que tout livre obéit à sa nécessité. Or ce livre ne nous raconte pas –quelque prétention qu’il en ait – Constantinople au temps des sultans. Ni Constantinople tout court. C’était amplement déjà fait, et bougrement mieux. Il ne nous apprend rien sur Michel-Ange, mais là encore, comme le disait l’auteur, n’est-ce-pas … Il ne nous apprend même rien sur la construction d’un pont. Rien, enfin, sur l’amour, le désir, la violence des passions ou les relations conflictuelles entre l’homme de génie et les puissants de ce monde (Cela aurait pu, puisque Michel-Ange se trouve coincé entre le pape Jules II et le sultan Bajazet). A titre d’exemple, cette phrase inouïe de platitude, et plusieurs fois répétée dans le récit : « Sous tous les cieux, il faut donc s’humilier devant les puissants »… Quelle révélation faite au grand homme, et fallait-il faire tant de kilomètres pour comprendre cela !
A première vue, ce livre n'obéit donc à aucune nécessité. On dirait même que l’auteur s’est donné pour mission d’être plat, terne, le plus terne possible. Mais alors dans quel but ?
Nous en venons à ce qu’est non pas un livre, mais un objet culturel à bandeau rouge ou violet sur la table d'un libraire de nos jours : et pour cela, empruntons quelques phrases piochées ça et là, qui donnent le ton de l’ouvrage :
« Cette année là, Michel-Ange a quitté Rome sur un coup de tête, le samedi 17 avril, la veille de la pose de la première pierre de la nouvelle basilique San Pietro. »
« Il était allé pour la cinquième fois consécutive prier le pape de bien vouloir honorer sa promesse d’argent frais. On l’a jeté dehors »
« Amusé par son intérêt, Michel Ange crâne ».
J’ai à dessein placé en italiques trois expressions dont la fonction est d’introduire le lecteur contemporain et son vocabulaire de tous les jours dans le crâne et le cœur, ni plus ni moins, d'un homme du seizième siècle, et pas n'importe lequel, Michel-Ange. Attardons-nous sur le dernier exemples : Crâner est donné pour familier par Le petit Robert qui date son apparition dans le lexique français de 1845, et le cite chez Zola : « Vous avez une boutique, vous rêvez de crâner devant le quartier ». Car bien sûr, Michel-Ange, comme l’héroïne du Ventre de Paris, ne peut que crâner. Or s’il crâne, soyons sérieux, est-ce vraiment un effet de styyle original ? signifiant ? provocateur ? Non, s'il crâne, c'est qu'il est, finalement, très classe moyenne 2010, en réalité. S'il crâne, ce Michel-Ange énardien (comme certains commencent à le dire ici ou là), c'est qu'il n'est dans ce récit, venons-en au fait, comme Constantinople, Mesihi, le pape Jules II, le sultan Bajazet, l'éléphant, le singe et la basilique San Pietro, qu’un simple alibi culturel.
A l'image de cette phrase, digne d’un élève de troisième qui ferait quelques efforts pour séduire son (sa) professeur(e) : « Des lambeaux de cauchemar lui scellent les paupières », la plupart des phrases sont simples : sujet / verbe/complément ; tout est écrit au présent de narration. Un chapitre (deux à quatre pages) se lit ainsi à la vitesse où un métro passe d’une station à l’autre. Ce qui fait de cet objet de consommation culturel un produit d’évasion commode pour aller et revenir du boulot par exemple. « Un style épuré », lit-on ça et là. Et de fait, en mélangeant ainsi le lexique de tous les jours à quelques termes pittoresques ou soutenus, Mathias Enard nous offre la possibilité de devenir en allant au boulot les contemporains des turcs ou des florentins du début du XVIème siècle, ce qui n’est certes pas rien et mérite, trouveront certains, qu’on lui tende la pièce : Guide, en quelque sorte, d’un tourisme littéraire qu’on voudrait faire passer pour une expérience de lecture, et surtout, de culture. Flatter le snobisme littéraire contemporain, voilà donc au final la clé de l’entreprise, à laquelle Acte-Sud et sa couverture ténébreuse, sa présentation de l’auteur sur le mode de l'argument d'autorité (6) se rend complice. Une affaire réussie puisque les lycéens - à cela rien de très étonnant - viennent de lui donner leur Goncourt : vu la taille (153 pages), le prix (13 euros), la lisibilité du livre et l'académisme presque scolaire du sujet, ça nous fera un joli succès de librairie pour les fêtes de Noël…
(1) Nerval, Voyage en Orient, 1851
(2) Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, 1811
(3) Lamartine, Clair de Lune, 1835
(4) Gautier, Constantinople, 1853
(5) Loti, Les capitales du monde, 1892
(6) Actes-Sud vient de ré-éditer en poche le laborieux prix France-Inter de l'an passé
(7) « Mathias Enard a étudié le persan et l’arabe et fait de longs séjour au Moyen-Orient », assène le quatrième de couverture.

ZIEM Félix : LEVER DE SOLEIL A CONSTANTINOPLE , 2e quart XIX siècle (Rennes ; musée des beaux-arts)
23:52 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature, mathias enard, prix goncourt | 
lundi, 08 novembre 2010
La carte, le territoire, la capitale et le prix Goncourt
 La carte et le territoire s'étend sur une chronologie de plus d’un siècle, des origines d’un grand-père, qui se perdent dans la France rurale du dix-neuvième siècle, « une sorte de flaque sociologique peu ragoutante », (p 39), à la mort de son petit fils, dans une France qui, depuis 2020, a traversé de nombreuses crises financières et sociales, et est devenue « un pays surtout agricole et touristique, n’ayant guère à vendre que des hôtels de charmes, des parfums et des rillettes, ce qu’on appelle un art de vivre. »
La carte et le territoire s'étend sur une chronologie de plus d’un siècle, des origines d’un grand-père, qui se perdent dans la France rurale du dix-neuvième siècle, « une sorte de flaque sociologique peu ragoutante », (p 39), à la mort de son petit fils, dans une France qui, depuis 2020, a traversé de nombreuses crises financières et sociales, et est devenue « un pays surtout agricole et touristique, n’ayant guère à vendre que des hôtels de charmes, des parfums et des rillettes, ce qu’on appelle un art de vivre. »
Mais, annonce le texte, ce grand père, artisan photographe, « avait été le premier d’une longue lignée à sortir de la pure et simple reproduction sociale du même » (p 40). Le petit-fils revenant mourir dans la maison familiale de Chatelus-le-Marcheix dans la Creuse, on peut penser que la boucle est bouclée, même si entre temps, dans ce village à la Marianne maçonnique (faire comme l’auteur, fréquenter wikipédia) les « habitants traditionnels de zone rurale » (p 414) ont été remplacés par des Russes et des Chinois aisés venus goûter le charme de la French Touch et de ses cultures provinciales.
Avec ce nouveau roman, Houellebecq poursuit donc une espèce d'ambition dépitée, déjà exprimée ailleurs : à l’image de celle de son héros de peintre dont on suit pas à pas le développement de la carrière, « donner une vision exhaustive du secteur productif de la société de son temps » (p 123), « des processus industriels » (p 143) et de leurs irrémédiables déclins puisque dans ses dernières œuvres, «le triomphe de la végétation est total»
Jed Martin est donc le prétexte et le prisme à travers lequel le périple dans le siècle s’opère : on apprend au détour d’une page (235) qu’il avait treize ans en 1981: il serait donc né en 1968, d’un père entrepreneur -ce qui le délivra des contingences matérielles - et d’une mère, dont il fut tôt orphelin, et dont il lui aurait paru invraisemblable « qu’elle ait pu être adolescente dans les années 1960, qu’elle ait pu posséder un transistor ou aller à des concerts de rocks » (p 47).
Doublement distancié par rapport à son époque, Jed Martin incarne ainsi un pur produit de l'idéal frelaté des deux dernières décennies du XXème siècle : il est également l’œil vivant devant lequel se contorsionnent acteurs et victimes (son père est un bel exemple des deux) du monde post-moderne, de ses postures aussi facétieuses que fausses, aussi irresponsables que sécurisantes, de son impuissance chronique à produire du vrai. Il assiste ainsi à la dissolution économique, morale et culturelle de son pays, dont le titre rappelle en creux l’existence réelle (territoire) et symbolique (carte).
Le tout se déplie à la manière de « ces romans réalistes du dix-neuvième siècle français » (p 77) dont Houellebecq caricature jusqu’à l’extrême les procédés :
- Les interventions incessantes d’un narrateur post-moderne à présent si omniscient qu'il emprunte ses commentaires aux notices de wikipédia pour les intégrer à son texte (celle sur Frédéric Nihous, p 236 reste un modèle du genre), singeant, sur le mode du dégradé, le Balzac phraseur qui, sur toutes choses donnait un point de vue.
- Des périphrases ostentatoires dans le but d'éviter les répétions : celles que Houellebecq auteur, par exemple, applique à Houellebecq personnage, et qui lui permettent de décliner la liste de ses romans antérieurs à coup de « l’auteur des Particules élémentaires était vêtu d’un pyjama », « l’auteur du Sens du combat se recula d’un mètre », « une seule bouteille demanda l’auteur de La Poursuite du Bonheur » (p 164 et 165) …ne manquent ni de sel ni d’ironie.
- Le mélange de personnages réels et fictifs ainsi que le « name-dropping », qui tant crispa l'inénarrable Ben Jalloun, procédé pourtant vieux comme le réalisme, dont Félicien Marceau dans son Balzac et son monde disait il y a quarante ans : « Nous nous sommes habitués au procédé. Proust l’a employé et Jules Romains et Aragon et bien d’autres ; Balzac, pour sa part, en a usé avec beaucoup d’audace (il va jusqu’à faire d’une de ses héroïnes la veuve de Danton) et aussi, de temps en temps, j’imagine, avec une pointe d’amusement (lorsqu’il cite son tailleur Buisson) ».
- La présence insistante de l’argent, du prix et de la valeur des choses : coût de la réparation au noir d'un chauffe-eau, d'un breakfast dans le limousin, prix des maisons, des appartements, des terrains, frais de la contribution par Houellebecq lui-même au catalogue de l'exposition (dix mille euros + un portrait de lui...), cote des tableaux et spécifiquement des toiles du héros (six millions d'euros pour un Houellebecq écrivain), dans le contexte d'un marché de l'art dominé par les plus grandes fortunes de la planète : « sept cent cinquante mille d'euros … se dit-il. Ça n’avait aucun sens. Picasso non plus, ça n’avait aucun sens » (p 232) ; « on en est à un point où le succès en termes de marché justifie et valide n’importe quoi, remplace toutes les théories, personne n’est capable de voir plus loin, absolument personne. » (p 206)
07:30 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : littérature, prix goncourt, houellebecq, la carte et le territoire, actualité | 
samedi, 14 novembre 2009
L'indécence Ndiaye
Il y a une véritable indécence à prolonger une polémique sur « la France de Sarkozy, pays monstrueux», alors qu’on vient d’empocher un Goncourt et qu’on mène, de Berlin, une carrière d’écrivain à Paris somme toute assez fructueuse. Une indécence de baronne parvenue, à provoquer ainsi la victimisation. Une indécence d'imbécile.
« Je regrette » dit la dame « que le Ministre de la Culture ne prenne pas position sur le sujet ». (le sujet = ses propos) Mais qu’est-ce que c’est, encore, que cet ego surdimensionné ? La dame, qui a bien l’air d’appartenir à son temps tout de lieux communs tissé, ne me donne guère envie de fréquenter sa prose, à vrai dire. En ai quand même feuilleté quelques pages, tout à l’heure, dans le coin best-sellers d’une grande surface. Rien de bien neuf visiblement. Rien que du très convenu, du très bobo- banlieusard, dont seuls les medias comme les inrockuptibles ou Libé sont encore friands. Rien que du très bête, chez cette dame, à vrai dire. Et j’ai laissé tout ça sur le rayon best-seller d’une grande surface. Comment ne pas voir qu'ici encore, comme toujours, l'indécence et le commerce se rejoignent ?
Hélas, l’indécence est devenue dans ce pauvre pays un argument de vente. Depuis longtemps. Et chez certains, ça fonctionne et ça tourne comme la planche à billets en période de faillite.
Jusqu’où la littérature va-t-elle dégringoler entre les mains de ces gens ?
Jusqu’où l’esprit ?
La pensée ?
16:29 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : édition, marie ndiaye, prix goncourt, littérature, gallimard | 
mardi, 03 novembre 2009
Mes Goncourt...
Je me suis amusé à dresser la liste des lauréats du Goncourt que j’avais lus, et je m’aperçois que sur la liste entière (que j’ai empruntée à Wikipédia), je n’en ai lu que douze (ou treize car 1922 et 1951 posent problèmes). Les voici ;
Le Feu (1916), A l’ombre des Jeunes filles en fleurs (1919), Le Vitriol de Lune et le Martyre de l’obèse (1922), Raboliot (1925), La Condition humaine (1933), L’Araigne (1938), Le premier accroc coûte 200 francs (1944),Le rivage des Syrtes (faut-il le compter ? – 1951), Le roi des Aulnes (1970), Rue des boutiques Obscures (1970), Les égarés (1983), Les Champs d’Honneur (1990), Je m’en vais (1999).
Oui je sais, Romain Gary et Duras on me le dit souvent, mais que voulez-vous ? Quand ça tombe des mains, ça tombe des mains….
Dans toute cette liste, le fait qu’ils aient été couronnés n’a été déterminant que deux fois (1983, 1999). J’achèterai donc celui de cette année dans dix ans (si on en parle encore)
PS. Pour tenir ce calendrier, peut-être devrais-je mettre mon nez dans Ingrid Caven : si quelqu’un qui l’a lu passe par là ...
13:12 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (23) | Tags : prix goncourt, lecture, littérature | 
jeudi, 29 octobre 2009
Un Goncourt pour Renard
Un prix Goncourt attribué le Jour des morts. Drôle d'idée honnêtement ! Signe que l'époque ne croit plus trop aux présages, bons ou mauvais. Car c'est bien le prochain 2 novembre, à 12h 45 pétantes, «afin de faciliter la couverture médiatique de l’événement, en permettant notamment au lauréat d’être présent chez Drouant avant le début des journaux radio et télévision de 13h. », qu'on apprendra le nom de l'heureux(se) élu(e). Un certain talent pour la communication et le marketting, les vioques de l' Académie, dites-moi !
Extrait (pour se mettre en forme), du Journal de Jules Renard, en date du 23 novembre 1909. Il est alors académicien depuis 2 ans, et mourra le mois de mai suivant :
« 23 novembre – Dîner Goncourt. Ils sont à table, Mirbeau près de Daudet, réconciliés, Descaves voudrait donner le prix à Léon Bloy. Hennique s’oppose à ce couronnement de l’insulteur; à Léautaud : Bourges déclare son livre infect.
On parle de la pourriture du monde. C’est peut-être la seule qualité de l’Académie Goncourt, d’être honnête.
Daudet raconte que, dans un salon, une dame avait un cordon qui passait sous sa jupe. On a tiré : c’était un ténia. Cette histoire affole Bourges.
Mirbeau dit :
- Les ouvriers, mon cher ? Je m’en suis servi cet été Ils sont stupides.
Daudet est tout fier de les mater en réunion publique.
- Renard me dit Rosny ainé, on vous imite beaucoup pour le Prix.
C’est la famille des renardeaux.
Crise. Souffle précipité, dégoût universel. La mort peut venir dans une heure dans dix ans. Dire que j’aime mieux dix ans !
Encore une fois j’ai perdu l’équilibre. Je touche le fond. Tout à coup, guérison si je travaillais.
La mort proche, on sent le poisson »

19:56 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jules renard, prix goncourt, littérature | 









