dimanche, 03 janvier 2010
Mes étrennes (2)
Dans cette page extraite de Chemins de Solitude (1946) l’écrivain Gabriel Chevallier évoque le temps de sa prime enfance et les vieilles personnes qu’il connut alors, gens de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle nés aux alentours de 1830 : occasion d'une rêverie sur le sort des humains.
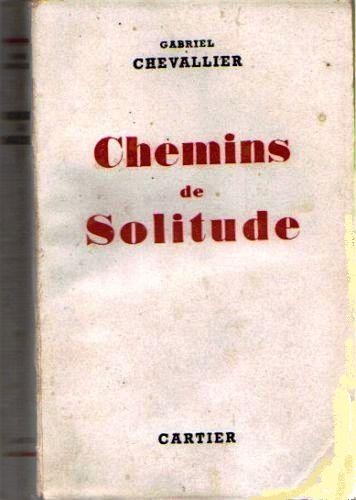
15:35 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : 2010, gabriel chevallier, littérature, lyon | 
mercredi, 02 décembre 2009
LEON BLOY
15:05 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon bloy, littérature | 
dimanche, 29 novembre 2009
Le journal de Tanis
Le hasard de la navigation m’a fait découvrir Le Journal de TANIS. Il s’agit de larges extraits du journal intime de Stanislas Guillot (1872-1939), dit TANIS, de 1921 à 1936, mis en ligne par Isabelle GAUTHERON, d’août 2007 à décembre 2008. Dans ce journal commencé « un soir que j’avais le cafard et que j’étais quelque peu souffrant, inquiet pour l’avenir» s égrène le quotidien d’un homme simple et touchant. Voici comment Isabelle Gautheron parle de lui :
« En 1914 , il est mobilisé et part depuis la gare de la petite ceinture avenue Clichy pour la gare de l’est. Il en reviendra meurtri près de cinq ans plus tard et reprendra son emploi au Carbone.
Célibataire malgré lui, il tint de 1921 à sa mort en 1939 un journal dont certains passages sont retranscrits ici.
Solitaire et mélancolique, il y évoque les moments heureux de l’enfance sur les fortifs’, son amour entier et contrarié pour Jeanne, la rupture profonde de la guerre, son aversion pour les doctrines politiques du moment. Ce journal constitue un témoignage sur la vie quotidienne à Clichy et Paris entre les deux guerres. »
« … Encore un cahier que je termine. Demain, il faudra en acheter un autre. Ce que j’ai commencé ne peut s’arrêter qu’avec moi. », écrit Tamis, le 1er mai 1926. Dans ses « mémoires », Tanis a écrit un jour qu’il espérait qu’ un écrivain pourrait y trouver un jour le canevas d’un roman. Qui sait ?

Quelques extraits :
15:22 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : stanislas guillot, littérature, tamis | 
samedi, 28 novembre 2009
Désespérément éclairant
Certains jours, on (je) a (ai) envie de ne rien faire (flemme). De laisser plutôt faire les autres. (Merci, les autres !)Surtout lorsqu’ils font bien (très, très bien). Tel est ce samedi (aujourd'hui), au midi duquel (un peu plus d'une heure en réalité) je vous propose de suivre ce lien avec Jacques Ellul (1912-1994), le penseur désespérément éclairant de la résistance à la société technicienne (le progrès et ses sortilèges). Le remarquable billet de Frasby sur son blog certains jours (toujours en retard d'un ou deux) lui rend un bel hommage, agrémenté de plusieurs liens, dont l’un sur lequel je vous conseille de vous arrêter : ce long entretien avec Jacques Ellul présentant, sur Daily Motions, plusieurs extraits d'un film, le jardin et la ville. dont je relève quelques formules assez savoureuses : "le monde technique sera celui de l'insignifiance et de la puissance : quand vous arrivez à une puissance extrème, ce que vous faites n'a plus de sens"; "ce n'est pas un état durable, l'état de hippie". "Les conduites suicidaires de leurs fils ne remettent pas en cause les conduites imperturbables des techniciens"; "Le technicien exerce une technique qui le satisfait" (grandiose, ça... Peut-on parler d'orgasme techniciste ?)
Et puis enfin : « Faire une révolution contre une société qui est déjà dépassée, cela ne signifie rien... »
C’est bien là le fond du problème…
Désespérant, éclairant...

13:13 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jacques ellul, littérature, certainsjours, frasby | 
dimanche, 22 novembre 2009
Les talents fourvoyés de la collaboration
Décidément, il y a de multiples raisons de mettre son nez dans ce numéro 20 du Magazine des livres. Et si l’on se promène de blog en blog, on en retrouve un certain nombre :
- Un article nourri de Feuilly sur la traduction par Marie Darrieussecq des recueils Tristes et Pontiques d’Ovide.
- Une analyse très circonstanciée du roman de Stéphane Beau Le Coffret, signée par Marc Villemain.
- Un papier d’Eric Poindron sur les auteurs oubliés
- Un entretien de Bartleby avec Brian Evenson
- Un papier de Jean Jacques Nuel sur la revue Les moments littéraires.
Bref, que du beau monde.
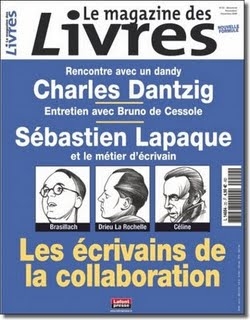
Et puis fait rare ô combien ! page 14, quelques lignes sur Henri Béraud dans le dossier de Frédéric Saenen sur « Les talents fourvoyés de la collaboration littéraire » qui bien sûr, ne pouvaient me laisser tout à fait indifférent.
Car ce qu'on y lit est à la fois juste et très insuffisant.
Juste, car on y reconnait de façon claire le fait que le procès de Béraud ne fut qu’un règlement de comptes ; que Béraud était en effet « plus anglophobe qu’antisémite » que l’instruction faite à la hâte « fut mal montée de bout en bout » que « les auditions confinent au surréalisme » et que le tout ne fut qu’une « pantalonnade inique et grotesque »
Juste enfin car si on entend par «pamphlétaire pur jus» pamphlétaire de génie, l'appelation est on ne peut plus adequate.
Insuffisant, pourtant, car le tort qui a été fait et à l’homme et à l’œuvre par ce procès bâclé n’est pas assez dénoncé.
Voici un témoignage de Pierre Galtier Boissière à ce sujet :
« Visite à Henri Béraud, à l’île de Ré.
Gracié, après avoir trainé le boulet des condamnés à mort pendant quinze jours Béraud, condamné au bagne à vie, connut les horreurs, à Poissy, où les gardes-chiourmes le trainèrent, nu, dans la neige, et où le molestaient les « droit commun », escrocs, casseurs et maquereaux, tous d’un tricolorisme éclatant. Le 7 janvier son transfert au pénitencier Ars-en-Ré, dans cette ile qu’il avait habitée et aimée pendant vingt ans, apporta au condamné, grâce à un directeur humain, une sérieuse amélioration de régime. Mais pendant six ans la maladie s’acharna sur le malheureux que terrassèrent trois attaques successives. A la troisième le gouvernement, persuadé qu’il allait trépasser, accorda une grâce médicale et le fit transporter aux « Trois Bicoques » où sa femme Germaine habitait depuis plusieurs années, ravitaillant et soutenant son forçat avec un dévouement extraordinaire. Béraud devait survivre huit ans.
Jusqu’en 47, je lançai dans l’Intransigeant une campagne sur « L’hypocrisie de l’épuration » pour demander la libération, entre autres, d’Henri Béraud. En mars 53, Béraud m’écrivit qu’il voulait revoir, avant de mourir, son vieux copain de 1918 ; un obligeant ami s’offrit à me conduire.
Je n’avais pas vu Henri depuis vingt ans. Je fus épouvanté. Des bouquins à portée de son lit voulaient faire croire qu’il lisait encore ; mais le malheureux ne pouvait plus écrire de sa bonne main que guidée par celle de sa femme. Ses cordes vocales ayant été touchées il parlait d’une lamentable petite voix enfantine ; il n’était pas exactement gâteux, mais le champ de sa conscience était considérablement rétréci et sa mémoire ne remontait pas au-delà de son emprisonnement. « Demande à Germaine », murmurait-il, très las.
Voilà ce qui six de bagne ont fait de l’étourdissant causeur, du prestigieux écrivain, de l’intrépide reporter, du si attachant flâneur salarié : un mort-vivant. » (1)
Si on ne peut réparer le tort fait à l'homme, du moins peut-on exiger et faire en sorte que l’œuvre sorte de cet enfer sinistre dans lequel la maintient depuis des années le silence des éditeurs et des universitaires. Comment ? En la lisant. En parlant d’elle. A ce propos, il faut reconnaitre que cette appellation de «pamphlétaire pur jus » est bien insuffisante et ne fait qu’entretenir une image fausse et convenue. Béraud fut pamphlétaire comme il fut journaliste, pour vivre, dirions-nous aujourd’hui. Son œuvre romanesque et autobiographique existe, en marge de ses pamphlets. Le pamphlétaire pur jus s’y révèle un lyrique pur jus tout autant qu’un romancier pur jus ; bref, le réduire à n’être que pamphlétaire, c’est réduire Hugo à Napoléon le Petit ou Chateaubriand au De Bonaparte et des Bourbons.
Ceux qui ont eu la chance de mettre un peu le nez dans ladite œuvre savent de quoi je parle :
« Combien de fois, posant ma plume, m’est-il arrivé de penser longuement à ces jours lointains où j’aurais voulu vivre ? Seul avec moi-même, je m’amuse à les recréer tels que je les imagine, et c’est avec tant de foi, un plaisir si passionné que, bien souvent, j’y crois vivre, en effet. C’est une féerie que je m’offre, en spectateur nocturne et solitaire. La grande chambre, où j’écris, voit bientôt ses ombres remplies d’hôtes inconnus et fantasques, des perspectives cavalières, d’édifices en décor, de véhicules surannés. Reconstruire ainsi le passé, avec une imagination qui n’est sans doute qu’une mémoire, se laisser enchanter, voyager dans le temps, accueillir ces images qui naissent et s’effacent, se pencher, l’oreille tendue vers un son lointain, vivre autrefois, c’est mon opium. »
Ces lignes se trouvent dans la dédicace de Béraud à Pierre Brisson, au début de Quatorze Juillet (1929).
Il faut à ce point citer cette phrase de de Gaulle (avril 1946) à propos de ces «Les talents fourvoyés de la collaboration littéraire » dont nous entretient le magazine des livres de ce mois, phrase qui se passe de commentaires : « L’intellectuel Maurras n’était pas n’importe qui, ni Brasillach, ni Béraud. Encore Béraud n’eut-il pas de rapports avec les Allemands. Mais il était contre moi. »
Et pour clore ce douloureux chapitre, comme le rapporte Jean Butin dans l’autobiographie de cet écrivain à redécouvrir par tous d’urgence, un jour, de Gaulle fut interpellé à l’Assemblée Consultative par un socialiste qui lui reprocha d’avoir gracié Béraud ( !). De Gaulle le cloua à son banc d’un ton sans réplique : « C’est une histoire entre ma conscience et moi. J’en suis seul juge »
(1) Jean Galtier-Boissière Mémoires d’un Parisien, La table ronde, tome III (1963)
(2) Jean Butin, Henri Béraud, sa longue marche de la gerbe d’or au pain noir, Horwath, 1979
00:40 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : magazine littéraire, collaboration, littérature, henri béraud | 
samedi, 14 novembre 2009
Lecture de Roland Tixier
J’ai rencontré hier un homme charmant. En compagnie duquel nous avons passé, une poignée d’auditeurs et moi-même, un moment de poésie – oui, ce mot galvaudé peut encore retrouver, à l’occasion de moments comme ceux-ci, un peu de sens.
De poésie donc
Roland Tixier, a lu dans l’intimité du premier étage des Xanthines, l’intégralité de son recueil, Simples Choses. (1) J’avais déjà lu les 180 haïkus (2), mais j’avoue qu’ainsi parlés, oralisés, racontés – et par celui qui vit dans leur rythme mental depuis – dit-il – une dizaine d’années, ils ont pris une sorte d’existence intérieure tout à fait étonnante.
Pour parler de sa poésie et de sa façon de mettre en relief les mots, Roland Tixier évoque, un rien malicieux, les expositions de mots auxquels les surréalistes aimaient s’adonner, ou bien encore les films sous-titrés. Il parle également du vocabulaire et du style de Georges Simenon, cité par Vialatte (« Simenon écrit comme tout le monde, mais personne n’écrit comme Simenon ») Mettre en valeur les mots simples des gens simples, afin de restituer le dénuement d’un simple moment, tel pourrait être son art poétique.
La lecture de Tixier est très régulière. Psalmodiant, il s’interrompt pour préciser, parfois : « Ce haï-ku, c’est un jour de soldes, à Monoprix… » Ou encore, « là c’était devant la mairie de Vaulx en-Velin, quand les pigeons viennent grappiller les grains de riz juste après les mariages… » ; « Là, c’était deux amoureux sur l’avenue Bianqui, deux amoureux qui s’embrassaient au lieu de faire un créneau… » « le poilu moussu, c’est dans le quartier Montchat… »
Il est des mots dont la mise en relief est inquiétante :
Je ne vois plus l’homme au chien
Ont-ils quitté le quartier ?
Ou peut-être pire ?
Cette strophe est d’ailleurs la seule, dans tout le recueil, à posséder deux points d’interrogation. Les autres sont non ponctuées, comme liées ensemble car, dit-il «un haïku n’a de sens que dans le nombre »
Avec humour, Roland Tixier nous raconte que pour voyager aujourd’hui, il n’est plus besoin d’aller au Japon. Changer de rue lui suffit .
Et lorsqu’il lit ce haïku :
causerie dans l’entrée
il ne fait pas très froid
si on regarde bien
il prend le temps de nous expliquer : « j’allais sortir, et la voisine m’a dit : Il ne fait pas trop froid, si on regarde bien ».
Magnifique sous-titrage, poète ! Magnifique sous-titrage avec ces mots de rien, ces mots du quotidien. Et on a envie de lui dire qu’en effet « il ne fait pas très froid si on le lit bien… »
(1) Simples Choses Roland Tixier, Éditions Le Pont du Change
13 € - ISBN : 978-2-9534259-0-1
(2) Premier billet ICI
15:11 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : poésie, roland tixier, le pont du change | 
mercredi, 11 novembre 2009
Paul Lintier, la censure, le cafard...
20 décembre
Pourquoi donc suis-je si triste, si las, si découragé ? Je n’ai pourtant pas eu froid cette nuit dans la cabane entre François et Arsène. Mais il y a de ces jours d’irrémédiable malaise. Cela vous saisit brusquement, vous étreint vous angoisse, assombrit toutes choses comme une lourde nuée noire. On ne sait pourquoi. Et c’est ce qui rend cette impression douloureuse plus inquiétante pénible comme le sont les pressentiments, ces transes de l’imagination auxquelles, certes, je ne crois pas, mais qui sont étrangement émouvantes.
Aucun malheur précis ne se présente à ma pensée, aucune crainte de mort plus immédiate pour moi, rien de pire que ce grand risque auquel nous sommes pourtant accoutumés.
CENSURE
Certes, cette pensée-là pour nous est bien un gouffre. Pourtant, ce n’est pas le vertige, dont on ne se défend jamais lorsqu’on se hasarde à le sonder, qui ce matin fait le fond de ma détresse. Ce n’est pas cela qui me trouble si intimement, qui me cause ce désespoir irrémédiable. Est-ce la nostalgie du passé ? Un peu. Est-ce le doute sur mon avenir immédiat, la confiance en ma chance qui s’éclipse un moment ? Un peu aussi. Mais c’est autre chose, un malaise intime, indéfinissable, indicible, une étreinte à la gorge, l’attente d’un malheur. C’est on ne sait quoi. C’est une misère de plus parmi tant de misères. On appelle cela le cafard.
Le Tube 1233, Paul Lintier, Paris, Plon, 1917
22:45 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : paul lintier, littérature, le tube 1233 | 
jeudi, 05 novembre 2009
Au bal des ardents
Le jeudi 5 novembre
à partir de 18 heures,
la Librairie le Bal des Ardents
accueille
Serge Rivron et Pierre Autin-Grenier
les deux derniers lauréats du prix Léo Ferré
pour une rencontre et une lecture autour de leurs textes.
Librairie Le Bal des Ardents
17, rue Neuve / 69001 LYON
tel : 04 72 98 83 36
La librairie Le Bal des Ardents est située sur la Presqu'île, entre la Place des Terreaux (métro Hôtel-de-Ville) et les Cordeliers (métro Cordeliers).
Le prix Léo Ferré est décerné par la ville de Grigny.
Pierre Autin Grenier l'a obtenu en 2007 pour Un cri
et Serge Rivron pour La Chair en 2008.
07:33 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : lyon, littérature | 
mardi, 03 novembre 2009
Le cimetière des chiens

Léon Bloy est mort un 3 novembre, celui de cette terrible année 1917 dont Louis Guilloux fit l’année du Sang Noir. Terrible rencontre, quand on y pense, que celle qui aurait pu se produire entre Cripure et Léon Bloy, « morts » à quelques semaines d’intervalles, finalement.
Voici un extrait du Sang du Pauvre, que Bloy écrivit de janvier à mars 1909.
A propos de cet extrait, il écrivit dans son Journal (Le Vieux de la montagne) le 16 mars 1909 : « Visité le cimetière des chiens à Asnières en vu d’un chapitre pour le Sang des Pauvres. Recueilli quelques notes quelques inscriptions bouffonnes ou odieuses. Là, plus que partout ailleurs éclate le mépris absolu du pauvre. Je reviens documenté, inexprimablement dégoûté et vomissant »
_____________________________________________________
« Un certain effort n’est pas inutile pour s’habituer à cette pensée d’une nécropole de chiens. Cela existe pourtant à Asnières dans une île autrefois charmante de la Seine. Oui les chiens ont un cimetière, un vrai et beau cimetière avec concessions de trois à trente ans, caveau provisoire, monuments plus ou moins somptueux et même fosse commune pour les idolâtres économes, mais surtout, on le suppose, pour que les pauvres appartenant à l’espèce humaine soient mieux insultés. (…)
La monotonie des « regrets éternels » est un peu fatigante. La formule de fidélité, plus canine que les chiens eux-mêmes : « Je te pleurerai toujours et ne te remplacerai jamais » surabonde péniblement. Néanmoins le visiteur patient est récompensé.
« Ma Ponnette protège toujours ta maîtresse. – Kiki, trop bon pour vivre. – Drack, il nous aimait trop et ne pouvait vivre. – Linda morte d’attachement, de fidélité d’intelligence et d’originalité (au-dessous de deux niches). - Sur ton corps le printemps effeuillera des roses.- A Folette, O ma mignonne tant aimée De ma vie, tu fus le sourire. – La brutalité des hommes a mis fin à notre amour. »
Et celle-là oh ! Celle-ci : « Mimmiss, sa mémère à son troune-niouniouse… »
On est forcé de se demander si la sottise décidément n’est pas plus haïssable que la méchanceté même. Je ne pense pas que le mépris des pauvres ait jamais pu être plus nettement, plus insolemment déclaré. Est-ce l’effet d’une idolâtrie démoniaque ou d’une imbécilité transcendante ? Il y a là des monuments qui ont coûté la subsistance de vingt familles ! J’ai vu en hiver, sur quelques-unes de ces tombes d’animaux, des gerbes de fleurs dont le prix aurait rassasié cinquante pauvres tout un jour ! Et ces regrets éternels, ces attendrissements lyriques des salauds et des salaudes qui ne donneraient pas un centime à un de leurs frères mourant de faim. « Plus je vois les hommes plus j’aime mon chien », dit le monument à Jappy, misérable cabot bâtard, dont l’ignoble effigie de marbre crie vengeance au ciel. La plupart de ces niches sans abois sont agrémentées, pour la consolation des survivants d’une photographie du pourrissant animal. Presque toutes sont hideuses, en conformité probable avec les puantes âmes des maîtres ou des maîtresses. « Les attractions, a dit Fourier sont proportionnelles aux destinées. »
Je n’ai pas eu le bonheur d’assister à un enterrement de 1ère classe. Quel spectacle perdu ! Les longs voiles de deuil, les buissons de fleurs les clameurs et les sanglots de désespoir, les discours peut-être. Malheureusement, il n’y a point de chapelle. Avec un peu de musique, la Marche Funèbre de Beethoven, par exemple, il m’eût été facile d’évoquer le souvenir des lamentables créatures à l’image de Dieu portées, après leur mort, dans les charniers de l’Assistance et enterrées à coups de souliers par des ivrognes.
Toute caisse contenant un animal mort dit l’article 9 du règlement sera ouverte pour vérification à son entrée au cimetière. Ce très sage article a sans doute prévu le cas où quelque putain richissime y voudrait faire enterrer son père. »
Le sang du Pauvre, « les deux cimetières » (chapitre XIX), 1983 réed. Mercure de France
12:35 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, cimetière des chiens, sang du pauvre, léon bloy | 









