dimanche, 03 janvier 2010
Mes étrennes (2)
Dans cette page extraite de Chemins de Solitude (1946) l’écrivain Gabriel Chevallier évoque le temps de sa prime enfance et les vieilles personnes qu’il connut alors, gens de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle nés aux alentours de 1830 : occasion d'une rêverie sur le sort des humains.
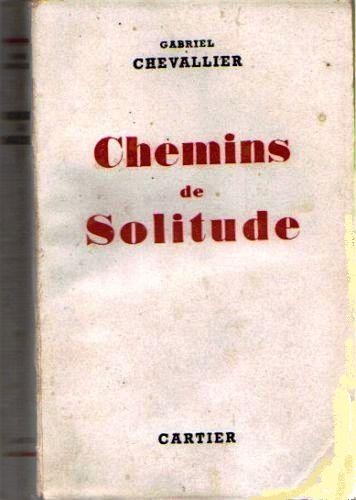
« Cette époque de mon enfance avait assurément, outre ses inconvénients des travers et des ridicules. Cependant, aux jeunes hommes trop imbus de mécanisation et d’accélération, qui la diraient déplorablement arriérée, je demanderai s’ils croient que les commodités modernes ont engendré un fier relèvement de l’intelligence et coïncidé avec des événements fameux pour l’humanité.
L’époque désuète que j’évoque, si elle manquait d’éclairages modernes, de baignoires, d’ondes et d’un confort devenu courant, ne manquait pas d’une certaine tenue. A l’âge du pétrole, qui succédait à celui de la chandelle, on avait le loisir d’être aimable et de se plaire à son sort. Une certaine ultime lenteur, dont on ne soupçonnait ni le prix ni l’utilité présidait encore à la vie, à la veille que les hommes se ruassent à l’assaut des distances croyant le bonheur caché aux antipodes. La tâche accomplie tenait lieu de diplôme à des citoyens estimés qui s’efforçaient de leur mieux, à tous les échelons de la confuse condition sociale. Faire plaisir était une obligation aussi élémentaire que celle de dire merci ou pardon.
Sans doute n’ai-je point goûté pleinement tous les bienfaits du vieux temps, que j’ai vu progressivement s’altérer et disparaître. Mais je sens à de lointaines réminiscences que les rapports entre Français étaient plus simples, plus honnêtes et plus bonhommes à l’époque de mon enfance.
Il est vrai qu’à mes propres souvenirs se mêlent ceux d’un temps plus ancien encore que je n’ai connu qu’à travers les récits et légendes des vieux parents, qui cloués à leur fauteuil récapitulaient leur vie – comme je récapitule aujourd’hui une partie de la mienne pour lui chercher une signification, dans la déroute où nous sommes de toutes choses sensées, en présence du plus terrible et humiliant fiasco qui ait jamais accablé les hommes de notre race.
Il me semble maintenant que ces vieux parents décrivaient un âge d’or tant ils parlaient bien d’une certaine sérénité répandue sur la vie qui les laissait apaisés au soir de leurs jours. L’un après l’autre ils passaient doucement du déclin à la tombe comme le soleil couchant chavire derrière les coteaux de nos campagnes, car même les moins croyants - et parfois ceux-là de préférence - étaient empreints d’une profonde pitié humaine qu’ils étendaient, une fois retirés des luttes, à tout ce qui vivait autour d’eux, en attendant le signal du grand silence ordinaire où tout se dissout.
 Je n’ai pas connu ces vieilles gens dans la pleine activité de leurs jours et soumis à la tyrannie des passions. Je ne revois que leurs visages austères de la fin, déjà desséchés, alors que, tout étant pour eux accompli, ils ne pouvaient rien retoucher à leur aventure humaine. N’envisageant plus que l’inéluctable, ils s’apprêtaient à faire devant lui bonne contenance.
Je n’ai pas connu ces vieilles gens dans la pleine activité de leurs jours et soumis à la tyrannie des passions. Je ne revois que leurs visages austères de la fin, déjà desséchés, alors que, tout étant pour eux accompli, ils ne pouvaient rien retoucher à leur aventure humaine. N’envisageant plus que l’inéluctable, ils s’apprêtaient à faire devant lui bonne contenance.
Ces ancêtres longtemps oubliés, je sais que je me les représente parés d’un prestige qui tient à ce que l’âge de leur renoncement a coïncidé avec celui de mes premières espérances. Car je sais qu’il fut aussi un temps où je dus lutter contre eux, les renier en quelque sorte, pour aller de l’avant. Je désirais, pour jouer ma partie, ne pas sentir peser sur moi leur air de sévérité et d’ironique expérience. J’aurais été embarrassé de leur expliquer mes actions, non que j’aurais eu à en rougir, mais j’aurais craint leurs moqueries et leurs maximes désenchantées. Je sentais trop l’écart : ils avaient vécu et j’apprenais à vivre.
Ces êtres qui sont déjà dans la tombe près d’un demi-siècle d’avance sur moi, je me sais aujourd’hui leur pair. Par ma propre vie, je mesure la leur, dont j’évalue les limites. Je devine ce que cachaient les attitudes qui m’imposaient jadis. C’est la raison qui fait que je reviens maintenant sans crainte à ces vieillards que j’ai à peine entrevus, figés dans leur sagesse dernière, pour les interroger sur un temps différent du mien et qui fut peut-être plus heureux.
Mais je me dis d’autre part que leur temps a précédé le nôtre, que dans la suite des siècles et des enchaînements de familles ou de générations, nous sommes tous solidaires du résultat à quelque échelon qu’il survienne. Tout cela ne prouve peut-être qu’une chose : que j’atteins un âge où l’on accepte l’idée du submergeant chaos où les êtres s’engloutissent pêle-mêle quelle qu’ait été la somme de leurs œuvres.
Il y avait encore cela chez les vieilles gens dont je parle, cela qui parfois m’écartait d’eux avec crainte : une lueur glacée de leur regard qui me semblait, à tant de questions que j’aurais voulu poser, une réponse sardonique, venue du plus profond d’un grand désespoir. Je sais maintenant qu’il s’agissait de l’incurable désespoir des hommes, ce mal qui donne aux vieillards un air de mendiants. Je sais qu’ils mendiaient quelques jours supplémentaires de chaleur sur leurs vieux os, quelques jours pour voir encore briller le soleil, frémir les branches, glisser les nuages, et qu’ils ont des moments de haine pour la jeunesse, parce qu’elle ne se pose pas à tout instant la question de l’heure, la question du terme. »
Gabriel Chevallier, Chemins de Solitude, Paris, Lyon, Cartier, 1945
15:35 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : 2010, gabriel chevallier, littérature, lyon | 









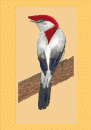
Commentaires
Merci de ce cadeau, ces belles étrennes. La couverture du livre m'émeut profondément. Je pense à ce que disait l'un de vos lecteurs, ce plaisir de trouver un livre quand il arrive dans la boîte à lettres. Je vois très bien celui-là dans la mienne et l'amour à le tenir dans les mains. Merci Solko pour ces bonheurs infinis.
Écrit par : Michèle | dimanche, 03 janvier 2010
"Dans la suite des siècles et des enchaînements de familles ou de générations, nous sommes tous solidaires du résultat à quelque échelon qu'il survienne."
et je reprends cette autre :
"Ces êtres qui sont déjà dans la tombe près d'un demi-siècle d'avance sur moi, je me sais aujourd'hui leur pair."
Elle m'évoque cette autre de Béraud que j'ai souvent à l'esprit, même si elle ne dit pas du tout la même chose que celle de Gabriel Chevallier :
"Nous n'aurons jamais le même âge parce que nous ne l'aurons pas en même temps."
Les mots quand ils sont justes deviennent nos compagnons assidus.
Écrit par : Michèle | dimanche, 03 janvier 2010
Grâce à vos mots je souhaite aussi lire "La peur" de Gabriel Chevallier.
Écrit par : Marie-Hélène | dimanche, 03 janvier 2010
"Ce mal qui donne aux vieillards cet air de mendiants..." C'est bouleversant.
Ps: Solko, venez chez moi avec Monsieur Chevallier quand vous voulez, je vous ferai visiter la salle de bain. Je pense qu'elle devrait bien vous plaire...(Ceci n'est pas de la publicité).
Écrit par : Frasby | lundi, 04 janvier 2010
Très beau texte. Sans vouloir faire de pub pour mon blog, j'ai mis un texte de l'orientatliste Georges Marçais évoquant la ville de Tlemcen et ses gens au temps jadis. Ces textes, par leur beauté, me font rêver, me rendent nostalgique, et en même temps suscitent en moi la peur envers notre époque et pour le devenir de nos enfants, et finalement comme tout un chacun, peut-être par un réflexe de défense, j'en viens à m'interroger sur la réalité de l'existence décrite dans ces textes. A l'âge de la vieillesse, n'éproverons pas la même nostalgie pour ce temps actuel que nous décrions et qui à certains égards nous fait même peur ? J'ai lu des textes d'auteurs de l'Antiquité (Ovide ? Sénéque ? je ne sais plus) où j'ai trouvé des descriptions nostalgiques des générations plus anciennes et des critiques acerbes envers l'état actuel de la société. Et finalement, je m'intérroge sur la pertinence de ces descriptions et de ces évocations nostalgiques. Je me demande si cela ne fait pas partie de la nature humaine que d'embellir le passé. Vous qui êtes professeur, n'avez vous pas constaté que les parents et même les anciens élèves ont tendance à dire que leur école était mieux avant, du temps où ils y étaient, mais qu'à présent elle s'est beaucoup dégradée. Mais bon, peut-être que mes interrogations n'ont pas lieu d'être et qu'à travers ces textes finalement, il suffit juste d'admirer la beauté de l'écriture et une certaine perception subjective du temps jadis. Bien à vous
Écrit par : pier paolo | lundi, 04 janvier 2010
Juste vous dire que je me suis posé les mêmes questions que vous et que j'apprécie beaucoup l'interpellation que vous faites et à laquelle chacun de nous ne peut qu'être sensible. Je ne me suis pas lancée comme vous à soumettre cette interrogation parce que j'ai reculé devant le travail à recenser finement de quoi il est question chaque fois que quelqu'un déplore tel ou tel trait de son époque.
Je me rappelle simplement comment il y a dix ans, des rires goguenards ont accueilli la pensée du dromologue Paul Virilio, lesquels rires disaient : "bah, chaque époque a eu peur de ce qui est nouveau !"
Écrit par : Michèle | lundi, 04 janvier 2010
Maintenant il y a le contexte et le discours qu'il tient dessus. J'ai lu de nombreux témoignages d'auteurs, et aussi des témoignages de vieilles personnes, m'affirmant que la guerre de 14 et l'expérience que les hommes ont faite dans les tranchées, puis celle de 40 et la découverte de la Shoah et d'Hiroshima, avaient considérablement durci le monde, changé le rapport de force entre les individus au sein même de la société. Trop jeune pour en témoigner, je le crois néanmoins. Quant aux critiques qu'a pu faire Sénèque, elles s'opèrent dans une période de décadence, en tous points similaires à la notre.
Ainsi se mêlent deux vision, l'une qu'on pourrait dire "universelle " (avec la prudence qu'il faut avoir en tête quand on utilise ce mot - mais le vieillissement est une expérience commune à tous les hommes), l'autre contextuelle (période de décadence ou non ?). Pour moi, il est clair que nous sommes actuellement dans un contexte de décadence assez spectaculaire et très effrayant. Ce facteur est évidemment discutable.
Bien à vous.
Écrit par : solko | lundi, 04 janvier 2010
L'un est la croyance dans le progrès illimité, l'idée héritée du scientisme du XIXème, que le sort de l'homme est améliorable à l'infini.
L'autre est la croyance dans l'usure inévitable des choses et des civilisations, le déclinisme.
Or ces lieux communs ont toujours été actifs chez les uns et les autres, à toutes les époques. Mais au-delà des assertions des uns et des autres, on peut se rattacher à des faits. Encore que l'écrivain, lui, ne se soucie que de dire la justesse de son ressenti, et se moque bien de savoir si ce ressenti correspond à une réalité historique ou non, à une vérité communément admise ou non.
Écrit par : solko | lundi, 04 janvier 2010
Écrit par : Agaric | lundi, 04 janvier 2010
Écrit par : solko | lundi, 04 janvier 2010
Écrit par : tanguy | lundi, 04 janvier 2010
La similitude avec l’Empire romain est flagrante. Les milliers de chômeurs qui vivaient à Rome (« panem et circenses ») tandis que les colonies comme l’Egypte fournissaient tout le blé nécessaire me font penser à nos usines qui se délocalisent bien loin, laissant notre société vide de sens, si ce n’est celui de consommer.
Et puis autrefois chacun essayait de survivre, sans plus. Aujourd’hui que le principe est la concurrence acharnée liée au libre échange, le ton se durcit, évidemment. Il faut être le meilleur et le plus fort et n’avoir aucune pitié pour les autres. Les rapports humains s’en ressentent forcément.
Écrit par : Feuilly | mardi, 05 janvier 2010
Écrit par : solko | mardi, 05 janvier 2010
Les commentaires sont fermés.