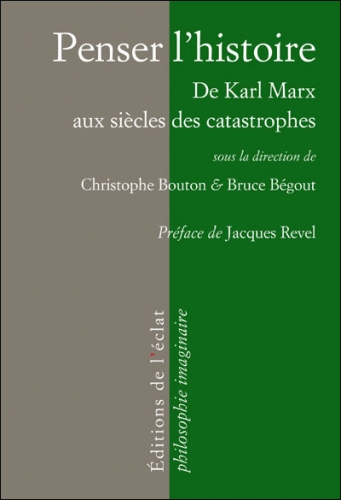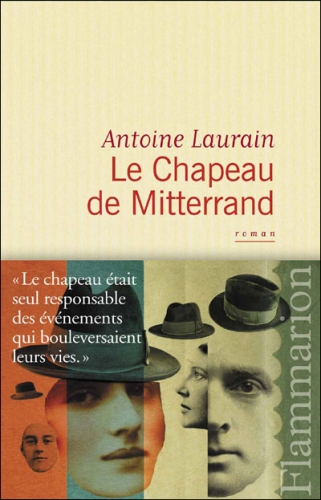mercredi, 16 mai 2012
Terra Nostra
De cette journée du 15 mai, on se souviendra surtout de la mort de Carlos Fuentes, parce que pour le reste…
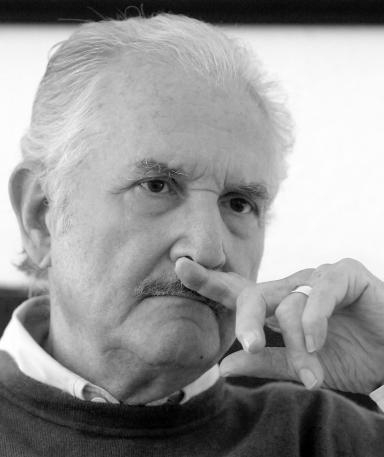
J’ai lu Terra Nostra alors que je n’avais qu’une trentaine d’années. De ce pavé éblouissant, n’émerge d’abord, avec le recul, que la haute figure de Philipe II battant la dalle du pavé de son Escurial. Une mémoire tout autour. Un imaginaire. La mémoire d’un entrelacs de récits et d’époques hautement maîtrisé, vertigineux. Du peu que nous sommes. D’un plaisir de la conquête, à venir à bout d’une page, puis d’un chapitre, de quelques tentatives juvéniles de réécriture, d’un isolement de soi magnifique ressenti en une terre étrangère. D’une spiritualité austère et emplie de parfum, d'un sortilège. Le langage politique, devant ce langage-là, n’est qu’une vaste fumisterie.
07:33 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : carlos fuentes, littérature, terra nostra | 
lundi, 09 avril 2012
De Myrelingues, de l'incroyance, du torchecul...
On fête aujourd’hui l’anniversaire de la mort de François Rabelais, si l’on en croit un épitaphier du milieu du XVIIIe siècle de l’église Saint-Paul à Paris : «François Rabelais, décédé âgé de 70 ans rue des Jardins le 9 avril 1553 a été enterré dans le cimetière de Saint-Paul». Je me souviens comme d’hier de la récitation qu’un professeur de seconde nous fit, dès notre première rencontre le jour de la rentrée, de la méthode torcheculative, par laquelle Grandgousier connut « l’esprit merveilleux » de son fils Gargantua, et songea d’en faire un jour un « docteur en gai science ». Le pari était audacieux. Me revient en mémoire un certain scepticisme devant ses éclats de rire que je jugeai forcés, ne trouvant pas, moi-même, ce chapitre 13 du Gargantua et son énumération fastidieuse de torchecul si hilarant que ça. D’autant qu’il n’accompagna le texte d’aucune explication, nous laissant seuls avec la faconde d’Alcofribas.
Lui savait -nous pas encore- quel tonnage de commentaires érudits, parfois passionnants, souvent divagants, Rabelais avait engendré. Plus tard, je mis mon nez dans les pages de Lucien Febvre, plus tard dans celles de Spitzer, et plus tard encore dans celles de Bakhtine. Le problème de l’incroyance du XVIe siècle, dans sa belle collection « L’évolution de l’humanité » (téléchargeable ICI) me passionna à l’époque, parce que ce texte mettait en lumière, et j’avais grandement besoin de comprendre cela, « la religiosité profonde de la plupart des créateurs du monde moderne ». La thèse de Febvre (1878-1956) reste une grande et belle œuvre à lire aujourd’hui. Leo Spitzer (1887-1960), je ne l’évoque pas non plus sans quelque émotion parce que bruissaient encore dans sa génération ce souci de s’approprier le passé européen via le style que les siècles successifs avaient imprimé à sa littérature, cette conscience, désormais perdue, que cette littérature est le plus légitime de notre héritage. Bakhtine, enfin (1895-1976), qui dégagea la dimension purement carnavalesque, liée au bas corporel, de l’œuvre.
Il m’arrive parfois de songer, quand je me rends de la place des Jacobins à la rue Grenette en passant par la rue Mercière, que ce fut longtemps le trajet de Rabelais se rendant de l’Hôtel Dieu à l’atelier de François Juste. « Me voici revenu en l’Athènes des Gaules : l’inclyte et famosissime urbe de Lugdune la Myrelingues, Lyon aux dix mille langages, ubi est sedes studiorume meorum… », s’écrie le Rabelais de Claude le Marguet dans son roman Myrelingues la Brumeuse. Il s’agit d’une fantaisie du journaliste qui écrivit dans les années vingt ce roman historique à la gloire du Lyon de 1536. Cela reste un beau coup de chapeau, non seulement à Rabelais lui-même, mais aussi à cette artère où battaient les presses à bras dans tous ces ateliers transformés en restaurants pour touristes, quand ils n’ont pas été détruits lors des rénovations de Louis Pradel. Le souffle et le rire de Rabelais sont certes à présent légers sur la ville, et il faut beaucoup d’imagination pour retrouver l’un ou l’autre dans la mémoire de ses pierres. C’est cependant faisable, en quelque coin plus éminemment poétique qu’un autre, à condition de zyeuter quelque enseigne sculptée ou gravée dans la pierre et d’y rajouter la récitation de quelque verset rabelaisien :
« Ci entrez, vous, qui le saint Evangile
Annoncez en sens agile malgré ce qu'on gronde;
Vous aurez céans refuge et bastille;
Contre l'hostile erreur qui tant distille
Son faux style pour en empoisonner le monde:
Entrez, que l'on fonde ici la foi profonde,
Puis que l'on confonde de vive voix et par rôle
Les ennemis de la sainte Parole. »
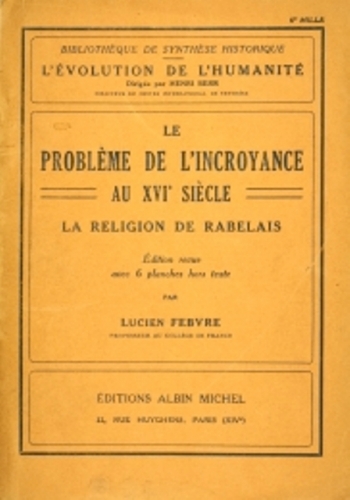
00:15 Publié dans Bouffez du Lyon, Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : myrelingues, torchecul, lucien febvre, françois rabelais, littérature, rue mercière, françois juste, lyon | 
vendredi, 30 mars 2012
La vie dans les bois
L’Ermite. — Je me demande ce que fait le monde en ce moment. Voilà trois heures que je n’ai entendu même une sauterelle sur les myricas. Les pigeons dorment tous sur leurs perchoirs, — sans un battement d’ailes. Etait-ce la trompette méridienne d’un fermier qui vient de retentir de l’autre côté des bois ? Le personnel rallie bouilli de bœuf salé, cidre et gâteau de maïs. Pourquoi les hommes s’agitent-ils ainsi ? Qui ne mange pas n’a pas besoin de travailler. Je me demande combien ils ont récolté. Qui voudrait vivre où l’on ne peut penser à cause des aboiements de Turc. Et… oh ! le ménage ! tenir brillants les boutons de porte du diable, et nettoyer ses baquets par cette belle journée ! Mieux vaut ne pas tenir maison. Disons, quelque creux d’arbre ; et alors pour visites du matin et monde à dîner ! Rien que le toc toc d’un pivert. Oh, ils pullulent ; le soleil y est trop chaud ; ils sont nés trop loin dans la vie pour moi. J’ai de l’eau de la source, et une miche de pain bis sur la planche. Ecoutez ! J’entends un bruissement des feuilles. Quelque chien mal nourri du village, qui cède à l’instinct de la chasse ? ou le cochon perdu qu’on dit être dans ces bois, et dont j’ai vu les traces après la pluie ? Cela vient vite, mes sumacs et mes églantiers odorants tremblent. Eh, Monsieur le Poète, est-ce vous ? Que pensez-vous du monde aujourd’hui ?
Le Poète. — Vois ces nuages ; comme ils flottent ! C’est ce qu’aujourd’hui j’ai vu de plus magnifique. Rien comme cela dans les vieux tableaux, rien comme cela dans les autres pays — à moins d’être à la hauteur de la côte d’Espagne. C’est un vrai ciel de Méditerranée. J’ai pensé, ayant ma vie à gagner, et n’ayant rien mangé aujourd’hui, que je pouvais aller pêcher. Voilà vraie occupation de poète. C’est le seul métier que j’aie appris. Viens, allons.
L’Ermite. — Je ne peux résister. Mon pain bis ne fera pas bien long. J’irai volontiers tout à l’heure avec toi, mais pour le moment je termine une grave méditation. Je crois approcher de la fin. Laisse-moi seul, donc, un instant. Mais pour ne pas nous retarder, tu bêcheras à la recherche de l’appât pendant ce temps-là. Il est rare de rencontrer des vers de ligne en ces parages, où le sol n’a jamais été engraissé avec du fumier ; l’espèce en est presque éteinte. Le plaisir de bêcher à la recherche de l’appât équivaut presque à celui de prendre le poisson, quand l’appétit n’est pas trop aiguisé ; et ce plaisir, tu peux l’avoir pour toi seul aujourd’hui. Je te conseillerais d’enfoncer la bêche là-bas plus loin parmi les noix-de-terre, là où tu vois onduler l’herbe de la Saint-Jean. Je crois pouvoir te garantir un ver par trois mottes de gazon que tu retourneras, si tu regardes bien parmi les racines, comme si tu étais en train de sarcler. A moins que tu ne préfères aller plus loin, ce qui ne sera pas si bête, car j’ai découvert que le bon appât croissait presque à l’égal du carré des distances.
L’Ermite seul. — Voyons ; où en étais-je ? Selon moi j’étais presque dans cette disposition-ci d’esprit ; le monde se trouvait environ à cet angle. Irai-je au ciel ou pêcher ? Si je menais cette méditation à bonne fin, jamais si charmante occasion paraîtrait-elle devoir s’en offrir ? J’étais aussi près d’atteindre à l’essence des choses que jamais ne le fus en ma vie. Je crains de ne pouvoir rappeler mes pensées. Si cela en valait la peine, je les sifflerais. Lorsqu’elles nous font une offre, est-il prudent de dire Nous verrons ? Mes pensées n’ont pas laissé de trace, et je ne peux plus retrouver le sentier. A quoi pensais-je ? Que c’était une journée fort brumeuse. Je vais essayer ces trois maximes de Confucius ; il se peut qu’elles me ramènent à peu près à l’état en question. Je ne sais si c’était de la mélancolie ou un commencement d’extase. Nota bene. L’occasion manquée ne se retrouve plus.
Le Poète. — Et maintenant, Ermite, est-ce trop tôt ? J’en ai là juste treize tout entiers, sans compter plusieurs autres qui laissent à désirer ou n’ont pas la taille ; mais ils feront l’affaire pour le menu fretin ; ils ne recouvrent pas autant l’hameçon. Ces vers de village sont beaucoup trop gros ; un vairon peut faire un repas dessus sans trouver le crochet.
L’Ermite. — Bien, alors, filons. Irons-nous à la rivière de Concord ? Il y a là de quoi s’amuser si l’eau n’est pas trop haute
Thoreau, Walden ou la vie dans les bois, 1854, texte intégral ICI
Les Bois, Pier Antonio Gariazzo
12:18 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : gariazzo, thoreau, walden ou la vie dans les bois, littérature, romantisme, anarchisme | 
dimanche, 04 mars 2012
Penser l'histoire à Bron, avec Bouton et Bégout
Christophe Bouton et Bruce Bégout présentaient hier à la Fête du livre de Bron leur volume Penser l’histoire, de Karl Marx au siècle des catastrophes, fruit d’une série de travaux menés dans le cadre du centre de recherches Lumières, Nature, Sociétés de l’université Michel de Montaigne à Bordeaux. Préfacé par Jacques Revel, l’ouvrage publié en 2011 se compose de plusieurs contributions, dont une de chacun des deux intervenants.
Pour la mise en bouche, Christophe Bouton retrace brièvement le sens général de l’histoire, tel que l’ont défini les Lumières et dans leur sillage Hegel puis Marx : le fil conducteur du progrès est l’extension de la citoyenneté, basée sur la conquête politique de la liberté par le plus grand nombre, de l’empire oriental ou égyptien dans lequel seul un grand homme était libre (empereur ou pharaon), à la Grèce Antique où seuls quelques hommes étaient libres, jusqu'aux idéaux de la Révolution Française qui postule que tous les hommes peuvent être libres. Il dresse ensuite le constat de la remise en cause par de nombreux penseurs modernes de cette philosophie heureuse de l’histoire devant les guerres mondiales du XXème siècle et le « temps des catastrophes » dans lequel nous nous trouvons à l’ère du capitalisme mondialisé. Il ne s’agit donc pas de réactiver les philosophies du passé, mais de définir des outils et des schémas d’interprétations appropriés pour saisir l’époque actuelle, définie principalement par la perte du sens. Rien de très neuf, en somme, mais une mise en perspective à la fois claire et professorale.
Partant d’une formule de Jan Patocka dans ses Essais hérétiques,, « l’homme ne peut vivre dans la certitude du non sens », Bruce Bégout rappelle alors qu’il ne peut y avoir de pensée historique sans un début et une fin. Le concept d’histoire débute ainsi pour nous avec les Grecs et se décline depuis en deux schémas linéaires jusqu’à une fin : une première ligne continue, théologique, qui postule l’idée d’un but et qu’on peut dire progressiste ; une seconde, discontinue, eschatologique, qui se borne à attendre une fin, et qu’on peut dire messianique. En somme, nous dirigeons-nous encore vers un but ou attendons-nous simplement une fin ? Voilà qui pourrait alimenter les riches débats menés en ce moment par les principaux candidats à la (re) conquête de l'Elysée.
La réflexion des deux invités aborde ensuite la question du rôle de l’homme dans l’histoire, à travers une article de Christophe Bouton sur le sens et les limites de la « faisabilité » de l’histoire par les hommes eux-mêmes. Contre l’idée que l’histoire serait ouvertement « disponible à l’action humaine », ils examinent trois arguments :
- L’argument d’impuissance, selon laquelle la volonté humaine se brise contre la force des événements inéluctables et le discours fataliste qui s’ensuit. De ce point de vue Napoléon, dont la grande volonté s'enlisa dans l’hiver russe n’est pas, comme le suggère Tolstoï dans Guerre et Paix, le grand stratège légendaire qu’on croit.
- L’argument de l’ironie de l’histoire, qui consiste à dire que les hommes sont acteurs d’une histoire qui leur échappe inévitablement, et qu’ils ne savent pas, le plus souvent, la signification de l’histoire qu’ils écrivent : Ainsi Gorbatchev et sa Pérestroïka.
- L’argument selon lequel vouloir faire de l’histoire est dangereux car cela autorise trop de crimes collatéraux. Et que, si vouloir « faire de l’histoire est dangereux », il faut sortir de la philosophie de l’histoire et revenir à la nature. Après avoir cherché à « transformer le monde », il faut réapprendre à le « conserver ». On reconnait là, quelque peu simplifiés, les points de vue d’Hannah Arendt et de Gunther Anders.
La présentation se clôt par un détour vers la littérature et la notion d’Uchronie. On imagine alors ce que serait l'histoire contemporaine si, par exemple, Hitler avait gagné la guerre. Ce concept d'uchronie, pendant de celui d'utopie, ouvre selon Bégout un rapport original et nouveau à l’histoire et à l’imaginaire. Là-dessus, l'auditoire est rendu à lui-même, tandis que les auteurs se dirigent vers la table où se tiennent les dédicaces, comme c'est l'usage. Dehors, la nuit est tombée et l'hippodrome de Bron se vide de ses badauds d'un jour qui se dirigent sans faire d'histoire en file indienne vers le tramway.
20:37 Publié dans Bouffez du Lyon, Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : christophe bouton, bruce bégout, penser l'histoire, fête du livre, bron, littérature | 
mardi, 28 février 2012
Classé sans suite

Patrik Ourednik
Les éditions Allia viennent de publier un court roman de l'écrivain tchèque Patrik Ourednik, Classé sans suite. Original, le récit débute véritablement au chapitre deux, sur un banc : « Les arbres recyclaient le gaz carbonique dans la crainte de Dieu ». Nous nous trouvons à Prague, aux cotés d'un héros vieillissant, dans un espace fraîchement recomposé par les incessantes turbulences du siècle : «Le banc de Dyck se trouvait sur une place presque villageoise, limitée d’un côté par une église, de l’autre par d’anciennes écuries, aujourd’hui musée Andy Warhol. Les écuries dépendaient d’un relais de chasse, aujourd’hui Académie des Beaux-Arts ; sous le régime précédent, elles abritaient le musée de la Résistance ouvrière ».
Aussi ironique que savant, le récit d'Ourednik se découvre truffé d’habiles clins d’œil à divers auteurs ou traditions romanesques, lesquels, dans l'arrière-pays de l’intrigue, ouvrent de multiples horizons littéraires qui sont autant de pistes pour interpreter l'histoire :
- Clin d’œil à Romain Gary, puisque le personnage principal a écrit, sous le pseudonyme de Viktor Jary, un roman intitulé La vie devant soi. « qui a dû sortir en1974 ou 1975 ». (p103).
- Clin d’œil au Gide des Faux Monnayeurs avec une figure du romancier ouvertement mise en abyme ; Clin d’œil à Diderot, ouvertement pastiché au chapitre XXIV : « Lecteur ! Notre récit vous parait dispersé ? Vous avez l’impression que l’action stagne? Que dans le livre que vous tenez en main, il ne se passe au fond rien de très remarquable ? Gardez espoir : soit l’auteur est un imbécile, soit c’est vous ; les chances sont égales. D’autres trépassèrent, oyez ! nous mourrons tous ! Qui c’est qui sait comment ça finira ? On s’embrouille parfois dans sa propre vie sans même s’en apercevoir ; il en va de même pour les personnages de roman.».
- Clin d’œil à Beckett puisque le récit commence sur un banc, avec des personnages qui n’ont plus rien à se dire depuis longtemps, dans un pays où « la plus haute manifestation de l’intelligence consiste à répéter ce que quelqu’un a déjà dit ».
- Clin d’œil à Simenon, avec une sorte de Maigret tchèque qui enquête sur des éléments disparates, comme un crime vieux de quarante ans, un suicide, des incendies ou un viol plus récents.
- Clin d'œil à Borges et Joyce, et à tous les grands maîtres de la déconstruction littéraire, avec en guise d’ouverture un chapitre un en gambit du Roi, le récit lui-même ne débutant qu’au chapitre deux et ne s’achevant (comme l’enquête) que dans un calembour, le titre Classé sans suite désignant in fine le caractère incomplet, inachevé (qu’on soit commissaire, romancier ou lecteur) de toute recherche de sens : « Nous naissons dans un roman dont le sens nous échappe et le quittons sans avoir rien compris » (p 143)
Non sans ingénuité, l’éditeur offre en guise de mode d’emploi ou de guide de lecture une longue postface signée Jean Montenot, qui explicite la démarche de l’écrivain sur le ton professoral de l’essai universitaire.
Le caractère inabouti de l’intrigue ainsi que les jeux d’érudition frôlant parfois le pastiche de son auteur peuvent légitimement laisser pantois un lecteur, qui se sentirait par ci moqué, par là manipulé. En fin classique « pour qui tout est dit et l’on vient trop tard », Patrik Ourednik, traducteur de Rabelais en tchèque, l’avertit à sa manière, avec beaucoup d'esprit :
« - Du nouveau ? Il serait temps, dit le plus vieux au plus jeune
- Si vous croyez que c’est facile! » (p 75)
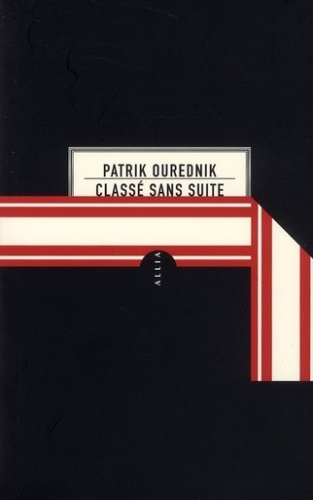
Un bref entretien avec Ourednik, à lire ICI.
07:33 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : classé sans suite, patrik ourednik, allia, prague, littérature, roman | 
lundi, 27 février 2012
Un ange noir
Curieux texte, que le dernier roman de François Beaune. Dans un Lyon dont le centre névralgique serait la place des Terreaux, ses SDF et ses punks à chiens et qui, pour le reste, se résume à des lieux de passage, de travail ou de survie, il examine de près la faillite de l’héritage républicain, « la faillite du code de vie commun » (p 97). A partir d’un fait divers relaté par le Progrès, il plonge son lecteur dans le carnet de bord d’un personnage ambigu, petit blanc fin de race « né avec une sciatique » (p 65) et « vivant parmi les mules obéissantes (p 67). A la croisée de plusieurs mondes, Alexandre Petit (c’est lui l’ange noir annoncé par le titre) tient à la fois du pauvre type, du justicier et du criminel en cavale.
Par une sorte de malédiction maternelle la fois sociologique, affective et onomastique, ce héros qui sait lire ne retient pas ce qu'il lit.. Entendons par là qu’il n’a ni le goût ni le désir ni la capacité de déchiffrer sur le long terme le monde à travers autre chose que des sensations immédiates ou des impressions instable. Sa mère l’ayant détaché, coupé de tout héritage, il ne maîtrise donc ni les codes de l’ancien monde (« boulets de certitudes éculées à traîne derrière soi - p 238), ni vraiment ceux du nouveau. De l’expérience qu’il fait de sa vie sociale, il ne tire qu’une énergie lucide et négative, une énergie d’extermination qui le pousse au crime gratuit, voire sacrificiel. C’est donc un personnage complexe, attachant et malsain, avec lequel le lecteur peut être tout autant distancié qu’en totale empathie : d’où l’intérêt du roman, la richesse du texte, l’originalité du sujet.
Ce personnage règle donc ses comptes non seulement avec sa « vieille carne de mère » institutrice très classe moyenne, mais aussi avec tout son entourage, gens de gauche à la duplicité manifeste qui ont manufacturé la décadence de son univers (« une mauvaise foi, cette tradition de gauche que je pratique depuis l’enfance, et qui s’applique à tout » p 244), qu’ils soient de grands penseurs (nos grands intellectuels s’époumonent au-dessus de la tête des gens, professeurs, intellectuels m’ont appris à viser trop haut » p258) ou de simples militants (« Leur fausse envie de changement me donne des haut-le-cœur. Ils regardent le match, mais ils sont convaincus qu’ils feraient un meilleur entraîneur que celui en fonction» p 110).
Dès lors, écrit le héros, « Mon sort est déjà programmé » (p 52), « Le sort s’acharne et me colle ce crime sur le dos » (p56). Car il cache un secret «difficile à décrire » : pour résumer, dit-il, on ne le trouve pas sympathique : « l’antipathie que je dégage est telle une seconde nature. Je vis avec depuis toujours ». (p 36)
Dans son environnement qui ne lui offre plus rien de naturel (« La ville, quand je respire, se soulève de pollution. Son ombre tremble. La pire odeur, je crois, est cette odeur artificielle de croissant. Je peux vomir au moment où je croise cette onde sucrée de boulangerie dans le couloir du métro »), Alexandre Petit estime « faire partie des rescapés » (p 67) : « nous survivons grâce au progrès de la médecine. La société moderne, en vaccinant, a choisi de faire cohabiter fantômes et vivants, sans distinction » (p 67) Ayant apprivoisé son état maladif, l’ange noir, qui a appris « les petites lâchetés » nécessaires à sa survie va découvrir durant les chapitres de ce texte envoutant le plaisir du crime, un crime qu’il situe entre nécessité et délivrance.
Dans l’univers de François Beaune, il y a ceux qui, proches de l’ironique Dieu des temps modernes, se pavanent de l’autre côté de l’écran parce qu’ils ont réussi, et ces autres que ce même Dieu a oubliés, qui meurent dans la société civile, (infirmiers, policiers, profs, commerçants, punks, SDF…) « Le monde est inversé » (p 157) et «la statistique est une pieuvre aux immenses tentacules ventousés à nos têtes » (p252) : « Statistiquement, nous avons 7,3 fois plus de chances de refaire un chemin familier que d’en prendre un nouveau » (p 191), « 99% de ce qui a vécu que terre a déjà disparu (p169). Statistiquement aussi, nous avons tous une chance de devenir criminels tant le monde est devenu laid et la figure de l’autre haïssable, qu’il soit turc (« Les Turcs attirent les affamés tels les étrons les mouches » « rouleau de bidoche grillant heureux dans l’air rance au milieu des fautes d’orthographe ») ou discounter (« Le discounter est pire qu’un Turc : il touche à tous les coins de la vie de consommateur. Il te noie et te charme de laideur. »)
D’où cet aveu : « j’ai appris à considérer le beau comme un danger. Quand j’aperçois un produit laid comme les yaourts premier prix, je suis instinctivement attiré, je les mets dans mon panier avec plaisir, avec l’impression d’être à ma place. Le laid est l’intuition du pauvre » (p204)

Thriller, fable sociale, le roman pourrait apparaître comme celui d’une génération sacrifiée sur l’autel de la fameuse « adaptation » au monde moderne, qui fut et demeure la litanie de tous les biens pensants du système : « Chacun sait qu’adaptation est mutation, mutation qui réclame le sacrifice d’une génération au minimum, sacrifice dont la prochaine génération bénéficiera car elle aura sa place, elle connaître les nouvelles règles de comportement », écrit Beaune à la fin de son texte, comme pour justifier à la fois l’errance et le sur-place de son héros, surdiplômé et enquêteur à la Sofres, bénévole aux Restos du cœur et antisocial confirmé, adolescent attardé et criminel, héros trouble dans la psyché duquel se lit toute la schizophrénie molle de l’époque.
François Beaune, Un Ange Noir, Verticales, 2011
11:31 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : françois beaune, un ange noir, verticales, littérature, lyon, société, politique | 
vendredi, 24 février 2012
Le prix de l'universel

J’ai relu ce soir une très belle nouvelle de Pirandello, un peu conceptuelle, mais pleine d’une vérité limpide, Les pensionnaires du souvenir. Le dramaturge italien y développe l’idée que les vivants oublient et abandonnent les morts parce que « la réciprocité de l’illusion » n’est plus jouable avec eux : « Vous pleurez parce que le mort, lui, ne peut plus vous donner une réalité. »
Et c’est vrai qu’il y a deux langages : celui de la communication, du débat, de l’échange, fait le plus souvent d’opinions, de préjugés, d’impressions, par lequel nous sommes inévitablement placés vis à vis entre vivants, et ainsi réduits à la part la plus faible de nous-mêmes. Et puis celui de la littérature, composé à meilleure distance, fabriqué de moins de « réciprocité » ou d’immédiateté, et donc plus affranchi du réel, véritablement plus exigeant en termes de solitude et de vérité, et dans lequel l’idée que nous puissions mourir ou disparaître - idée proprement scandaleuse dans le premier type de discours- a cessé de l’être pour devenir ipso facto l’une des conditions d’accès à la lucidité, c’est-à dire à la lecture.
C’est la raison pour laquelle je finis par penser qu’il n’est pas idéaliste de se dire que, quelque dérisoire que soit le débat politique prétendument démocratique face à la réalité verrouillée que nous subissons, et si médiocre soit la production éditoriale contemporaine, la grande littérature qui est usage de la belle langue et quête d’une forme parfaite de soi-même, et qui ne se confond ni avec le débat public, ni avec l’édition, possède encore tout son poids parmi nous, pour peu que dans la communauté de ce nous, nous n’omettions jamais d’inclure tous nos morts.
00:24 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, pirandello, nouvelles, solitude, langage | 
dimanche, 19 février 2012
Le chapeau de Mitterrand
1986, huit mois après les législatives :Un homme retrouve sa femme et son fils sur le quai 23 de la gare Saint-Lazare. Sa femme lui demande d’où il tient le chapeau qu’il porte. Il lui répond que c’est le chapeau de Mitterrand. Alors, t’es président, interroge le fils, espiègle. Oui, je suis président, réplique Daniel Mercier.
C’est ainsi que débute le roman de Antoine Laurain, Le chapeau de Mitterrand, une comédie romanesque plutôt réussie dont le héros est ce fameux chapeau auquel le bandeau de couverture prête des connotations à la Magritte. Comme les personnages de Golconde, plusieurs citoyens plus ou moins ordinaires sont amenés en effet durant le livre à porter ce même chapeau (porter le chapeau ?), sans toujours identifier le nom de son médiatique propriétaire.
Daniel Mercier est un client des luxueuses brasseries parisiennes, dans lesquelles il déguste des plateaux de fruits de mer sitôt que sa femme et son fils ont le dos tourné. Un jour qu’il s’attable parmi ces clients qui ont « chacun sur le visage ce sourire calme et confiant des gens qui ont réussi dans la vie », il a la surprise de voir François Mitterrand, Roland Dumas et un troisième acolyte « un gros trapu à lunettes » prénommé Michel (Charasse ?) s’attabler à ses côtés. Le Président passe commande d’une douzaine d’huitres et d’un saumon, et le pauvre Daniel, cédant à la tontonphilie de ces années là, songe tétanisé qu’il ferait n’importe quoi pour être véritablement le quatrième hôte de la table d’é côté.
Deux heures et demi passent. Le président quitte enfin la table mais oublie son chapeau. Daniel, dont le dernier larcin remonte à 1965 (un 45 tours de Christophe) s’en empare le cœur tremblant. Laurain campe ici un personnage ridicule, presque à la limite du fétichisme, qui en dit long sur ce que le socialisme était devenu sous la conduite d’un tel président. Il enfile le galurin, marqué aux initiales FM en or sur la bande de cuir intérieure : « Il lui semblait que son cerveau baignait dans une aspirine rafraichissante » (p 31). A partir de ce moment, tout lui réussit : investi par une « force tranquille » et « un calme apaisant » (« un chapeau donne à celui qui le porte une autorité sur celui qui n’en porte pas » (p 38), il est nommé par son PDG directeur financier de la Sogélec de Rouen. Le chapeau de Mitterrand en effet, c’est comme le chapeau de Dieu : « depuis qu’il le portait, sa seule présence l’immunisait contre les tourments de la vie quotidienne » Cette imbécilité chronique qui s’est saisi du personnage aurait pu s’arrêter là : en effet en allant avec sa petite famille dans le train, il oublie dans un filet du compartiment de train son précieux talisman et se retrouve saisi d’eczéma dysidrosique. On verra par la suite qu’il n’en sera rien.
C’est une jeune femme de 27 ans qui s’en saisit alors, et qui grâce à lui va interrompre une liaison amoureuse dégradante avec un homme qui refuse de quitter sa légitime pour elle, gagner le prix Balbec de la nouvelle : « Ce chapeau donnait une noblesse inhabituelle à la découpe de son visage, pour qu’il tienne correctement, elle avait relevé ses cheveux en chignon » (p 57) Mais son goût du romanesque la pousse à son tour abandonner le couvre-chef sur un banc de parc Monceau. Le ramasse alors un nouveau-venu, qui l’échangera à son insu dans une brasserie avec quelqu’un d’autre jusqu’à ce qu’après une longue enquête et moult échanges de courrier, le personnage du début (Daniel) rentre en sa possession.
Fou de joie, il offre alors un séjour à Venise à sa femme, Venise où comme hasard se trouve aussi Mitterrand. Un Mitterrand en manteau et écharpe rouge, mais sans chapeau : « Le chapeau et le président venaient de passer à quelques mètres l’un de l’autre » (p 192). « C’est comme s’il manquait quelque chose à la silhouette qui représentait la France dans le monde » ( p 193), songe alors notre illuminé. Nous sommes à quelques jours de l’élection présidentielle de 1988. Après une dernière péripétie, le héros découvre dans la doublure du galurin présidentiel un fin papier rectangulaire, de l’écriture même de Mitterrand : « Récompense, merci », avec le numéro du secrétariat de l’Elysée. On est alors à quelques jours de l’élection présidentielle. Mercier se dit que ce « talisman » qui a modifié sa vie et celles de plusieurs individus peut jouer un rôle. Il téléphone et obtient un rendez-vous avec Mitterrand au Florian où, devenu enfin un convive à part entière du président, il lui rend son chapeau : « Quelques mois après avoir retrouvé son chapeau, François Mitterrand pulvérisa toutes les prédictions des instituts de sondages, se faisant réélire avec 54,2% des suffrages exprimés » (p 211)
A quelques mois des élections de 2012, la lecture de cette fable ironique est assez bienvenue. Elle nous rappelle d’abord à quel point le socialisme fin de courses de Tonton fut vide et plus que tout se résuma en effet, surtout dans les milieux parisiens, à un culte ridicule de la personnalité, dans une société réduite plus que jamais à la parade et au spectacle. On se souvient d’ailleurs qu’au lendemain de la réélection, Libé salua plus l’artiste que l’idéologue convaincu.
Pour qui, au final, vote Antoine Laurain ? C’est la question qu’on peut se poser in fine, tant ce récit habile joue sur plusieurs tableaux, ménageant la chèvre et le chou : si Sarkozy gagne, le romancier pourra toujours dire qu’il l’avait prédit, puisque son président à lui est réélu. Si Hollande l’emporte, il dira alors qu’il avait anticipé la victoire d’un ancien premier secrétaire du PS. Certes, réduire Mitterrand à un chapeau est une métonymie peu flatteuse pour la gauche, y compris pour celle d’aujourd’hui dont les mentors sont le pur produit de ces années-là. En, même temps filtre à travers les lignes une espèce de nostalgie pour cette époque, au fur et à mesure que le lecteur est invité à en retrouver les diverses mythologies : Michel Polac (p 80), Yves Mourousi et Marie Laure Augry (p91), Serge Gainsbourg (p 139) Dallas (p 187), Jean Luc Lahaye (p 188) le franc et le fameux Pascal (p 184), la polémique sur les colonnes de Buren (p 160). La fable demeure ainsi ouverte, même si la satire de la fatuité humaine – chose semble-t-il la mieux partagée au monde – laisse peu de place à une lecture idéaliste de la société contemporaine.
Antoine Laurain - Le chapeau de Mitterrand - Flammarion, 2012
01:03 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : antoine laurain, le chapeau de mitterrand, années 80, satire, littérature, roman | 
samedi, 11 février 2012
L'Astrée techno
Il y a loin du vocabulaire amoureux contemporain aux jeux galants qui avaient cours du temps d'Honré d'Urfé, né par temps frisquet d'un 11 février de l'an 1567. Avec les bergers de l'Astrée, nous voici en Gaule, au Vème siècle de notre ère, dans cette partie de la plaine du Forez qu’arrosent les eaux limpides du Lignon : « Auprès de l’ancienne ville de Lyon, du côté du soleil couchant, il y a un pays nommé Forez qui en sa petitesse contient ce qui est de plus rare au reste des Gaules… » Ainsi débute le roman inachevé d’Honoré d’Urfé, dont les douze premiers livres parurent en 1607, tandis qu’autour du bon roi Henri IV, triomphait la mode des pastorales. En 1610, l’année de Ravaillac, est éditée la seconde partie. Sur ce lien, le texte mis en ligne par Paris Sorbonne.
Se replonger quelques instants dans les aventures d'Astrée et de Céladon, c’est une bonne façon de couper court aux intrigues médiatiques contemporaines et de rompre avec l'à peu près linguistique qui nous sert de langue nationale et de langage amoureux. Imaginons par exemple une traduction en français contemporain de cette phrase, piochée au hasard; c'est Silvandre, s'adressant à Diane : «Ma maîtresse, ne plaignez point la peine que vous avez prise de venir jusques ici; car encore que vous vous soyez un peu détournée, toutefois vous verrez une merveille de ces bois.»
Lire l'Astrée en 2012, c'est tout à la fois probablement s'aventurer en une terra incognita fort périlleuse, s'adonner à une véritable ascèse de l'esprit, et prendre le risque d'une perplexité sans fond. Je m'y étais frotté il y a bien longtemps, lorsque j'étudiais La Nouvelle Héloise de Rousseau. Les années 80 épousaient le déclin et la somnolence d'un président pharaonnique et malade, et le quartier latin n'avait déjà, (de latin), que le nom. Bref, le siècle précédent s'effilochait dans l'ignorance des amours entre bergers et bergères, dans le mépris des ruisseaux et des nymphes, et dans l'oubli des pastorales d'Henri IV. Aussi, ce croustillant feuilleté de culture savante m'avait-il déjà passablement ennuyé, n'étant moi-même plus capable de surprendre l'écho d'un roman national dans le tissu du roman sentimental (comme la préface de je ne sais plus quel universitaire m'y invitait). Quel musicien audacieux serait à présent capable de mettre en musique ce sonnet de l'Astrée en pur langage françois ? Sur un fond techno qui rendrait les paroles inaudibles, il n'est pas dit après tout qu'un certain goût de l'époque pour le frivole et le décalé ne lui assurerait pas un petit succès...
Mon Dieu quel est le mal dont je suis tourmenté ?
Depuis que je la vis ceste Cleon si belle,
J'ay senty dans le cœur une douleur nouvelle,
Encores que larron son œil me l'ait osté.
Depuis d'un chaud desir je me sens agité,
Si toutefois desir, tel mouvement s'appelle,
De qui le jugement tellement s'ensorcelle,
Qu'il joint à son dessein ma propre volonté.
De ce commencement mon mal a pris naissance,
Car depuis le desir accreut sa violence,
Et soudain loing de moy le repos s'envola.
Au lieu de ce repos nâquit l'inquietude,
Qui serve du desir bastit ma servitude :
Voila quel est mon mal, mais mon Dieu qu'est cela ?
Tapisserie représentant Astrée et Céladon au bord du Lignon (Bastie d'Urfé)
09:55 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : l'astrée, honoré d'urfé, littérature, henri iv, pastorales |