lundi, 09 avril 2012
De Myrelingues, de l'incroyance, du torchecul...
On fête aujourd’hui l’anniversaire de la mort de François Rabelais, si l’on en croit un épitaphier du milieu du XVIIIe siècle de l’église Saint-Paul à Paris : «François Rabelais, décédé âgé de 70 ans rue des Jardins le 9 avril 1553 a été enterré dans le cimetière de Saint-Paul». Je me souviens comme d’hier de la récitation qu’un professeur de seconde nous fit, dès notre première rencontre le jour de la rentrée, de la méthode torcheculative, par laquelle Grandgousier connut « l’esprit merveilleux » de son fils Gargantua, et songea d’en faire un jour un « docteur en gai science ». Le pari était audacieux. Me revient en mémoire un certain scepticisme devant ses éclats de rire que je jugeai forcés, ne trouvant pas, moi-même, ce chapitre 13 du Gargantua et son énumération fastidieuse de torchecul si hilarant que ça. D’autant qu’il n’accompagna le texte d’aucune explication, nous laissant seuls avec la faconde d’Alcofribas.
Lui savait -nous pas encore- quel tonnage de commentaires érudits, parfois passionnants, souvent divagants, Rabelais avait engendré. Plus tard, je mis mon nez dans les pages de Lucien Febvre, plus tard dans celles de Spitzer, et plus tard encore dans celles de Bakhtine. Le problème de l’incroyance du XVIe siècle, dans sa belle collection « L’évolution de l’humanité » (téléchargeable ICI) me passionna à l’époque, parce que ce texte mettait en lumière, et j’avais grandement besoin de comprendre cela, « la religiosité profonde de la plupart des créateurs du monde moderne ». La thèse de Febvre (1878-1956) reste une grande et belle œuvre à lire aujourd’hui. Leo Spitzer (1887-1960), je ne l’évoque pas non plus sans quelque émotion parce que bruissaient encore dans sa génération ce souci de s’approprier le passé européen via le style que les siècles successifs avaient imprimé à sa littérature, cette conscience, désormais perdue, que cette littérature est le plus légitime de notre héritage. Bakhtine, enfin (1895-1976), qui dégagea la dimension purement carnavalesque, liée au bas corporel, de l’œuvre.
Il m’arrive parfois de songer, quand je me rends de la place des Jacobins à la rue Grenette en passant par la rue Mercière, que ce fut longtemps le trajet de Rabelais se rendant de l’Hôtel Dieu à l’atelier de François Juste. « Me voici revenu en l’Athènes des Gaules : l’inclyte et famosissime urbe de Lugdune la Myrelingues, Lyon aux dix mille langages, ubi est sedes studiorume meorum… », s’écrie le Rabelais de Claude le Marguet dans son roman Myrelingues la Brumeuse. Il s’agit d’une fantaisie du journaliste qui écrivit dans les années vingt ce roman historique à la gloire du Lyon de 1536. Cela reste un beau coup de chapeau, non seulement à Rabelais lui-même, mais aussi à cette artère où battaient les presses à bras dans tous ces ateliers transformés en restaurants pour touristes, quand ils n’ont pas été détruits lors des rénovations de Louis Pradel. Le souffle et le rire de Rabelais sont certes à présent légers sur la ville, et il faut beaucoup d’imagination pour retrouver l’un ou l’autre dans la mémoire de ses pierres. C’est cependant faisable, en quelque coin plus éminemment poétique qu’un autre, à condition de zyeuter quelque enseigne sculptée ou gravée dans la pierre et d’y rajouter la récitation de quelque verset rabelaisien :
« Ci entrez, vous, qui le saint Evangile
Annoncez en sens agile malgré ce qu'on gronde;
Vous aurez céans refuge et bastille;
Contre l'hostile erreur qui tant distille
Son faux style pour en empoisonner le monde:
Entrez, que l'on fonde ici la foi profonde,
Puis que l'on confonde de vive voix et par rôle
Les ennemis de la sainte Parole. »
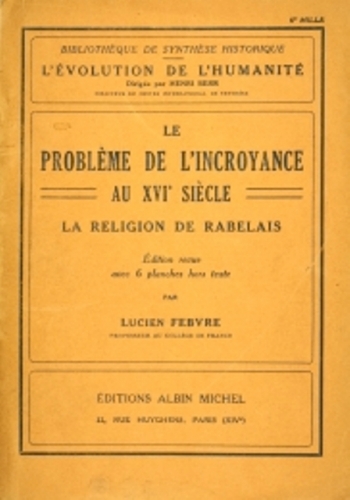
00:15 Publié dans Bouffez du Lyon, Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : myrelingues, torchecul, lucien febvre, françois rabelais, littérature, rue mercière, françois juste, lyon | 
jeudi, 09 septembre 2010
Rue Mercière ...
Je me suis demandé, en la parcourant tout à l’heure, à quoi pouvait ressembler cette rue Mercière au temps serein de sa splendeur. D’un siècle à l’autre, la métamorphose de tant de prestigieux libraires-imprimeurs en restaurateurs suggère, même s’il est assez facile, un commentaire assez accablant pour notre époque. Sébastien Gryphe, Jean de Tournes, François Juste logèrent donc ici, en compagnie de tant d’autres publieurs d’almanachs et de traités, relieurs de livres et tailleurs d’images en tous genres, et voici que je touche un peu du songe leurs enseignes coloriées, là-même où ne s’étale plus que l’ardoise commune de maints plats du jour à quelques euros.
Au musée de l’imprimerie, non loin de là, dans une rue au nom médiéval jusqu’à la caricature (rue de la Poulaillerie, où vécut Pierre Valdo, vestige du vieux marché de la volaille - n’est-ce pas François Villon qui fit dire au frère Archier de Bagnolet : « Meurtre ne fis onc qu’en poulaille… »), la production des anciens maîtres-imprimeurs attend le chaland sous des vitrines impeccablement nettoyées. Là, les colonnes des incunables aux lettrines enluminées, qu’on vient lécher du regard avec ce soupçon de convoitise, gage du beau. J’ai rêvé quelques minutes devant cette page de Der Stadt Nuremberg, qui date de 1595, page posée aux côtés de son bois gravé. Je savais que cette hôtel de la Couronne avait été jadis, la maison du Consulat avant l’édification de l’Hôtel-de-ville des Terreaux. Mais j’ignorais qu’il appartînt auparavant au Crédit Lyonnais. J’ignorais aussi qu’il avait été un bordel.

Sur le chemin du retour m'est venue à l'esprit l'absence prolongée de Marcel Rivière, et je me suis demandé à quel moment de ce besogneux automne à poindre elle finirait par prendre fin.
08:29 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : rue mercière, musée de l'imprimerie, lyon, culture, rues de lyon | 









