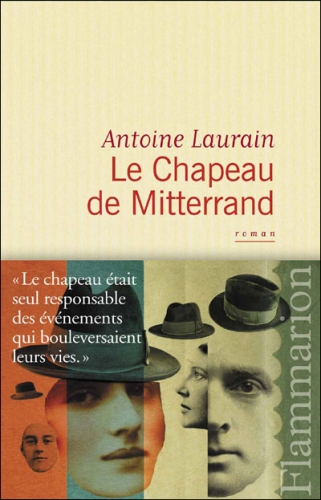vendredi, 20 mars 2015
La Queue chez Alexipharmaque
Merci à Alexipharmaque pour son commentaire en deux temps de La Queue, dont cet extrait qui me touche tout particulièrement : "Un livre, aussi, écrit par un vrai connaisseur de la langue française, qui a fait le pari d’adapter le style de son écriture au contenu du récit – variable donc suivant les moments, comme les couleurs des jours et des saisons". Parce que c'est vrai, soumettre le style au contenu, c'est faire le contraire de ce que le siècle précédent a promu sous le gant de fer des structuralistes, c'est à dire plier le contenu à la toute puissante, à la sacro-sainte forme, et c'est un des grands plaisirs de l'écriture de se laisser couler ainsi, de méandre en méandre ...
(se la couler douce ?)...
18:31 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexipharmaque, la queue, le bug, littérature, roman, thévenet | 
mardi, 31 décembre 2013
Ma dissidence
Parce que nous sommes des individus, nous sommes tous des dissidents : des frontières, que nous ne cernons pas toujours, nous séparent des idéologies et des lieux communs dominants, tout comme de celles et de ceux qui sont moins influents. L’histoire personnelle de chacun d’entre nous a sculpté notre originalité de manière indélébile, et ce caractère original, c'est-à-dire non reproductible, parce qu'il est quasiment archéologique, se heurte en permanence au monde uniforme des sociétés organisées.
La dissidence se distingue de la révolte par le fait qu’elle ne tente pas de changer ni de transformer l’ordre de ces sociétés. Toute société humaine ayant besoin d’ordre, ce serait prendre le risque de devenir soi-même un jour un représentant, voire un garant de cet ordre, et de sombrer ainsi dans l’uniformité, le ridicule, l'ennui de soi, et tout le diktat qui en découle. C’est pourquoi la figure la plus radicale de la dissidence a toujours été incarnée par l’artiste.
Vivre dans un tel monde, j’entends par là le monde contemporain, c’est serrer au plus près sa propre dissidence, au sein de toutes les contraintes – essentiellement sociétales & financières, mais pas seulement – qui nous sont imposées par l’ordre dominant, quel qu’il soit. Voilà pourquoi l’artiste – je veux dire la part la plus artiste de chacun d’entre nous – ne peut être que heurté, choqué par le discours simplificateur des idéologues de tous crins, particulièrement ceux qui sont au pouvoir et prétendent de ce fait régir les mœurs, gérer les affaires et édifier les spectacles de la Cité.
La littérature - tantôt salon précieux et tantôt hall de gare, tantôt estrade de bateleur et tantôt académie d’initiés – est un des lieux où l’individu pour qui c’est une nécessité vitale peut marquer sa dissidence. C’est en tout cas le lieu où moi-même, personnage terne et fondu dans la masse, qu’une carte d’identité, un numéro de sécurité sociale, un autre de compte en banque et quelques autres codes définissent à gros traits pour la société organisée, l’ai sauvegardée. Cela, aussi bien par un travail de lecture que par un travail d’écriture, les deux étant inextricablement liés.
Moi seul sais ce que tout ce travail m’a coûté et m’a apporté. De ce savoir – si l’on peut appliquer un terme aussi ridicule à ce dont il est question, ou de cette connaissance, mais c'est guère mieux, j’ai fait un roman. Le roman de ma dissidence, si l’on veut. Ce texte a du mal, et cela peut se comprendre en raison de sa nature, à trouver un genre (conte philosophique ? épopée ? science-fiction ? fantasy ?). Et partant un éditeur, car ces derniers ont horreur de ce qui n’est pas calibré, normé, ajusté à un public pré-établi, une cible, comme on le dit élégamment en marketing. Ce qui peut se comprendre. Pour ma part, hormis marquer ma propre originalité, je ne sais qui je cible. C'est ainsi. C'est ma seule note d'intention...
Après avoir longtemps croupi dans mon esprit, ce roman croupit donc dans mes cartons depuis un certain nombre de mois. Tout bien considérer, le fait a beau être ennuyeux, il est aussi plutôt flatteur : Ce roman a visiblement un problème avec l'ordre établi. La rencontre directe avec le public étant constitutive de mon originalité, il est donc probable que je me décide un de ces jours à le publier moi-même. Soit sur ce blog, soit ailleurs. En attendant, on peut considérer que ce court texte en est la juste -et juste- la préface.
08:07 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, roman, solko | 
vendredi, 26 avril 2013
A propos d'écrire (1)
Ce qui est plaisant dans l’écriture du roman, c’est cette double posture de l’homme qui sait et de celui qui ne sait pas. Il n’y a pas à tortiller, comme disait ma grand-mère, il faut laisser venir, laisser agir, laisser parler. Mais il faut aussi conduire, diriger, viser.
C’est un sérieux mélange de la plus extrême gravité et d’une pure fantaisie. Le romancier est un dictateur pour rire. Composer un personnage - ou pour un personnage, car derrière chaque être de papier se cache, n’en déplaise à Nathalie Sarraute et son air du soupçon, l’idée au moins d’une personne -, composer un personnage, c’est échapper à l’idéologie.
Et puis il y a le mot juste. L’esprit s’arrête parfois. Et c’est le trou.
On sait qu’un mot est attendu là, un seul. Et le reste de la phrase, du paragraphe parfois est au rendez-vous, mais le mot manque.
Ne reste alors que deux solutions : soit passer outre, se contenter d’un synonyme qu’on biffe et qui sert de pis aller, en attendant le lendemain ou une prochaine relecture. Soit l’attendre. S’allonger, fermer les yeux, guetter dans le silence comme un chat sa proie. Car si j’ai le pressentiment, même confus, du mot qui devrait se trouver à cette place, c’est qu’il existe. Les mots sont comme les personnages, n’en déplaise aux mythomanes du Nouveau Roman : il y a toujours une réalité derrière…
20:47 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, écriture, roman | 
dimanche, 14 avril 2013
Arracher les jours
Je viens d’arracher un dimanche d’écriture au monde. Ça n’a l’air de rien, mais ce n’est pas évident : le boulot au lycée, brouhaha continuel et vain d’un présent désenchanté dans lequel sont englués élèves et professeurs ; le spectacle blasé de l’échec programmé de Hollande et de ses clowns, qui ont tous l’air d’exister il y a vingt ans en arrière de cela ; l’écoute désenclavée des colères de la rue de toutes natures, qui toutes ont leur légitimité, et qui, quoi qu’il arrive, n’aboutiront pas, parce que le pouvoir n’appartient plus à la rue, depuis un certain vote pour Maastricht.
Long travail, depuis début février, aux deux-tiers accomplis. Demeure un tiers. A peu près.
Impression de livrer un combat solitaire pour quelques-uns qui me liront. Impression de planer, déconnecté de ce qu’ils nomment le Réel, avec un personnage familier en train de prendre corps, ou un autre, figure, à l’esprit, plutôt que dans le bus ou le magasin, sur le trottoir, des inconnus, des étrangers. Et merci.
Quand ce roman sera achevé, ne pas penser encore à la quête d’éditeurs, trop décourageant ! Comme le sont ces piles d’invendus dans les centres de distribution d’objets culturels indéterminés, ce désamour patent de tout une peuple pour sa littérature, dont je suis le témoin attristé dans les écoles, depuis bientôt vingt ans. Trop long métier.
Parfois, ce n’est qu’une phrase d’écrivain piochée dans un livre au hasard qui relance la machine, met fin au découragement, au désœuvrement, comme le disait joliment Balzac. Car il faut éviter le suicide de son talent.(1) Ce n’est pas un vain mot que de dire que lorsqu’on s’attèle à l’écriture, on a pour frères tous ceux qui ont écrit, poussé la charrue devant, et creusé le sillon.
Quand vraiment ça peine, ça tire, ça coince, je contemple tel ou tel de leur visage. Sur le web, des photos des uns, des autres. J’ai devant moi dans mon bureau cette photo de Béraud à sa table de travail, par Blanc & Demilly, acquise en salle des ventes, l’an passé.
Ce billet que je conclus n’est qu’une lucarne entrouverte. Pour m’aider à m’y remettre au prochain jour arraché, au prochain vol...
(1) Balzac, La cousine Bette
21:29 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : béraud, écriture, roman, littérature | 
mardi, 28 février 2012
Classé sans suite

Patrik Ourednik
Les éditions Allia viennent de publier un court roman de l'écrivain tchèque Patrik Ourednik, Classé sans suite. Original, le récit débute véritablement au chapitre deux, sur un banc : « Les arbres recyclaient le gaz carbonique dans la crainte de Dieu ». Nous nous trouvons à Prague, aux cotés d'un héros vieillissant, dans un espace fraîchement recomposé par les incessantes turbulences du siècle : «Le banc de Dyck se trouvait sur une place presque villageoise, limitée d’un côté par une église, de l’autre par d’anciennes écuries, aujourd’hui musée Andy Warhol. Les écuries dépendaient d’un relais de chasse, aujourd’hui Académie des Beaux-Arts ; sous le régime précédent, elles abritaient le musée de la Résistance ouvrière ».
Aussi ironique que savant, le récit d'Ourednik se découvre truffé d’habiles clins d’œil à divers auteurs ou traditions romanesques, lesquels, dans l'arrière-pays de l’intrigue, ouvrent de multiples horizons littéraires qui sont autant de pistes pour interpreter l'histoire :
- Clin d’œil à Romain Gary, puisque le personnage principal a écrit, sous le pseudonyme de Viktor Jary, un roman intitulé La vie devant soi. « qui a dû sortir en1974 ou 1975 ». (p103).
- Clin d’œil au Gide des Faux Monnayeurs avec une figure du romancier ouvertement mise en abyme ; Clin d’œil à Diderot, ouvertement pastiché au chapitre XXIV : « Lecteur ! Notre récit vous parait dispersé ? Vous avez l’impression que l’action stagne? Que dans le livre que vous tenez en main, il ne se passe au fond rien de très remarquable ? Gardez espoir : soit l’auteur est un imbécile, soit c’est vous ; les chances sont égales. D’autres trépassèrent, oyez ! nous mourrons tous ! Qui c’est qui sait comment ça finira ? On s’embrouille parfois dans sa propre vie sans même s’en apercevoir ; il en va de même pour les personnages de roman.».
- Clin d’œil à Beckett puisque le récit commence sur un banc, avec des personnages qui n’ont plus rien à se dire depuis longtemps, dans un pays où « la plus haute manifestation de l’intelligence consiste à répéter ce que quelqu’un a déjà dit ».
- Clin d’œil à Simenon, avec une sorte de Maigret tchèque qui enquête sur des éléments disparates, comme un crime vieux de quarante ans, un suicide, des incendies ou un viol plus récents.
- Clin d'œil à Borges et Joyce, et à tous les grands maîtres de la déconstruction littéraire, avec en guise d’ouverture un chapitre un en gambit du Roi, le récit lui-même ne débutant qu’au chapitre deux et ne s’achevant (comme l’enquête) que dans un calembour, le titre Classé sans suite désignant in fine le caractère incomplet, inachevé (qu’on soit commissaire, romancier ou lecteur) de toute recherche de sens : « Nous naissons dans un roman dont le sens nous échappe et le quittons sans avoir rien compris » (p 143)
Non sans ingénuité, l’éditeur offre en guise de mode d’emploi ou de guide de lecture une longue postface signée Jean Montenot, qui explicite la démarche de l’écrivain sur le ton professoral de l’essai universitaire.
Le caractère inabouti de l’intrigue ainsi que les jeux d’érudition frôlant parfois le pastiche de son auteur peuvent légitimement laisser pantois un lecteur, qui se sentirait par ci moqué, par là manipulé. En fin classique « pour qui tout est dit et l’on vient trop tard », Patrik Ourednik, traducteur de Rabelais en tchèque, l’avertit à sa manière, avec beaucoup d'esprit :
« - Du nouveau ? Il serait temps, dit le plus vieux au plus jeune
- Si vous croyez que c’est facile! » (p 75)
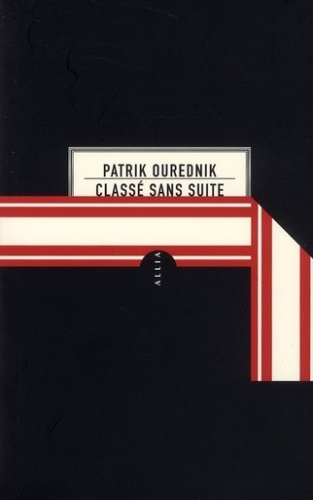
Un bref entretien avec Ourednik, à lire ICI.
07:33 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : classé sans suite, patrik ourednik, allia, prague, littérature, roman | 
dimanche, 19 février 2012
Le chapeau de Mitterrand
1986, huit mois après les législatives :Un homme retrouve sa femme et son fils sur le quai 23 de la gare Saint-Lazare. Sa femme lui demande d’où il tient le chapeau qu’il porte. Il lui répond que c’est le chapeau de Mitterrand. Alors, t’es président, interroge le fils, espiègle. Oui, je suis président, réplique Daniel Mercier.
C’est ainsi que débute le roman de Antoine Laurain, Le chapeau de Mitterrand, une comédie romanesque plutôt réussie dont le héros est ce fameux chapeau auquel le bandeau de couverture prête des connotations à la Magritte. Comme les personnages de Golconde, plusieurs citoyens plus ou moins ordinaires sont amenés en effet durant le livre à porter ce même chapeau (porter le chapeau ?), sans toujours identifier le nom de son médiatique propriétaire.
Daniel Mercier est un client des luxueuses brasseries parisiennes, dans lesquelles il déguste des plateaux de fruits de mer sitôt que sa femme et son fils ont le dos tourné. Un jour qu’il s’attable parmi ces clients qui ont « chacun sur le visage ce sourire calme et confiant des gens qui ont réussi dans la vie », il a la surprise de voir François Mitterrand, Roland Dumas et un troisième acolyte « un gros trapu à lunettes » prénommé Michel (Charasse ?) s’attabler à ses côtés. Le Président passe commande d’une douzaine d’huitres et d’un saumon, et le pauvre Daniel, cédant à la tontonphilie de ces années là, songe tétanisé qu’il ferait n’importe quoi pour être véritablement le quatrième hôte de la table d’é côté.
Deux heures et demi passent. Le président quitte enfin la table mais oublie son chapeau. Daniel, dont le dernier larcin remonte à 1965 (un 45 tours de Christophe) s’en empare le cœur tremblant. Laurain campe ici un personnage ridicule, presque à la limite du fétichisme, qui en dit long sur ce que le socialisme était devenu sous la conduite d’un tel président. Il enfile le galurin, marqué aux initiales FM en or sur la bande de cuir intérieure : « Il lui semblait que son cerveau baignait dans une aspirine rafraichissante » (p 31). A partir de ce moment, tout lui réussit : investi par une « force tranquille » et « un calme apaisant » (« un chapeau donne à celui qui le porte une autorité sur celui qui n’en porte pas » (p 38), il est nommé par son PDG directeur financier de la Sogélec de Rouen. Le chapeau de Mitterrand en effet, c’est comme le chapeau de Dieu : « depuis qu’il le portait, sa seule présence l’immunisait contre les tourments de la vie quotidienne » Cette imbécilité chronique qui s’est saisi du personnage aurait pu s’arrêter là : en effet en allant avec sa petite famille dans le train, il oublie dans un filet du compartiment de train son précieux talisman et se retrouve saisi d’eczéma dysidrosique. On verra par la suite qu’il n’en sera rien.
C’est une jeune femme de 27 ans qui s’en saisit alors, et qui grâce à lui va interrompre une liaison amoureuse dégradante avec un homme qui refuse de quitter sa légitime pour elle, gagner le prix Balbec de la nouvelle : « Ce chapeau donnait une noblesse inhabituelle à la découpe de son visage, pour qu’il tienne correctement, elle avait relevé ses cheveux en chignon » (p 57) Mais son goût du romanesque la pousse à son tour abandonner le couvre-chef sur un banc de parc Monceau. Le ramasse alors un nouveau-venu, qui l’échangera à son insu dans une brasserie avec quelqu’un d’autre jusqu’à ce qu’après une longue enquête et moult échanges de courrier, le personnage du début (Daniel) rentre en sa possession.
Fou de joie, il offre alors un séjour à Venise à sa femme, Venise où comme hasard se trouve aussi Mitterrand. Un Mitterrand en manteau et écharpe rouge, mais sans chapeau : « Le chapeau et le président venaient de passer à quelques mètres l’un de l’autre » (p 192). « C’est comme s’il manquait quelque chose à la silhouette qui représentait la France dans le monde » ( p 193), songe alors notre illuminé. Nous sommes à quelques jours de l’élection présidentielle de 1988. Après une dernière péripétie, le héros découvre dans la doublure du galurin présidentiel un fin papier rectangulaire, de l’écriture même de Mitterrand : « Récompense, merci », avec le numéro du secrétariat de l’Elysée. On est alors à quelques jours de l’élection présidentielle. Mercier se dit que ce « talisman » qui a modifié sa vie et celles de plusieurs individus peut jouer un rôle. Il téléphone et obtient un rendez-vous avec Mitterrand au Florian où, devenu enfin un convive à part entière du président, il lui rend son chapeau : « Quelques mois après avoir retrouvé son chapeau, François Mitterrand pulvérisa toutes les prédictions des instituts de sondages, se faisant réélire avec 54,2% des suffrages exprimés » (p 211)
A quelques mois des élections de 2012, la lecture de cette fable ironique est assez bienvenue. Elle nous rappelle d’abord à quel point le socialisme fin de courses de Tonton fut vide et plus que tout se résuma en effet, surtout dans les milieux parisiens, à un culte ridicule de la personnalité, dans une société réduite plus que jamais à la parade et au spectacle. On se souvient d’ailleurs qu’au lendemain de la réélection, Libé salua plus l’artiste que l’idéologue convaincu.
Pour qui, au final, vote Antoine Laurain ? C’est la question qu’on peut se poser in fine, tant ce récit habile joue sur plusieurs tableaux, ménageant la chèvre et le chou : si Sarkozy gagne, le romancier pourra toujours dire qu’il l’avait prédit, puisque son président à lui est réélu. Si Hollande l’emporte, il dira alors qu’il avait anticipé la victoire d’un ancien premier secrétaire du PS. Certes, réduire Mitterrand à un chapeau est une métonymie peu flatteuse pour la gauche, y compris pour celle d’aujourd’hui dont les mentors sont le pur produit de ces années-là. En, même temps filtre à travers les lignes une espèce de nostalgie pour cette époque, au fur et à mesure que le lecteur est invité à en retrouver les diverses mythologies : Michel Polac (p 80), Yves Mourousi et Marie Laure Augry (p91), Serge Gainsbourg (p 139) Dallas (p 187), Jean Luc Lahaye (p 188) le franc et le fameux Pascal (p 184), la polémique sur les colonnes de Buren (p 160). La fable demeure ainsi ouverte, même si la satire de la fatuité humaine – chose semble-t-il la mieux partagée au monde – laisse peu de place à une lecture idéaliste de la société contemporaine.
Antoine Laurain - Le chapeau de Mitterrand - Flammarion, 2012
01:03 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : antoine laurain, le chapeau de mitterrand, années 80, satire, littérature, roman | 
jeudi, 09 juin 2011
Le neveu de personne
-Que faisiez-vous, il y a plus de vingt ans ?
- Moi ? J’écrivais un roman.
-Vous n’aviez pas encore compris que c’était vain ?
-Il m’a fallu l’écrire pour cela.
-Que racontait votre roman ?
-Une vie. Pas la mienne, je vous rassure.
-Laquelle ?
-Celle d’un homme que j’avais rencontré dans la morgue d’un hôpital où je travaillais pour gagner ma croûte. Celle d’un gardien d’amphithéâtre.
-Et que se passait-il dans ce roman?
-Honnêtement, pas grand-chose. Cet homme veillait.
-Mais encore ?
-A un moment il tombait amoureux.
-Et alors ?
-Il résistait.
-Pourquoi ?
-Parce qu’il savait comment tout finit entre deux serpillères.
-Et vous avez trouvé un éditeur ?
-A l’époque, oui.
-Lequel ?
-A quoi bon le nom précis. Non loin de Saint-Sulpice, et de cette magnifique chapelle dont le plafond fut peint par Delacroix. Dans une petite rue en pente.
-Et alors ?
-Dans cette honorable et vieille maison, on m’a proposé d’éditer mon roman, à condition que j’y retouchasse deux trois bricoles.
-Vous avez accepté ?
-Non.
-Vous avaient-ils demandé l'impossible ?
-J’avais conçu l’amphithéâtre comme une véritable métaphore de la conscience. Une architecture inhérente au texte. Aux personnages eux-mêmes. Une véritable métaphore de la conscience du pays qui était en train de disparaître dans les années 80, voyez. Disparaître ! La France des rivières non polluées, où se péchaient des vairons. Cette France dont mon gardien veillait, sans autre raison que la précarité matérielle qui déjà gouvernait son existence, les morts. Ils ont trouvé qu’il y avait trop de métaphores pour un public déjà bien peu « littéraire ». C’est eux qui affirmaient cela, je précise.
-Je vois à votre mine qu’ils ont renâclé pour autre chose.
-Ils m’ont dit : « gardez le principe de votre conscience, mais rendez tout cela plus croustillant. Si votre gardien pouvait coucher un peu, de ci de là, avec ses morts… »
-Vous avez tiqué ?
-Ce n’est pas le mot. J’aurais pu accepter, rentrer dans le circuit, le marché comme on dit. C’était avant Darrieussecq, Beigbeder, Catherine Millet et le reste des guignols… C’était ça, donc, ou bien… Je n’ai pas voulu me vendre. J’ai repris mon manuscrit.
-Quelle vanité !
-J’ai passé les concours d’enseignement. J’ai gardé ma liberté de parole.
-Votre liberté ? Mais si personne ne vous lit ?
-Je n’ai pas besoin qu’on me lise pour pouvoir manger. Ni pour payer mes crédits.
-Et vous ne regrettez pas cette décision ?
-Dans un monde où tout est à crédit, non !
-Ils sont plus riches que vous, les guignols…
-Ils ne viennent pas, non plus, d’où je viens.
-Franchement ?
-A la surface des choses, parfois, évidemment, j’ai de profonds regrets. Ah, tâte-toi le cœur, tâte-toi le cœur, me dis-je ! Car l’enseignement de la littérature, enfin de ce qu’est devenue cette malheureuse littérature française -et je rajoute bien : française - dans ce que sont devenus l’école, les lycées… L’enseignement de la littérature est un métier… A la surface des choses, donc, m’arrivent parfois de profonds et mélancoliques regrets. Mais en mon for intérieur, jamais ! Je n’ai jamais regretté.
-Et aujourd’hui, si on vous proposait à nouveau…
-Quoi ?
-Si on vous proposait…
-Je me sens plus lourd, beaucoup plus opaque qu’à l’époque, blindé. Et aussi beaucoup plus léger. Incroyablement plus décrotté. Si un éditeur me proposait…
- Eh bien ?
- Connaissez-vous la fin du Neveu de Rameau ? C’est un livre extraordinaire, savez-vous ? Un des dix ou quinze bouquins qui s’emporteraient sans réfléchir à deux fois sur l’ile déserte s’il fallait demain déguerpir…. Tout le monde y danse un peu le pas de cette pantomime, savez-vous ? La superbe pantomime des Gueux.
-Continuez !
-On m’a marché sur la queue, et je me relèverai, dit le Neveu au Philosophe incrédule.
-Et alors ?
-Peut-être est-ce ce que je dirai à l’Editeur. Vous m’avez marché sur la queue, et je me suis relevé. Après tout, qu’est-ce qu’un éditeur, quand on a son salaire qui tombe chaque mois ? De quoi avons-nous besoin de lui ? Je lui dirai : marchand…
-Il vous rira au nez
- Je lui dirai : marchand, appartenez-vous toujours à la Compagnie Générale des Eaux, ou quelqu’un d’autre vous-a-t-il encore racheté les bottes, l'assiette et le chapeau ?
-Vous le ferez vous rire au nez, c’est assuré !
- Je lui dirai : allons, allons, je veux voir aussi le pas de votre danse…
- Il vous répondra d’aller vous faire f… dans vos classes bondées !
- Mais je fais cela très bien sans lui, et depuis fort longtemps. Connaissez-vous la dernière phrase du Neveu de Rameau ? J’irai me faire foutre, lui dirai-je, à condition qu’il me la lise.
- Il vous dira vanité !
- Je répondrai ignorance. Allons, allons, petit bonhomme, qu’il me la lise et sur-le-champ! Elle sonne si juste à mon oreille que quand il m’arrive parfois de relire les feuillets de l’Amphithéâtre, je me réjouis tout seul à me la répéter.
-N’est-ce pas vous qui prétendiez qu’écrire un roman vous semblait désormais vain ?
-Que dire alors de l'éditer ?
-Et que dire d’enseigner ?
-Vous touchez-là un sujet délicat. Nous en avons déjà parlé hier, le motif est sans fin. Mais je ne suis, moi, le Neveu de personne. Passez, monsieur mon contradicteur, la nuit qui vous convient. Et n’oubliez pas de lire, à la toute fin…

Le Neveu de personne a été écrit en 2009 (déjà). Je le republie aujourd’hui, en vous invitant également à lire ICI le billet qu’un écrivain consacre, sur son blog, à ses rapports avec divers éditeurs …
10:06 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : littérature, édition, roman, diderot, le neveu de rameau, le gardien d'amphithéâtre | 
mardi, 15 septembre 2009
De l'écriture en tant que choix
Ecrire, c’est avant tout cela : faire un choix.
Entre tel et tel adjectif, tel et tel temps ou mode, telle et telle figure de style, tel et tel registre de langue…
Tel et tel lieu commun, également, tant la langue est une mère prostituée.
Ecrire c’est suivre aussi le fil de sa pensée sans perdre l’énergie.
C’est encore entretenir avec quelques livres et quelques auteurs une conversation vivante
Dans la mesure du possible,
Je veux dire dans la mesure où le monde actuel et ses contingences
Le permet.
Ecrire c’est enfin adhérer à sa propre solitude, la plus profonde et la plus juste :
Ne pas la fuir, ne pas la nier, ne pas tenter de la combattre ou de la falsifiier.
Lui donner la parole, ce qui demeure une haute exigence et une vraie délicatesse à l’égard de soi-même,
Dans un propos adressé à autrui
13:58 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : ecriture, littérature, roman | 
jeudi, 10 juillet 2008
Le Bât d'Argent (Joseph Jolinon)
« Moins de dignité, un peu plus de fric » : La formule résume la triple crise, économique, morale et religieuse, qui cingle de plein fouet la bourgeoisie lyonnaise au cours des années trente, et dont témoigne le cycle des trois romans que le romancier Joseph Jolinon consacre à la décomposition d’une famille, les Debeaudemont. La question romanesque de la transmission (celle de l’argent, celles des sentiments, des comportements, des valeurs) est au centre crucial des enjeux sur lesquels reposent les intrigues entremêlées : Tout comme la mère, fille de financiers « apparentée à ce que Lyon compte de bourgeoisie ancienne restée pure de mésalliance », a tenté comme elle le pouvait, durant les deux premiers tomes, de concilier adultère et catholicisme, le fils va longtemps hésiter entre sa passion, qu'il croit sincère, pour une dactylo de la Guillotière et la dot, qu'il sait nécessaire, que lui tend un des partis les plus intéressants de la ville :
"Les heures se succèdent, sonnées avec lenteur par les églises de la ville ancienne, aux cloches différentes, éveillant les souvenirs de combien de générations retournées en poussière, parmi lesquelles combien de fils de familles tombés dans les bras de filles du peuple ! Pathétiques nuits lyonnaises au bord de la Saône au calme plat, fenêtres closes et feux éteints, toutes barques amarrées Nuits en mouvement perpétuel d'eau qui coule des collines et des brumes qui renaissent pour s'évanouir, vouées à la vie secrète"
Quant au père, on sait depuis la fin de L'Arbre sec qu'il a fini suicidé dans la Saône. A la fin de ce tome III (Le Bât d’Argent), son digne rejeton qui finit marié à une femme qu'il n'aime pas s’exclame : « ça m’est égal,, pourvu que ça dure autant que moi » : Moi ! Tel sera donc le mot de la fin de la trilogie, et on sait combien, dans un roman bien ficelé, ce dernier mot compte. Comment mieux mettre l’accent sur cette montée en puissance des divers individualismes qui structurent l’ensemble des conflits présents, conflits que ni l’époque ni la ville n’ont les moyens d’absorber ? La scène durant laquelle est estimée à son juste pesant d’or la valeur de l’héritage qui a survécu aux affres de quatorze-dix-huit, mille neuf cent dix-sept et mille neuf cent vingt-neuf est, à ce titre, éloquente :
« Emprunt de l’Etat Russe, à quatre et demi Obligations de cinq cent francs...
- Combien ?
- Cent soixante.
- Quatre-vingt mille francs qu’il a mis là ! Une part de la dot de ta mère Ca vaut quinze cents francs le tout, à l’heure actuelle. C’est quand même foutant ! Continue !
- Cinquante emprunts à Saint-Pétersbourg, 1912
- Même chose. Passons !
- Brazil Railway Company, six pour cent, 1913. Vingt obligations ...
- Ce n’est plus côté depuis cinq ans il y a un procès… »
Cela se poursuit durant des pages : moment pathétique durant lequel le Bât d’Argent, point encore absolument vide, se découvre tout de même pathétiquement bien entamé : « La génération qui borde le ciel de nuées tragiques n’est pas celle qui reçoit l’averse », en conclut le fils de famille à une autre page du roman. Belle formule, et comme vouée à être répétée fort amèrement par chaque génération qui suit l'autre : « Tout nous dit que nous ne vieillirons pas comme vous, derrière des banques et des frontières barbelées, jouissant à loisir du droit de cultiver les arts, de gominer nos phrases et nos cheveux blancs ». Tandis, donc, que le fils se console dans les bras de sa maîtresse, une fille du faubourg avec lequel il apprend durant quelques jours à regarder le monde d’en bas, et pour laquelle il vendra tout de même, avant qu'elle ne meure, "la moitié de son paquet de titres", sa digne mère - à qui tout le monde répète que le deuil lui va bien - contemple inlassablement des paysages : « Que de laideurs démocratiques », soupire tristement la dame de Lyon, sur le point d’arranger le mariage du dernier représentant des Debeaudemont du haut du fort de Loyasse, «que de laideurs », comme « une offense à sa jeunesse », «les jardins ouvriers » et «les habitations à bon marché » qui fleurissent et sur la colline et la défigurent...
Avec ce mariage final, chacun peut penser que tout va rentrer dans l’ordre, la loi voulant que 1934 suive harmonieusement 1933, lequel se serait en toute simplicité substitué à 31-32, avec la même allégresse qu'un pas de danse sur un parquet ciré ; le père aurait remplacé le fils et la dame de Lyon pourrait retourner prier à Fourvière en compagnie de sa bru, en toute tranquillité. Mais le romancier nous rappelle discrètement qu'entre 1931 et 1935, des événements se sont déroulés en Europe : mines qu'il dépose, en quelque sorte, les pas de personnages moins avertis qu'il ne l'est. On comprend que ce mariage sera le commencement d'une autre dégringolade.
Certes, Joseph Jolinon n'a pas ce style claironnant, parfois flamboyant qu'on reconnait - et moi le premier - à Henri Béraud. C'est un auteur au verbe plus neutre, qui décline son phrasé un ton en-dessous. Il a cependant une façon malicieuse de travailler le cliché, en artisan de la langue conscient et soucieux du bel ouvrage. Cliché, mis au service de la lucidité. La critique de l'époque l'a souvent comparé à Montherlant (en raison, sans doute, de son discours récurrent sur l'avènement du sport). Ce qui m'intéresse chez lui, c'est sa façon de tirer un parti romanesque de la crise insoluble que traverse la société bourgeoise des années trente. Avec cette trilogie qui mériterait une réédition, il brisait, pour ses contemporains qui se croyaient "à l'abri", une illusion très vivace dans la France de son temps - et qui l'est certainement dans celle du nôtre : celle qu’on pourrait, au nom du droit magique que confère la "mondanité", échapper aux violences des remous de l’Histoire, au nom des droits de l'homme et de ceux du chrétien, court-circuiter comme par enchantement ceux, toujours prégnants en littérature et ailleurs, du Destin.
19:32 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, jolinon, lyon, roman, romans, culture |