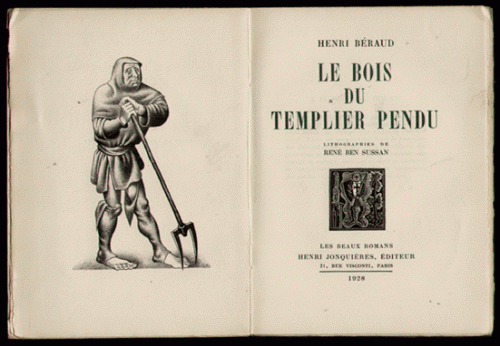dimanche, 18 mai 2014
Falco & la vie volée
Je regardais l’autre jour une série dont on dit « qu’elle cartonne » sur TF1. Le thème en est la vie volée. Elle met en scène un policier dans la tête duquel son meilleur ami a planté un pruneau, une vingtaine d’années plus tôt. Il sort du coma, retrouve sa femme qui a épousé un autre homme, sa fille qui est adulte, son commissariat métamorphosé, le tout dans une société qui a complètement changé. Il se heurte à l’indifférence des vivants, seulement rompue par la surprise parfois gênée de ses proches. Il plonge dans ses enquêtes, pour se divertir de son mal. On pressent qu'il finira par devenir lui-même, au fil des épisodes, l'objet principal de son enquête.
Le thème n’est pas très original, nombre d’écrivains, dont Béraud dans son magnifique roman Lazare, l’ont déjà traité dès les années 20. C’était à l’époque des soldats blessés qui, après un long coma, se heurtaient à l’indifférence des gens de l’après-guerre, avides de jouir.
Et je me demandais s’il est vraiment nécessaire que son meilleur ami vous ait jadis planté un pruneau dans le crâne pour éprouver un tel malaise, un tel insidieux sentiment : sentir sa vie volée. D’une certaine façon, et c’est peut-être ce qui explique le succès de cette série, nous avons tous une part intime de nous-mêmes, de notre vie, de notre temps, qui a été, qui est et qui sera encore volée. Tout cela est lié à la façon dont le monde, la société – qui ne sont rien d’autres qu’une sorte de coma de l’âme – se saisissent de nous, à celle dont nous jugeons les autres, qui tout autant nous jugent, à ce qui se fige là-dedans.
C’est un drôle de sentiment, qui se mêle à ceux de la diversion, de la déception. Vie volée : Y entrent sans doute en jeu autant de lucidité que d’illusions. Il laisse un grand vide au cœur, avec l'impression -fondé ou non- que le mystère de vivre s’est encore un peu plus épaissi, et que l’on n’a cette fois-ci, dans une société de plus en plus perdue, déboussolée, fausse, plus aucun droit à se laisser distraire. Mais distraire de quoi ? Résonne alors à nouveau la question que posa, un jour, le poète Rimbaud : Comment agir, ô cœur volé ?

20:20 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : falco, vie volée, policier, polar, tf1, rimbaud, lazare, béraud, séries tv | 
dimanche, 10 novembre 2013
Le canard déchainé
Je ne sais trop quelle folie commémorative s’abat sur nous. La frontière est toujours tenue, dans ce genre de manifestations, entre recueillement et travestissement, mémoire et lieu commun, symbole et spectacle. Dans Ce que j’ai vu à Berlin, Béraud raconte que les Allemands ont regretté de n’avoir pas avoir eu l’idée du soldat inconnu avant nous. Car même s’il ne le dit pas en ces termes, Béraud démontre que le soldat inconnu est une géniale opération de communication voulue par Clemenceau. Anne Méaux dira la même chose à propos de la Libération de Paris et de la descente des Champs par De Gaulle. La communication politique- propaganda - naît vraiment au vingtième siècle, l’ère des médias, même si l’Eglise et les Rois ont toujours su pratiquer l’art du spectacle. Nous sommes, avec le media moderne, dans le différé et le retransmis, ce qui change la donne aussi bien dans la création du spectacle que dans ses effets.
On nous annonce donc un calendrier commémoratif. Le Goncourt de cette année, que je n’ai le temps ni de lire ni de chroniquer, a ouvert cette vaste entreprise de marketing. Mieux vaut relire Paul Lintier et Galtier-Boissière, sans aucun doute. Ou même Tardi. La guerre de Troie eut son Homère. Celle de Quatorze aura eu sa multitude de copistes, signe qu’elle fondait un nouveau monde ; c’était la première fois qu’on utilisait aussi systématiquement l’arme chimique, et qu’on pratiquait avec tant de véhémence le fameux bourrage de crânes. Le Canard Enchaîné, dont la dernière Une raille les velléités commémoratives de l’actuel président demeure le dernier journal à tradition polémique, parmi tous ceux qui naquirent de la contestation de la grande Muette d’alors. Signe qu'une certaine presse, dont on apprend dans les écoles de journalistes que le respect de la ligne éditoriale doit être la seule lettre et le cirage de pompes de la politicaille le seul esprit a, hélas, mis fin à la libre parole, au nom du mythe absurde de l'objectivité et de celui, au moins aussi absurde, de la République .
21:36 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : béraud, lintier, tardi, canard enchaîné, littérature, polémique, clemenceau, anne meaux, soldat inconnu | 
jeudi, 24 octobre 2013
La grève des milliardaires et le courroux du philosophe
 Les footballeurs devraient s’entourer de quelques conseillers en communication. Déjà, parler de grève dans une profession dont le revenu moyen mensuel s’élève à 50 000 euros a quelque chose d’obscène. Cela fait penser à la sortie d’Evra, pourtant reconduit en sélection nationale par le comique Deschamps, traitant de clochards Courbis et autres consultants presse. Mais pousser le vice jusqu'à la faire pour de bon, je crois que c'est suicidaire.
Les footballeurs devraient s’entourer de quelques conseillers en communication. Déjà, parler de grève dans une profession dont le revenu moyen mensuel s’élève à 50 000 euros a quelque chose d’obscène. Cela fait penser à la sortie d’Evra, pourtant reconduit en sélection nationale par le comique Deschamps, traitant de clochards Courbis et autres consultants presse. Mais pousser le vice jusqu'à la faire pour de bon, je crois que c'est suicidaire.
J’étais, je m’en souviens, en Avignon en juillet 98. Nous jouions mon adaptation du Moine de Lewis et je planais bien dans ma bulle. Pour une affaire de comédienne ayant eu un nez cassé, nous avons eu vent de ce qui se passait aux urgences de l’hôpital cette nuit là de coupe du monde, et qui était proprement terrifiant. Le carnaval de la culture foot, c'est à dire du foot érigé en culture débutait dans ce malheureux pays, récupéré par un pouvoir politique qui avait à vendre du black blanc beur, pure ineptie en lieu et place du bleu blanc rouge. Je me souviens qu’à l’époque, j’avais trouvé le slogan inepte sans plus m’y arrêter. Subtil subterfuge par lequel la race prenait la place de la classe dans la mythologie politique post-moderne. Là-dessus la zone Europe avec ses états historiques privés de leur souveraineté monétaire. Là-dessus la crise orchestrée par le monde de la finance internationale, la mondialisation, les délocalisations Là-dessus les peurs galopantes et sans doute légitimes sur le sort de cette humanité à 7 milliards d’epsilons complètement dépendants en général et sur le sien en particulier.
Dans le Monde de ce soir,:Jean Birnbaum accuse Finkielkraut de lepénisme pour avoir écrit L’identité malheureuse. Je ne l’ai pas lu, je ne le lirai pas, mais je salue au passage le courage de Birnbaum ! quel vaillant acte de résistance vraiment, petit gars planqué au Monde des Livres ! On peut suivre encore aujourd'hui sur France 2 la video du passage de Finkielkraut chez Taddei dans Ce soir ou jamais . On a le droit d’être ou non d’accord avec lui, mais le traiter de lepéniste comme le fait le petit journaleux du Monde, c’est simplement dégueulasse. A moins que ce ne soit la mode, de se faire Finkielkraut entre la poire et le fromage. Finkielkraut a, comme Zemmour, la chance d'être juif, ce qui fait qu'on n'ira tout de même pas le traiter de fasciste parce qu'il tient le stand de la francité (quel mot!) dans la foire d'empoigne actuelle. Mais on sent que ça démange certains de ces plumeux,
J'avais rencontré Finkielkraut lors du conflit contre Allègre et son programme contre l'école - qui entre temps a été adopté et sur-adopté, même. Et il m'avait dit : ça va être très difficile de ne pas finir fou dans le monde qu'ils nous préparent. Nous avions parlé de l'école, de l'OCDE, des positions sur le sujet de Régis Debray, de Danièle Sallenave. J'ai une vraie sympathie pour cet homme-là qui croit encore à la complexité du monde et des idées. Une autre fois, je l'ai croisé dans le Luxembourg. Il marchait la tête en avant, les mains dans le dos, l'une tenant l'autre, comme si on l'attendait encore au Procope. Mais il s'est arrêté à la brasserie du Luxembourg, où il a pris le thé avec une vieille dame.
On peut juger les gens à l'emporte-pièce, certes. On peut coller aux idéologies et aux préjugés de son temps. Je préfère m'appuyer sur les hasards des rencontres et ce que j'apprends des faits. La vie, la vraie, son tissu qui donne sens et fait mémoire est là. Et pour passer du coq à l'âne, mais toujours dans la rubrique des faits, en feuilletant un prospectus pour des bouquets de chaines TV l'autre jour,je m'étonnais, moi théâtreux exalté de 1998 égaré avec ma troupe au milieu de klaxons hystériques, je déplorais même qu'il y ait des bouquets cinéma, des bouquets variétés, des bouquets sports, des bouquets cul, des bouquets séries tv, des bouquets nature et découverte, et même des bouquets histoire du monde ou musique classique, mais pas, mais rien, rien du tout sur la littérature ou le théâtre. Pourtant, et même en restant dans du mainstream pur jus, entre toutes les archives de l'INA, les retransmissions télé, les émissions pseudo littéraires à la Pivot et consorts, les documentaires et les archives de tous les théâtres, il y aurait de quoi faire au moins une seule chaîne. Mais rien, nada. Béraud, qui ne manquait pas d'humour, écrivit un jour que le meilleur moment du théatre, c'est quand on rentre à pied chez soi. Il a écrit un livre très drôle sur le sujet, dans lequel il consigne ses critiques théâtrales, et qu'il a appelé Retours à pieds. J'espère avoir le temps d'en parler ici un jour. Mais Dieu, que le temps passe vite.
En guise de consolation, j'ai trouvé ce portrait de Dullin en Avare que je trouve à la fois élégant et nostalgique. Les deux, dans le meilleur sens du terme. Je clonclus donc ce billet pas décousu du tout avec lui.
21:30 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : dullin, béraud, théâtre, jean birnbam, le monde, finkielkraut, ligue1, grève de footballeurs, zlatan, taddei | 
dimanche, 14 avril 2013
Arracher les jours
Je viens d’arracher un dimanche d’écriture au monde. Ça n’a l’air de rien, mais ce n’est pas évident : le boulot au lycée, brouhaha continuel et vain d’un présent désenchanté dans lequel sont englués élèves et professeurs ; le spectacle blasé de l’échec programmé de Hollande et de ses clowns, qui ont tous l’air d’exister il y a vingt ans en arrière de cela ; l’écoute désenclavée des colères de la rue de toutes natures, qui toutes ont leur légitimité, et qui, quoi qu’il arrive, n’aboutiront pas, parce que le pouvoir n’appartient plus à la rue, depuis un certain vote pour Maastricht.
Long travail, depuis début février, aux deux-tiers accomplis. Demeure un tiers. A peu près.
Impression de livrer un combat solitaire pour quelques-uns qui me liront. Impression de planer, déconnecté de ce qu’ils nomment le Réel, avec un personnage familier en train de prendre corps, ou un autre, figure, à l’esprit, plutôt que dans le bus ou le magasin, sur le trottoir, des inconnus, des étrangers. Et merci.
Quand ce roman sera achevé, ne pas penser encore à la quête d’éditeurs, trop décourageant ! Comme le sont ces piles d’invendus dans les centres de distribution d’objets culturels indéterminés, ce désamour patent de tout une peuple pour sa littérature, dont je suis le témoin attristé dans les écoles, depuis bientôt vingt ans. Trop long métier.
Parfois, ce n’est qu’une phrase d’écrivain piochée dans un livre au hasard qui relance la machine, met fin au découragement, au désœuvrement, comme le disait joliment Balzac. Car il faut éviter le suicide de son talent.(1) Ce n’est pas un vain mot que de dire que lorsqu’on s’attèle à l’écriture, on a pour frères tous ceux qui ont écrit, poussé la charrue devant, et creusé le sillon.
Quand vraiment ça peine, ça tire, ça coince, je contemple tel ou tel de leur visage. Sur le web, des photos des uns, des autres. J’ai devant moi dans mon bureau cette photo de Béraud à sa table de travail, par Blanc & Demilly, acquise en salle des ventes, l’an passé.
Ce billet que je conclus n’est qu’une lucarne entrouverte. Pour m’aider à m’y remettre au prochain jour arraché, au prochain vol...
(1) Balzac, La cousine Bette
21:29 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : béraud, écriture, roman, littérature | 
samedi, 05 janvier 2013
LYON ET L'ART MODERNE, de Bonnard à Signac 1920-1942
Durant la période de l’entre deux guerres, les artistes parisiens se réunissent à Lyon, constituant ainsi une des scènes artistiques les plus marquantes pour l’art moderne. Formés en 1920 par des peintres et sculpteurs issus des Beaux arts de Lyon, le groupe Ziniar inspire pendant quatre ans la vie culturelle lyonnaise. Dès 1952 est crée le Salon du Sud-Est, où se côtoient Pierre Bonnard, Paul Signac, Henri Matisse et leurs confrères lyonnais.
La ville est alors animée par un nombre important de critiques d’art. Dans le même temps, les photographes Théodore Blanc et Antoine Demilly immortalisent les relations d’amitiés qui unissent les artistes et leurs critiques et collectionneurs.
Le musée Paul Dini à Villefranche organise depuis le 14 octobre 2012 et jusqu’au 10 févrrier 2013 cette exposition qui met en valeur le rôle du docteur Emile Malespine, Marcel Michaud, Marius Mermillon, Georges Besson, ainsi que les écrivains Joseph Jolinon, Henri Béraud et Mathieu Varille.
Un catalogue de 180 pages accompagne cette exposition.

Le dimanche 27 janvier 2013 à 14h 30, l'Association rétaise des amis de Béraud organise une visite de cette exposition commentée par Daniel Marc, en présence de son président Francis Bergeron.
Musée municipal Paul-Dini
2 place Faubert 69400 Villefranche-sur-Saône
01:07 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul dini, ziniar, peinture, lyon, béraud, exposition, bonnard, signac | 
lundi, 24 décembre 2012
Le bois du templier pendu : de la légende à l'acte notarié
Nous sommes sous le premier des rois maudits (1), le jour de la saint Blaise de l’an 1309. Venu de Vienne, « où il avait par miracle échappé aux archers du roi Philippe le Bel », un chevalier du Temple est pendu à la maîtresse branche d’un feuillard (2), devant la fontaine Jean Page par les manants de Sabolas qu’il maudit (3).C’est le premier événement d’un récit qui s’achève en août 1793, au moment du siège et de l’incendie de Lyon, tandis qu’un avenir « couleur de sang » se profile à l’horizon. Nous lisons Le bois du templier pendu, premier épisode de la Conquête du pain, le triptyque consacré à l’histoire des paysans du Dauphiné dont Béraud souhaite qu’elle soit son grand œuvre. Ce premier tome, pensé comme une ouverture grandiose, il l’écrivit en 1926, peu après Le Plan sentimental de la ville de Paris, et avant Mon ami Robespierre. Il est alors reporter au Journal de Mouthon, et ses « choses vues » à Moscou comme à Berlin (4) sont déjà publiées. Il est au faîte de sa popularité.
Une superstition savamment entretenu par les moines comme par les nobles ayant établi une relation de cause à effet entre cet événement fondateur et les malheurs qui s’abattent au fil du temps sur les habitants du village, le texte suggère que cette superstition demeure la cause essentielle de leur servilité. Paradoxalement, elle est aussi leur seul bien commun ; faute de posséder la glèbe, leur seule culture, une sorte de religion, « la religion de la terre » : « Mais aucun n’avait maudit la terre. Ils la plaignaient plutôt d’être, comme eux, asservie, de subir la dure loi féodale. »
Siècles et générations passent :les tentatives de révoltes contre les maîtres ayant échoué les unes après les autres, Béraud fait avec beaucoup d’habileté naître chez ses personnages une lueur d’intelligence : être sage, c’est savoir distinguer l’oppresseur ; ils ne pourront donc se dégager du servage sans dégager la terre elle-même de la loi féodale ; ils ne se libéreront pas de la malédiction par la révolte ou la violence, mais en devenant un jour maîtres du sol ; c’est la lente association, au fil des siècles, de la liberté et de la propriété, qui devient le fil de l’intrigue, durant les deux premières parties du roman, qui nous amène de 1309 jusqu’en 1455, et à l’épisode du procès de Sabolas, dont Louis XI est l’instigateur.
A deux reprises, après l’épisode de la lèpre et celui du baron des Adrets, toute la fragile mémoire du passé de Sabolas est menacée de disparition. La permanence de l’effroi de ces pauvres gens, devant les barbaries que les puissances dévastatrices qui s’abattent sur eux leur font vivre, est l’autre fil conducteur de l’intrigue. Au centre de l'épopée, la scène nodale du baron des Adrets, « image vivante du carnage », obligeant tous les fils aînés de chaque famille du village à sauter des murailles :
« Dix-huit Sabolassiens dont le plus jeune avait huit ans périrent de la sorte. Si grand était l’effroi et la soumission de ces pauvres gens que tous obéirent, à l’exception du petit qu’il fallut précipiter. On trouva encore huit moines dans la petite chapelle. Le baron leur fit subir le même sort que les paysans. » L’effroi devant le baron protestant, comme s’il était la vivante incarnation du templier pendu, comme si tout était à recommencer devant un nouveau maître.
Mais toujours, la vie et la transmission orale du passé de Sabolas reprennent leurs droits grâce au cours souvent confus des naissances (bâtards, confusion d’enfants) et à la parole qui fend le silence des superstitions récurrentes : « Une fois encore, la vie l’emporta. Tout fut oublié, car la jeunesse écoute distraitement les récits des vieilles fileuses ; elles-mêmes finissent par confondre ce qu’elles ont vu et ce qu’elles ont entendu. Si bien que le templier de la fontaine maléfique, le cruel seigneur Jean de la Mortut et le bon dauphin Humbert, tout comme Alain Champartel, le fi des barons et comme Luc le Belleau qui sous les rois chevaliers vécut deux cents ans ne formaient qu’une même assemblée de fabuleux personnages où le sire des Adrets prit place, devant même qu’il ne rendit aux diables son âme traîtresse, méchante et deux fois renégate. »
Mais peu à peu, les légendes deviennent de vils ragots : « Les commères, aux veillées, ressassaient vainement les légendes de la paroisse. Il y avait dans les bonnes maisons de Sabolas, de solides garçons qui ne craignaient point les fantômes. L’histoire du Templier pendu les troublait davantage. De même que les anciens, ils se gardaient, la nuit, de traverser la clairière où la fontaine Jean page, souillée par la mort, continuait de répandre sans bruit son eau maudite. Ils faisaient taire les radoteuses et se signaient ; puis, jouant aux esprits forts, se mettaient à rire. »
Le dernier conte est ainsi le fruit d’un simple d’esprit : le templier serait sorti de sa tombe. Le fossoyeur « avait trouvé la dalle verte et moussue du templier dressé contre le mur de l’église. La tombe était vide ; et l’on voyait sur la terre battue du chemin la trace de pieds nus. »
Ainsi vidée de sa croyance populaire, après avoir formé la matière des trouvères, la légende devient « La Chanson du Fantôme », une chanson à boire de soldats.
A la mi-octobre de 1690, profitant des ordonnances de Mars, lesquelles adjugeaient au bout de dix ans les terres abandonnées en jachères à qui les mettrait en culture, Marc Chambard, « de serf allait devenir colon ». Béraud prend soin de nous dire que le premier homme libre qui, « ni clerc ni noble pouvait cependant parler en sa demeure du ton d’un maître » le doit au fait de savoir lire et compter. La rupture avec ses ancêtres est d’ailleurs marquée dans son patronyme dont la forme a suivi les évolutions phonétiques (Champartel, Escampart, Chambard) « Descendant en ligne directe des Champartel, il ne savait de ses ancêtres que d’orgueilleuses et très obscures légendes » C‘est Magnaud Chambard,
A la vente des Biens Nationaux, le lieu maudit est acheté par « maître Louis Chambard », son petit-fils. En rompant avec la superstition, ce dernier sera-t-il le fondateur d’un nouveau monde ? Le récit dit très exactement comment les hommes ont échappé au mythe, à la légende, en sachant peu à peu lire, compter, ainsi qu’en devenant maîtres et propriétaires de la terre qu’ils labourent : lorsqu’en 1790, prenant sa destinée en main, Louis Chambard, chaque saison, achète des terres et chaque saison, fait bâtir, il devient le véritable meurtrier du Templier de 1309.
« Le passé, maître Louis héritier du vieux Magnaud ne l’asservissait-il point jusque dans son symbole et dans sa légende, maintenant que ses valets de charrue avaient labouré la clairière maudite et que ses moutons buvaient à la fontaine Jean page ? Si, quelque nuit de lune, le Templier revenait, en blanc suaire et cuirasse étincelante, errer sous les hêtres du Grand Devoir, il s’arrêtait aux bornes du froment. Il s’en retournait, le blanc Reproche, dernier et lumineux écho de jadis pour n’apparaître jamais plus. »
Mais celui qui affranchit le pays de la superstition l’a-t-il pour autant libéré de la servitude ? Le cœur du problème est là, bien vivant, culturel. Dans cet étonnant récit qui couvre cinq siècles d’Histoire, Béraud dévoile avec beaucoup d’acuité que si la vieille querelle rurale de la bourgeoisie contre ses anciens maîtres est bien le moteur de son émancipation, elle est aussi le fondement de son aliénation.
Des siècles de labourage sur cette glèbe appartenant toujours à l’autre, qu’il fût baron ou prieur, ont en effet accouché d’une vieille loi rustique dont ce Chambard est l’héritier, et qu’il ne transformera pas lui-même. De serf, précise le texte, il devint colon en créant de toute sa force têtue la nouvelle inégalité : celle du travail. « Après un maître, un autre maître, ainsi le voulait la dure loi rustique ». Ce Chambard est bien un cousin dauphinois du Gaubertin de Balzac, lequel constate « un fait malheureusement trop commun, aujourd’hui, l’asservissement d’un canton, d’une petite ville, d’une sous préfecture par une famille » (5)
Qui doit légitimement posséder la terre : Celui qui la laboure ? Celui qui la protège ? Celui qui la bénit ? L’ancien Régime posait la question de la propriété d’une manière encore antique et véritablement agricole. Les temps modernes, urbains et financiers, diront : Qui la terre doit-elle enrichir ? Celui la laboure ? Celui la possède ? De la légende on passe à l’acte notarié.
En remettant à jour en pleine années folles et modernité gidienne la question du servage, véritable colonne vertébrale du rapport entre les classes et les hommes sous l’Ancien Régime comme sous le nouveau, Béraud relate minutieusement les conditions dans lesquelles s’est édifié le mythe de la propriété, sur lequel repose tout l’édifice bourgeois des temps modernes : Pas de liberté sans possession dûment acquise et notariée. Pas de liberté sans travail. La vieille servitude féodale, la Révolution ne l’aura donc tout au plus transformée qu’en servilité citoyenne :
« Aux foires comme aux champs, le clan s’enrichissait, et maître Louis n’attendait pas que le pot du bisaïeul fût rempli d’assignats. Chaque saison, il achetait des terres ; chaque année, il faisait bâtir. En tout temps, il remplissait les étables et retournait le sol. Sa maison croissait. Il lui fallait des gens. Dans Sabolas même il en trouvait, où les pauvres étaient bons et solides domestiques, et fort dociles, pourvu qu’on les appelât citoyens. »
Dans la dédicace « à P.S.B. Gavault » de son roman, Les Paysans, Balzac ne disait pas autre chose : « Vous allez voir cet infatigable sapeur, ce rongeur qui morcèle et divise le sol, le partage, et coupe un arpent de terre en cent morceaux, convié toujours à ce festin par une petite bourgeoisie qui fait de lui à la fois son auxiliaire et sa proie »
Les divisions qui menacent Sabolas, le calendrier lui-même, qui soudainement structure la chronologie de façon plus précise que les formules de l’ancien récitant, a charge de les marquer : le 26 messidor, Le 20 juillet 1789, le vendredi saint de l’an 1790. Les patronymes se transforment avec l’effacement des anciens dialectes. Sur le socle de l’antique sagesse rustique, qui était commune à tous, des psychologies rudimentaires poussent et déterminent des comportements nouveaux, individuels, bourgeois.
Le Magnaud a deux enfants, l’un héritier de la malice et de la convoitise, l’autre du goût pour la liberté. L’un devient, après être parti comme le sergent Lèbre, militaire, l’autre le premier maire de la commune. Ces deux frères poursuivront une intrigue qui s’achève devant l’incendie de Lyon qu’on voit à l’horizon, durant la révolution. « L’officier, avait brûlé les chartes du servage ; mais la vraie Révolution, le maire de Sabolas l’avait faite, lui, sans y penser, en prenant le geste des anciens, l’humus tiède dans ses poings acharnés. Il la faisait en créant de toute sa force têtue la nouvelle inégalité : celle du travail. »
Comme on l’a déjà dit précédemment, en décryptant les tombes du vieux cimetière de Sabolas, Béraud écrivait d’une certaine façon l’histoire de ceux dont les noms remplissaient les « monuments aux morts » de la Grande Guerre. En marge de la grande littérature, il justifiait leur attachement (aujourd’hui passé de mode) à défendre le sol natal. Au-delà de cet hommage grave et lyrique, le polémiste contestait déjà les fondements idéologiques du mythe du Progrès, dont la gauche qu’il quitterait bientôt se gargarisait pour mieux illusionner de nouveaux serfs, les oublieux gens des villes. Ce faisant l’écrivain lyonnais légitimait la nécessité d’une authentique réaction contre le monde moderne, et ses brillantes impostures.

Templiers en tenues de villes,
détails d'une tombe dans l’église templière de Villalcàzar de Sirga
1 Druon écrit ses Rois maudits à partir de 1955. On y assiste à l’exécution d’un autre templier, Jacques de Molay, qui lance la même malédiction à Philippe le Bel et ses descendants. Avant Druon, Béraud écrivit l’histoire des manants maudits.
2 un feuillard est un hêtre en patois du Dauphiné
3 Sabolas, de Satolas, village du Dauphiné dont est originaire la mère de Béraud. Voir Béraud et le cimetière de Sabolas.
4.Ce qui n'est pas anordin : il a compris que les promesses de la révolution fusse comme la paix signée par Clémenceau sont deux chimères, et qu'un risque de guerre couve à nouveau en Europe.
5 Balzac, Les Paysans
19:39 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : béraud, littérature, le bois du templier pendu | 
dimanche, 23 décembre 2012
Béraud et le cimetière de Sabolas
Le Bois du Templier Pendu, sort de presse en 1926. Béraud, le nomade, le voyageur qui passe tous ses étés à courir les capitales, y retrace patiemment cinq siècles de l’histoire d’un village de laboureurs, de 1309 à 1790 (Fin le 26 messidor). Sabolas (sabots las) est une variante fictive de Satolas, le village dauphinois d’où provient la branche maternelle de sa famille. C’est le premier volume de La Conquête du Pain, l’épopée sédentaire des ancêtres laboureurs qui comprendra deux autres titres : Les lurons de Sabolas et Ciel de Suie
Tout commence – est-ce un hasard ? -, dans un cimetière, avec une poignée de « noms sans visages », celui de trépassés dont nul grimoire, dans les coffres du château, n’a conservé le souvenir :
« Ces trépassés n’avaient en leur vie guère parlé plus que les bœufs du sillon et les moutons du pâtis – et pourtant ils laissaient à leurs descendants maintes leçons (...) Qu’est-ce que l’on savait d’eux ? Rien que ces noms qu’ils avaient transmis avec la peur de l’enfer, et le respect du seigneur, et l’appel confus de l’humaine fatigue vers l’avenir menteur. »
« Sous les pères des barons, les pères des vilains poussaient la charrue et tiraient la faucille. Leur sueur avait séché sur les champs du maître ; il fût resté d’eux rien autre chose que l’usure de leurs mains sur l’outil agricole, n’étaient justement ces noms sans visage – Champartel, Perrin, Collard, Pejud, Griveau, Pastourel, Barge, Le Belleau, Pillerod, Rigault, Goy, Vaunel Espognant – ces noms dont toutes les syllabes résonnaient dans le nom de Sabolas, ces vies passées qui faisaient de Sabolas un tout bien clos, semblable à l’arche des Ecritures, une nef allant à son destin et flottant sur les âges comme sur un flot trouble et hasardeux, plein d’ombres. » Le bois du Templier pendu, II
Au moment où Béraud rédige ces lignes s’alignent depuis peu, au centre de chaque village de France, d’interminables, de muettes et de solidaires listes de noms tout pareils à ceux-ci.. L’œil n’en finit pas de glisser sur ces ex-voto partout alignés, dont le classement alphabétique étire de loin en loin et la noblesse et l’horreur. Chaque administration, chaque institution dresse le sien. Des noms qui se répètent au fil de dates similaires sur chaque monument, d’un coin de la France à l’autre. Des homonymes, par milliers. Pour la première fois dans l’Histoire, le héros est pluriel. Innombrables sont les morts. Sous l’arc de Triomphe parisien, le singulier en qui le sacrifice de tous ces ruraux abattus s’incarne ne porte, significativement, aucun patronyme. Un mot, seul, aux contours incertains, est capable de qualifier la victime, que les orateurs révolutionnaires avaient sans cesse à la bouche, et dont Michelet fit le titre d’un livre : Le peuple.
Il n’est pas indifférent de rappeler que le co-fondateur des Annales, Marc Bloch, né en 1886, fait partie de cette génération d’historiens pour qui déchiffrer, consigner l’histoire des gens réels est plus important que de retenir des événements : le monument aux morts, page de garde d’une démarche qui orientera les historiens vers les actes notariaux et les archives municipales plutôt que vers les chroniques des rois de France, page de garde, également, de La Conquête du Pain.
L’idée fondatrice, c’est que ce peuple des campagnes qui vient d’être saigné à blanc, quelques remarques fameuses des Caractères de La Bruyère (1688), un chapitre dans Le Peuple de Michelet (1846), un long poème de Lamartine (Jocelyn) les récits champêtres de Georges Sand (1845-1853), le roman de Balzac (1855), et la Terre du bourgeois Zola (1887), ne suffisent plus à raconter sa légende. « Je raconte une histoire, débute-t-il, pour les gens d’ici » (C’est à dire dédiée aux gens d’ici). En exergue de la deuxième édition du Bois du Templier pendu, il rajoute cette citation de Shakespeare : « Qui va là ? – Paysans, pauvres gens de France ! »
Dès l’incipit, la formule orale du vieux roman arthurien prédomine : « C’était en l’an 1309… Il y avait un franciscain…. En ce temps-là Sabolas…. Or entendez-bien… A cette heure, donc… ». Elle jouxte un peu partout les termes féodaux dont la résonance archaïque donne au récit un ton soutenu : affouage, échanguette, glèbe, vesprée, mesnil, vilains, châtellenies… Les paragraphes se suivent, courts comme les laisses en prose d’un récitant. Dans les phrases qui se succèdent, on retrouve souvent le rythme et la cadence d’un mètre. Ainsi la description du templier, lors de l’épisode fondateur, de la fable d’où procède la suite du récit, où l’on repère une dominante de vers de six syllabes :
6 Un manteau s’étalait
8 sur la croupe de son cheval
6 qui suivait à pas lents
6 les lacets du sentier
6 L’homme allait, l’air pensif
6 et semblait arriver
6 des confins de la terre.
Le texte qui dit la légende prend ainsi la forme de la légende qu’il raconte :
« On racontait cela le soir, sous la lumière fumeuse des torches de résines. Tous ceux de Sabolas savaient par cœur ces histoires et croyaient, sur la foi des anciens, qu’à chaque nouvelle lune, le templier revenait prier, mains jointes, près de la fontaine Jean Page. Quiconque apercevait le blanc manteau et les mailles luisantes du fer vêtu, mourait dans l’année. La fontaine elle-même passait pour vénéneuse… Les trouvères imitaient ces récits et les accréditaient dans les châteaux. Nul, en pays dauphinois, ne doutait du pouvoir de ce blanc et double fantôme, et les curés faisaient, aux Vigiles, réciter par leurs paroissiens une oraison propre à exorciser la forêt. »
Dans la prose béraldienne surgit parfois un écho de La Fontaine ou de La Bruyère : « Le paysan osa relever le front et se vêtir comme un homme » fait directement allusion au texte célèbre des Caractères, tandis que la narration suit en chapitres « le spectacle historique de la civilisation », rendant linéaire son déroulement : Guerre de cent ans, peste, jacquerie, famines, bohémiens, lèpre, baron des Adrets, recruteurs des guerres royales, tous les malheurs qui tombent successivement sur le village ne constituent que la longue suite des péripéties grâce auxquelles s’énonce, autour de la petite histoire des laboureurs, comme en un écho parallèle et lointain, la grande, l’officielle, qu’on croirait située hors roman, placée littéralement comme en orbite par une force centrifuge, étrangère au centre de gravité constant du village et de son cimetière.
Cette façon que le narrateur a de saisir les personnages dans leur espace et dans leur temps, d’être en osmose avec leur marche vers la propriété du sol sans jamais poser sur eux le regard externe du citadin est la grande originalité de Béraud par rapport à Balzac ou Zola, le procédé qui assure toute la force lyrique du récit. Ainsi, lorsqu’un épisode de l’histoire de France bouleverse soudainement l’espace et le temps de Sabolas, le lecteur comprend qu’un peu de temps linéaire est passé, qu’on a changé de siècle. Les événements historiques fondamentaux du monde citadin sont réduits à n’être ici presque que des marqueurs temporels. Aucun de ces événements, si brutaux, si inexpliqués, si dramatiques soient-ils, ne paraît être en mesure de rompre le temps cyclique du laboureur que ressuscite, quoi qu’il arrive, celui de la narration : L’existence de Luc Belleau, un personnage devenu centenaire, peut se résumer de cette manière :
« Les misères et les joies des hommes tenaient, dans sa mémoire, moins de place que les vicissitudes des champs. Les grandes dates de sa carrière n’étaient ni les guerres ni la venue des princes. C’étaient les fastes et les fléaux agricoles (…) Il ne savait pas le nom des cinq rois qui, lui vivant, s’étaient succédé au trône de France. Il connaissait mieux les étoiles et leurs bienfaits.»
D’une génération à l’autre, d’un épisode ou d’un chapitre à l’autre, le moteur de l’histoire se réduit donc à la longue marche de ces sabots qui, malgré leur lassitude, leur effroi devant la cruauté des puissants, leurs crédules superstitions, leurs représentations primitives du monde naturel et politique qui les entoure, vont pourtant parvenir à conquérir patiemment ce qui assure la permanence de la survie en donnant le pain, c’est à dire la possession de la terre : « Un débris de tribu, dans un bout de pays, partait à la conquête du pain ».
Délivrer ses descendants du servage, tel est l’unique quête des héros. Cet enjeu épuise des générations de personnages avant d’aboutir au compromis révolutionnaire. Ainsi Béraud s’inscrit dans la droite ligne de Michelet, en voyant dans l’émancipation du servage le fil conducteur de l’Histoire de ce peuple français dont les noms s’alignent désormais par milliers sur les monuments aux morts du siècle nouveau.
Au sens que Mikhaïl Bakhtine (1) conféra un jour au terme, ce cimetière est donc bien le chronotope (2)e des trois récits du cycle, puisque le cours des centaines de vies humaines qui s’y rencontrent au fil des siècles vient inexorablement s’achever entre ses murs. Après la scène de pillage de Sabolas par le baron des Adrets (fils aînés précipités des murailles, viol des femmes, incendie des maisons et exécutions en série), il reste même le seul lieu intact au milieu des ruines calcinées :
« Il ne restait rien de Sabolas, ni maisons, ni clocher, ni récoltes, ni curé, ni espoir, ni Dieu, ni saints. Absolument rien, que le cimetière. »
Et lorsque le corps de Patrice, le héros de Ciel de Suie, y est inhumé en 1894, le cycle peut s’achever sur une ultime phrase, réponse à la question « Qui va là ? » de l’exergue : « C’est un homme qui pleure. Passez votre chemin ! ». Entre cette œuvre romanesque et les écrits autobiographiques, si un lieu opère la transition, c’est bien encore lui : Après la mort de son père, le héros de La Gerbe d’Or, le narrateur de Qu’as-tu fait de ta jeunesse s’interroge : « Que fait-il maintenant ? Que font-ils les chers témoins, s’ils ne m’attendent, heureux et consolés, au pied de l’église, dans le vieux cimetière où nos anciens dorment sous les herbes folles ? »
Véritable matrice de l’œuvre, le cimetière de Sabolas est donc le point de départ et d’arrivée de toutes les créatures de Béraud. Il est la page où s’exprime le mythe béraldien par excellence : celui de la pérennité des aïeux, de la permanence et de la force du temps. Comme les monuments aux morts des humbles poilus de quatorze, il sollicite le récit historique de façon presque incantatoire : L’imaginaire qu’il suscite supplée les carences de l’histoire. Comme légitimée par l’abandon, la rêverie comble le manque d’archives, de grimoires, de manuscrits. Autour de ces vies qui furent et dont on n’a retenu que des noms, la mémoire et l’oubli, les deux pôles antagonistes de la force du temps, finissent par se fondre dans la rêverie où elles cessent de se combattre. Le temps qui la structure est celui de la fidélité historique, fondement de l’identité du seul héros à travers toutes les épreuves qui le frappent tour à tour : Sabolas. Fondement revendiqué haut et fort, également, de l’identité du narrateur et de la permanence de sa voix
[2] « Nous appellerons chronotope, ce qui se traduit littéralement par temps espace, la corrélation essentielle des rapports spatio-temporels, telle qu’elle a été assimilée par la littérature (…) Dans la chronotope littéraire a lieu la fusion des indices spatiaux e’t temporels en un tout intelligible et concret
Monument aux morts de Satolas
22:32 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : béraud, littérature, satolas, sabolas, dauphiné, guerre | 
jeudi, 05 juillet 2012
Bernanos : Les fantômes de la liberté
« Il n'importe pas de condamner ce monde. Il vaudrait mieux le plaindre. Il a besoin de pitié. Seule la pitié pourrait blesser son orgueil. La psychologie actuelle démontre très bien que l'orgueil n'est qu'une des formes du redoutable complexe d'infériorité. Le monde moderne est un monde humilié, un monde déçu, c'est ce qui le rend furieux. Le sentiment de la ridicule disproportion entre ses réalisations et ses promesses donne à cette fureur un caractère de férocité. Tous les ratés sont cruels. Le monde moderne est un monde raté. Il risque aujourd'hui de se jeter dans le suicide pour échapper à l'intolérable aveu de son impuissance ».
Georges Bernanos (« Le monde moderne est un monde humilié » - interview publiée le 10 février 1939 dans O Journal, et repris dans La France contre les robots)
A quel moment, quelle occasion, ai-je compris que j'avais un besoin pressant, criant, urgent de lire Bernanos, de lire Béraud, de lire Galtier-Boissière, de lire Jean Giono, de lire Louis Guilloux - nés successivement en 1888, 1885, 1891, 1895, 1899 ? C'était il y a dix ans, à peu près, que j'ai ressenti le besoin du témoignage de cette génération, pour me laisser par eux expliquer ce qu'avait été le monde avant que leurs fils ne s'en emparent, et ne se mentent à eux-mêmes, et en fassent celui dans lequel j'étais né.
Je me souviens bien avoir, dans les années soixante-dix, commencé à étudier la littérature latine, la littérature française, dans un vieux bon lycée de province qu'avaient construit des chrétiens. L'héritage... Malheureusement, cet héritage venait toujours buter contre cette date de 45, qu'on nous présentait alors comme un renouveau, un commencement, une ère grandiose, une libération.
Moi, j'étais le témoin de cette modernité-là déjà déconfite quelque trente ans plus tard, vraiment dégradée, de Pascal ou Chateaubriand en Jacques Prévert ou Boris Vian, de Madame de La Fayette ou Juliette Récamier en Benoite Groult ou Juliette Gréco, de Vivaldi en Gainsbourg, et de La Tour en Dali...
Et lorsque je me suis alors franchement posé la question de l'héritage, et de ce que je pourrais, moi, faire - me venait toujours cette sensation que c'était vraiment pitié qu'être né dans ces années 50, à l'heure de Kerouac, d'Edith Piaf et du Coca cola. Pitié. Qu'il n'y avait plus rien à faire, de toute façon, car quelque chose de diffus, d'inexpliqué, comme une malédiction, mais de bien réel, était là.
Et je tournais les yeux vers mes copains, et je les saluais.
Pitié, vraiment, mes copains, ces petits frères des soixante-huitards déjà rangés du bon côté de la barricade, déjà cohn-benditisés à souhait, prêts à voter Mitterrand avant même d'être encartés, vraiment. Un de mes excellents potes à l'époque répétait : "ce qu'il faut garder, c'est la dignité, et le sens de l'humour..." Vite dit. Je l'aimais bien quand même.
Nous essayions donc, du haut de nos seize dix-sept ans, de conserver dignité et sens de l'humour, tout en se récitant des pages de Nerval (Ah, Sylvie), comme on se parlerait, sur un terrain vague, du temps d'avant l'explosion d'une raffinerie. En ces années-là, je vis les hommes et aussi les femmes de mon pays commencer à vraiment polluer toutes leurs rivières, se précipiter en hordes dans des centres commerciaux pour acheter des yaourts dans des petits pots en plastique, et chanter La pêche aux moules avec Jacques Martin. Mes copines, alors. Mes copines ?
Pitié, elles aussi. Tragiquement pitié, ces copines, avec leur crédulité de jeunes libérées en mini-jupes, à un point que c'en était ridicule. A dix-huit ans, déjà fatigué d'Arthur Rimbaud comme il dut l'être de lui-même, je lisais donc Kabîr et Toukaram en me demandant où était passé l'Occident dans tout ça. Déconfiture de la Royauté Technique. Technologique.
L'Occident n'était plus qu'une force technologique, à l'image de ses deux monstruosités : Hiroshima et le premier homme sur la lune. Tout le monde était d'accord pour trouver que la première était monstrueuse. Peu s'aperçurent que la seconde était pire. Mais d'hommes, de spiritualité, point régnant au pays des grandes surfaces et des temples de la consommation. Et certes, ce n'est ni le néant Sartre, ni le néant Beauvoir qui, à l'époque, auraient pu m'expliquer où était passé l'Occident que j'avais appris à l'école. Ces deux là, qui en étaient les fossoyeurs acharnés, avaient déjà décidé de n'avoir aucun descendant. Nada ! Ces deux là, opportunistes sans talent mais roués, étaient fins de race à l'extrême, monstres d'égoïsme et le sachant jusqu'à la moelle, ils appelaient ça existentialisme, deuxième sexe, libération, modernité, littérature et autres conneries mortifères. L'Institution Universitaire faisait alors s'achever la littérature du dix-neuvième siècle grosso modo à Proust, et débuter celle du vingtième à peu près aux alentours de Nathalie Sarraute. Comme s'il n'y avait rien eu entre. Rien. Pas un homme. Que des maudits
18:17 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (69) | Tags : bernanos, littérature, politique, société, france, béraud, quatorze dix-huit | 
jeudi, 14 juin 2012
La décadence de Guignol
Puisque nous parlions du père Thomas dimanche, et que nous sommes entre deux tours de législatives, voici un témoignage précieux sur le caveau Guignol du passage de l’Argue à Lyon, et de manière plus large sur la teneur polémique de l’esprit lyonnais, comme on a pu dire à l’époque. Le texte date de 1912.
Il y a foule au passage de l’Argue. L’affiche promet une revue. Salle étroite, au plafond bas, culotté par la fumée des pipes. Les murs s’adornent de fresques sans prétention : l’Ile-barbe, les aqueducs de Beaunant et la place du Gros-Caillou, traités d’un pinceau primitif, à la moderne, font les frais essentiels de cette décoration.
Mais le public n’a d’yeux que pour le théâtre, où « huit décors neufs et quatre-vingt personnages » affirment la munificence d’un impresario qui ne recule évidemment « devant nul sacrifice ». Les changements à vue, les jeux de lumière et les apothéoses se succèdent, ébahissent une assistance qu’on peut croire blasée par les raffinements des théâtres subventionnés et par le luxe des Kursaals.
Depetits cris de femmes chatouillées et des rires gras précisent le caractère du spectacle. Ce Guignol n’est pas pour les enfants. Que les nourrices, elles-mêmes, se gardent d’y rencontrer les militaires : il n’en faudrait pas davantage pour faire tourner leur lait.
Guignol, compère, arbore sur son cotivet un feutre provocant, et son complet marron sort évidemment de la Belle Jardinière. Son linge arrive de Londres. Sa cravate fait concurrence à celle de l’excellent dessinateur Fargeot, l’homme le mieux cravaté de Lyon, comme chacun sait. La commère, qui représente la Presse lyonnaise, est une superbe poupée rose et blonde, couverte de mousseline et de soie. Où-es-tu, brave Madelon, orgueil de nos souvenirs ? Par-dessus quels moulins as-tu jeté ton canezou, ton pet-en l’air de calicot et ton bonnet à tuyaux ? Gnafron laissant au journaliste Bibi les exubérances de la trogne, devient un ivrogne convenable, un viveur élégamment éméché, vêtu d’une impeccable redingote et coiffé d’un dix-huit reflets à la mode.
Ces trois protagonistes nous débitent les potins du jour, nous présentent le succès de l’année. Successivement nous voyons défiler les balcons fleuris, l’Armée du salut, les Ondines, les Aéroplanes, la nouvelle gare des Brotteaux, les briquets automatiques, le four crématoire, l’ermite du Mont-Cindre, M Vial de Vaise, les WC souterrains, que sais-je encore ?
Les actualités sont personnifiées par d’accortes marionnettes qui nous en débitent de vertes, avec leurs petits airs de ne pas y toucher, ne regrettant que d’être en bois et de ne pouvoir -pour cause – nous montrer leurs jambes.
Il faut entendre ces mots à double entente, ces refrains pimentés et ces dialogues polissons, sortir de ces lèvres impassibles, jaillir de ces faces où rien ne trésaille, où pas une fibre ne s’émeut pour dénoncer une pudeur ou nous indiquer une réticence ; il faut voir ces gestes étroits et monotones, faits pour accompagner des sentiments moyens, ponctuer des répliques excessives, des phrases qui n’ont d’ordinaire pour excuse que la verve du corps souple et la gaîté d’un bras spirituel ; il faut, dis-je, entendre et voir ce Guignol pour connaître la saveur de l’humanité toute crue.
Et, sortant de là, j’ai renouvelé pour mon compte la prosopopée de Fabricius :
« O père Mourguet, ô père Thomas, qu’eussent pensé vos grandes âmes si pour votre malheur, rappelés à la vie, vous eussiez vu la scène pompeuse de ce théâtre créé par vos mains ? Dieu ! eussiez-vous dit, quel est ce langage étranger ? Quelles sont ces pièces efféminées ? Que signifient ces décors, ces clinquants et ces lumières ? Ce n’est plus la Croix-Rousse, c’est Montmartre qui vous amuse ! Ce sont des rhéteurs qui vous égaient ! Les dépouilles de Guignol sont la proie des chansonniers… »
Mais ces lamentations se perdraient dans le désert. Et les deux grandes ombres s’indigneraient vainement. Qui se souvient aujourd’hui du Guignol de la rue Noire, de l’allée des Brotteaux ou du Caveau des Célestins ? du vrai Guignol guignolant que créèrent de toutes pièces, vers l’an 1845, ces deux hommes de génie auxquels on n’a point élevé de statue ? Qui se rappelle du type de canut gouailleur et bon enfant, quelque peu bambocheur, à la fois naïf et sceptique ; pratique aussi, mais serviable, et toujours joyeux, dans le bonheur comme dans l’infortune, que nos pères applaudirent en foule dans la petite baraque du pont Morand ?
Qui se rappelle ? … Mais il n’y a plus ni canuts, ni Guignol. Il n’y a plus que le café-concert.
Marrons de Lyon, Henri Béraud, 1912
05:55 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : théâtre, guignol, passage de l'argue, lyon, politique, satire, polémique, béraud, littérature |