mardi, 08 septembre 2009
Lazare et les petites patries dans le temps
« Je n’écrirai pas de roman sur la guerre ; la guerre n’est pas un sujet de littérature »
Alors que Lintier, Barbusse, Dorgelès, pour parler de proches de Béraud, publient très vite leur témoignage ou leur roman de guerre, curieusement dès 1917, Béraud s’y refuse, au nom même de la littérature ou du moins, de la conception qu’il s’en fait. Il tiendra parole.
A une exception près : celle de ce curieux roman, dont la parution suit de peu l’attribution du Goncourt pour le Martyre de l’Obèse (1922)
Dans ce roman, Béraud éclipse avec une grande pudeur l’événement collectif (la guerre, sa guerre, cette guerre sans gloire) de son récit pour n’en retenir que l’événement intime, particulier : Son héros, un civil, est un ancien pianiste qui a été victime d’un accident de voiture en 1906. Il n’aura donc pas eu, lui, l’occasion de la faire : Il a perdu conscience pour sombrer dans une folie, qui l’a coupé du monde entièrement. Il est devenu un autre et cet autre se « réveille » dans une clinique psychiatrique, seize ans plus tard, en 1922 :
« Se retrouver sans savoir ni comment ni pourquoi dans une chambre d’hôpital n’était-ce donc que cela ? une impression de repos, l’élasticité d’un lit de malade, un subit déploiement de blancheurs, rien de plus. Il acceptait avec tranquillité son aventure ; ce qui le surprenait et l’effrayait, c’était plutôt, singulière réversion, de n’être ni surpris ni effrayé »
« La guerre ? Eh bien oui, la guerre ? - et puis après ? », dit Jean Mourin, lorsqu’on lui en apprend l’existence. Le héros de Lazare était le seul être humain à n’en avoir, à aucun moment, ressenti la réalité. « A quoi bon ? Il acceptait tout en bloc. »
Et, un peu plus loin : « Qu’était-ce, en définitive, que la métamorphose du monde, comparée au prodige de sa résurrection ? »
Lazare, chacun le sait, est une parabole.
Or, pour qu’un simple revenant devienne un véritable ressuscité, il y faut la volonté de Dieu. Il y faut toute la force du miracle.
La mesure de l’écart entre l’avant et l’après-accident, tel est l’argument du récit qui inflige à son héros une rude épreuve : Car si le Lazare biblique pouvait ré-susciter les contours d’un individu dans le temps historique des mortels, c’est qu’il était devenu, cet individu, la manifestation de l’action de l’Eternel, ni plus ni moins, au sein de ce temps historique des mortels. Tel quel, l’autorité du miracle témoignait en sa faveur. Qu’est devenu Jean Mourin ? De quoi sa résurrection est-elle la manifestation ? De quelle autorité ?
Un miracle… La société des hommes est-elle capable d’en produire un ?
Cette paix étrange, cette France des années 20 en constante crise politique, ce règne de l’argent, un miracle ? Peut-on y ressusciter ? Cela vaut-il le coup ?
Telles sont les douloureuses questions posées par cet étrange et beau roman.
Lazare sera donc vraiment en premier lieu le roman de ces enfants humiliés dont parle Bernanos, « perdus dans la paix comme le moine dans le siècle » : La Victoire ne les aimait pas.
« Ce qui l’entoure, ce sont les hommes de son temps, qui sont morts tandis qu’il était lui-même hors de l’humanité, aussi mort qu’un mort, errant dans l’ombreuse contrée de la folie, d’où le voyageur, s’il revient, ne rapporte pas plus de souvenirs qu’un trépassé, s’élevant du limon, n’en rapporterait du monde aveugle et sourd où les fossoyeurs l’avaient englouti » (chapitre II)
Hors de l’humanité … Aussi mort qu’un mort … L’expérience de la guerre : un coma.
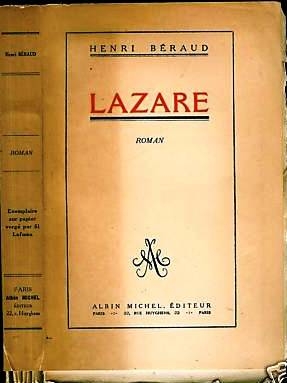
« Ne différait-il pas de toute l’humanité, habituée à concevoir la vie comme un phénomène continu, alors que pour lui, Jean Mourin, aucune perception de l’univers ne pouvait se séparer de la notion d’intermittence ? ».
Les choses sont là, l’adhérence aux choses, tragiquement s’est éclipsée. La perception de la contemporanéité sociale avec les autres hommes est irrémédiablement estompée. Le Lazare biblique, de retour de la mort, était émissaire, lui, d’un mystère divin gage d’une réinsertion parmi les vivants : il avait vécu la mort, et la foule se pressait pour l’interroger ; les prêtres voulaient connaître ; le mystère de ce Lazare sans Dieu, tardif Ulysse parmi des contemporains prétendants à peu de choses, indiffère. Jean Mourin a beau s’enfermer dans un appartement pour se griser de musique, comme du temps de sa splendeur et de sa vie sociale heureuse, rechercher indéfiniment son épouse disparue, s’accrocher à tous les éléments saillants du Réel qui l’entoure, se composer comme il le peut « une petite patrie dans le temps », cet autrefois sur lequel il croit qu’un peu de lui parviendrait encore à avoir prise est mort, bel et bien, avec sa part de lyrisme et de véritable belle humeur. Personne ne veut savoir. Personne n’interroge son mystère. Personne ne songe même qu’il puisse en porter. Personne ne remarque le moderne Lazare, ni ne comprend qu’il a vu et intériorisé, lui aussi, quelque chose d’universel et de terriblement sauvage. Quelque chose de trop humain pour être désormais épique. On passe son chemin. Rien de plus commun que l’homme sans qualités. Tel est le mal de Jean Mourin, qui ne se confond à aucun moment avec une quelconque nostalgie de l’avant, à aucun regret de l’Age d’Or.
« Se pouvait-il, vraiment, que l’on pût disparaître sans que nul ne conservât même le souvenir de votre ombre ? Du Paris de 1906 au Paris de 1922, l’espace était-il donc aussi grand ? A peine l’âge d’un adolescent. ».
Il a beau rechercher des vieux amis, des connaissances, des contemporains, car, souligne le narrateur, même à ses angoisses intérieures, l’homme veut des témoins : Il ne retrouve finalement que le double qu’a fabriqué, durant le temps de son inconscience, son inconscience. Ce double qui le harcèle, significativement baptisé Gervais, loin de figurer un héros, n’est qu’un citoyen affreusement ordinaire, dans la peau duquel il ne peut que s’engluer à la fin du roman : Gervais, qui le récupère au final dans le regard des autres, l’engloutit dans le tombeau d’une banale démence et le suaire d’un désespoir commun. Telle est la destinée de l’homme moderne.
On a cru voir dans Lazare, lors de sa parution, un roman fantastique. Lecture borgne. Lazare est un roman qui dit la nature fantastique du passage de la guerre à la paix, dans une culture de masse. On a comparé hâtivement Lazare et Le Horla.
La dédicace à Lucien Debech n’était pourtant-elle pas explicite ? Maupassant ! Il y a dans ce roman comme une préfiguration de Kafka, qui laisse réellement songeur :
A Lucien Dubech : A vous, mon cher ami, qui, parlant des petites patries dans le temps avez su définir les certitudes de notre génération, j’offre le témoignage de ses inquiétudes et de ses doutes. Il se peut que ces sortes d’énigmes laissent indifférents ceux qui nous précèdent comme ceux qui nous suivront. Mais nous, qui vieillîmes sans vivre, avons trop fréquenté les morts pour résister aux vertiges de certains gouffres.
D’autres diront si, par cet ouvrage, l’auteur parvient tout ensemble à élargir les possibilités de la vraisemblance et à communiquer sa propre angoisse. Acceptez-le tel quel, Lucien Debech, je vous l’offre par-dessus la barricade, en gage de mon estime et de mon admiration. »
Telle est la douloureuse initiation que doit subir Jean Mourin, telle est aussi la clé de la signification de cet insolite roman : Sa tentative se bornant à re-susciter les contours d’un individu d’une époque au sein d’une autre, il lui faudra découvrir qu’il n’est que la manifestation d’un hiatus historique, d’une folie historique, (d’un accident) au sein d’une chronologie humaine dont pas une parcelle d’éternité ne possède le pouvoir de le délivrer. Il lui faudra admettre avec lucidité que sa résurrection n’est qu’un banal retour qui ne suscite aucun étonnement, sa douleur, aucune compassion. « Rien ne revit, affirme ailleurs le narrateur du Plan Sentimental de Paris. Car tout vit ». La tentative hautement absurde de ce faux ressuscité ne peut donc déboucher que sur un constat désespérant : ce qu’il est devenu, ce qu’il peut susciter à nouveau de passion, d’esprit, d’intérêt dans le monde, c’est proprement rien du tout. La guerre, quand on a subi l’initiation du non sacré qu’elle découvre, il est vain de tenter d’en revenir. Mais comment survivre avec ?
Plus tard – mais plus tard seulement-, lorsqu’il entamera la rédaction de La Conquête du Pain, Henri Béraud adoptera sa solution : rejeter la guerre non pas au plus profond de soi, mais au plus profond du passé en lui assignant une place logique dans la longue chaîne chronologique des catastrophes historiques. Dans l’interminable énumération des heurts et des malheurs qui, depuis la nuit des temps, frappa l’humanité, et dont le cortège dramatique formera l’intrigue d’un prochain livre, Le bois du Templier Pendu, lui conférer la nature d’un simple cataclysme historique, parmi d’autres, et déjà dépassé, un de plus, qui a balayé du monde et que du monde balayera. Mais pour l’instant ? L’événement historique – l’événement extérieur à la conscience – est rapporté à la seule incidence qu’il a eu sur la conscience, précisément. Une rupture de la vie civile. Un laps de temps non vécu dans la réalité commune des hommes et des femmes. Un cauchemar qui prend la forme romanesque et la durée littéraire d’un coma. Si pour certains, la littérature est la vraie vie, si pour d’autres elle ne peut que livrer la dé-composition du langage ou du monde, il est possible que pour Béraud, elle ne soit (ce qui n’est pas forcément moindre) que la vraie survie, que la seule forme de sacre de soi hors du cauchemar, hors du coma.
Les ancêtres, nous dira Le Bois du Templier pendu, ne s’en sont-ils pas toujours remis ? Les ancêtres n’ont-ils pas survécu ? Ils se sont, cahin-caha, tous appuyés sur une force plus puissante que les cataclysmes itinérants : Non, pas l’Eternité, mais quelque chose de plus humain, de plus relatif et de plus tortueux, qui est sans doute la seule conscience de la permanence du temps accessible à un esprit humain : le sens de la durée.
La Grande Guerre fascinera qui elle voudra, passionnera de futurs historiens qui y déchiffreront ce qu’il leur plaira, intéressera de futurs sociologues qui y verront une fin ou un début, qu’importe ? Pour l’heure, il s’agit de lui survivre.
Bien que tout change, rien ne change. En composant son texte, l’écrivain s’adonne, lui, à une entreprise qui n’a d’autre quête que la permanence de soi, dans la durée de l’espèce : Qu’importent les commotions que l’événement (l’accident, le coma, la folie) a laissées en son for intérieur : Il doit conquérir une place, sa place, sa petite patrie dans le temps. Une parabole, en réalité : La parabole du démobilisé, sphinx porteur d’une énigme que personne ne cherche à connaître dans la Thèbes moderne où « tout vit », mais où rien ne sait :
« Or cette guerre arrache les masques de plusieurs millions d’hommes, écrit l’historien Frédéric Rousseau. Durant cette guerre longue et pour des dizaines de millions d’hommes, la mort est vue – elle est partout – la mort est sentie – elle pue -, la mort est entendue ; voilà qui est totalement inattendu ; les représentations conventionnelles se désintègrent ; le code immédiat explose. Une part du scandale de cette guerre tient précisément là, dans ce spectacle inédit, inouï. Toute la défense moderne contre l’angoisse de la mort s’effondre (…) En réalité, cette guerre interrompt – définitivement ? – une mutation des représentations de la vie et de la mort engagée plusieurs siècles auparavant. » (2)
En éclipsant la guerre hors de son récit, transformée de façon plus générale en une période de perte de conscience suffisamment longue pour que soient élargies « les possibilités de la vraisemblance », Henri Béraud obéit à la logique salvatrice du transfert : la guerre n’est qu’un accident. La fiction devient le lieu-même, salvateur, qui rend possible le refoulement. Lieu où le personnage de Jean Mourin se perd et se dissout dans la fiction de sa folie, lieu où l’écrivain assure, pour lui-même et son lecteur, une partielle rédemption.
Du point de vue de la réception, si l’on en croit la dédicace à Lucien Dubech, la métamorphose de la guerre en accident de la route reçoit une fonction : rendre accessible à « ceux qui nous précèdent » comme à « ceux qui nous suivront » l’expérience intérieure du démobilisé. Dans tous les sens du terme, cette expérience se transmet en un mot : dépaysement. Ne déclare-t-il pas, dans son Plan Sentimental : « Les aspects d’un temps nouveau, qui n’est déjà plus notre temps, ne se superposent pas toujours si rudement aux chères images de la jeunesse. Ne serait-ce pas, ce dépaysement, le plus aride sacrifice que le destin exige de la génération sacrifiée ? »…
Dans l’œuvre romanesque de Béraud, ce roman est une sorte d’iceberg solitaire qui paraît isolé des autres, aussi bien par son thème que par la contemporanéité de son propos. Roman de l’improbable guérison, pour ne pas dire de l’impossible résurrection, témoignage de l’effroi, Lazare est aussi le texte où la maladie trouve les mots dont elle a besoin pour s’énoncer, où le dialogue entre vivants est réamorcé.
Son roman à propos de la guerre, si l’on veut.
Il ne dénonce rien, il ne revendique rien. Il constate, simplement, ce que cette guerre, maudite comme la démence des hommes qui enterrent les autres, a fragmenté en lui. Il dresse la mesure de l’écart, encore une fois. Il évalue ce qu’il faudra, parmi les hommes - et sans Dieu -, en prenant appui sur les petites patries dans le temps, tenter de reconduire en soi de la permanence de l’éclat vital. Ce n’est pas un roman de guerre. Éconduisant la guerre, il la ramène à sa signification minimale : Il faut rendre à Lazare ce qui est à Lazare, à la folie des hommes ce qui est à la folie des hommes, à la littérature ce qui est à de son ressort ; Béraud ne dit rien d’autre, à propos de la guerre, que la révélation exacte de sa nature moderne : un enfer dont le sacre est inutile, une entreprise de mort pour rien, une initiation sans lendemain, qui ne pourra fasciner que ceux qui ne l’auront pas connue, et dont la littérature n’a rien à faire, n’en déplaise à d’autres romanciers dont l’écriture voudrait être un témoignage aussi événementiel que vain de l’indicible ou un voyage définitif et suicidaire au bout de la nuit.
1N 1 - Nous sommes venus au lieu que je t’ai dit, où tu verras les foules douloureuses qui ont perdu le bien de l’intellect » (Dante, L’Enfer, Chant III, 16-18)
2. 2. La Guerre censurée, Points seuil
07:27 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : henri béraud, lazare, rentrée littéraire, littérature, écriture, romans, guerre de quatorze, lucien dubech | 










Commentaires
Écrit par : solko | mardi, 08 septembre 2009
C'est un superbe texte encore et sur les écrits de H.Béraud.
Il m'a fait me souvenir d'un malade mental qui travaillait avec ma mère à la buanderie de l'Hôpital psychiatrique St Luc de Pau:il s'est réveillé un jour(coma, folie? je ne sais pas), il n'a pas pu s'adapter car il n'y avait plus personne autour de lui, pas de famille, pas d'amis, plus aucun repères, il a replongé dans la folie;J'avais 15 ans quand j'ai entendu son histoire et j'ai regardé d'un autre œil ces personnes car j'en avais peur.
Je vais relire ce texte.
Merci solko
Écrit par : La Zélie | mardi, 08 septembre 2009
Je reviendrai sur ce billet.
Écrit par : Michèle | mardi, 08 septembre 2009
Écrit par : Pascal Adam | mardi, 08 septembre 2009
Écrit par : Michèle | mardi, 08 septembre 2009
Il avait publié un essai en 1912 "L'école moderne de peinture lyonnaise". Silence (éditorial) entre 1912 et 1922...
Je voudrais avoir tout lu de lui et en même temps quel bonheur de savoir que c'est encore à lire. Je ne sais plus qui avait dit cela à quelqu'un qui n'avait pas encore lu "Je vous envie d'avoir cette découverte à faire".
Écrit par : Michèle | mercredi, 09 septembre 2009
Y'a pu qu'à...
Amitié
Écrit par : Bertrand | mercredi, 09 septembre 2009
les editions Mémoire des Arts de Lyon ont réédité "L'école moderne de peinture lyonnaise".
http://www.memoire-des-arts.com/catalog/advanced_search_result.php?keywords=ecole+moderne&x=4&y=11
et, plus récemment la monographie, "Adrien Bas. Une vie dédiée à la peinture" dans laquelle est inséré "Un peintre Adrien Bas" de Paul Lintier, dont la péface est signée Béraud.http://www.memoire-des-arts.com/catalog/advanced_search_result.php?keywords=adrien+bas&x=7&y=4
Écrit par : Dominique Rhéty | mercredi, 09 septembre 2009
J'essaye de compenser la disette de mon épicerie municipal!
@solko: l'idée de Michèle est très bonne, vous devriez y penser.
Écrit par : La zélie | mercredi, 09 septembre 2009
Pour les livres de Béraud, savez-vous que sur rare-book.com, on trouve La Gerbe d'or à 6€, Qu'as-tu fait de ta jeunesse? à 8€, Le Martyre de l'obèse à 3€, ce que j'ai vu à Moscou à 4€50 etc. Solko parle d'ebay ; je ne sais pas acheter sur ebay. Mais ce que je voulais dire, c'est que cela coûte peut-être moins cher que les cartouches de l'imprimante et le papier. Même si au prix des livres il faut ajouter le port.
Ceci dit, j'avoue avoir imprimé "Le dernier franc" et "Un Pascal dans la neige" la première fois que je les ai lus. Puis l'écran devient très vite une habitude. Même si je n'en suis pas loin s'en faut à l'I-phone.
Bonne soirée Zélie.
Écrit par : Michèle | mercredi, 09 septembre 2009
Merci beaucoup pour toutes ces indications. Je suis allée voir sur les éditions Mémoire des Arts de Lyon "L'école moderne de peinture lyonnaise", je crois que je vais craquer.
Et la monographie "Adrien Bas", bien sûr .
J'ai lu dans "Qu'as-tu fait de ta jeunesse" ce passage dont vous parliez, sur l'amitié que Béraud porte à Lintier :
"C'était un Manceau, trapu, très brun, l'air rustique, avec des yeux pleins d'un sombre feu. Il faisait son droit, mais ne pensait qu'aux lettres. A dix-sept ans il avait publié son premier livre, un tableau de la vie de tous les jours, fait d'une pâte solide et charnue, toute à son image et qui, l'exprimant tel qu'il était, ne devait rien à personne. Il était de ceux, bien rares, qui prennent dans l'existence la matière de leurs écrits. Il parlait la plume à la main, sans gêne et sans but, pour passer le temps comme s'il racontait des histoires à des gens pour leur plaisir et le sien. (...)"
Magnifique. Merci.
Écrit par : Michèle | mercredi, 09 septembre 2009
Quand j'ai commencé à lire et travailler sur cet auteur, j'ai pris contact avec un professeur que j'avais eu auparavant, et que j'ai toujours beaucoup aimé, je parle là de Jacques Seebacher, bien sûr. Et à Jacques Seebacher, spécialiste de Michelet et de Hugo, j'ai demandé s'il voulait bien conduire une thèse sur cette oeuvre qu'il connaissait bien. "C'est trop tôt", m'a-t-il dit, d'un ton asez attristé, je dois dire. Nous étions alors dans les années 2000 ou 2001. Jacques est mort depuis, faudra-t-il attendre notre mort à tous ?
Le projet de thèse s'est transformé en essai, dont ces quelques articles ici publiés forment des extraits. Protection oblige, je ne publie pas tout, à savoir l'essentiel (qui porte sur le cycle romanesque des trois principaux romans de Béraud, le cycle de "la Conquête du Pain"). J'ai renoncé à envoyer aux éditeurs ce travail qui n'est pleinement compréhensible que de ceux qui ont lu l'oeuvre (on tourne en rond).
Le mieux serait en effet une édition commentée, avec un appareil critique fourni.
Affaire à suivre...
Écrit par : solko | mercredi, 09 septembre 2009
Bonne journée
Écrit par : solko | jeudi, 10 septembre 2009
Écrit par : La Zélie | jeudi, 10 septembre 2009
Vous allez sur le billet de Solko "Paul Lintier" (il vous suffit de taper ce nom dans la petite lucarne de recherche, colonne de gauche en haut du site) ; dans l'une de ses réponses Solko donne le lien précis. Switcher sur ce lien et vous êtes sur le site de rare-book et tout de suite dans la recherche avancée vous entrez un titre de Béraud et vous avez toutes les propositions ; je viens d'essayer pour La Gerbe d'or.
Peut-être avez-vous déjà trouvé d'ailleurs...
Bien à vous
Écrit par : Michèle | jeudi, 10 septembre 2009
Je m'en veux car j'avais lu ce billet et ses commentaires.Et en plus j'avais consulter ce lien mais je n'avais pas sauvegarder l'adresse.Avec Google, j'obtenais un lien où il n'y avait rien.
Il est vraiment bien ce blog: c'est un salon de discussion et d'échanges et son auteur apprécie.
Merci solko.
Écrit par : La Zélie | vendredi, 11 septembre 2009
Je cours vaquer à mes secrètes occupations.
Écrit par : solko | vendredi, 11 septembre 2009
Écrit par : Michèle | vendredi, 11 septembre 2009
Drôle de coïncidence !
Écrit par : S. Jobert | samedi, 12 septembre 2009
Les commentaires sont fermés.