lundi, 02 mars 2009
1925 : Béraud chez les soviets
A tout seigneur, tout honneur : Albert Londres n'aura attendu ni André Gide ni Henri Béraud pour lancer, en 1917, déjà ce cri à Edouard Helsey : "Qu'est-ce que nous fichons ici ? Nous sommes correspondants de guerre et l'on ne cherche qu'à nous empêcher d'aller à la guerre. Hier encore, on m'a refusé les moyens de me rendre à Berry-au-bac où l'on se bagarre tous les jours. J'en, ai assez de délayer les topos des services d'information. D'ailleurs ces combats de tranchée sans issue, ces coups de main localisés vont vraisemblablement se prolonger toute l'année. Et pendant ce temps-là, des événements gigantesques se produisent ailleurs. Un cataclysme est en train de creuser un abîme dans l'histoire du monde, et nous n'essayons pas d'en être les témoins. Il faut aller en Russie. Viens-tu avec moi ?" (1)
Même inquiétude, même questionnement, quelques années plus tard, de la part d'un autre professionnel du grand reportage, Henri Béraud : « On part pour ce pays, qui semble le plus lointain du monde, avec tant de notions contradictoires. On est aux portes de l'énigme : Est-ce Icarie ou Paestum ? Eldorado ou Gomorrhe? L'imagination travaille, la curiosité vous ôte le sommeil. »(2)
Albert Londres avait été le premier à accomplir le voyage en 1920, pour L'Excelsior. En juillet 1925, Béraud le suivit pour le Journal. Le succès de ce reportage (3), publié en octobre et dédié à Joseph Kessel, tient du vertige : « A l'époque, certains prétendirent que jamais succès de presse n'avait égalé celui-là (...) Les lettres de lecteurs arrivaient par milliers. Les plus grands journaux du monde traduisirent, mot pour mot, mes trente articles. En quelques jours, mon nom atteignit à la grande célébrité », peut noter Béraud, trente ans plus tard dans Les Derniers beaux Jours, dernier volet de son autobiographie
Qu'y révélait-il de si sensationnel ?
Deux choses.
Tout d'abord, la fin du communisme dans la dictature bolchévique. Entre le fascisme mussolinien et le bolchévisme, aucune différence : «Rien, extérieurement, ne ressemble plus la vie moscovite que la vie romaine : cortèges, emblèmes, crainte, silence. C'est à dire que la réaction et la révolution n'ont, après elles, laissé aux hommes déconcertés qu'un être sombre et masqué, le Dictateur inconnu, qui ne saurait subsister sans l'adhésion de certains groupes, nécessairement avantagés au détriment des autres. A parler brutalement, il s'agit de deux fascismes. » Et ailleurs : « ce ne fut pas la fin de la Révolution russe. Ce fut la faillite du Communisme au profit d'un régime nationaliste et même xénophobe, d'un impérialisme qui s'essaie dans l'ombre aux gestes arrogants, et que nous aurons, conclue-t-il, à démasquer ». De quoi se faire de bons amis parmi les intellectuels bourgeois du Parti Communiste Français, où l'on aura la mémoire vive, en temps et heures.
Ensuite que le régime soviétique ne se dirigeait pas vers le capitalisme d'état. Il était déjà dedans. En plein. Il n'y avait donc plus rien à attendre de la Révolution russe à Levalois Perret. Rien. Le recueil des articles s'ouvrait par un avertissement solennel « au peuple »: Après avoir rappelé ses origines populaires, n'ayant pas besoin « d'aller au peuple comme certains fils à papa qui, pour arriver plus vite dans les milieux populaires, s'y rendent en automobile, il précisait : «Le devoir était de dénoncer la faillite de l'égalité économique telle qu'on l'avait promise aux insurgés d'Octobre ; il fallait dire comment, au cœur même de la capitale prolétarienne, les pauvres subissent plus que n'importe où l'insolence de la fortune et l'immonde assouvissement des profiteurs.» Les travailleurs, chez nous, écrivait-il « ont fait la seule révolution qui compte, celle des salaires. Ils n'ont rien attendre du bolchévisme. »
Suivait, en une trentaine de chapitres et 250 pages reprenant tous les articles du Journal une démonstration impeccable : la propagande qui s'abat sur le peuple russe, le silence dans les rues, les circuits organisés (déjà !) pour touristes occidentaux, les miséreux et les millionnaires, l'interview hilarante du camarade Kamenev, au fait de sa puissance en 1925, la NEP (nouvelle politique économique), les disparus de 1918 et les exécutions qui se poursuivent, la xénophobie des dirigeants russes, la presse inexistante hormis l'omniprésente Pravda, la « novlangue » (avec, notamment deux exemples sur lesquels il s'arrête longuement : la prison, rebaptisée « institut de la privation de liberté », et le contremaître devenu «ouvrier aîné»...). La littérature dite "de reportage" d'Henri Béraud est très fournie. De 1919 à 1934 passant de L'œuvre au Petit Parisien, puis au Journal, de quoi remplir huit recueils de reportages aux éditions de France : Ce que j'ai vu à Moscou (1925), Ce que j'ai vu à Berlin (1926), Le Flâneur salarié (1927), Rendez-vous européens (1928), Ce que j'ai vu à Rome (1929), Emeutes en Espagne (1931), Le feu qui couve (1932), Vienne, clef du monde (1934). Ces ouvrages, comme d'ailleurs ceux d'Albert Londres, ont connu à l'époque un succès qu'on ne peut imaginer. Ceux de Londres furent, à juste titre, ré-imprimés. Ceux de Béraud, non. Il faudra bien qu'un éditeur quelque peu entreprenant, un jour, dans ce pays aux habitants emplis d'amnésie, répare ce préjudice.
A tout seigneur, tout honneur : Albert Londres n'aura attendu ni André Gide ni Henri Béraud pour lancer, en 1917, déjà ce cri à Edouard Helsey : "Qu'est-ce que nous fichons ici ? Nous sommes correspondants de guerre et l'on ne cherche qu'à nous empêcher d'aller à la guerre. Hier encore, on m'a refusé les moyens de me rendre à Berry-au-bac où l'on se bagarre tous les jours. J'en, ai assez de délayer les topos des services d'information. D'ailleurs ces combats de tranchée sans issue, ces coups de main localisés vont vraisemblablement se prolonger toute l'année. Et pendant ce temps-là, des événements gigantesques se produisent ailleurs. Un cataclysme est en train de creuser un abîme dans l'histoire du monde, et nous n'essayons pas d'en être les témoins. Il faut aller en Russie. Viens-tu avec moi ?" (1)
Même inquiétude, même questionnement, quelques années plus tard, de la part d'un autre professionnel du grand reportage, Henri Béraud : « On part pour ce pays, qui semble le plus lointain du monde, avec tant de notions contradictoires. On est aux portes de l'énigme : Est-ce Icarie ou Paestum ? Eldorado ou Gomorrhe? L'imagination travaille, la curiosité vous ôte le sommeil. »(2)
Albert Londres avait été le premier à accomplir le voyage en 1920, pour L'Excelsior. En juillet 1925, Béraud le suivit pour le Journal. Le succès de ce reportage (3), publié en octobre et dédié à Joseph Kessel, tient du vertige : « A l'époque, certains prétendirent que jamais succès de presse n'avait égalé celui-là (...) Les lettres de lecteurs arrivaient par milliers. Les plus grands journaux du monde traduisirent, mot pour mot, mes trente articles. En quelques jours, mon nom atteignit à la grande célébrité », peut noter Béraud, trente ans plus tard dans Les Derniers beaux Jours, dernier volet de son autobiographie
Qu'y révélait-il de si sensationnel ?
Deux choses.
Tout d'abord, la fin du communisme dans la dictature bolchévique. Entre le fascisme mussolinien et le bolchévisme, aucune différence : «Rien, extérieurement, ne ressemble plus la vie moscovite que la vie romaine : cortèges, emblèmes, crainte, silence. C'est à dire que la réaction et la révolution n'ont, après elles, laissé aux hommes déconcertés qu'un être sombre et masqué, le Dictateur inconnu, qui ne saurait subsister sans l'adhésion de certains groupes, nécessairement avantagés au détriment des autres. A parler brutalement, il s'agit de deux fascismes. » Et ailleurs : « ce ne fut pas la fin de la Révolution russe. Ce fut la faillite du Communisme au profit d'un régime nationaliste et même xénophobe, d'un impérialisme qui s'essaie dans l'ombre aux gestes arrogants, et que nous aurons, conclue-t-il, à démasquer ». De quoi se faire de bons amis parmi les intellectuels bourgeois du Parti Communiste Français, où l'on aura la mémoire vive, en temps et heures.
Ensuite que le régime soviétique ne se dirigeait pas vers le capitalisme d'état. Il était déjà dedans. En plein. Il n'y avait donc plus rien à attendre de la Révolution russe à Levalois Perret. Rien. Le recueil des articles s'ouvrait par un avertissement solennel « au peuple »: Après avoir rappelé ses origines populaires, n'ayant pas besoin « d'aller au peuple comme certains fils à papa qui, pour arriver plus vite dans les milieux populaires, s'y rendent en automobile, il précisait : «Le devoir était de dénoncer la faillite de l'égalité économique telle qu'on l'avait promise aux insurgés d'Octobre ; il fallait dire comment, au cœur même de la capitale prolétarienne, les pauvres subissent plus que n'importe où l'insolence de la fortune et l'immonde assouvissement des profiteurs.» Les travailleurs, chez nous, écrivait-il « ont fait la seule révolution qui compte, celle des salaires. Ils n'ont rien attendre du bolchévisme. »
Suivait, en une trentaine de chapitres et 250 pages reprenant tous les articles du Journal une démonstration impeccable : la propagande qui s'abat sur le peuple russe, le silence dans les rues, les circuits organisés (déjà !) pour touristes occidentaux, les miséreux et les millionnaires, l'interview hilarante du camarade Kamenev, au fait de sa puissance en 1925, la NEP (nouvelle politique économique), les disparus de 1918 et les exécutions qui se poursuivent, la xénophobie des dirigeants russes, la presse inexistante hormis l'omniprésente Pravda, la « novlangue » (avec, notamment deux exemples sur lesquels il s'arrête longuement : la prison, rebaptisée « institut de la privation de liberté », et le contremaître devenu «ouvrier aîné»...). La littérature dite "de reportage" d'Henri Béraud est très fournie. De 1919 à 1934 passant de L'œuvre au Petit Parisien, puis au Journal, de quoi remplir huit recueils de reportages aux éditions de France : Ce que j'ai vu à Moscou (1925), Ce que j'ai vu à Berlin (1926), Le Flâneur salarié (1927), Rendez-vous européens (1928), Ce que j'ai vu à Rome (1929), Emeutes en Espagne (1931), Le feu qui couve (1932), Vienne, clef du monde (1934). Ces ouvrages, comme d'ailleurs ceux d'Albert Londres, ont connu à l'époque un succès qu'on ne peut imaginer. Ceux de Londres furent, à juste titre, ré-imprimés. Ceux de Béraud, non. Il faudra bien qu'un éditeur quelque peu entreprenant, un jour, dans ce pays aux habitants emplis d'amnésie, répare ce préjudice.
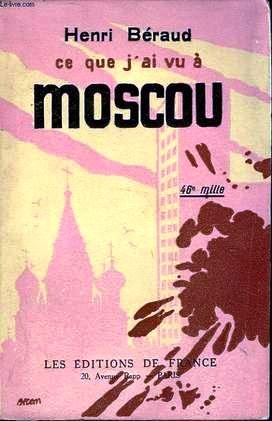
Florilège
A Moscou, Lénine n'est pas mort depuis plus de dix-huit mois qu'il a déjà son mausolée, palace burlesque dont la file des visiteurs s'allonge bien au-delà de Saint Basile, parfois jusqu'aux berges de la Moskowa :
« C'est une obsession. Ce crâne rond, cette barbiche, ces yeux bridés, ce visage pensif et absent, on le retrouve à chaque pas. La propagande vous le visse à jamais dans la mémoire. Il est partout dans tous les étalages, quelle que soit la marchandise offerte aux chalands, Lénine en litho, Lénine au pastel, Lénine pyrogravé, Lénine en mosaïque, Lénine sur linoléum, Lénine encrier, Lénine sous-main. » Et Béraud de noter : « Cette débauche d'effigies et cette floraison de ressemblances miraculeuses, où donc l'avons-nous observées ? C'est à Rome. La figure tirée au plus grand nombre d'exemplaires, après celle de Lénine, est assurément celle de M Mussolini (...) Sans doute les dictatures, toutes les dictatures, engendrent-elles ce goût de l'image et de l'imitation » ! (Chapitre 6) : « En 1925, comme aux pires jours de 1918, on se méfie des murs. L'obsession du microphone serre toutes les mâchoires russes, - ce sera ainsi pour la vie d'une génération. » (Chapitre 19) « Voyageurs, touristes, commerçants qui vous disposez à partir pour l'U.R.S.S., n'oubliez point que le communisme est fondé sur le mépris des biens terrestres et, en particulier, de l'argent. J'oublie de vous dire le nom de l'hôtelier qui sait louer ses chambres et vendre ses repas au triple du plus haut marché mondial. Cet hôtelier n'est autre que l'Etat soviétique. Il a peut-être raison de ne pas tolérer la concurrence. ».
« Comment on vit à Moscou : Assez bien lorsqu'on a beaucoup d'argent, fort mal lorsqu'on en a peu, et, lorsqu'on n'en a pas, on crève. Tous les vieux sont crevés, et tous les "bourjouis" crèveront, car on leur refuse le droit de travailler et la permission de quitter la Russie. Quant aux autres, ceux qui ont pu se dire « prolétaires », ils en ont pour leur roubles, peu ou beaucoup. Cela dépend de leur condition. »
« Il y a chez les dirigeants de l'union des Soviets, une sorte d'esprit cinématographique. Ils sont partisans de la vision brève, des images superposées et du gros plan. Nulle puissance au monde ne les égale pour truquer le décor. Au service de leurs invités, ils mettent des autocars, dont le parcours, admirablement réglé, ne côtoie que les façades de cette Los Angeles sociale. Quant à l'envers, on fait de son mieux pour le cacher aux regards indiscrets ». (chapitre 18)
Et pour clore, ce passage saisissant, description d'un dimanche sur les bords de la Moskowa (chapitre 22) :
« Croient-ils encore à quelque chose, ces hommes, que le Régime du Travail soviétique, formant dix-sept catégories, a placés dans les plus basses ? Ils sentent confusément que cela doit être ainsi, qu'il y aura toujours, toujours, des masses sacrifiées, des travailleurs obscurs, des foules à qui l'on redit, d'âges en âges, les éternels mensonges. Il pleuvait toujours. Le soir venait. Il fallait songer à regagner les faubourgs de Moscou. Par groupes, les ouvriers se levèrent. Tramways et remorques s'emplirent d'une cargaison maussade. Je pris l'une des dernières voitures. Notre tramway bondissait, lâchait d'énormes, craquantes et verdâtres décharges, grandes lueurs, lumières folles où passaient les limousines éclairées, qui filaient vers l'Ermitage. On vendait des journaux. J'en pris un. Il contenait un article sur la triste condition de vie des prolétaires français. Peut-être nos ouvriers n'ont-ils pas encore tout ce qu'on leur doit souhaiter de bien-être et de ressources. Mais s'en trouverait-il un qui pût, en connaissance de cause, souhaiter l'avènement d'un bonheur où le prolétariat a perdu jusqu'au souvenir du temps où il riait ? »
Ces lignes datent de 1925. C'était hier. Ou peut-être demain.
Autres articles sur des reportages de Béraud :
- Ce que j'ai vu à Berlin :
http://solko.hautetfort.com/archive/2009/03/14/henri-bera...
- Ce que j'ai vu à Rome :
http://solko.hautetfort.com/archive/2009/03/15/la-dedicac...
(1) Edouard Helsey, Envoyé spécial, cité par Pierre Assouline dans sa biographie d'Albert Londres
(2) Henri Béraud, Ce que j'ai vu à Moscou
(3) Pour Ignace Mouthon, directeur du Journal, « cela représenta du jour au lendemain, pour un bon mois, 250 000 exemplaires supplémentaires ». Quant au recueil de l'intégralité des articles publiés aux Editions de France, il réalisa un tirage de 300.000 exemplaires.
22:39 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : henri béraud, le petit parisien, littérature, moscou, soviets, communisme, russie | 










Commentaires
Méfiez vous, à force de nous passionner avec Béraud, Vous allez finir par attirer les multinationales de l'édition qui iront vendre des concentrés de Béraud à Hollyvoude qui seront retraduits en France ( "le petit Béraud Facile" "Béraud pour les nuls" ""URSS : Béraud savait")
D'ici que Béraud soit adapté au cinéma avec brad Pitt dans le rôle de Béraud. Vous êtes tellement convaincant sur Béraud que ça risque de devenir hénaurme , et tout finira comme Debord au centre Pompidou... Félicitations tout de même quel billet !
J'attends avec impatience votre billet sur les entretiens de Béraud avec le professeur Halambique "Béraud et le sceptre D'Ottokar ", c'est possible ?
Écrit par : frasby | lundi, 02 mars 2009
Écrit par : Porky | lundi, 02 mars 2009
Écrit par : solko | lundi, 02 mars 2009
Mais cela viendra, à son heure.
Écrit par : solko | lundi, 02 mars 2009
Libre oui, c'est la moindre des choses, mais c'est un adjectif qui fait beaucoup souffrir ceux qui le portent à même la peau ? Mais vous savez ça n'est ce pas ? (Je suppose qu'il est trop tard pour vous "récupérer"? )
Blague à part (Mais, non, je ne blaguais pas !)
J'ignore tout sur Béraud, donc je ne pouvais pas savoir. Même si j'ai beaucoup écouté Radio Tirana , ils ont caché aussi cela ?
Écrit par : frasby | lundi, 02 mars 2009
Pardonnez moi, je suis extrêmement troublée par la fulgurance de votre récent commentaire chez moi, dans la crypte du couvent des Clarisses. Ce qui ne nous éloigne absolument pas du sujet ou plutôt qui vous rapproche.
Du soleil .
Écrit par : frasby | lundi, 02 mars 2009
Écrit par : Thomas P | lundi, 02 mars 2009
Je lis vos billets et ceux de Sophie, n'ai juste pas la force de commenter, ne trouve pas la force de trouver quoi dire et me tais... Mais je suis tombé sur le commentaire chez Frasby et en effet il est simplement magnifique.
A bientôt.
Écrit par : tanguy | lundi, 02 mars 2009
Si je comprends bien, Solko, "Ce que j'ai vu à Moscou" (1925), 250 pages, fut tiré à plus de 250 000 exemplaires.
Quand, dans la note (3) de bas de page, vous dites "Quant au recueil de l'intégralité des articles publiés aux Editions de France, il réalisa un tirage de 300 000 exemplaires", cela veut-il dire que chacun des 8 recueils qui constituent la "littérature de reportage" de Béraud, a tiré à 300 000 exemplaires ?
J'ai l'air de pinailler, mais avec l'impact qu'ont eu ces recueils entre 1925 et 1934, je voudrais comprendre pourquoi il n'y a pas eu de réédition, à l'instar des ouvrages d'Albert Londres.
Quand on voit les extraits que vous nous donnez à lire de "Ce que j'ai vu à Moscou", on brûle du besoin de tout lire et on imagine ce qu'il peut y avoir dans les autres recueils et en particulier les trois derniers "Emeutes en Espagne"(1931), "Le feu qui couve" (1932) et "Vienne, clef du monde" (1934).
On imagine que la 2e Guerre mondiale, la Guerre froide ensuite, ont posé une chape de plomb là-dessus.
Béraud a-t-il des ayant-droits ? Les textes tombent dans le domaine public au bout de cinquante ans, non ? ou c'est encore soixante-dix ? Comment faire pour ne pas laisser cela sous le boisseau?
Ce qui m'intéresse dans le recueil que vous évoquez aujourd'hui, c'est que vous dites que Béraud y révélait "la fin du communisme dans la dictature bolchévique" ; et, ajoutez-vous : "Entre le fascisme mussolinien et le bolchévisme, aucune différence."
"La fin du communisme dans la dictature bolchévique" : cette formulation dit que le bolchévisme, ce n'était plus le communisme.
Chaque fois qu'il y a amalgame entre communisme et nazisme, entre communisme et fascisme, j'ai envie de préciser ceci :
Il y a ceux pour qui le communisme est mauvais parce qu'il vise des idéaux d'égalité, de justice, de fraternité ; et il y a ceux pour qui il est mauvais quand il trahit ces idéaux.
Le nazisme repose sur l'application d'un programme haïssable ; le bolchévisme (ainsi que toutes les dictatures se réclamant à tort du communisme) repose sur la perversion et la trahison d'un idéal.
En tout cas, Solko, je me répète : reconnaissance infinie pour votre travail et la découverte incroyable qu'il entraîne.
Une fois les rééditions faites - rêvons un peu, et pourquoi ne pas lancer une sorte de pétition-souscription - (d'abord sauvegarder, hein, Frasby ?), on saura auprès de qui trouver des idées pour contrer toutes tentatives de récupération...
Écrit par : michèle pambrun | mardi, 03 mars 2009
Bonne lecture. Lisez pour nous, qui attendons de tomber sur des perles pareilles.
Écrit par : michèle pambrun | mardi, 03 mars 2009
250 000 exemplaires, c'est le nombre d'exemplaires du "Journal", vendus en plus durant le mois où sont parus les reportage (Mouthon en est le directeur)
300.000 exemplaires, c'est le nombre d'exemplaires vendus du livre qui a été fait à partir de ces articles, au vu du succès de l'édition journal.
A l'époque, la distinction que nous faisons aujourd'hui entre communisme (la théorie, pour faire vite) et bolchévisme (ce qui existe en Russie), je crois que les gens ne la faisaient pas aussi nettement : les bolchéviques réalisaient le communisme dans leurs lointaines terres. Or Béraud précisément découvre cette différence aujourd'hui communément reconnue. D'où, à certains moments, une sorte de brouillage (notions contradictoires évoquées par lui). Ce que Béraud découvre avec horreur, c'est l'établissement programmé de ce qu'Hannah Arendt appelle un "système totalitaire", ni plus ni moins, derrière les beaux idéaux revendiqués. Une véritable xénophobie, aussi, sur laquelle il insiste, et qui relève de la "trahison" (2ème cas parmi ceux que vous évoquez).
Écrit par : solko | mardi, 03 mars 2009
Écrit par : solko | mardi, 03 mars 2009
I se pourrait bien que ce soit tout pareil pour du Solko.
Celui des Nouvelles. Celui des billets (de banque). Celui des billets (du blog). Celui des chroniques littéraires. Celui des coups de gueule humoristico-politico-(hein)corrects.
C'est tout pareil. On prend tout. On en redemande.
C'était petite récré au boulot, avant de plier bagage ; si c'est trop élogieux, trop rococo, trop riquiqui, trop embarrassant/embarrassé, le sucrer. Sans rancune, d'aucun côté.
Écrit par : michèle pambrun | mardi, 03 mars 2009
Pour trouver des Béraud facilement et à des prix abordables, je vous recommande un site sûr, "rare book.com"
(ce ne sont que des bouquinistes).
Et il y en a pas mal, à tous les prix.
Ce que vous me dites est fort gentil. Tout fait ventre. Je prends donc, moi aussi !
Écrit par : solko | mardi, 03 mars 2009
Écrit par : Thomas P | mercredi, 04 mars 2009
Les commentaires sont fermés.