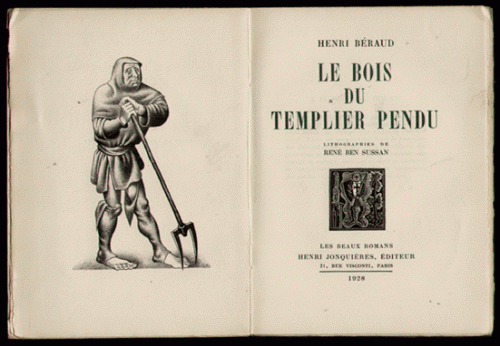dimanche, 20 avril 2014
Devinette
De qui sont les lignes suivantes ? A noter que l'illustration, au même titre que certains éléments du texte, constitue un précieux indice :
« L’affection spirituelle et pure qui unit longtemps Mme Jaubert à Musset, et dont ses lettres nous ont gardé la température si tendre, entretenait un halo de discrète gloire autour des boucles blanches de la vieille dame. Elle avait été jeune sous Louis-Philippe ; et ses derniers amis ayant commencé d’être célèbres sous l’Empire, elle n’assemblait plus autour d’elle que des survivants d’un autre âge. Les débris d’un temps continuent d’une époque à l’autre, comme les souvenirs des Tuileries survivaient à leurs ruines calcinées, qui n’étaient pas déblayées encore. Ainsi mon père, en ses vingt ans, touchait de la main un monde déjà historique et recueillait ses témoignages. C’est là qu’il connut Mme Howland, beauté mure mais de grand esprit, amie autrefois de Cousin, de Prévost-Paradol et de Fromentin, plus tard d’Halévy, de Reyer, du peintre Degas, que j’ai moi-même vue très vieille dame, et dont je n’ai pas oublié le regard, comme elle cherchait à retrouver en moi l’image adolescente de mon père, ni son soupir, à ce retour. Romanesque, spirituelle, autoritaire et quelque peu désabusée, j’ai des lettres d’elle à mon père, de la qualité le plus rare où, malgré le détachement feint et la tendresse d’une femme au bord du déclin se mêle aux plus affectueuses gronderies. C’est elle qui lui donna, je crois, ce beau surnom d’hurluberlu dont on l’accueillait en souriant chez la marraine (…) Le marquis Du Lau survenait, vétéran de l’Empire et du Grand-Cercle, et aussi Charles Haas, de qui plus tard Marcel Proust a fait Swann ; et le comte Lepic, naguère chambellan de Napoléon III. La conversation s’égaillait, et mon père faisait des croquis.»

23:00 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature | 
dimanche, 13 avril 2014
Pierre Autin-Grenier, inutile et tranquille, définitivement
« Au zinc de certains cafés commence à se murmurer assez sérieusement que la Terre ne serait pas ronde, pas du tout. Je reçois aujourd’hui la lettre d’un ami m’assurant que mon adresse est fausse et qu’en fait je n’habite nullement où je l’imagine. Autour du Soleil la Terre tourne cependant, et cette lettre fameuse m’est pourtant bien parvenue. Il semble donc qu’il y ait belle lurette que les boussoles n’indiquent plus vraiment le nord, mais divers endroits assez désemparés où chacun tente, dans les limites étroites de ses moyens, d’un peu s’ancrer pour échapper au tournis général et retrouver d’illusoires certitudes en vue des rafistoler l’idée précaire qu’il peut se faire de l’avenir »

Inutile et tranquille, définitivement : dernières paroles de Toute une vie bien ratée, un récit qui date de 1997, et d'où les lignes ci-dessous sont tirées, des lignes de Pierre Autin-Grenier (1947-2014), qu’on ne croisera plus sur le boulevard de la Croix-Rousse ni au grand café de la Soierie ni ailleurs, puisqu'il vient de quitter Lyon et la Terre plus trop ronde à ce qui se murmure de plus en plus autour de nous...
22:31 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lyon, croix-rousse, littérature, pierre autin-grenier | 
mardi, 14 janvier 2014
Ca y est maintenant, Maintenon, c'est Gayet
Le temps est loin où les puissants de ce monde allaient s’encanailler auprès de jolies grisettes dans le joli bois de Romainville. Aujourd’hui, les présidents de la République vont chercher leurs premières dames dans le show-business. .Après Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, Hollande I et Trierweiller, voici Hollande II et Gayet. Une chanteuse, une journaliste et à présent, une actrice. Un président, a fortiori de gauche, un président normal, avec une caissière Monoprix ou une femme de ménage aurait peut-être eu symboliquement plus d’allure : une jolie romance sociale, quoi. Mais la grisette d’aujourd’hui a perdu tout romantisme, les grands de ce monde aussi, dont les secrets d’alcôves se découvrent dans la presse people à côté de ceux des stars de la télé-réalité. Comment diable pourrions-nous jamais les respecter ? Le président du Mariage pour tous plus bling bling et plus faux que son prédécesseur tant décrié qui, lui, au moins, épousait, se ramasse dans la figure le désordre, la vulgarité et l’inconséquence qu’il a créés. Car à la grossièreté d’un goujat devant une femme, il allie l’inconséquence du collégien auprès d'une autre, dans une mise à nu de la collusion abyssale entre le monde du show-business, celui des médias, de la politique et celui de la tromperie.
85% des Français n’aurait pas, dit-on, changé d’avis au sujet de ce calamiteux président : c’est que seulement 15% en avait une bonne. C’est aussi que la plupart d’entre nous avons d’autres chats à fouetter, d’autres spectacles à regarder, d’autres symboliques à ressentir que ce piteux vaudeville. On ne tire pas sur une ambulance, dit le proverbe. Mais cette ambulance folle prétend conduire encore un gouvernement usé jusqu’à la corde et à représenter le pays sur la scène du monde, comme le claironnait Calderon en son temps.Si tout ceci n'est qu'un rôle, alors il faut savoir le jouer.Et quand on joue aussi mal, il faut accepter d'être sifflé.
« Philippe ne sent pas l’honneur de la France comme le sentait l’ainé des Bourbons », nota François René de Chateaubriand à propos de la petitesse de Louis Philippe. « Hollande ne sent pas l’honneur de la France comme le sentait De Gaulle », pourrait-on dire, De Gaulle, qui écrivait en début de ses Mémoires : « Ce qu’il y a en moi d’affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle ». On était loin, alors des journalistes de Paris Match et des actrices de seconde zone. A quoi ressemblera la première phrase des Mémoires de Hollande, si ce bonimenteur qui ne sait même pas parler correctement les fait écrire par un nègre un jour ?
Dans ce marais fangeux dont il est déjà l’épicentre pas même deux années après sa triste élection, François Hollande s’aventure tel un Bernard l’Hermite dans la grandeur déchue du rêve socialiste français qu’il a, depuis longtemps, contribué à faire voler en éclat, sur le mode à la fois carnavalesque et vil de l’imposteur : Division des Français avec ce chantage aussi permanent que ridicule au racisme et à l’antisémitisme, croisades contre des signes et déni du Réel ; exaltation bêtifiante d’un égalitarisme confus et des éléments de langage bidonnés qui vont avec (Mariage pour tous, ABCD de l’égalité, pacte de responsabilité -ha ha !), auxquels on tente de donner force de loi parce que, faute d’être majoritaire dans le pays, on l’est encore dans les assemblées.
Ce président n’a ni la carrure ni l’allure de la fonction qui le ridiculise, lui, plus qu’il ne la ridiculise: Tout seul dans son jardin, comme le chanta un jour Carla Bruni, mais décidé sans aucun doute à s’y cramponner. On a beau, en effet, le surnommer Pépère ou Flanby, l’homme est un manœuvrier sans conviction tout prêt à jouer au pingouin le plus longtemps sous le feu des projos, comme François le Premier joua à la grenouille pour durer. Et avec lui tous ceux qui se nourrissent du pouvoir que lui donne la Constitution. Le pire des années 90/95 est de retour, carnaval, mensonge, duplicité, pitrerie, décomposition, ce que, dans un billet désabusé (Le changement c’est Maintenon), j’eus la tristesse de voir venir gros comme un maison ICI en son temps.
00:58 Publié dans Des Auteurs, Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : conférence de presse, hollande, gayet, trierweiller, showbusiness, france, politique, décomposition, bling bling, élysée, naufrage | 
jeudi, 31 octobre 2013
L'illustre français
J’ai relu aujourd’hui une trentaine de pages des Illustres Françaises de Robert Challe, dans l’édition nouvelle publiée en 1991 chez Droz par Deloffre et Cormier ; j’avais lu et annoté cette œuvre il y a longtemps, puis je l’avais totalement oubliée. Et au bout de quelques pages, sans doute à cause de l’enchantement que procure le rythme de ces phrases dont la syntaxe cherche à coller à chaque instant soit au sentiment, soit à l’action, il m’a semblé n’en avoir quitté que d’hier la lecture.
En revenant à moi après une petite heure passée dans ces pages, je me suis interrogé en silence sur la magie de cette langue française qui venait de m’unir aussi intimement à cet auteur dont rien d’autre ne reste sur Terre, que ses mots. Considérant l’état actuel du pays, la vacuité de la vie politique et éditoriale, la précarité de la pensée, la nullité des arts et des modes, la grossièreté et l’irréligiosité des hommes et des femmes, la fatuité de tout un chacun, je me suis demandé ce qu’un homme du XVIIème siècle comme lui trouverait à revenir parmi nous aujourd’hui : et je me suis dit qu’il ne trouverait sans doute rien, ni honneur ni prestige ni beauté.
Mais qu’au contraire ce que quelqu’un du XXIe siècle comme moi trouvait à revenir en sa langue demeure d’une saveur irremplaçable, inégalée. C’est le français à la fois populaire et savant, dont la syntaxe à peine détachée du tronc latin ramasse à pleine propositions les mots de la rue. Pas un seul terme technique ni administratif. Pas la moindre abstraction, du moins grossière et vaniteuse comme celles dont nous nous gargarisons à présent. Ce sentiment de légèreté n’est sensible qu’au fil de la lecture, grâce à l’oubli progressif de l’immondice linguistique dans lequel la contemporanéité plonge notre esprit.
Et en même temps qu’elle est oxygène par sa pureté, je me disais que cette langue perdue est aussi squelette par son maintien : le maintien, c'est-à-dire l’appui ferme et constant sur la consonne et la voyelle fermée, c’est évidemment ce qui manque le plus au français d’aujourd’hui, imprécis, pauvre et confus à force de s’être disloqué au contact de la presse, de l'audiovisuel et de la traduction. Les gens de cette époque, dont la raison était frottée dès leur plus jeune âge à la langue du droit comme à celle des Écritures, allaient sans grand mal d’un autre train, tout cela est certain.
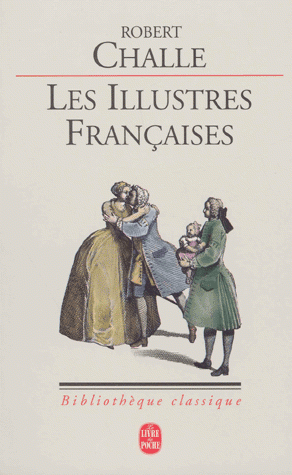
00:02 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : illustres françaises, robert challe, littérature, france, culture, romans | 
samedi, 22 juin 2013
L'émergence du cadavre en littérature
Plus que toute autre, la littérature du dix-neuvième siècle abonde en descriptions de cadavres. Il est peu de romans, à bien regarder, qui n’en recèlent au moins une : cadavres d’enfants, cadavres de soldats, cadavres de saintes ou de courtisanes, cadavres de vieux chrétiens et d'assassins sans foi ni loi : cadavres, si j’ose dire, en tous genres.
Qu’on en juge par ce constat : Parmi les vingt romans des Rougon-Macquart de Zola, quinze s’achèvent par l’évocation voire la description détaillée d’un cadavre. Comme si la description du corps –souvent dans un très sale état – du héros constituait un vrai dénouement. Celui de Nana demeure un modèle du genre :
« C’était un charnier, un tas d’humeur, une pelletée de chair corrompue, jetée là, sur un coussin. Les pustules avaient envahi la figure entière, un bouton touchant l'autre; et flétries, affaissées, d'un aspect grisâtre de boue, elles semblaient déjà une moisissure de la terre, sur cette bouillie informe, où l'on ne retrouvait plus les traits. Un oeil, celui de gauche, avait complètement sombré dans le bouillonement de la purulence. L'autre, à demi ouvert, s'enfonçait, comme un trou noir et gaté ».
Le cadavre de la reine de Paris n’inspire plus ni regret ni compassion à ceux qui hurlent A Berlin sous ses fenêtres : on passe à autre chose, la grande Histoire – ou du moins la vision que s’en fait Zola – roule sur le cadavre condamné à l'oubli, et tel est le sens de sa fulgurante décomposition.
Le principe naturaliste de clore une narration par la desciption d'un cadavre, récurrent chez Zola, prend naissance dans l'imitation de Balzac et de son réalisme. Dans César Birotteau, La fille aux yeux d’or, La femme de trente ans, La peau de Chagrin, pour ne citer qu’eux, la description d'un mort parachève la théâtralité de tout le récit. Et le véritable dénouement n’est pas une action, mais un état post-mortem, souvent non exempt d’ironie, comme ici pour le Christ de la parfumerie :
« En présence de ce monde fleuri, César serra la main de son confesseur et pencha la tête sur le sein de sa femme agenouillée. Un vaisseau s’était déjà rompu dans sa poitrine, et par surcroit, l’anévrisme étranglait sa dernière respiration.
-Voilà la mort du juste, dit l’abbé Loraux d’une voix grave, en montrant César par un de ces gestes divins que Rembrandt a su deviner pour son tableau du Christ rappelant Lazare à la vie.
Jésus ordonne à la Terre de rendre sa proie le saint prêtre indiquait au Ciel un martyr de la probité commerciale à décorer de la palme éternelle. »
L’exhibition finale du cadavre n’a pas toujours été de mise : « N’exigez pas de moi que je vous décrive mes sentiments, ni que je vous rapporte ses dernières expressions », précise le narrateur de Manon Lescaut. On se souvient, de même, avec quelle jalouse pudeur Claire tire le voile sur le visage de Julie dans La Nouvelle Héloïse. Rousseau pourtant évoque les chairs du visage, qui « commencent à se corrompre », là où Prévost se contentait de parler d’un corps « exposé à devenir la pâture des bêtes sauvages ».
Les romanciers du dix-neuvième siècle n’auront de cesse de prolonger cette tentation. La poésie, elle-même, s’emparera du motif : Une Charogne de Baudelaire, Souvenir de la nuit du 4 de Hugo, Le dormeur du Val de Rimbaud, pour ne citer que les plus institutionnalisés, Enfin, quand la tragédie du grand siècle interdisait qu’on mourût sur scène, tout drame romantique ne saurait se conclure sans un amas de cadavres dans les minutes qui précèdent la chute du rideau. L’acteur doit donc aussi jouer le cadavre, et c’est sur cette improbable figuration que s’achève le spectacle et que le drame trouve sa fin, dans le sentiment que le spectateur emporte.
Dans son grand Sermon sur la mort, Bossuet, au plus établi de l’âge classique, avait pourtant fait preuve d’une solennelle prémonition, rendant compte pour le futur de la difficulté de dépeindre un cadavre :
« La chair changera de nature, le corps prendra un autre nom ; même celui de cadavre ne lui demeurera plus longtemps : il deviendra un je ne sais quoi, qui n’a plus de nom dans aucune langue ».
L’aigle de Meaux stipulait que dire le cadavre est un artifice impossible. A moins d’être – ce qu’il s’interdit par nature – un rapport d’autopsie, le discours littéraire sur le cadavre n’a donc pour seule ressource que de modaliser à l’infini toutes les variations de la peur et du désir qu’il suscite chez le survivant.
Si l’on s’intéresse d’un peu plus près à cette mode du cadavre dont la littérature du XIXème témoigne, on découvre assez vite quel problème littéraire elle pose à chaque écrivain : l’objet cadavre étant proprement indicible et indescriptible, à moins de s’en tenir à un rapport d’autopsie (et encore), c’est donc davantage la somme idéologique des peurs, des désirs, des pulsions et des représentations imaginaires de chacun qui se projette et se donne à lire, en lieu et place du corps mort décrit. Dans leur volonté de dire le Réel, le Beau, le Laid, le Sublime ou le Fantastique, des générations d’auteurs n’ont ainsi pas manqué d’esthétiser, chacune à leur façon, cet objet incontournable, que les siècles antérieurs avaient, plus prudemment, tenu à distance.
Ainsi, Chateaubriand décrivant le cadavre d’Atala en 1801 réconcilie l’homme et la nature dans une harmonieuse mise en scène de la foi chrétienne et du le grand rassemblement fraternel des défunts devant la promesse de la Résurrection.
« Ses lèvres comme un bouton de rose cueilli depuis deux matins, semblaient languir et sourire. Dans ses joues d'une blancheur éclatante, on distinguait quelques veines bleues. Ses beaux yeux étaient fermés, ses pieds modestes étaient joints et ses mains d'albâtre pressaient sur son coeur un crucifix d'ébène. Elle paraissait enchantée par l'Ange de la mélancolie et par le double sommeil de l'innocence et de la tombe. Le nom de Dieu et du tombeau sortait de tous les échos, de tous les torrents, de toutes les forêts (…) et l’on croyait entendre, dans les Bocages de la mort, le chœur lointain des décédés, qui répondait à la voix du solitaire ».
Ni tristesse, ni désespoir de la part de Chactas, le survivant, mais une sérénité raffermie lorsque qu’il offre de ses mains mêmes à « la terre du sommeil » la dépouille « comme un lys blanc », dont « le sein s’élève au milieu du sombre argile »
Cette vision du cadavre chrétien connait une fortune considérable et de multiples imitations, à tel point que le peintre Girodet s’en empare pour triompher au salon de 1808 avec Les Funérailles d’Atala.

Du romantisme au naturalisme, dans ce XIXème ébranlé par les soubresauts convulsifs de plusieurs révolutions, hanté par les spéculations spirituelles (spiritisme, martinisme) les plus extrêmes, la représentation du cadavre a ainsi évolué en même temps que celle que l’homme a pu se faire de sa propre condition et de son propre destin, au fur et à mesure également que la représentation issue du catholicisme perdait de son emprise sur les esprits. Qu’il s’agisse d’affirmer la foi chrétienne ou celle dans le positivisme, la description du cadavre est devenu au cours du XIXème siècle un lieu idéologique, qui draine ses figures de style, ses passages obligés et ses lieux communs ; promesse de rédemption chez l'un, siège même de la pourriture excrémentielle chez l'autre, il se charge de tenir sur les vivants un discours sans ambigüité et occupe du coup dans l'oeuvre une place inédite auparavant.
(à suivre)
00:12 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, romantisme, chateaubriand, balzac, naturalisme, zola | 
mardi, 21 mai 2013
Dominique Venner
Personne ne peut rester indifférent au geste d'un homme qui se suicide devant un autel. Pour de multiples raisons, qui vont bien au-delà du geste spectaculaire. D’abord parce que dans la théologie catholique, le suicide est un péché d’orgueil, le pire qu’on puisse asséner à son Créateur. Cela dit, je ne doute pas qu’en conscience, Dominique Venner ne se soit pas considéré comme un suicidé, mais bien plutôt comme un soldat.
de multiples raisons, qui vont bien au-delà du geste spectaculaire. D’abord parce que dans la théologie catholique, le suicide est un péché d’orgueil, le pire qu’on puisse asséner à son Créateur. Cela dit, je ne doute pas qu’en conscience, Dominique Venner ne se soit pas considéré comme un suicidé, mais bien plutôt comme un soldat.
Dans le dernier billet qu’il a laissé ce matin même sur son blog, consacré à la loi absurde passée en coup de force par Hollande, il écrit ceci :
« Je viens d’écouter un blogueur algérien. De toute façon, disait-il, dans quinze ans les islamistes seront au pouvoir en France et ils supprimeront cette loi. Non pour nous faire plaisir, on s’en doute, mais parce qu’elle est contraire à la charia »
Suit cette phrase, citée partout : « Il faudra certainement des gestes nouveaux, spectaculaires et symboliques pour ébranler les somnolences, secouer les consciences anesthésiées et réveiller la mémoire de nos origines. Nous entrons dans un temps où les paroles doivent être authentifiées par des actes ».
Pour se maintenir au pouvoir et faire, à sa place, la politique de son prédécesseur, Hollande a mis le doigt dans un engrenage qui finira par lui être fatal, c’est celui d'une manipulation trop criante de l’opinion. Parce qu’il en avait besoin, il a fait de cette réforme du mariage « pour tous » une manière d’être de gauche quand même. Il a pris de front l’épiscopat français et une grande partie des catholiques, de même que la tradition du pays, alors qu’il était si simple de mettre sur pied une union civile donnant les mêmes droits aux homosexuels, sans engager avec le mot mariage une possibilité de recours devant la cour de justice européenne pour obtenir des droits sur la filiation, et sans choquer les consciences religieuses, juives et musulmanes comprises.
Mais Hollande a beau être un énarque doctrinaire enfermé dans l'histoire de son parti et sa stratégie personnelle, il veut être le président de tous les Français. Aujourd’hui pompier pyromane, il parle d’apaisement pour tenter d’éteindre par la loi l’incendie qu’il a lui-même allumé en proposant cette loi. Le sang de Dominique Venner l’éclabousse donc indirectement comme, ironie du sort, celui de Grossouvre lui aussi suicidé (mais à l’Elysée), éclaboussa plus directement Mitterrand, l’homme que le triste sire qui habite àl’Elysée s’est donné pour modèle. Ironie du sort, toujours, non seulement Venner et Grossouvre étaient de grands amis, mais encore Venner, en tant que directeur de la Nouvelle Revue d’Histoire, avait dernièrement rouvert le dossier sur le prétendu suicide de son ami personnel, ce même Grossouvre qui fut surnommé durant deux septennat le ministre de la vie privée de MItterrand
Bref, le suicidé de Notre Dame n'est pas n''importe qui, un quelconque agité d'extrême droite, un simple militant anti mariage pour tous, comme on le clame sur toutes les ondes
Je cite ici quelques propos de Venner, plus érudit que militant, directeur de la NRH où écrivit Decaux et Jacqueline de Romilly, qui permettent d’aider à mieux comprendre cet acte, par-delà les raisons données par la propagande officielle :
« Ce qui caractérise la société dans laquelle nous vivons et ses classes dirigeantes, c'est le rejet de l'histoire, le rejet de l¹esprit historique. Celui-ci avait plusieurs mérites. Il assurait d'abord la vigueur du sentiment national ou identitaire. Il permettait d'interpréter le présent en s'appuyant sur le passé. Il développait l¹instinct stratégique, le sens de l'ennemi. Il favorisait aussi une distance critique par rapport au poids écrasant du quotidien. Ce rejet de l'histoire s¹accompagne paradoxalement d'une hypertrophie médiatique de ce qu'on appelle la mémoire, qui n'est qu'une focalisation partielle et partiale d'évènements contemporains. Comme les autres spécialistes des sciences humaines, les historiens subissent le chaos mental de l'époque et participent à l'effort général de déstructuration. Sous prétexte de répudier tout impérialisme culturel, l¹enseignement de l'histoire a brisé le fil du temps, détruisant la véritable mémoire du passé. Suivant l'expression d¹Alain Finkielkraut, il nous apprend à ne pas retrouver dans nos ancêtres l'image de nous-mêmes. Le rejet de la chronologie est un procédé très efficace pour éviter une structuration cohérente de l'esprit. Cela est bien utile. La cohérence gênerait la versatilité et le tourbillonnement dont se nourrit une société soumise à la tyrannie de l'éphémère et de l'apparence. Ma conception de l'histoire est évidemment différente. Je l'ai définie dans l¹éditorial du premier numéro d'Enquête sur l¹histoire : Notre vision du passé détermine l'avenir. Il est impossible de penser le présent et le futur sans éprouver derrière nous l'épaisseur de notre passé, sans le sentiment de nos origines. Il n'y a pas de futur pour qui ne sait d'où il vient, pour qui n'a pas la mémoire d'un passé qui l'a fait ce qu'il est. Mais sentir le passé, c'est le rendre présent. Le passé n'est pas derrière nous comme ce qui était autrefois. Il se tient devant nous, toujours neuf et jeune. »
L'impératif de l'historien (propos recueillis par Laurent Schang).
La gauche, enfin cette gauche socialo-libérale exécrable, Lang, Bergé, Mamère et consorts, va fêter non loin de Notre Dame sa « victoire » à la Bastille. Ils vont klaxonner dans les rues, aussi ? Sans doute ce que Hollande et ses sbires appellent apaiser. En attendant, voici une capture d’écran (vers 20h30), qui en dit long sur l’état des troupes, en effet. Triste pays.
20:55 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : dominique venner, suicide, notre-dame, mariage gay, politique, france, société, festif, décadence | 
mardi, 22 janvier 2013
Lucchini est plus intelligent que l'Education Nationale
Et sans doute que la Comédie Française, contre laquelle il prend la plus subtile des revanches. Alceste à bicyclette ou Quand l'effroyable vient à bout de l'indicible. A voir sans la moindre hésitation.

14:48 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : molière, théâtre, le misanthrope, fabrice lucchini, lambert wilson, cinéma, alceste à bicyclette | 
mercredi, 02 janvier 2013
Le chemin de Tardi
Dans l’avalanche d’infos insipides, idiotes ou de pure propagande, les bonnes nouvelles sont suffisamment rares pour qu’on prenne la peine de les saluer ; en voici une : Tardi vient de refuser la Légion d’Honneur Ça ne m’étonne pas.
Tous les lecteurs d’Adèle Blanc-Sec, du Voyage, du Cri du Peuple, du Stalag II B et de La guerre des tranchées le savent : Tardi est un mec bien. Il n’a donc pas envie de se retrouver embourbé dans le régiment aussi folklorique qu’insignifiant des sportifs, humoristes et autres décorés du Nouvel An à qui l’on attribue chaque année cette distinction devenue plus médiatique qu’honorifique. Un ruban tralala, même plus mondain au sens que la bonne société donnait jadis à ce mot et qui, à sa façon, reste un genre d’allégeance. Il refuse, dit-il, de se trouver « pris en otage par quelque pouvoir que ce soit ». Il veut continuer son chemin de solitaire. Il a raison. Emboitons lui le pas. C’est le bon.

Tardi, Mort à Crédit
14:36 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : tardi, légiond'honneur, france, bandes dessinées | 
dimanche, 23 décembre 2012
Béraud et le cimetière de Sabolas
Le Bois du Templier Pendu, sort de presse en 1926. Béraud, le nomade, le voyageur qui passe tous ses étés à courir les capitales, y retrace patiemment cinq siècles de l’histoire d’un village de laboureurs, de 1309 à 1790 (Fin le 26 messidor). Sabolas (sabots las) est une variante fictive de Satolas, le village dauphinois d’où provient la branche maternelle de sa famille. C’est le premier volume de La Conquête du Pain, l’épopée sédentaire des ancêtres laboureurs qui comprendra deux autres titres : Les lurons de Sabolas et Ciel de Suie
Tout commence – est-ce un hasard ? -, dans un cimetière, avec une poignée de « noms sans visages », celui de trépassés dont nul grimoire, dans les coffres du château, n’a conservé le souvenir :
« Ces trépassés n’avaient en leur vie guère parlé plus que les bœufs du sillon et les moutons du pâtis – et pourtant ils laissaient à leurs descendants maintes leçons (...) Qu’est-ce que l’on savait d’eux ? Rien que ces noms qu’ils avaient transmis avec la peur de l’enfer, et le respect du seigneur, et l’appel confus de l’humaine fatigue vers l’avenir menteur. »
« Sous les pères des barons, les pères des vilains poussaient la charrue et tiraient la faucille. Leur sueur avait séché sur les champs du maître ; il fût resté d’eux rien autre chose que l’usure de leurs mains sur l’outil agricole, n’étaient justement ces noms sans visage – Champartel, Perrin, Collard, Pejud, Griveau, Pastourel, Barge, Le Belleau, Pillerod, Rigault, Goy, Vaunel Espognant – ces noms dont toutes les syllabes résonnaient dans le nom de Sabolas, ces vies passées qui faisaient de Sabolas un tout bien clos, semblable à l’arche des Ecritures, une nef allant à son destin et flottant sur les âges comme sur un flot trouble et hasardeux, plein d’ombres. » Le bois du Templier pendu, II
Au moment où Béraud rédige ces lignes s’alignent depuis peu, au centre de chaque village de France, d’interminables, de muettes et de solidaires listes de noms tout pareils à ceux-ci.. L’œil n’en finit pas de glisser sur ces ex-voto partout alignés, dont le classement alphabétique étire de loin en loin et la noblesse et l’horreur. Chaque administration, chaque institution dresse le sien. Des noms qui se répètent au fil de dates similaires sur chaque monument, d’un coin de la France à l’autre. Des homonymes, par milliers. Pour la première fois dans l’Histoire, le héros est pluriel. Innombrables sont les morts. Sous l’arc de Triomphe parisien, le singulier en qui le sacrifice de tous ces ruraux abattus s’incarne ne porte, significativement, aucun patronyme. Un mot, seul, aux contours incertains, est capable de qualifier la victime, que les orateurs révolutionnaires avaient sans cesse à la bouche, et dont Michelet fit le titre d’un livre : Le peuple.
Il n’est pas indifférent de rappeler que le co-fondateur des Annales, Marc Bloch, né en 1886, fait partie de cette génération d’historiens pour qui déchiffrer, consigner l’histoire des gens réels est plus important que de retenir des événements : le monument aux morts, page de garde d’une démarche qui orientera les historiens vers les actes notariaux et les archives municipales plutôt que vers les chroniques des rois de France, page de garde, également, de La Conquête du Pain.
L’idée fondatrice, c’est que ce peuple des campagnes qui vient d’être saigné à blanc, quelques remarques fameuses des Caractères de La Bruyère (1688), un chapitre dans Le Peuple de Michelet (1846), un long poème de Lamartine (Jocelyn) les récits champêtres de Georges Sand (1845-1853), le roman de Balzac (1855), et la Terre du bourgeois Zola (1887), ne suffisent plus à raconter sa légende. « Je raconte une histoire, débute-t-il, pour les gens d’ici » (C’est à dire dédiée aux gens d’ici). En exergue de la deuxième édition du Bois du Templier pendu, il rajoute cette citation de Shakespeare : « Qui va là ? – Paysans, pauvres gens de France ! »
Dès l’incipit, la formule orale du vieux roman arthurien prédomine : « C’était en l’an 1309… Il y avait un franciscain…. En ce temps-là Sabolas…. Or entendez-bien… A cette heure, donc… ». Elle jouxte un peu partout les termes féodaux dont la résonance archaïque donne au récit un ton soutenu : affouage, échanguette, glèbe, vesprée, mesnil, vilains, châtellenies… Les paragraphes se suivent, courts comme les laisses en prose d’un récitant. Dans les phrases qui se succèdent, on retrouve souvent le rythme et la cadence d’un mètre. Ainsi la description du templier, lors de l’épisode fondateur, de la fable d’où procède la suite du récit, où l’on repère une dominante de vers de six syllabes :
6 Un manteau s’étalait
8 sur la croupe de son cheval
6 qui suivait à pas lents
6 les lacets du sentier
6 L’homme allait, l’air pensif
6 et semblait arriver
6 des confins de la terre.
Le texte qui dit la légende prend ainsi la forme de la légende qu’il raconte :
« On racontait cela le soir, sous la lumière fumeuse des torches de résines. Tous ceux de Sabolas savaient par cœur ces histoires et croyaient, sur la foi des anciens, qu’à chaque nouvelle lune, le templier revenait prier, mains jointes, près de la fontaine Jean Page. Quiconque apercevait le blanc manteau et les mailles luisantes du fer vêtu, mourait dans l’année. La fontaine elle-même passait pour vénéneuse… Les trouvères imitaient ces récits et les accréditaient dans les châteaux. Nul, en pays dauphinois, ne doutait du pouvoir de ce blanc et double fantôme, et les curés faisaient, aux Vigiles, réciter par leurs paroissiens une oraison propre à exorciser la forêt. »
Dans la prose béraldienne surgit parfois un écho de La Fontaine ou de La Bruyère : « Le paysan osa relever le front et se vêtir comme un homme » fait directement allusion au texte célèbre des Caractères, tandis que la narration suit en chapitres « le spectacle historique de la civilisation », rendant linéaire son déroulement : Guerre de cent ans, peste, jacquerie, famines, bohémiens, lèpre, baron des Adrets, recruteurs des guerres royales, tous les malheurs qui tombent successivement sur le village ne constituent que la longue suite des péripéties grâce auxquelles s’énonce, autour de la petite histoire des laboureurs, comme en un écho parallèle et lointain, la grande, l’officielle, qu’on croirait située hors roman, placée littéralement comme en orbite par une force centrifuge, étrangère au centre de gravité constant du village et de son cimetière.
Cette façon que le narrateur a de saisir les personnages dans leur espace et dans leur temps, d’être en osmose avec leur marche vers la propriété du sol sans jamais poser sur eux le regard externe du citadin est la grande originalité de Béraud par rapport à Balzac ou Zola, le procédé qui assure toute la force lyrique du récit. Ainsi, lorsqu’un épisode de l’histoire de France bouleverse soudainement l’espace et le temps de Sabolas, le lecteur comprend qu’un peu de temps linéaire est passé, qu’on a changé de siècle. Les événements historiques fondamentaux du monde citadin sont réduits à n’être ici presque que des marqueurs temporels. Aucun de ces événements, si brutaux, si inexpliqués, si dramatiques soient-ils, ne paraît être en mesure de rompre le temps cyclique du laboureur que ressuscite, quoi qu’il arrive, celui de la narration : L’existence de Luc Belleau, un personnage devenu centenaire, peut se résumer de cette manière :
« Les misères et les joies des hommes tenaient, dans sa mémoire, moins de place que les vicissitudes des champs. Les grandes dates de sa carrière n’étaient ni les guerres ni la venue des princes. C’étaient les fastes et les fléaux agricoles (…) Il ne savait pas le nom des cinq rois qui, lui vivant, s’étaient succédé au trône de France. Il connaissait mieux les étoiles et leurs bienfaits.»
D’une génération à l’autre, d’un épisode ou d’un chapitre à l’autre, le moteur de l’histoire se réduit donc à la longue marche de ces sabots qui, malgré leur lassitude, leur effroi devant la cruauté des puissants, leurs crédules superstitions, leurs représentations primitives du monde naturel et politique qui les entoure, vont pourtant parvenir à conquérir patiemment ce qui assure la permanence de la survie en donnant le pain, c’est à dire la possession de la terre : « Un débris de tribu, dans un bout de pays, partait à la conquête du pain ».
Délivrer ses descendants du servage, tel est l’unique quête des héros. Cet enjeu épuise des générations de personnages avant d’aboutir au compromis révolutionnaire. Ainsi Béraud s’inscrit dans la droite ligne de Michelet, en voyant dans l’émancipation du servage le fil conducteur de l’Histoire de ce peuple français dont les noms s’alignent désormais par milliers sur les monuments aux morts du siècle nouveau.
Au sens que Mikhaïl Bakhtine (1) conféra un jour au terme, ce cimetière est donc bien le chronotope (2)e des trois récits du cycle, puisque le cours des centaines de vies humaines qui s’y rencontrent au fil des siècles vient inexorablement s’achever entre ses murs. Après la scène de pillage de Sabolas par le baron des Adrets (fils aînés précipités des murailles, viol des femmes, incendie des maisons et exécutions en série), il reste même le seul lieu intact au milieu des ruines calcinées :
« Il ne restait rien de Sabolas, ni maisons, ni clocher, ni récoltes, ni curé, ni espoir, ni Dieu, ni saints. Absolument rien, que le cimetière. »
Et lorsque le corps de Patrice, le héros de Ciel de Suie, y est inhumé en 1894, le cycle peut s’achever sur une ultime phrase, réponse à la question « Qui va là ? » de l’exergue : « C’est un homme qui pleure. Passez votre chemin ! ». Entre cette œuvre romanesque et les écrits autobiographiques, si un lieu opère la transition, c’est bien encore lui : Après la mort de son père, le héros de La Gerbe d’Or, le narrateur de Qu’as-tu fait de ta jeunesse s’interroge : « Que fait-il maintenant ? Que font-ils les chers témoins, s’ils ne m’attendent, heureux et consolés, au pied de l’église, dans le vieux cimetière où nos anciens dorment sous les herbes folles ? »
Véritable matrice de l’œuvre, le cimetière de Sabolas est donc le point de départ et d’arrivée de toutes les créatures de Béraud. Il est la page où s’exprime le mythe béraldien par excellence : celui de la pérennité des aïeux, de la permanence et de la force du temps. Comme les monuments aux morts des humbles poilus de quatorze, il sollicite le récit historique de façon presque incantatoire : L’imaginaire qu’il suscite supplée les carences de l’histoire. Comme légitimée par l’abandon, la rêverie comble le manque d’archives, de grimoires, de manuscrits. Autour de ces vies qui furent et dont on n’a retenu que des noms, la mémoire et l’oubli, les deux pôles antagonistes de la force du temps, finissent par se fondre dans la rêverie où elles cessent de se combattre. Le temps qui la structure est celui de la fidélité historique, fondement de l’identité du seul héros à travers toutes les épreuves qui le frappent tour à tour : Sabolas. Fondement revendiqué haut et fort, également, de l’identité du narrateur et de la permanence de sa voix
[2] « Nous appellerons chronotope, ce qui se traduit littéralement par temps espace, la corrélation essentielle des rapports spatio-temporels, telle qu’elle a été assimilée par la littérature (…) Dans la chronotope littéraire a lieu la fusion des indices spatiaux e’t temporels en un tout intelligible et concret
Monument aux morts de Satolas
22:32 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : béraud, littérature, satolas, sabolas, dauphiné, guerre |