lundi, 31 janvier 2011
Terres
Deux personnages marchent en direction d’une « terre jaune », une terre idéale dont l’un d’entre eux, Kétal, se dit persuadé qu’elle existe. C’est celui qui déambule devant. Derrière, Aride, un plus petit, qui porte le plus lourd bagage et se plaint : « C’est encore loin ? » Ainsi débute Terres, la pièce de Lise Martin que Nino d’Introna vient de créer au TNG de Lyon.
Très vite les deux hommes découvrent cette terre jaune (Israël ? L’Ouest Américain ? Le paradis perdu ?) puis en prennent possession, malgré la mention propriété privée inscrite en lettres capitales dessus. Le (les) propriétaires déboulent bientôt, en revendiquent eux aussi la propriété. Et c’est la guerre. Le texte de Lise Martin demeure suffisamment simple, ouvert et allégorique pour intéresser le jeune public auquel Nino d’Introna s’adresse aussi dans son théâtre.
Ce qui est surtout et constamment captivé ici, c’est l’œil. Car cette terre jaune, qui n’est qu’Idéal, la scénographie la fait vivre au gré de la marche et des stations des acteurs dans un carré de couleur. C’est du visuel minutieusement réglé.
A lire la direction d’acteurs, on comprend que le choix de Nino d’Introna fut de mettre en scène avec le plus de légèreté possible le caractère incessamment belliqueux de l’espèce. Du public. Même petit. Même tout petit : Le spectateur peut ainsi découvrir à un tournant du spectacle que la scène est dans un bac à sable. Et tout le spectacle converge alors vers une image finale, belle trouvaille, vraiment, pour éclairer d’un nouveau jour le titre de la pièce et l’allégorie qui la sous-tend.
Impossible de ne pas songer alors à Rousseau : « Le premier qui, ayant enclos un terrain s’avisa de dire : ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. »

Dans un entretien avec Blandine Dauvilaire, journaliste à Théâtre contemporain.net, Nino d’Introna révélait en janvier 2010 :
« Je pense qu’en réalité, tout ce que l’on voit chez les hommes dans la société actuelle, se trouve déjà à l’origine de l’humanité, c'est-à-dire dans la petite enfance. Il y a finalement peu de différence entre cette folie qui consiste à vouloir posséder une terre ou une femme, et deux enfants autour d’un bac à sable qui se battent pour la propriété d’un seau. Sans batailles, l’humanité ne pourrait probablement pas exister. Mais je n’ai pas de solution, alors j’ai envie de montrer que la propriété est la base de la relation. »
Terres, de Lise Martin, mise en scène de Nino d’Introna, avec Maxime Cella, Thomas Di Genova, Alexis Jebeile, Sarah Marcuse.
TNG, Lyon 9ème - jusqu’au 5 février 2011
06:03 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : nino d'introna, théâtre, tng, lise martin, terres, lyon | 
samedi, 15 janvier 2011
L'étudiant au salon
Je ne veux pas faire d’analogies déplacées, mais enfin, la halle Tony Garnier fut à Lyon, durant plusieurs décennies, un abattoir, pour ne pas dire l’abattoir municipal. Veaux, vaches, cochons y rendirent donc en masses beuglantes ce qu’ils avaient d’âme, avant d’aller remplir en tranches et morceaux les assiettes des bonnes et braves gens d’entre Saône et Rhône.
C’est entre ces murs que depuis hier et jusqu’à demain se tient le salon de l’étudiant.
Passage obligé d’un parcours qu’on nomme désormais pré-professionnalisant ; dans les travées étroites entre les multiples stands, de longs convois de marcheurs : on cause masseterre, bétéhesse et class’prepas, en familles ou en couples.
Ce n’est là, me direz-vous, qu’une parenthèse de temps sérieux, pris en sandwiches entre des spectacles du plus haut intérêt (des animations waltdisneyesques, un tour de chant nohâesque, une soirée avec Michel Sardou, voyez, que du divertissement mainstram très basic, suffit de consulter le programme, quoi) .
Mais là, en attendant, c’est du sérieux, l’avenir des petits, quoi !
On compulse avec fébrilité ou détachement les brochures emplies de sigles et de photos, on interroge, on a – et c’est un peu normal dans toutes ces traverses – du mal à trouver le chemin de l’avenir. Tel métier : combien ça gagne ? L’avenir ? A quoi ça ressemble ? Et puis, combien sommes-nous sur le coup ?
Une certaine morosité s’installe.
Trouver sa place, y accorder son goût, ni simple ni facile, dirait-on. C’est alors qu’on s’aperçoit que pour les parents les plus modestes, la novlangue technicienne des sciences de l’orientation, c’est de l’étrusque, pour ne pas dire du basque paléolithique. Voilà que cela saute aux yeux, combien tout est démontable dans cet univers en kit, et que même les plus sages, les plus sérieux, les mieux avertis d’entre nous, ne faisons qu’y passer, passablement désorientés à l’endroit où ça compte, celui du cœur.
Au cœur de l’après-midi, justement, je me suis pris à rêver à ce que Justin Godart écrivit en 1899 dans sa thèse sur l’Ouvrier en Soie : Justin Godart expliquait qu’un apprenti-tisseur passait au minimum cinq ans en apprentissage chez un maître, avant de subir l’examen dit « du chef d’œuvre », puis de devenir compagnon pour au minimum rester deux ans chez un nouveau maître, chez lequel il devait dormir chaque soir, gage de son sérieux. Au sortir de cette « formation», il n’était encore qu’un ouvrier, et pas un « Bac + 7 ».
« Pendant les années de l’apprentissage, écrit Godart, « l’homme se développe, à qui bientôt on pourra en toute sécurité (le point est d’importance) décerner ses lettres de maîtrise. » La maîtrise arrivait enfin, et avec elle « l’inscription faite sur les registres de la Communauté, aux armes de la ville » Alors seulement l’ouvrier en soye pouvait s’installer à son compte, et revendiquer le titre de ce métier.
Combien (s’ils revenaient), ces gens-là - qui tissèrent entre autres les splendides teintures de Versailles et des robes d’évêques par centaines - s’étonneraient de voir ces bacheliers à la fois si vaniteux et si désemparés, errant d’un stand à l’autre, à la recherche de quoi – finit-on par se demander, la barre au front dans ce brouhaha en fin d’après-midi.
On se dit finalement que tout comme mères, pères, grand-mères, femmes, amoureux et autres ont leur fête et leur journée, il convient que comme l’automobile, l’agriculture, le livre, le mariage ou le chien, l’étudiant aussi ait son salon.
Et que cela, seul, est ce qui compte.

19:57 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : salon de l'étudiant, lyon, orientation, politique | 
dimanche, 09 janvier 2011
René Leynaud, poète
« Vivant je ne le suis sinon qu’en vos poitrines
Réside encor la voix que la mort me ravit,
Et redire mon nom me fait l’ombre divine
Du soleil de mes jours venir à mon envi
Et moi venir à moi, et ma chair transparaître
Mieux acquise aux voix que mon chant ne sut l’être »
 Les poésies de René Leynaud ont plusieurs été fois exhumées. Une première fois par Francis Ponge qui, triant dans les papiers que la veuve du résistant fusillé à trente quatre ans lui donna, supervisa la publication du premier recueil posthume en 1947. Une seconde fois par Paul Gravillon, journaliste au Progrès qui fut à l’origine de la réédition par les éditions Comp’act et le Goethe Institut de ce même recueil, en 1994.
Les poésies de René Leynaud ont plusieurs été fois exhumées. Une première fois par Francis Ponge qui, triant dans les papiers que la veuve du résistant fusillé à trente quatre ans lui donna, supervisa la publication du premier recueil posthume en 1947. Une seconde fois par Paul Gravillon, journaliste au Progrès qui fut à l’origine de la réédition par les éditions Comp’act et le Goethe Institut de ce même recueil, en 1994.
« Je l’ai connu par hasard dans une anthologie de Seghers. », raconte ce dernier. « J’étais fait-diversiers de nuit au Progrès». Découvrant qu’il avait été journaliste au Progrès, Gravillon écrivit à Gallimard et reçut le recueil. Il découvrit alors une amitié entre un écrivain qu’il admirait (Albert Camus) et un jeune poète qu’il ne connaissait pas. « Modeste et mystérieux », dit Gravillon, fort justement de Leynaud, en parlant de l’intérêt humain qu’il ressentit à lire ses textes.
Dans ses poèmes, Leynaud, le martyr de Villeneuve dans l'Ain, évoque si souvent la mort que sa femme parla à leur sujet un jour de « textes prémonitoires ». Les trois derniers paragraphes d’un long poème en prose, Etre, sont, de ce point de vue, magnifiques :
«Soudain, et sans que je le voulusse, je me trouvai debout contre la vitre. Je regardai au-delà de mon visage dressé dans un reflet.
En bas le kiosque, les arbres, ce qui m’apparut de la place, les trottoirs, les quais, tout était renversé dans une lumière bouleversante de déluge. Le paysage entier, ciel livré à la terre, s’ordonnait suivant une certaine détresse, un désespoir sans cause d’exister.
Et je compris soudain dans une soudaine lenteur, que cette détresse c’était celle-là même que je n’avais pas reconnue en moi, noyée sans visage, lorsque je marchais en quête de ton absence. Et je fermai les yeux pour mieux te nier, toi, sans nom, sans voix, sans regard, toi, contre tous les désirs de mon être, que je retrouvais dans cette maison illuminée de bitume et d’eau, et tapie sournoisement au creux de cette chambre où j’étais seul, enfermé dans ma déchirante volonté d’exister enfin hors de tout. »
Magnifique est également, dans ce recul où nous sommes par rapport à l’événement de la Résistance, cette longue préface de Camus à son ami. Cet extrait, parmi d’autres, dans lequel il narre leur conversation au 6 de la rue qui porte aujourd’hui son nom, au bas des pentes, dans la chambre de bonne où il l’hébergeait lors de ses visites à Lyon : « J’aimais le voir rire. Il le faisait rarement, si j’y réfléchis, mais alors de tout son cœur et jeté sur sa chaise avec abandon. L’instant d’après, il était debout, dans une position où je le revois souvent, les pieds un peu écartés, roulant ses manches très au-dessus des biceps et relevant ses bras solides pour essayer de discipliner ses cheveux toujours en désordre. Nous parlions de boxe, de bains de mer et de camping. Il aimait la vie physique, l’effort, la terre fraternelle, et tout cela silencieusement, à la façon même dont il mangeait, avec un bel appétit taciturne. Quand minuit approchait, il vidait sa pipe, disposait de nouvelles cigarettes dont il me priait d’user pendant la nuit, et, la veste sous le bras, partait d’un pas vigoureux. Je l’entendais encore dans l’escalier et je regardais autour de moi ce qui lui appartenait. »
A Camus, René Leynaud écrivit : « Je me suis souvent demandé si je ne m’exerçais pas à la poésie pour me démontrer à moi-même que je n’étais pas poète, ou encore pour tuer en moi le prestige des mots, qui est grand. Déjouer, tromper les mots qui nous séparent de nous-mêmes et de Dieu. Car il est vrai peut-être que les mots nous cachent davantage les choses invisibles qu’ils ne nous révèlent les visibles. J’ai parfois le dégoût de la poésie, ma passion profonde. C’est dans ces moments-là que je me sens le plus près d’autre chose. »
Et Camus de rajouter : « Aujourd’hui, délivré de toute passion, délivré de la poésie, Leynaud n’appartient qu’à cette autre chose. Il savait, en m’en parlant, que cette autre chose n’avait pas de sens pour moi et que le seul endroit où je pouvais le rejoindre était sa certitude. Mais il aimait ma différence comme j’aimais la sienne. Et quelle que soit la vérité de cet appel qu’il ressentait, le déchirement où il était, et qu’il me disait si simplement, suffit à lui donner tort quand il doutait d’être poète ».
21:51 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : rené leynaud, poésie, albert camus, littérature, paul gravillon, lyon | 
mercredi, 05 janvier 2011
Violence ordinaire dans la cité
Récemment, sur le net, a circulé un grand nombre de récits d’agression de personnes, comme on dit : une octogénaire, un disc-jockey, une jeune femme, un journaliste… Pour un collier, pour un sac, pour un refus d’entrer, pour un mégot, pour un regard de travers…. On ne sait trop à qui profite cette profusion de récits délétères qui se répand partout. Forcément, leur nombre agit sur l’esprit de tout un chacun à force d’être ainsi assénés, tant on peut dire toute chose et son contraire au sujet de cette violence débridée devenue l’ordinaire de la cité. L’un d’entre eux m’a arrêté, que je reproduis tel quel :
« Un Lyonnais de 44 ans était en garde à vue dimanche à Lyon après avoir percuté en état d'ivresse une femme en coma éthylique allongée sur un parking, à la sortie d'une boîte de nuit, le matin du jour de l'An, a-t-on appris de source policière.
La victime, une ancienne prostituée de 35 ans connue dans les milieux de la drogue, a succombé à ses blessures une heure après son transfert à l'hôpital.
Interpellé sur place, le conducteur, également sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants et très connu des services de police, a déclaré aux enquêteurs qu'il n'avait pas vu le corps de la femme, gisant dans la pénombre devant sa voiture.
Il a en outre affirmé ne pas la connaître, ce que les enquêteurs tentaient de vérifier dimanche, selon la même source. »
Tous les clichés du genre s’y retrouvent : L’usage du on, pour commencer, pour qualifier la voix qui informe. Entre l’événement et cette voix, par deux fois, le relai indispensable d’une métaphore, aussi musicale qu’éculée, pour égayer le récit : « la source ». A l’endroit où ça se passe, une figure anonyme mais efficace, celle de la police, des enquêteurs, dont le dur et improbable boulot redouble celui du journaliste : « ils tentent de vérifier » On croit entendre la-derrière le bruissement des pas de Maigret sur le gravier, ou ceux de Colombo sur l’asphalte. Alors, on retient son souffle.
Tout le personnel romanesque habituel à ce genre de saga erre en arrière-plan, les milieux de la drogue et ceux de la prostitution sans lesquels, depuis les meilleurs romans-feuilletons de Moïse Millaud, il n’est de presse qui vaille : « une ancienne prostituée », un « conducteur connu des services de police ». Par deux fois se profilent un avant à l’événement tragique, lequel sous-entend que, peut-être, malgré les affirmations du bonhomme, ils se connaissaient : Avec tout ce que cela implique de scenarii possibles en amont, et de mobiles à supposer pour ce qui deviendrait alors un meurtre prémédité. Le cœur se pince.
Car ce qui frappe, dans l’ambiance indispensable du « parking au petit matin » empli de « pénombre » et, on l’imagine, glacial, c’est le caractère parfaitement gratuit et, pour tout dire, déréalisé, dont le fait divers se trouve sans ça enrobé : La prostituée qui succomba aux blessures était déjà dans le coma, raide saoule devant la voiture depuis on ne sait combien de temps garée là : son corps, il ne ne l’avait pas vu, forcément, à cause de la pénombre. Elle, dans le rôle de la victime, lui, dans celui de l’assassin, certes, mais finalement innocemment tous deux, sans le vouloir ni le savoir, et sans même s’en rendre compte, tout comme dans un film, vraiment, ou dans un récit primable au Goncourt de l’an prochain, plongés dans une œuvre qui dirait l’irresponsabilité chronique des silhouettes en société du spectacle, l’inanité des temps postmodernes et de leur violence ordinaire à l’usage de figurants somnambules et même pas héroïques.
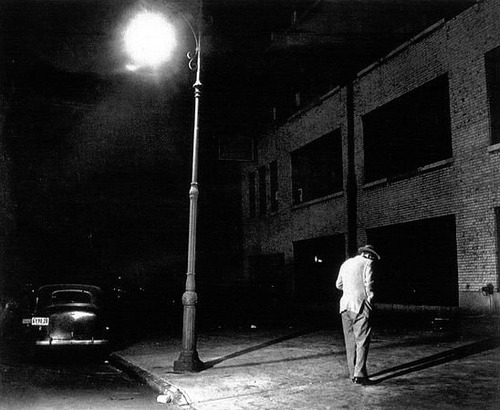
10:19 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : politique, société, lyon, violence, actualité | 
lundi, 03 janvier 2011
Maire de Lyon
Edouard Herriot, lorsque j’étais petit, c’était à la fois quelque chose et puis rien. Quelque chose : maire de Lyon durant cinquante deux ans ! Monolithique, dans sa génération, le bonhomme ! Rien : un homme du passé immédiat, mort alors que je n’avais que deux ans, et remplacé par un homme plus que médiocre qui abîma à jamais Lyon avec son bétonnisme aigu, le dénommé Pradel. Herriot déjà, ça n’était plus qu’une rue, la rue de l’Hôtel de Ville, débaptisée en rue Edouard Herriot. A present, lorsque je demande à des élèves s’ils savent qelque chose de ce type, ils me disent tous : rien. Rien... Le leçon de Sénèque : Comme les gloires passent, n'est-ce pas ? Pauvre Edouard...
Et puis une tombe grotesquement stalinienne, à l’entrée du cimetière de Loyasse. Grotesque, c'est même peu dire. C'est par là qu'à dix-sept ans, lorsque j'allais me saouler avec des potes en un lieu éloigné des familles, nous faisions le mur ... Il faut, se dit-on en voyant son gigantisme peu chrétien, savoir choisir son camp. Amusante, la gerbe de l'actuel maire de Lyon, à chaque Toussaint. Glissons.
Devant la nullité de son successeur, évidemment, cet Edouard ressemblait encore à quelque chose dans les années 60 : comment oublier pourtant qu’il avait signé l’arrêt de mort du dernier pont de pierre de la ville, un ouvrage de treize arches séculaire, le pont de la Guillotière, ainsi que celui de l’hôpital de la Charité et toutes ses cours intérieures, pour les remplacer par un hôtel des Postes, et un autre des Impots, comme pour rivaliser de laideur : Quelle ineptie ! Herriot malgré sa gloriole politique ne fut-il pas à ce titre guère plus qu’un moderniste opportuniste, sans grande vue ni grande culture, encensée par une bourgeoisie locale en mal de baron du cru ?
Albert Thibaudet, lorsqu’il évoque d’Herriot, en parle comme d’un girondin, mais c’est parce qu’il confond girondin et provincial. En réalité, nul ne fut plus centralisateur et jacobin que cet Herriot, dans sa manière autocratique de gérer sa capitale des Gaules comme si elle devait sans cesse rivaliser avec Paris. Il ne s’y trompe d’ailleurs pas, Thibaudet, qui écrit, dans la République de professeurs :
« Le maire de Lyon est le premier de Lyon – mais après le préfet, et son gouvernement facile, ressemble plus à celui d’un président de la République qu’à celui d’un chef de gouvernement. »
Ou encore :
« Paris est la capitale de la France, mais Lyon est la capitale de la province. Les politiques savent à quel point le Cartel des gauches de 1924 était une formation lyonnaise »
Herriot eut pour successeur un imbécile. Personne ne parla mieux de Louis Pradel que Pierre Mérindol. Je cite : « C’est un modeste expert en assurance automobile qui n’a jamais connu d’autres lauriers que ceux des concours de circonstances » Ou encore : « Le drame de Lyon – car il est bien vrai que la ville est défiguré – c’est que le maire ait été aussi mal entouré » (1)
L’inconsistance du successeur de Pradel, un Collomb, déjà (mais Francisque) n’est plus à souligner. Avec lui, le Grand Orient assoit un peu plus son autorité sur l’Hôtel de Ville, représenté par des guignols du nom de Soustelle, Ambre, Bullukian, Combes, Béraudier. Je cite toujours Mérindol, un homme fin et intelligent à la plume lucide : « La pauvreté de la solution Collomb – même si elle est une construction d’origine maçonnique –est le reflet de la pauvreté du personnel politique à Lyon. »
Sans doute est-ce à partir de Michel Noir et des années quatre-vingts qu’on commença a oublier Herriot et son autre temps. Le portrait qu’en dresse Pétrus Sambardier le rendrait presque sympathique :
« Généralement, le président, vers midi et demie, se rend à pied de l’Hôtel de Ville au cours d’Herbouville. Il remonte, pensif, à petits pas, l’allée de platanes du quai Saint-Clair. Les solliciteurs malins connaissent cette promenade et retardent souvent l’heure de déjeuner du président. M. Herriot est accueillant. Il s’assied volontiers sur un banc du quai pour écouter, sans impatience, le garçon « de platte » (2) racontant son dernier exploit de sauveteur ou la vieille femme exposant ses misères » (3)
Il y quand même, dans le ton du journaliste, un air d’hagiographie et l’on n’est pas loin du Joinville exaltant son saint Louis. En contrepoint, voici un portrait d’Henri Béraud, réalisé en novembre 1913, et publié dans le numéro 2 de la revue l’Ours :
« C’est en matière administrative surtout que le bon garçonnisme de M.Herriot lui crée des difficultés. On ne fait pas avec des sourires la besogne d’un comptable. Les poignées de mains et les gros compliments dont les plus acerbes prolos s’accommodent, font quelquefois la fortune politique d’un habile homme. Mais quand, par ces moyens, on est parvenu à ses fins, quand on a pris place au centre des affaires, il faut abandonner ces accessoires de parlottes électorales, comme les avocats laissent robes et toques au vestiaire du Palais. En affaires, il faut se montrer homme d’affaires. M. Herriot y parvient-il ? Non. (…) Les rapides succès de M. Herriot ont fait de lui un séducteur des foules… »

16:24 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : politique, lyon, littérature, edouard herriot, thibaudet, collomb, pétrus sambardier | 
vendredi, 24 décembre 2010
Le Noël du Satinaire
Je pinsavo mo cotaire
Quand la minay a souna
Com’in bravo satinaire
J’ayen fini ma jorna
Quand Michi, notron aprinti
Sauti n a bas de son meti,
Coran come un ecervela
Laissi son corse a marqua
La première strophe place le contexte chez les satinaires (fabricants de satin) entre un maître (Dufour) et son apprenti Michel : « Je pansais mes cautères quand minuit a sonné. Comme un honnête satinaire j’avais fini ma journée, quand Michel, notre apprenti sauta en-bas de son métier, courant comme un écervelé, laissa sa pièce en cours non marquée. »
Je li disi : « Nigodaimo
On et-ai don que te va ?
-Je vouai uvri la liquairna
Per vair ce qu’i dion là-bas.
Accotà si vo n’aite sor :
I dion que var lo Jagobin
Y’a un infan tot divin
A partir de la deuxième débute un dialogue oral par lequel le conteur réactualise l’Evangile. Nigodème (nigaud que j’aime) est une interpellation courante qu’on retrouve dans beaucoup de Noël. Le Noël fait naître l’enfant aux Jacobins qui est alors le plus important couvent de la ville et qui fut vendu comme bien national pendant la Révolution et démoli vers la fin de l’Empire (ce qui permet de dater le texte vers le milieu du XVIIIème) : « Je lui dis : « Nigodème, où est-ce donc que tu vas ? -Je vais ouvrir la lucarne pour voir ce qu’on dit là-bas. Ecoutez donc, maître Dufour, écoutez si vous n’êtes pas sourd ; on dirait que vers les Jacobins, il y a un enfant tout divin. »
Y dion que c’est lo Messie
Qu’est venu pair nos sauva,
Et que la Viarge Marie
Cette nuit l’a infanta ».
J’u craie prou, Dufor u dit,
Car i ne vodrai pa manti ;
Dufor est un home de bien
Ce qu’i dit, il u sa bien.
Pas de difficultés de compréhension dans cette strophe, sinon le cinquième vers, dans lequel le narrateur reprend la parole : « Je le crois bien, lui dit Dufour ». La strophe suivante donne la parole à ce dernier : « femme n’es-tu pas prête, le dernier coup va sonner. Mets par-dessus ta cornette ta coiffe de taffetas. Demande donc à la Fanchon où elle a mis mon manchon. Bernadine, qu’as-tu fait de la clé de mon buffet » :
Fuma, n’ai-ce tu pas preta,
Le dari co va souna
Betta dessu ta cornetta
Ta coiffi de taffeta ;
Demina vaire à la Finchon
Ont elle a beta mon minchon.
Bernadina, qu’a-tu fait
De la clia de mon bufait ?
Les termes techniques se multiplient dans la strophe suivante, alors que le canut s’endimanche à la mode du petit bourgeois de son temps : habit canelle, cravate de cambrésine, chemise à dentelle, souliers de maroquin, perruque à trois talons, joli chapeau brodé. Un pain blanc à l’anis, une queue de mouton et un morceau d’échine ( « o du china ») en guise de réveillon ( « noutron dina ») que la servante doit faire cuire à l’étouffée (« bete in etuffaie »)
Bailla mon habit canella
Ma cravata de cambrin
Et ma chemis’a dintella
Mo solas de maroquin.
Te prendra din celi carton
Ma perruqua a très talon ;
Et pui te me vargetera
Mon joli chapiau broda
Lioda, bete in etuffaie
Cela cova de muton ;
Faie in sorte qu’ale saie
Couita quand je revindron ;
Puis te betra l’o du china
Qui sera pair noutron dina
Te prendra cheu lo bolangi
Ain grou pin blan à l’ani.
Nous voici « sans transition » dans la strophe suivante à l'intérieur de l'église durant la messe : les antagonismes de classe resurgissent lorsque le satinaire désigne à sa femme (« vait-u din cela chapella ») leur crevé de marchand accompagné de son épouse qui fait la belle au milieu du banc . « Ne disons pas de mal du prochain, notre marchand est assez bon chien : du moins s’il nous paye mal, il ne nous laisse pas chômer » conclut le canut ironiquement.
Vai-tu din cela chapella
Noutron creva de marchan ?
Sa fuma fai bian la bella
U milieu de celi ban !
Ne dion gin de ma du proochin !
Noutron marchan est prou bon chn :
Du moin s’y nous paye ma
Y nos laisse pas choma.
Le Noël s’achève par une strophe où il est fait allusion à un empereur, ce qui laisse à penser qu’elle fut rajoutée durant le Consulat, supposition renforcée par les mentions aux guerres avec l’Espagne et l’Angleterre : La prière traditionnelle à Saint-Joseph, patron de la bonne mort, clôt le texte.
Sainte Maria, de grâce
Pri par nos le Saigneur
Qu’avan que ceti an passe
No ayon un bon Amperor.
Que los Espagnos, los Anglais,
Fassaissiont vitemin la paix.
Que Saint-Joseph, votre mari,
Nos aidasse a bien muri.
11:35 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : noël, lyon, patois, llittérature, canut | 
lundi, 13 décembre 2010
Qu'as-tu fait de ta jeunesse ?
« Un jour nous vîmes s’asseoir à notre table un garçon fin et maladif, d’une pâleur nacrée. Une barbe légère encadrait son visage, où l’on ne voyait que deux grands yeux, d’une tendresse féminine et d’une rare beauté. Pouvions-nous penser que ces yeux deviendraient ceux d’un coureur de routes et qu’ils se fermeraient aux lueurs d’un drame terrible ? Il nous monte des larmes en pensant au destin de celui qui, vers Pâques, en 1903, vint à nous, le rire aux lèvres et les mains tendues. C’était le plus pur d’entre nous. Sa vie nous fut un charme et sa mort un exemple. Il avait dix-huit ans et s’appelait Albert Londres.
Albert incarnait alors avec une miraculeuse exactitude l’idéal des dernières grisettes. Il eut ce privilège entre tous envié d’être à chaque pas de sa route exactement l’homme attendu. A l’âge des premières amours, comme à tous les âges de sa brève existence, il n’eut qu’à se laisser vivre pour triompher.
Je voudrais le peindre tel qu’il fût. Mais que puis-je ? Ombre chère, comment te retrouver ? Quarante ans ont fui depuis ce matin rêveur où tu nous offris tes premiers vers, une mince brochure au titre anxieux et tendre. Un soleil jaune dorait les toits sous un ciel de coton mouillé. La rumeur étouffée de la ville accompagnait ta voix claire, et ta grâce animait le fier délabrement de notre mansarde.
Dès cette époque, il savait se passer de tout, et, pour commencer, du nécessaire. Jamais, à aucun moment, il n’eut rien d’un bourgeois. De toutes les faiblesses humaines, celles qui lui furent toujours étrangères, c’étaient assurément le goût des aises et la vanité. Plus tar, au temps même où, par état, il dut fréquenter les milliardaires et hanter les palaces, un meublé de troisième ordre suffisait à son confort. Il se passait des petites commodités comme il se moquait des honneurs. Son mépris du décorum s’étendait aux décorations. Jamais, de personne, il n’accepta aucun ruban. Il avait des politiciens de toute nuance le mépris le plus complet. Les gens en place lui faisaient l’effet de chevaux de fiacre. Mors d’ordre et mots creux le dégoutaient également. Patriote à l’extrême, il n’était nullement cocardier. Il ne suivait en aucune façon les musiques militaires. Il ne croyait à aucune louange, à aucune consécration. Lui, si courtois, si curieux, se gardait de lire ce qu’on écrivait sur ses œuvres. Les querelles d’écrivains lui faisaient hausser les épaules. Il ignorait jusqu’à l’existence des snobs. Quant à l’argent, lorsqu’il en eut, ce fut pour le laisser couler entre ses doigts, comme de l’eau. »

Ce portrait d’Albert Londres se trouve au cœur du dispositif de Qu’as-tu fait de ta jeunesse ?, deuxième tome des souvenirs de Henri Béraud.
05:40 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : albert londres, henri béraud, littérature, qu'ast-u fait de ta jeunesse, lyon | 
jeudi, 02 décembre 2010
Collomb aux deux ânes

Gérard Collomb était vendredi 26 novembre l’invité des chansonniers des deux ânes ; ou les chansonniers des deux ânes étaient les invités du maire de Lyon, on ne sait, puisque Jérôme de Verdière le remerciait de son accueil à la fin de l’émission. L’émission a été rediffusée hier soir sur Paris Première. Sous prétexte de se « prêter au jeu » des chansonniers, jusqu’à quel point un homme politique peut-il se prêter à la démagogie graveleuse, au degré zéro de la communication ? Quelques moments de ce spectacle affligeant :
16:04 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : politique, gérard collomb, socialisme, ps, lyon, paris première, théâtre des deux ânes | 
mardi, 23 novembre 2010
Louis Carrand

Louis Carrand, Chemin du vieux Collonges

Louis Carrand, Travaux des champs

Louis Carrand, Bordure d'étang
18:43 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : lyon, peinture, louis carrand, collonges, école lyonnaise, béraud | 









