mercredi, 18 mai 2011
Lyon, la rose, la soie,
Ce soir, Pierrick Eberhard (journaliste, historien), Christophe Ferry (du jardin botanique de Lyon) et Pierre Bonetto (designer textile) donnent une conférence, Lyon, la rose, la soie, au cinéma Saint-Denis, 77 grande rue de la Croix-Rousse à Lyon. Cette conférence est présentée par l’Esprit Canut. Prix d’entrée 5 euros.

16:49 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lyon, esprit canut, cinéma saint-denis | 
mercredi, 04 mai 2011
Disait-elle
Ma vieille prof de théâtre était toujours vêtue d’un pantalon fuseau et d’un pull over à col roulé. « On peut, disait-elle, réduire le jeu d’un comédien comme tout ce que raconte la totalité du Répertoire à deux mouvements fondamentaux : dire oui, dire non. Pour cela, vous disposez du regard, du geste, de la parole. Et c'est tout. »
Sur ces deux grandes tendances – le refus ou l’acquiescement-, elle nous expliquait que se greffait la gamme entière des nuances et des émotions qu’il nous faudrait jouer sur scène, et l’existence de milliers de personnages : honte, pitié, colère, désir, raisonnement… Tout cela ne revenant in fine qu’à approuver ou réfuter ostensiblement quelque chose, du regard, du geste ou de la parole, avec une intensité plus ou moins affirmée.
Pour le reste, nous disait-elle, il n’est de secret que l’articulation. Avant de monter sur scène, elle nous faisait répéter : Gros grand grain gris creux d’orge, quand te dégros grand grain gris creux d’orgeriseras-tu ? Je me dégros grand grain gris creux d’orgeriserai quand tous les gros grand grain gris creux d’orge se dégros grand grain gris creux d’orgeriseront. Idem avec le petit pot de beurre et d’autres pis-aller.
Après ça, elle nous fichait un texte entre les mains, un monologue d’Othello, un sermon de Bossuet, une chanson de Gaston Couté, ou tout autant une liste de commissions, et il fallait se débrouiller pour lui dire oui ou non avec ce texte-là, du regard, du geste, de la parole. Sans s’occuper du reste.
Elle se tenait en fond de salle, cigarette au bec. Elle ne fumait que des Gitanes. Dans la pénombre, cela formait une lueur, un grésillement, une écoute, un peu de fumée bleue. Quelques recommandations. De compliments, jamais.
Quand elle était contente de quelqu’un, elle le lui faisait savoir en lui proposant un petit rôle. On venait en car de toute la région pour voir les spectacles qu’elle montait dans son théâtre non subventionné. Des pièces de boulevard, écrites par elle ou par son mari. Un canevas bien rôdé, des répliques à l’efficacité éprouvées durant ses cours. Du 100% maison, disait-elle.
09:17 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : théâtre, littérature, lyon | 
vendredi, 04 mars 2011
Pont Lafayette
Tu coupes le Rhône par un pont assez veuf
Aux parapets verts et bas et neufs :
N’est-ce point là qu’il y a de nombreuses années
Tu as voulu sauter ?
Le site est aussi large qu’en ce temps-là ;
Le fleuve un peu plus sale,
Le ciel tout juste plus pollué,
Qu’importe que beaucoup de passants aient changé de têtes et de tenues :
Ceux-ci passeront à leur tour.
Te dis-tu : tout passe, c’est leur cortège.
Quel privilège, encore, devant toi,
Que cette façade et ces trois dômes,
Et la colère que tu ressens,
Plus mûre, plus saine qu’à l’époque,
Est plus construite mais plus vaine,
C’est le mot qui te vient, ainsi qu’insupportable :
Pourquoi te demeure aussi insupportable
Cette idée qu’en hôtel cinq étoiles
On vienne à changer ce vieil hôpital ?
A l’ombre de quelle croix aller mourir désormais ?
On n’arpente cette presqu'île que pour acheter,
Traîner en bandes, zoner,
Quand la banlieue ne vient pas y casser des vitrines,
Elle les lèche, et puis rien d’autre.
Le luxe t’est une offense et tu voudrais d’un coup de tête
Comme celle de Zidane sur Materazzi
Défoncer les vitrines du magasin Z… ,
Te voilà non loin des chapelles aux saints bas, assoupis.
Le quai se disait Bon Rencontre
On dit l’église encore Bonaventure
A quelle bonté rêves-tu donc, tu as tant rêvé là,
Tant sont morts, et quid de meilleur ?
Tu prends l’entrée d’un autre pont
Où piaille contre toi le vent des mouettes.
Sur une carte postale de la Belle Epoque, tu te souviens
Qu’une marchande de journaux se tenait là
Son tablier est bordé de dentelle piquée de cabochons
C’est sur ce pont qu’en 68
Un camion écrasa un commissaire.
Toute la presse de mai en parla.
Par là le Rhône est moins large que là-bas.
00:39 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : pont lafayette, lyon, littérature, poésie | 
samedi, 26 février 2011
Eugène Brouillard, croix-roussien
C’est un beau nom que Brouillard pour un lyonnais. Je veux dire pour un lyonnais né en 1870, un de ceux qui connurent les heures tout emplies de légendes des lancinants jours de brouillard. Une plaque déjà ancienne célèbre la mémoire d’Eugène Brouillard, au 21/23 rue d’Austerlitz, non loin du Gros Caillou à Lyon, où s'écoula la plus grande partie de son temps, tandis qu'il peignit quelque deux milles tableaux. Non loin de là, dans les années 80, quelque fou a volé le buste de pierre qui le représentait.
Eugène Brouillard (1870-1950), tulliste de son état, demeura longtemps un autodidacte dans cette capitale de province qui n’aimait pas les peintres ; il effectua cependant sa première exposition à 19 ans, et fut l’un des fondateurs du salon d’automne au début du XXème siècle.
Brouillard reprit souvent l’un de ses paysages préférés : les feux du couchant saisis dans les arbres en bordure des étangs de la Dombes. Paysages, maisons isolés, ruines : on le sent pénétré de l’influence de Vernay, de Carrand, de Ravier. « Amant passionné des Dombes, Brouillard est le chantre ému des peupliers tremblants, des vernes et des bouleaux au bord des lones. De grands arbres décoratifs se mirant dans le Rhône, des troncs vieillis de mille colorations près des étangs solitaires, des touffes de verdure humides longeant des routes aux grasses ornières parmi un automne ardent et roux. Voilà les fidèles confidents des nappes mortes où survit peut-être la vision antérieure des canaux du Nord », écrivit Tancrède de Visan à son sujet, rappelant au passage que sa famille paternelle venait du Nord. A partir de 1920, Eugène Brouillard devint une sorte de peintre officiel avec notamment la commande de 18 panneaux que lui passa la mairie du IIIème arrondissement pour sa salle des mariages, le Poème des saisons, des arbres et des eaux dont on voit un motif ci-dessous.
Ci-dessous, Après la pluie
22:01 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : eugène brouillard, peinture, lyon, peintre lyonnais | 
vendredi, 25 février 2011
Les rues trépassantes
Dans toutes les villes d’Europe, il y a des rues trépassantes
Dont les façades pleurent tous ceux qu’elles ont vécus :
Vieux moines emplis de componction, aux mains jointes sur l’estomac,
Marchandes de légumes, aux fesses rondes sous des jupes longues,
Vieux célibataires secs à l’épaule qui tombe, sous le frac sombre,
Ecoliers vifs, maîtres sévères,
Et mendiants quémandant, disant à chaque pièce qui tombe : « joie et bonheur sur votre famille »
Et polissons, polissonnes, gueux, gueuses, vaillants, vaillantes,
Tels,
Sur les vitraux emplis de suie des chapelles pleines de suif de l’église du quartier
Les sujets chrétiens, presque effacés par la pénombre ou le vacarme.
C’est triste et fade,

Un bâtiment replâtré, une rue restaurée, ravalée
Et ces arêtes désolées, aux angles des murs qui demeurent,
D’avoir été séparées d’autres, abattues,
Je salue, de ces rues très passantes
Les fantômes épiphaniques,
L’immense foule de ceux qui ont vécu.
Gravure : Le tournant Saint-Côme à Lyon, Drevet.
19:43 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, poésie, lyon, quartier grolée | 
mercredi, 16 février 2011
Eiffage ne convainc pas
Hier, mardi 15 février, le maire de Lyon présentait à nouveau aux Lyonnais le projet retenu pour le réaménagement de l’Hôtel-Dieu, en présence de Michel Chenevat le directeur régional pour la région Centre Est du « secteur Bâtiment et immobilier » du groupe Eiffage, de Didier Repellin, architecte en chef des monuments historiques, de Daniel Moinard, directeur général des Hospices civils de Lyon, de Nadine Gelas, vice-présidente du Grand-Lyon. La salle Justin Godart était à nouveau pleine, témoignage de l’intérêt que ce dossier exceptionnel a auprès le public. Une belle opération de communication, qui pourtant ne convainc pas. Le maire a commencé par exposer ses arguments politiques. Puis Michel Chenevat a brièvement détaillé à grands traits le projet de son groupe. Enfin Didier Repellin et Albert Constantin ont évoqué la nature de la restauration envisagée.
Intérieur du grand dôme -Photo : Cheumou Phildroso
Pour résumer la situation, le chantier serait à resituer dans la gestion globale des HCL, lesquels « ont beaucoup investi pour le développement d’hôpitaux modernes en périphérie de Lyon : un milliard d’euros d’investissement, vers le meilleur de la médecine » Le maire fait de la rénovation de l’hôpital Edouard Herriot une « vraie priorité ». Le financement de ces opérations passe nécessairement, explique-t-il, par des désaffectations : avant-hier l’Antiquaille, hier Debrousse, aujourd’hui l’Hôtel-Dieu. On comprend que pour la direction des HCL, ce qui compte est l’exploitation globale du parc hospitalier au sein duquel l’Hôtel-Dieu est un vieillard certes prestigieux, mais désormais inutile et couteux (sa rénovation est estimée à 150 millions d’euros), dont il faut autrement dit se débarrasser.
La ville de Lyon seule pourrait-elle reprendre à son compte un tel projet avec un plan de mandat budgétisé à 600 millions d’euros ? Le maire écarte d’un revers de manche une telle idée : « J’aime mieux réhabiliter La Duchère et Mermoz, et laisser Eiffage faire l’Hôtel-Dieu », dira-t-il. Derrière cet apparent intérêt pour le social se cache une étrange conception de la répartition territoriale de la ville. Le centre pour les riches, les ultra-riches, et les périphéries pour les modestes et les sans-le-sou. Est-ce le prix à payer pour devenir une « ville internationale » ? Pour Collomb, ça ne se discute même pas. Et plutôt que de prendre le temps d’établir un dossier à multiples partenaires, joignant musées, bibliothèques, théâtres, cinémas, commerces, restaurants, universités…, il préfère solliciter un groupe unique qui accorde sa priorité à l’industrie de l’hôtellerie de luxe.
C’est alors qu’intervient le groupe Intercontinental, partenaire d’Eiffage (qui s’installera aussi à Marseille grâce à la complicité de Jean Claude Gaudin). On prend grand soin alors de nous dire que cette industrie n’occupera que 30 % des lieux : le hall de l’hôtel sous le grand dôme qui demeurera ouvert au public, et la façade de Soufflot sur le bord du Rhône, qui abritera les duplex et les deux grandes suites : « Ce site dont on rêve tous », déclare ingénument Michel Chenevat, pour évoquer l’ensemble « dôme façade » ces fameux 30% qui seront dédiés à l’hôtellerie de luxe. En contrepartie, le groupe affirme rendre l’hôtel Dieu (le reste des bâtiments) aux Lyonnais, avec la réouverture de galeries, l’aménagement de cours intérieures, l’établissement d’un musée de la santé. Mais comment ne pas voir que ce qui est présenté comme « un parti-pris » n’est qu’un prétexte ? Dès 2014 certains commerces s’ouvriront et le tout devrait être livré en 2016.
C’est enfin au tour des architectes de prouver que la rénovation sera de qualité, et respectueuse du caractère historique du bâtiment. Didier Repellin et son adjoint expliquent que l’originalité du classement UNESCO de la ville au patrimoine de l’humanité s’est déroulée au motif non pas d’un patrimoine statique, mais dynamique… Dont acte ! Avec verve et lyrisme, ils nous font un cours sur l'histoire de l'Hôtel-Dieu. Pour finir, un bref film d’animation nous promène à travers la future rénovation et se clôt par ce slogan : « Lorsque l’Hôtel-Dieu s’anime, c’est tout Lyon qui rayonne »
Débute alors un débat avec la salle; un dialogue – évidemment de sourds, puisque toutes les décisions sont déjà prises.
Un étudiant fait remarquer que les figurants placés dans le film qu’on vient de voir, déambulant tous cravatés dans les cours intérieures ou sous le dôme de Soufflot, ne sont, à son sens, guère représentatifs du « peuple lyonnais », et qu’il craint somme toute une forme de « captation » des lieux au profit des plus riches. Gérard Collomb lui répond que s’il possède juste de quoi boire un café, il lui sera toujours plus agréable de boire son café dans un lieu joliment restauré, et parmi des gens cravatés, plutôt que dans les cafés de l’actuelle rue Bellecordière !
Cette question de « la captation des lieux » par les plus riches est bien au centre du débat qui se prolonge avec l’intervention de plusieurs représentants d’associations. L’Esprit Canut rappelle que si cette rénovation du bâtiment sert de prétexte au détournement du monument (car il s'agit de la mémoire des lieux), elle n’est tout simplement pas concevable. A quoi bon rénover un bâtiment si c’est pour tuer le monument ? La Renaissance du Vieux-Lyon s’inquiète des garanties qu’auront les associations de pouvoir être accueillies au PRES (pôle de recherche de l’enseignement supérieur) lorsque les signatures seront faites. Comment le maire garderait-il la main pour que le projet demeure lyonnais ? Un vieux monsieur accuse : « Il faudrait faire un geste pour ceux qui ne comprennent pas votre projet. Réserver une place pour une crèche et un établissement pour personnes âgées, c’est-à-dire pour les plus fragiles. Autrefois, les édiles lyonnais s’intéressaient à ce type de population ».
Collomb répond toujours de façon biaisée, en évoquant ce qu’il fait ailleurs, des logements sociaux, des rénovations de quartiers : comme si l’un devait forcément exclure l’autre. Comme s'il n'avait pas été possible, en prenant son temps, de ficeler un projet vraiment culturel dans ce site d'exception, au lieu de ce projet bling-bling, tape-à-l'oeil et clinquant.
Et l’on finit par penser qu’on est là au cœur de sa politique : la sectorisation du territoire au prétexte du social et le mépris de la culture patrimoniale au nom de l’affairisme contemporain ...
![]()
11:37 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : hôtel-dieu, lyon, eiffage, gérard collomb, didier repellin, michel chenevat | 
mercredi, 09 février 2011
TDM3 aux Ateliers
Après la nouvelle, le cinéma, le théâtre : TDM 3, théâtre du Mépris 3, comme une formule d’ouverture. Il faut d’emblée rappeler tout ce que le développement de cette problématique du mépris contient de générationnel.
En 1963, lorsque Godard propose la sienne, Gabily n’a que huit ans. Du désenchantement jusqu’au mépris devant l’amour, devant la femme, devant le cinéma, devant l’argent, devant la mer, lorsqu’à la toute fin du film, elle n’est plus qu’un horizon vide de dieux, une image veule qui se laisse aussi happer par la caméra, tandis qu’Ulysse, lui, s’est métamorphosé en un ridicule personnage de péplum, le film de Godard n’était qu’un long travelling, fait de couleurs, de lumière, de silence et de musique, qui conduisait à cela : cette séparation du héros et de l’écrivain, lequel tournant le dos à la mer et à Fritz Lang, retournait au théâtre.
« Notre histoire s’est écoulée », dira plus tard l’écrivain de Gabily devant le corps puant et couvert de pisse d’Ulysse. « Je me suis laissé manger moi-même », avouera plus tard l’Ulysse de Gabily.
©D.Anémian.
L’idée (la commande) date de 1992. Huit ans nous séparait alors de l’an 2000, de l’arrivée, du « nouveau millénaire », souvenez-vous, d’un nouveau brave new world lequel, faute de révolutions politiques, spirituelles, nous promettait une « révolution technologique », la seule, nous disait la publicité, qui serait à la hauteur des pauvres infirmes que la société du spectacle avait déjà fait de nous. L’humanité vivait ses dernières années sans portables, sans Internet, sans téléréalité, sans Zidane, sans le fameux tittytainment (1) conceptualisé par Zbigniew Brzezinski et ses sbires, partisans de la nouvelle économie.
Gabily, avec son groupe T’chan’g, incarnait alors un carré de résistance : « S'il n’est pas trop tard -ce dont on aimerait ne pas douter- on voudrait que ce qui fait de nous des acteurs-citoyens (y compris de nos propres aveuglements), des encore vivants-citoyens serve à la résistance, même partielle, même infime, à la domination du prêt à délasser pour tous ». (2)
Le théâtre pouvait-il s’organiser en lieu de résistance contre cette « déferlante » de l’image (3) ? En avait-il le temps, l’art, les moyens ?
Toutes ces questions sont au cœur de la confrontation entre quelques personnages incarnant l’Occident et réduits à quelques initiales, E (l’écrivain dépassé par les événements), R (le réalisateur cynique), P (le producteur libidineux), H (l’héroïne accroc à l’héroïne), C (le chœur de starlettes prêtes à se vendre) et U (Ulysse devenu clodo après Diên Biên Phû.).
Toutes ces questions sont aussi au centre du dispositif textuel de Gabily, qui mêle scènes de comédie caustiques entre ces personnages pour le coup à bout de souffle, et les soliloques beckettiens d’Ulysse, enfin douché et retrouvant le fil ressassant de son esprit. Mais déjà s’ouvre un autre monde avec les premiers attentats contre le World Trade Center de février 1993. Ce monde, « cette belle catastrophe » avec quoi « se faire des couilles en or », dont Gabily n’aura eu le temps de n’entrevoir que les prémisses, le producteur le préférera aux divagations d’un pauvre fou.
Au centre de la scène des Ateliers, Chavassieux a placé un exemplaire d’Ulysse, celui dans lequel le siècle fou qui allait faire de l’individu une quantité négligeable s’incarna, celui du grand Joyce. Ce bouquin jeté au sol négligemment par l’écrivain désabusé, tous les personnages l’enjambent par petits bonds, faisant mine de ne pas remarquer sa présence, au fur et à mesure qu’ils s’enfoncent dans le mépris. Autour du livre abandonné s’organise l’espace, le canapé-lit, la télévision, l’ordinateur, la caméra, les bobines, elles aussi abandonnées.
De Joyce à Godard, les signes du vingtième siècle subissent ainsi le mépris jusqu’à l’entrée du chœur hystérique de candidates venues pour un casting, ivres du narcissisme et avides de notoriété. Comme le vieux vétéran de Diên Biên Phû est délaissé par tous, l’œuvre littéraire, l’œuvre cinématographique, l’œuvre théâtrale le sont aussi, dans une sorte de mise en abyme à l’image d’un huis-clos, dans lequel ce curieux homme aux mains interprété par Chavassieux lui-même fait figure de clown en quête d’emploi.
La résistance à la société du spectacle demeure-t-elle au cœur de nos préoccupations, ou bien la société du spectacle, prompte à faire de tout un ingrédient de sa cause, a-t-elle déjà fait de ce motif un lieu commun ? L’art a-t-il encore les moyens de résister au mépris, désormais fait monde ?
La reprise de Gilles Chavassieux affronte avec une sorte de malice militante ces graves questions. Le spectacle a besoin de trouver son rythme car les comédiens, encore très isolés dans ce que leur rôle a d’allégorique, ont parfois du mal à déplier toute la densité du texte pour accorder leur énergie dans un jeu qui leur soit commun. Mais chacun assure avec force et conviction sa partie. Cette adaptation mérite donc d’être vue, saluée et défendue, et Chavassieux, porteur de Gabily comme il le fut de tant d’autres, remercié de ses choix et de ses exigences.
(1) Cocktail de divertissement abrutissant et d’alimentation suffisante permettant de maintenir de bonne humeur la population frustrée de la planète »
(2) Cadavres si on veut, Libération, juin 1994
(3) 1993 : l’année où mourait Fellini, l’annonciateur de Ginger et Fred
____________________________________________________
TDM3 – de Didier-Georges Gabily, mise en scène de Gilles Chavassieux
Avec Jean-Marc Avocat, Gilles Chabrier, Valérie Marinese, Alain-Serge Porta, Christian Taponard, Gilles Chavassieux, Lucie Donet et Claire-Marie Daveau, Emma Pluyaut-Biwer, Caroline Roussel et Louise Saillard-Treppoz
Du 7 au 19 février, Théâtre des Ateliers, Lyon.
10:04 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : tdm3, gabily, théâtre, ateliers, chavassieux, lyon, littérature, le mépris | 
mardi, 08 février 2011
Jean-Jacques Lerrant
 Jean-Jacques Lerrant, critique d’art et critique de théâtre, vient de mourir. Il fut à Lyon une figure si intimement mêlée à la vie culturelle de la seconde moitié du vingtième siècle que sa disparition ne peut laisser personne indifférent.
Jean-Jacques Lerrant, critique d’art et critique de théâtre, vient de mourir. Il fut à Lyon une figure si intimement mêlée à la vie culturelle de la seconde moitié du vingtième siècle que sa disparition ne peut laisser personne indifférent.
Il fut durant plusieurs décennies le promoteur d’une critique en partie disparue, qui ne se bornait pas simplement à résumer l’histoire et à placer une ou cinq étoiles à côté d’un titre. Une critique à la recherche de l’équilibre sain, entre ce qu’on doit au spectateur de vérité et ce qu'on doit d'empathie aux artistes; entre la représentation particulière et l'histoire plus large, l'esthétique dans laquelle elle s'inscrit. Ainsi y avait-il toujours quelque chose à apprendre dans un papier de Lerrant, un sillon à suivre, une perpective à adopter.
C’est drôle. Pas plus tard que l’autre jour, on me parlait de lui, de sa réaction à un spectacle de Planchon qu’il n’avait pas aimé : plutôt que de faire sur l’heure le papier qu’attendaient les rotatives, il avait pris son téléphone afin de demander à revoir le spectacle, et d’être sûr d’avoir compris d’où venait le problème…
La silhouette de Jean-Jacques Lerrant, vêtu de sa cape noire, demeure pour moi attachée aux longs couloirs de la rédaction du Progrès, aux fenêtres hautes donnant sur le petit dôme de l’Hôtel-Dieu, à la fébrilité qui s’emparait de tous dès la fin d’après-midi et jusqu’à une heure du matin. J'avais dix-sept ans, c'était mon premier boulot : écouter la cocotte de la rédaction (une radio) branchée sur les talkies walkies de police secours en constante liaison avec la préfecture (le nom de code à l'époque était Nestor, clin d'oeil à Hergé ? ). Dès qu'il se passait quelque chose il fallait prévenir un journaliste.
Un continent véritablement englouti à présent, ce Progrès, ses gardes, ses journalistes, ses garçons de bureau, ses rédacteurs, ses pigistes, passé évaporé dont n’émergeront que quelques paroles dites, quelques mots lus, vertu de l’écriture, se dit-on, devant la fin trop limpide des chairs.
Dans ce court texte Jean-Jacques Lerrant l'évoque, cette rue Bellecordière dont toute vie non marchande a été brin par brin déménagée, alors que les pouls du Progrès, des messageries lyonnaises, du café chez Vico, de l’Hôtel-Dieu, y battaient encore de toute leur puissance…
00:22 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : jean-jacques lerrant, théâtre, littérature, lyon, critique d'art | 
dimanche, 06 février 2011
Le dico de de nos pères
Essentiellement lié à une profession (les tisseurs) et à un lieu (Lyon, la Croix-Rousse), Le Littré de la Grand’Côte (de Clair Tisseur, alias Nizier du Puitspelu), se trouve encore chez les bons bouquinistes. Composé en 1894, il se présente comme un dictionnaire de termes ou d’expressions jugés par son auteur en voie de disparition, et qu’il recueille au gré de ses souvenirs, de ses promenades, de ses rencontres. Au fil des définitions, un véritable roman autobiographique,  celui de Puitspelu -alias Clair Tisseur (1827-1895)- se découvre, dont le lecteur peut, fragment par fragment, reconstituer la mosaïque. Quelques exemples : «Mon père avait une petite maison, en rue de l’hôpital » (art. aiguë) ; «Ma grand’, en passant un jour à Sainte-Foy devant la porte de sa chambre, aperçoit, en train de relever ses cheveux devant la glace, sa femme de chambre qui disait : je ne sons pas jolie, mais tout de même j’ons ce petit air ! » (article air) ; «Ma grand mère maternelle avait été l’amie de la dernière abbesse de la Déserte qui, après la Révolution, réduite à une grande gêne, lui vendit un très beau reliquaire du XVIIe siècle que nous possédons encore » (art. arquebuse) ; «Quand je revins de nourrice, j’avais une bonne grasse face large, mais sans flamme » (art. couyon) ; « Une des sœurs de mon grand-père, Barthélemy Puitspelu, passementier, se nommait Dodon » (art. dodon) ; « Quand j’étais gone, à Sainte-Foy, il me survint une enflure douloureuse à la partie inférieure du tibia » (art. fourche) ; « Il y a des mères qui forcent leurs enfants au travail. La mienne m’aimait tant que, si elle me voyait travailler avec un peu d’assiduité : Allons, me disait-elle, il ne faut pas tuer tout ce qui est gras. Va t’amuser ! » (art. tuer) «Lorsque j’étais aux Minimes, à la fin du déjeuner, l’élève chargé de la lecture pendant le repas lisait le martyrologe du jour » (art. col). « Mme Catiner, notre voisine, disait un jour à mon barjois… » (art crique) « Feu mon maître d’apprentissage avait pour maxime qu’il est plus facile de trouver un veau raisonnable qu’une femme raisonnable » (art. raisonnable)…
celui de Puitspelu -alias Clair Tisseur (1827-1895)- se découvre, dont le lecteur peut, fragment par fragment, reconstituer la mosaïque. Quelques exemples : «Mon père avait une petite maison, en rue de l’hôpital » (art. aiguë) ; «Ma grand’, en passant un jour à Sainte-Foy devant la porte de sa chambre, aperçoit, en train de relever ses cheveux devant la glace, sa femme de chambre qui disait : je ne sons pas jolie, mais tout de même j’ons ce petit air ! » (article air) ; «Ma grand mère maternelle avait été l’amie de la dernière abbesse de la Déserte qui, après la Révolution, réduite à une grande gêne, lui vendit un très beau reliquaire du XVIIe siècle que nous possédons encore » (art. arquebuse) ; «Quand je revins de nourrice, j’avais une bonne grasse face large, mais sans flamme » (art. couyon) ; « Une des sœurs de mon grand-père, Barthélemy Puitspelu, passementier, se nommait Dodon » (art. dodon) ; « Quand j’étais gone, à Sainte-Foy, il me survint une enflure douloureuse à la partie inférieure du tibia » (art. fourche) ; « Il y a des mères qui forcent leurs enfants au travail. La mienne m’aimait tant que, si elle me voyait travailler avec un peu d’assiduité : Allons, me disait-elle, il ne faut pas tuer tout ce qui est gras. Va t’amuser ! » (art. tuer) «Lorsque j’étais aux Minimes, à la fin du déjeuner, l’élève chargé de la lecture pendant le repas lisait le martyrologe du jour » (art. col). « Mme Catiner, notre voisine, disait un jour à mon barjois… » (art crique) « Feu mon maître d’apprentissage avait pour maxime qu’il est plus facile de trouver un veau raisonnable qu’une femme raisonnable » (art. raisonnable)…
La première fonction de ces remarques est de persuader le lecteur que le vocable lyonnais, qu’on dit alors en voie de disparition, était il y a encore peu, très vivant ; quand Littré va puiser ses références dans la Grande Littérature, Puistpelu n’a besoin que de se baisser au coin de sa cage d’escalier pour trouver les siennes. En introduisant son lecteur dans son intimité, sur le ton plaisant du commérage ou plus émouvant de la confidence, Puitspelu confère à ces remarques éparses une autre fonction : celle de le rendre sympathique, tel un grand oncle au ton patelin dont les bords du chapeau se recourbent sur des mèches blanches. Enfin, elles instaurent un système d’autoréférences entre le collectif et le particulier, le mythe personnel et le substrat communautaire : si le Littré de Puitspelu est le lexique de la Grand’côte, c’est donc que le parler de la grande Côte est aussi la langue de Puitspelu ; le roman d’une simple famille, en définitive, devient aussi celui de toute une corporation, de toute une ville, en réaction contre le pédantisme franco-parisien : « Sauf votre respect. C’est ainsi que disent quelques personnes qui tiennent à parler français. Nous autres, simples, disons toujours, à la lyonnaise, parlant par respect ». (art. saufre).
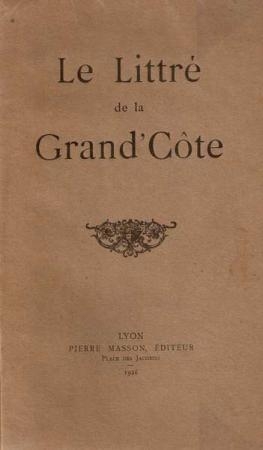 Ce roman familial fort discret s’élabore autour d’une nostalgie récurrente, qui, de même qu’elle affecte l’auteur, paraît au fil de la lecture affecter et la langue et le territoire dont, de façon métonymique, il se déclare le membre : un passéisme de bon aloi émane des définitions des termes populaires : « de mon temps à la Croix-Rousse… » (art. bardanière), « quel mot charmant, n’est-ce pas, quand nous étions petits gones ? » (art. badinage), « encore un métier de perdu, hélas ! » (art. arboriste), « jadis les fiacres de Vénissieux n’étaient autorisés à charger que du 1er novembre au 1er mai.» (art. allège), «on a démoli l’allée et la portion de maison placée au-dessus.» (art. allée des morts), «mot perdu à Lyon depuis qu’on se chauffe au charbon » (art.andier), « Mais hélas, aujourd’hui, tout a perdu sa vertu ! » (art. philtre), « Aujourd’hui, il n’y a plus que quelques rares Lyonnais qui aient gardé notre antique prononciation. » (art. prononciation)… Passéisme qui, outre ces quelques exemples, se diffuse un peu partout grâce à l’usage d’un imparfait narratif ostentatoire et proustien, affichant sur le mode du « il était une fois » l’arrière-plan regrettable dans lequel un certain progressisme, décidément détestable, paraît cantonner depuis peu la vraie vie. En voici quelques exemples : « De mon temps chaque bourgeoise secouait sa bardinière sur le carré. » (trad.: Chaque bourgeoise était propre, art. bardinière). « Chez mon oncle, on dînait et on soupait d’affilée, vu qu’on n’avait pas le temps de finir un repas avant de commencer l’autre. » (art. affilée). « Autrefois on donnait les innocents pour punition, non seulement aux enfants mais aux domestiques des deux sexes. C’était un souvenir des corrections de l’esclave. On ne voyait du reste pas à cette punition le caractère indécent et humiliant que nous lui attachons. » (art. Innocents – donner les innocents : donner le fouet). « Aujourd’hui, il n’y a que des ouvriers. Jadis, il y avait des artisans. Quand il fallait une certaine dose d’intelligence, de discernement, de goût pour l’exercice d’une profession, celle-ci était un art. » (art. airt). Tout le dictionnaire est ainsi structuré en sous-main par une première opposition aujourd’hui / autrefois. Opposition que redouble dans l’espace une seconde opposition, celle de la capitale de la province (Lyon) et celle du pays (Paris)
Ce roman familial fort discret s’élabore autour d’une nostalgie récurrente, qui, de même qu’elle affecte l’auteur, paraît au fil de la lecture affecter et la langue et le territoire dont, de façon métonymique, il se déclare le membre : un passéisme de bon aloi émane des définitions des termes populaires : « de mon temps à la Croix-Rousse… » (art. bardanière), « quel mot charmant, n’est-ce pas, quand nous étions petits gones ? » (art. badinage), « encore un métier de perdu, hélas ! » (art. arboriste), « jadis les fiacres de Vénissieux n’étaient autorisés à charger que du 1er novembre au 1er mai.» (art. allège), «on a démoli l’allée et la portion de maison placée au-dessus.» (art. allée des morts), «mot perdu à Lyon depuis qu’on se chauffe au charbon » (art.andier), « Mais hélas, aujourd’hui, tout a perdu sa vertu ! » (art. philtre), « Aujourd’hui, il n’y a plus que quelques rares Lyonnais qui aient gardé notre antique prononciation. » (art. prononciation)… Passéisme qui, outre ces quelques exemples, se diffuse un peu partout grâce à l’usage d’un imparfait narratif ostentatoire et proustien, affichant sur le mode du « il était une fois » l’arrière-plan regrettable dans lequel un certain progressisme, décidément détestable, paraît cantonner depuis peu la vraie vie. En voici quelques exemples : « De mon temps chaque bourgeoise secouait sa bardinière sur le carré. » (trad.: Chaque bourgeoise était propre, art. bardinière). « Chez mon oncle, on dînait et on soupait d’affilée, vu qu’on n’avait pas le temps de finir un repas avant de commencer l’autre. » (art. affilée). « Autrefois on donnait les innocents pour punition, non seulement aux enfants mais aux domestiques des deux sexes. C’était un souvenir des corrections de l’esclave. On ne voyait du reste pas à cette punition le caractère indécent et humiliant que nous lui attachons. » (art. Innocents – donner les innocents : donner le fouet). « Aujourd’hui, il n’y a que des ouvriers. Jadis, il y avait des artisans. Quand il fallait une certaine dose d’intelligence, de discernement, de goût pour l’exercice d’une profession, celle-ci était un art. » (art. airt). Tout le dictionnaire est ainsi structuré en sous-main par une première opposition aujourd’hui / autrefois. Opposition que redouble dans l’espace une seconde opposition, celle de la capitale de la province (Lyon) et celle du pays (Paris)
« A Lyon, nous employons toujours le premier, et à Paris, on emploie le second, parce qu’il appartient au style poétique. » (art. pot de chambre, par opposition à vase de nuit) : « C’est ce qu’à Paris ils appellent border un lit. » (article remployer) : « ils », par opposition au « nous , lyonnais », au « chez nous», ou au « au Gourguillon, nous disons couramment », assénés sans arrêt : « Voilà ce que vous entendrez chez nous ; les Parisiens disent… » (art. ancien) ; « je crois que le pôt, gigôt des Parisiens est une prononciation affectée, et que notre prononciation lyonnaise est la classique » (art. ot) ; «Gardons notre accent et ne soyons pas des perroquets. Est-il rien de plus ridicule qu’un provincial qui, revenant de Paris, essaie de prendre l’accent parisien et ne réussit qu’à faire lever les épaules à ceux qui écoutent son charabia » (art. avis). Si Puitspelu n’hésite pas à condamner le populaire parisien qui déforme les mots (art), il ne répète sans cesse que le populaire lyonnais ne les corrompt pas (art. finablement).
Ce provincialisme affiché serait anecdotique si, articulé à l’opposition jadis/aujourd’hui, et à la dissémination du roman personnel, il ne déclinait au nom d’une entière population les impressions d’un seul individu, « d’un petit gone », comme Clair Tisseur se nomme lui-même dans un autre de ses livres.
Ce tour de passe-passe, aux allures innocentes, permet ainsi, dans l’article canif, au modeste bourgeois qui a lu Homère de professer avec une hypocrite candeur que, pour qui ne connaît l’Odyssée, l’expression Charybde et Scylla demeure incompréhensible ; il suggère donc lui préférer le pittoresque tomber de canif en syllabe, expression qu’il recueille dans son bréviaire : manière peu délicate de dénoncer la culture érudite, au nom d’une pittoresque ignorance qui serait celle du ruisseau. Car on comprend à la lecture de nombreux articles que ce n’est pas de ce bon peuple de tisseurs que Puitspelu est en réalité épris, mais bien plutôt d’un moment heureux de sa propre vie, celui de son enfance. Si dans l’espace, le «parler» populaire des «vrais lyonnais» se voit assigné un territoire résolument restreint (la Grande Côte), il s’en voit assigné un autre dans le temps, l’enfance de son auteur, qui a littéralement « baigné » dedans : « A l’époque où le mot a été créé, on ne faisait ni ponts suspendus ni ponts en fer » (article pontiaude) ; autre exemple dans l’article « canetière » : « nouvelle machine avec laquelle je me suis laissé dire qu’on peut faire vingt ou trente canettes à la fois, tandis qu’avec le rouet, il fallait les faire une à une. Je ne désespère pas de voir un jour une invention pour faire vingt ou trente enfants à la fois ». D’où une posture à la fois neo-romantique et contre-révolutionnaire : « J’ai toujours pensé que le Peuple Souverain est le premier des barfouille-bachats » (autrement dit : imposture.) Mais ça, rajoute notre Littré du cru, « c’est défendu de le dire. Il faut se contenter de le penser ». Dans un recueil de réflexion privé, (Au hasard de la pensée, 1895), Clair Tisseur ne le pense-t-il pas en toutes lettres : « Ce qu’il faut à la multitude, c’est de la médiocrité de premier ordre »?
Le Littré de la Grand Côte se donne ainsi à lire comme un roman autobiographique joyeusement réactionnaire. En parfait décadent, Puitspelu érige en âge d’or l’Ancien Régime : « autrefois, mon père me racontait qu’au XVIIIe siècle… » (art. barouler). « Or sus, nos pères n’étaient pas moroses ou pédants comme nous. » (art. poil). Age d’or qui était celui du plaisir : « expression qui nous reporte aux temps antérieurs au Concordat où les fêtes étaient multipliées » (art. aimer) ; les révolutionnaires (les mathevons) se trouvent affublés d’un article défini générique qui les détermine en tant qu’espèce locale incongrue (les terroristes de Lyon) ; Clair Tisseur précise : « dans mon enfance, on ne les désignait que sous ce nom » (art.Mathevons) Le regret / respect de ce qui disparaît s’applique tout autant au bon peuple : ainsi, dans l’article canut, Puitspelu s’adresse solennellement au lecteur (« Lecteur, regarde avec respect ce canut ! ») pour lui signifier sa lente disparition (« Soixante mille métiers à mains lorsque j’étais borriau (apprenti), trois mille à l’heure où j’écris (1894). » Il glisse alors cette remarque : « Le nombre des ateliers privés va diminuant chaque jour au profit du métier mécanique. C’est à dire que la famille disparaît devant l’usine ».
Architecte, érudit, farceur, poète (à ses heures perdues, dirait Léon Bloy), Clair Tisseur (Puitspelu) mourut en 1895, à l'heure où triomphait la philologie; est-il saugrenu, pour conclure, d'affirmer qu'à l'orée du vingtième siècle, cet effort pour mêler l'objectivité du savant à la subjectivité de l'autobiographe, effort assez rare dans le genre du dictionnaire, est, comme l'aurait dit l'un de ses contemporains avec qui on l'aura rarement associé, « résolument moderne » ?
19:30 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : clair tisseur, accent lyonnais, littérature, lyon, littré de la grande cote | 

















