lundi, 21 mai 2012
Jean-Antoine Meyrieu
Etiennette l’avait mis bas au commencement de l’automne, l’année même que naquit l’Aiglon. On sait que ce dernier vint au monde au forceps et que Marie-Louise n’eut pas d’autre enfant. Tel ne fut pas le cas d’Etiennette qui, à sa naissance, avait déjà agnelé d’une fille (Michelle), d’un garçon (Jean-Claude). Après lui s’étaient annoncés Jean-Louis, Jean-Pierre, Jean-Marie, Claudine, Jean-François, Jean-Etienne et puis un autre Jean-Marie, pour remplacer le premier, qui s’était noyé vif dans une boutasse à quatre ans. Et cela aurait pu continuer si leur père à tous, Jean-Claude, n’avait fini par s’effondrer net d’un lâcher du cœur en poussant sa charrue, non loin de la Chivas, un soir de septembre 1824, laissant la bonne Etiennette au repos. Etait survenue l’hécatombe de 1825 (Michelle qui n’avait que dix-neuf ans, Jean-Claude qui n’en avait que dix-sept, Jean-Etienne qui n’en avait que deux). Sur un coup de colère, Jean Antoine avait décidé de laisser Aveyze pour s’installer à la ville. Il s’était rendu chez un tisseur des Grandes Terres, un pelaud comme lui et tous les siens, qui avait déserté Saint-Symphorien à pieds jusqu’à Lyon vingt-cinq ans avant lui, pensant faire fortune à la nouvelle que le Premier Consul était venu jusqu’en Bellecour pour y poser la première pierre de la reconstruction des façades abattues naguère sur l’ordre de la Convention. C’est avec des chemins comme ça que s’écrivit l’histoire de France.

Louis FROISSARD (1815-1860). La Place des Minimes à Trion
Sur le chemin des Grandes Terres, qui prenait au-dessus des Minimes à Trion et se répandait jusqu’au Point du Jour, s’étaient amassés des immeubles en pisé où s'entassaient les frais débarqués des campagnes venus rejoindre la Grande Fabrique renaissante. Presque deux cents gars pour un peu plus de cent-dix filles, tous placés chez des maîtres pour ouvrager. Tous savaient compter, déchiffrer et signer leur nom. Ils avaient entre cinq et sept ans pour apprendre tout le reste. Des unis, des jacquards, des velours, en tout presque cent soixante métiers battaient là, non loin de la chapelle de Fourvière où trônait la Vierge Noire qu'ils allaient prier le dimanche. Avec son maître, Jean Antoine avait traversé les guerres du tarif de 1831, celles pour la République de 1834. Tous ces combats pour la survie lui avait appris la grande vanité des causeurs, et qu’il ne pourrait compter que sur ses bras et sur sa tête à lui. Et qu'il lui faudrait passer longtemps à croiser du fil. C'est ce qu’il avait expliqué aux cadets venus d'Aveyze qui l’avaient rejoint l’un après l’autre. Tous croiseraient le fil désormais, loin du labour des aïeux. Et d’Etiennette qui, souvent, songeait à eux.
17:25 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : trion, jean antoine meyrieu, lyon, littérature, canuts | 
dimanche, 20 mai 2012
Volée de plomb
C’est une revue que ne manqueront pas d’apprécier celles et ceux qu’intéresse la typographie. Volée de plomb, proposée par l’association Retour de manivelle, a été composée à l’aide d’une fondeuse Ludlow. La couverture a été réalisée avec des caractères bois et des symboles en plomb. L’ensemble a été tiré sur une presse à épreuve FAG contrôle. « Dans le froid, la chaleur, la bonne humeur », précise-t-on.
Une tonne de matériel de récupération pour un acte militant qui prend son temps. La revue qui vient de voir le jour se veut « un instrument de propagande par le fait ». On pouvait rencontrer ses auteurs dont certains sont encore étudiants samedi 19 mai au bar associatif De l’autre côté du pont. De 18 à 20 heures se tint un débat où il fut question de la réappropriation des savoir-faire, de la dématérialisation du livre numérique, du bon usage de la technique, de la signification du travail, des conditions de formation d’une pensée critique en accord avec une action collective…
La revue en est à son numéro 1. Pour tout renseignement à son sujet, on peut contacter le groupe Retour de manivelle au 99 avenue de Paris, 42300 - Roanne
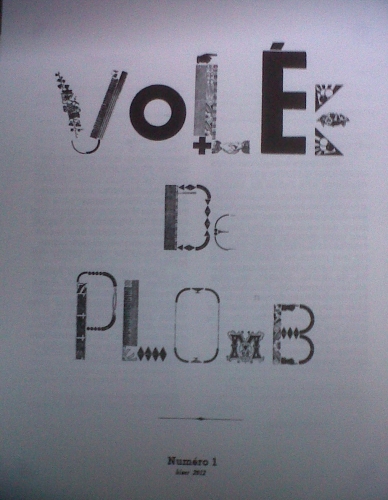
00:32 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : volée de plomb, retour de manivelle, typographie, littérature, roanne, lyon | 
mercredi, 09 mai 2012
Combas, le MAC, la Tête d'Or...
A P.A. Bardet et tous ses pairs
Quand on s’entretient d’art contemporain, et quel que soit le propos qu’on s’apprête à tenir, c’est d’argent qu’il faut parler tout d’abord puisque l’art, reflet de la société, est devenu une performance ; et qu’en société libérale, cette performance se doit d’être d’abord un marché : Partie de jambes en l’air entre une négresse sérieusement saloparde et un mec rose à quiquète de saucisse chauffée au bain marie, acrylique sur toile marouflée, signé sur la tranche de 65 x 57cm de Robert Combas, est estimé entre 8 000 et 12000 euros à la vente du 31 mai 2012 d'Auctions.fr (détails ici).
Pour une surface de 167 x 168, comptez de 30 000 à 40 000, avec cette acrylique sur toile Sans Titre signée en bas, à laquelle est joint un certificat de l’artiste daté de 1988 : « Le feeling, dit-il, c’est le rythme, c’est le batteur fou dans la jungle et les danses vaudou, c’est les Rolling Stones copiant les vieux morceaux des noirs, des bluesmen et sans le vouloir, créant une musique nouvelle. Moi c’est un peu comme ça pour la peinture, avoir le rythme (feeling) des écritures et des peintures publicitaires chinoises, arabes, méditerranéennes. Ma peinture c’est du rock»
sans titre
Ces choses étant posées, on peut s’attarder un instant sur la biographie de l’artiste. Fils de parents communistes, il a grandi dans la loge du concierge de la Bourse du travail de Sète, dans cette France d’avant 1981 où la culture était forcément de gauche quand le pouvoir et le pognon étaient naturellement de droite. Robert Combas se félicite d’être un autodidacte ayant poussé dans la culture populaire d’alors, faite de BD, de rock, de SF et de télé, de revendication politique et de libération des mœurs. Il suit les Beaux Arts de Montpellier et, dès 1981 dès participe à la création de la Figuration Libre.
On en arrive avec ce terme au conceptuel, sans quoi il n’est pas d’esthétique qui vaille dans la France des années 80. La Figuration libre se veut à la fois populaire, décomplexée et joyeuse, une compromis entre Dada et le psychédélisme, encore que le premier fut une révolte radicale contre l’émotion de l’art classique après la guerre de Quatorze, et le second une façon plus naïve de la transposer au sein de la contre-culture et de la constestation du consumérisme durant les Trente Glorieuses. Il y a loin, par exemple, entre les figures attrape-tout du français Combas et celles, gravement subversives, du polonais Tadeusz Kantor. Qu’importe. Ce n’est pas non plus la même génération.
Venons-en au fait qui est cette exposition que le Musée d’Art Contemporain de Lyon consacre depuis deux mois et pour encore deux autres à cet artiste. Sur trois étages et 3000 m2, quelques 600 objets (tableaux, sculptures, dessins), le visiteur a de quoi lire, entendre, zyeuter, en un mot ressentir, si je traduis le terme si convenu de feeling par lequel on nous propose d’aborder depuis une cinquantaine d’années tout ce qui n’est pas a priori rationnel. Avec Combas, on est de plain pied et qu’on le veuille ou non sur le registre de l’affirmation de soi : où qu’on se tourne, lignes, formes, couleurs finissent partout par dire le même moi. Il y a la partie exhibée, il y a celle, cachée. Aller de l’une à l’autre au gré de ses pas, c’est accomplir un voyage singulier de ce qu’on appelait jadis, avec le Michel Lancelot de Campus (suivre ICI) , « la contre-culture », à ce qui devint la « culture » (ou la « cuculture ) dans les années 80 ; du dilettantisme révolté à la consécration bien pensée, à travers un parcours qui se professionnalise au fur et à mesure qu’il rencontre et ses admirateurs, et ses détracteurs : J’ai pensé évidemment à ce que Jacques Rancière dit de ces piétas ou de ces portraits d’ancêtres qui, arrachés à leurs églises ou leurs châteaux par les armées napoléoniennes et proposés au badaud dans des espaces museaux perdirent tout leur sens et semblaient chercher, dans « ce milieu nouveau de liberté et d’égalité qui s’appelle l’Art » à en acquérir qui fut commun à tous dans le regard des badauds. Un, qui ne pouvait plus être qu’esthétique.
C’est alors que la question de l’exposition revient à nouveau, face à la production de Combas, production si contemporaine que lui-même fait partie de l’exposition : la virulence un peu naïve du trait et de la couleur, où se mêlent des souvenirs de Matisse, de Picasso comme de Popeye et de Mickey, aurait besoin de l’environnement urbain pour redevenir significative et vraiment festive. L’institution lui sied cher mal : livrée à elle-même, l’œuvre d’art se résume à la mise en scène d’une contre-culture devenue mainstream dans la loi du marché. Elle suscite, de mon point de vue, une relation bien trop narcissique et bien trop paradoxale. Le bourgeois bohème, celui qui a réussi songera peut-être (outre le fait que ça peut être un bon investissement) qu’il y rencontrera à chaque regard cette partie de lui-même, qu’il nomme en effet son feeling. Aussi, sur la paroi blanche d’un loft bien éclairé, l’œuvre, se murmure-t-il à lui-même, pourrait trouver sa place. Mais le petit bourgeois, pour sa part, regagnera ses pénates en songeant que non, vraiment, il ne mettrait jamais ça chez lui. A Rue 89, Combas affirme : « Si à 70 ans on me donne les honneurs, je monte sur la table et je pisse sur la table ». Quoi de plus générationnel que l’académisme un peu surfait d’une telle déclaration ?
Le musée et ses prétentions à l’Universel fut longtemps le lieu de la conservation et de la tradition ; il est devenu celui de l’entre soi culturel, un peu comme le parc de la Tête-d-Or, sa roseraie et son lac artificiel non loin de là le fut pour la bourgeoisie du Second Empire. Quand on entre dans le M.A.C lyonnais, qui fait face à Ciné-Cité, on est prié de laisser son sac dans une poubelle, qui fait office de vestiaire. Après tout, pourquoi pas ? L’exposition qu’il offre au consommateur, débarrassé de ses objets intempestifs qu’il croit personnels, est certes à connaître pour ce qu’elle dit du narcissisme aussi luxueux qu’insouciant de toute une génération. Ce qu’en pense un djeune, comme on dit, je me le demande. Les commentaires sont ouverts à tous les amateurs et tous les détracteurs.
Liens : Le Musée d'art contemporain et la visite virtuelle assez réussie, c'est ici
05:46 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (32) | Tags : robert combas, mac, lyon, peinture | 
lundi, 09 avril 2012
De Myrelingues, de l'incroyance, du torchecul...
On fête aujourd’hui l’anniversaire de la mort de François Rabelais, si l’on en croit un épitaphier du milieu du XVIIIe siècle de l’église Saint-Paul à Paris : «François Rabelais, décédé âgé de 70 ans rue des Jardins le 9 avril 1553 a été enterré dans le cimetière de Saint-Paul». Je me souviens comme d’hier de la récitation qu’un professeur de seconde nous fit, dès notre première rencontre le jour de la rentrée, de la méthode torcheculative, par laquelle Grandgousier connut « l’esprit merveilleux » de son fils Gargantua, et songea d’en faire un jour un « docteur en gai science ». Le pari était audacieux. Me revient en mémoire un certain scepticisme devant ses éclats de rire que je jugeai forcés, ne trouvant pas, moi-même, ce chapitre 13 du Gargantua et son énumération fastidieuse de torchecul si hilarant que ça. D’autant qu’il n’accompagna le texte d’aucune explication, nous laissant seuls avec la faconde d’Alcofribas.
Lui savait -nous pas encore- quel tonnage de commentaires érudits, parfois passionnants, souvent divagants, Rabelais avait engendré. Plus tard, je mis mon nez dans les pages de Lucien Febvre, plus tard dans celles de Spitzer, et plus tard encore dans celles de Bakhtine. Le problème de l’incroyance du XVIe siècle, dans sa belle collection « L’évolution de l’humanité » (téléchargeable ICI) me passionna à l’époque, parce que ce texte mettait en lumière, et j’avais grandement besoin de comprendre cela, « la religiosité profonde de la plupart des créateurs du monde moderne ». La thèse de Febvre (1878-1956) reste une grande et belle œuvre à lire aujourd’hui. Leo Spitzer (1887-1960), je ne l’évoque pas non plus sans quelque émotion parce que bruissaient encore dans sa génération ce souci de s’approprier le passé européen via le style que les siècles successifs avaient imprimé à sa littérature, cette conscience, désormais perdue, que cette littérature est le plus légitime de notre héritage. Bakhtine, enfin (1895-1976), qui dégagea la dimension purement carnavalesque, liée au bas corporel, de l’œuvre.
Il m’arrive parfois de songer, quand je me rends de la place des Jacobins à la rue Grenette en passant par la rue Mercière, que ce fut longtemps le trajet de Rabelais se rendant de l’Hôtel Dieu à l’atelier de François Juste. « Me voici revenu en l’Athènes des Gaules : l’inclyte et famosissime urbe de Lugdune la Myrelingues, Lyon aux dix mille langages, ubi est sedes studiorume meorum… », s’écrie le Rabelais de Claude le Marguet dans son roman Myrelingues la Brumeuse. Il s’agit d’une fantaisie du journaliste qui écrivit dans les années vingt ce roman historique à la gloire du Lyon de 1536. Cela reste un beau coup de chapeau, non seulement à Rabelais lui-même, mais aussi à cette artère où battaient les presses à bras dans tous ces ateliers transformés en restaurants pour touristes, quand ils n’ont pas été détruits lors des rénovations de Louis Pradel. Le souffle et le rire de Rabelais sont certes à présent légers sur la ville, et il faut beaucoup d’imagination pour retrouver l’un ou l’autre dans la mémoire de ses pierres. C’est cependant faisable, en quelque coin plus éminemment poétique qu’un autre, à condition de zyeuter quelque enseigne sculptée ou gravée dans la pierre et d’y rajouter la récitation de quelque verset rabelaisien :
« Ci entrez, vous, qui le saint Evangile
Annoncez en sens agile malgré ce qu'on gronde;
Vous aurez céans refuge et bastille;
Contre l'hostile erreur qui tant distille
Son faux style pour en empoisonner le monde:
Entrez, que l'on fonde ici la foi profonde,
Puis que l'on confonde de vive voix et par rôle
Les ennemis de la sainte Parole. »
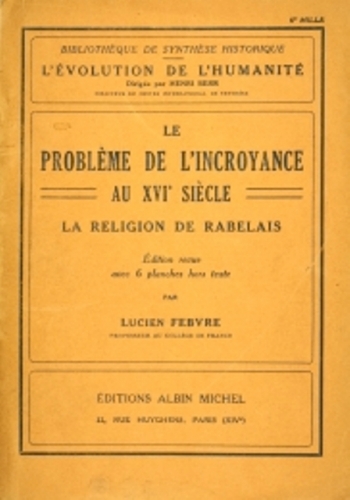
00:15 Publié dans Bouffez du Lyon, Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : myrelingues, torchecul, lucien febvre, françois rabelais, littérature, rue mercière, françois juste, lyon | 
lundi, 27 février 2012
Un ange noir
Curieux texte, que le dernier roman de François Beaune. Dans un Lyon dont le centre névralgique serait la place des Terreaux, ses SDF et ses punks à chiens et qui, pour le reste, se résume à des lieux de passage, de travail ou de survie, il examine de près la faillite de l’héritage républicain, « la faillite du code de vie commun » (p 97). A partir d’un fait divers relaté par le Progrès, il plonge son lecteur dans le carnet de bord d’un personnage ambigu, petit blanc fin de race « né avec une sciatique » (p 65) et « vivant parmi les mules obéissantes (p 67). A la croisée de plusieurs mondes, Alexandre Petit (c’est lui l’ange noir annoncé par le titre) tient à la fois du pauvre type, du justicier et du criminel en cavale.
Par une sorte de malédiction maternelle la fois sociologique, affective et onomastique, ce héros qui sait lire ne retient pas ce qu'il lit.. Entendons par là qu’il n’a ni le goût ni le désir ni la capacité de déchiffrer sur le long terme le monde à travers autre chose que des sensations immédiates ou des impressions instable. Sa mère l’ayant détaché, coupé de tout héritage, il ne maîtrise donc ni les codes de l’ancien monde (« boulets de certitudes éculées à traîne derrière soi - p 238), ni vraiment ceux du nouveau. De l’expérience qu’il fait de sa vie sociale, il ne tire qu’une énergie lucide et négative, une énergie d’extermination qui le pousse au crime gratuit, voire sacrificiel. C’est donc un personnage complexe, attachant et malsain, avec lequel le lecteur peut être tout autant distancié qu’en totale empathie : d’où l’intérêt du roman, la richesse du texte, l’originalité du sujet.
Ce personnage règle donc ses comptes non seulement avec sa « vieille carne de mère » institutrice très classe moyenne, mais aussi avec tout son entourage, gens de gauche à la duplicité manifeste qui ont manufacturé la décadence de son univers (« une mauvaise foi, cette tradition de gauche que je pratique depuis l’enfance, et qui s’applique à tout » p 244), qu’ils soient de grands penseurs (nos grands intellectuels s’époumonent au-dessus de la tête des gens, professeurs, intellectuels m’ont appris à viser trop haut » p258) ou de simples militants (« Leur fausse envie de changement me donne des haut-le-cœur. Ils regardent le match, mais ils sont convaincus qu’ils feraient un meilleur entraîneur que celui en fonction» p 110).
Dès lors, écrit le héros, « Mon sort est déjà programmé » (p 52), « Le sort s’acharne et me colle ce crime sur le dos » (p56). Car il cache un secret «difficile à décrire » : pour résumer, dit-il, on ne le trouve pas sympathique : « l’antipathie que je dégage est telle une seconde nature. Je vis avec depuis toujours ». (p 36)
Dans son environnement qui ne lui offre plus rien de naturel (« La ville, quand je respire, se soulève de pollution. Son ombre tremble. La pire odeur, je crois, est cette odeur artificielle de croissant. Je peux vomir au moment où je croise cette onde sucrée de boulangerie dans le couloir du métro »), Alexandre Petit estime « faire partie des rescapés » (p 67) : « nous survivons grâce au progrès de la médecine. La société moderne, en vaccinant, a choisi de faire cohabiter fantômes et vivants, sans distinction » (p 67) Ayant apprivoisé son état maladif, l’ange noir, qui a appris « les petites lâchetés » nécessaires à sa survie va découvrir durant les chapitres de ce texte envoutant le plaisir du crime, un crime qu’il situe entre nécessité et délivrance.
Dans l’univers de François Beaune, il y a ceux qui, proches de l’ironique Dieu des temps modernes, se pavanent de l’autre côté de l’écran parce qu’ils ont réussi, et ces autres que ce même Dieu a oubliés, qui meurent dans la société civile, (infirmiers, policiers, profs, commerçants, punks, SDF…) « Le monde est inversé » (p 157) et «la statistique est une pieuvre aux immenses tentacules ventousés à nos têtes » (p252) : « Statistiquement, nous avons 7,3 fois plus de chances de refaire un chemin familier que d’en prendre un nouveau » (p 191), « 99% de ce qui a vécu que terre a déjà disparu (p169). Statistiquement aussi, nous avons tous une chance de devenir criminels tant le monde est devenu laid et la figure de l’autre haïssable, qu’il soit turc (« Les Turcs attirent les affamés tels les étrons les mouches » « rouleau de bidoche grillant heureux dans l’air rance au milieu des fautes d’orthographe ») ou discounter (« Le discounter est pire qu’un Turc : il touche à tous les coins de la vie de consommateur. Il te noie et te charme de laideur. »)
D’où cet aveu : « j’ai appris à considérer le beau comme un danger. Quand j’aperçois un produit laid comme les yaourts premier prix, je suis instinctivement attiré, je les mets dans mon panier avec plaisir, avec l’impression d’être à ma place. Le laid est l’intuition du pauvre » (p204)

Thriller, fable sociale, le roman pourrait apparaître comme celui d’une génération sacrifiée sur l’autel de la fameuse « adaptation » au monde moderne, qui fut et demeure la litanie de tous les biens pensants du système : « Chacun sait qu’adaptation est mutation, mutation qui réclame le sacrifice d’une génération au minimum, sacrifice dont la prochaine génération bénéficiera car elle aura sa place, elle connaître les nouvelles règles de comportement », écrit Beaune à la fin de son texte, comme pour justifier à la fois l’errance et le sur-place de son héros, surdiplômé et enquêteur à la Sofres, bénévole aux Restos du cœur et antisocial confirmé, adolescent attardé et criminel, héros trouble dans la psyché duquel se lit toute la schizophrénie molle de l’époque.
François Beaune, Un Ange Noir, Verticales, 2011
11:31 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : françois beaune, un ange noir, verticales, littérature, lyon, société, politique | 
samedi, 18 février 2012
Les églises des pentes de la Croix-Rousse en péril
C’est l’ami Myrelingot qui a attiré mon attention sur cet article de la Tribune de l’Art de Didier Rykner, daté du15 février 2012 concernant l’état de délabrement dans lequel se trouvent deux églises des pentes de la Croix-Rousse, joyaux du patrimoine canut du premier arrondissement, Saint-Bernard et le Bon Pasteur : dégradations, profanations, tags, menaces d’effondrement et désintérêt flagrant de la municipalité pour le sauvetage de ces bâtiments historiques… Les deux photos ci-dessous, prises à l'intérieur du Bon Pasteur, proviennent de cet article que je vous invite à consulter et faire circuler. ( Cliquer ICI)

La chaire du Bon Pasteur, brisée à coup de masses.
Etat du 31 janvier 2012 - photo de Didier Rykner

Bon Pasteur : Plaque en marbre avec le nom des morts pour la France,
derrière,le maître-autel tagué
13:44 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : tribune de l'art, lyon, bon pasteur, saint-bernard, patrimoine, christinnanisme, gérard collomb | 
Radiographie de Saint-Bernard
Le 28 juin dernier, je publiais ce billet sur l’église Saint-Bernard, dont je vois de ma fenêtre la silhouette, sachant dans quel sinsitre état d’abandon elle se trouve. Je le republie aujourd’hui, accompagné d’un article que Louis Jacquemin consacre à l'histoire de celle du Bon Pasteur, qu’on sait également menacée et abandonnée par la municipalité
De quelque point qu’on pose l’œil sur sa hautaine pierre, cette église nous parait spectralement oubliée. A un point tel que je possède certains témoignages d’habitués de la place en contrebas, affirmant ne l’avoir jamais vraiment remarquée : « Ah bon, il y a une église ? ». Magnifique et inachevé, ce mur qu’on voit, prompt à surplomber l’abrupt, donne le ton : devant le monument arc-bouté, la verdure forme rempart, jungle touffue à l’image d’un Eden d’avant la faute, paradou zolien où s’ébattent d’hermaphrodites escargots. Lorsqu’il pleut, les plus intrépides s’aventurent hors du domaine en longues files brillamment baveuses. De bonnes âmes en rejettent quelques-uns dans le repaire, toujours humide et broussailleux. Les autres meurent sous le pas d’inattentifs ou de sadiques.
De ma fenêtre, j’aperçois ce mur qui tient tête à toutes les saisons. L’église n’a été que quelques décennies la paroisse des pauvres canuts. On était en 1852. Las de « descendre à Saint-Polycarpe », sur les bancs des riches marchands, ces derniers avaient obtenu du cardinal de Bonald un lieu de culte pour eux seuls. Le terrain fut offert par la famille Willermoz. L’architecte Tony Desjardins établit les plans ; La façade devait comporter un clocher ainsi qu’un double escalier monumental ; le manque d’argent compromit leur édification.
Quelques trente-cinq ans plus tard, la percée du funiculaire à travers la colline occasionna des affaissements de terrain et des lézardes inquiétantes dans l’édifice. Surgit le vingtième siècle qui, d’une guerre à l’autre, vit le pays s’enfoncer dans la déchristianisation. Les paroissiens devenant de plus en plus clairsemés, le bâtiment menaçant de plus en plus de s’effondrer, on finit par le désacraliser. Certains petits vieux redoutèrent un temps qu’il devint une mosquée pour les maghrébins de la Grande Côte, d’autres une église pour les intégristes. Certains espérèrent que la ville en ferait un lieu culturel. Tout cela demeura lettres mortes. L’insécurité sauva en quelque sorte le bâtiment, qui demeure ainsi.
Devant la porte close de Saint-Bernard, on se croirait perdu en quelque hameau ruiné, comme si, tout autour, la ville ne profilait plus ses bâtis, et que la colline fût partout sauvage. Tel le clocher de la Charité, Saint-Bernard est un des rares lieux éminemment poétiques où se murmure à voix presque authentique le passé de la ville, lieu magnétique en ce sens qu’il fut heureusement retiré aux vivants et demeure clos sur son mystère. Ainsi, lorsque je rejoins le plateau, il m’arrive de passer devant cette porte de bois aussi mystérieuse que fermée. Dans l'aveuglant sépia d’une carte postale d’autrefois, j’imagine la solennité déserte (et sans contredit peuplée de rumeurs) de cette chaire, ces bancs, ces chapelles, ces vitraux, ces statues, abandonnés au rêve d’une fantastique Résurrection, comme dans quelque conte enchanté de Barbey d’Aurevilly. Promeneur pourtant désabusé, je ne parviens pas à passer mon chemin sans emporter quelque grain de sa radiographie au cœur.

Histoire du Bon Pasteur, L. Jacquemin
Cette paroisse a été créée par le cardinal de Bonald en 1855. Elle avait été rendue nécessaire par l’accroissement de la population ouvrière venue habiter sur les pentes de la Croix-Rousse, le quartier de la soierie.
Une église provisoire fut ouverte au culte le 16 mars 1856.Or, ce jour-là, naissait Eugène-Louis-Napoléon, fils d’Eugènie de Montijo et de Napoléon III. L’Empereur décida à cette occasion d’être le parrain de tous les enfants nés le même jour que le petit prince.
L’abbé Callot, premier curé du Bon Pasteur, écrivit alors au souverain pour lui recommander son enfant, l’église née, elle aussi, le 16mars. Napoléon III accepta ce parrainage. Le couple impérial visita le bâtiment provisoire le 10 août 1860.
La première pierre de l’église définitive fut posée le 25 août 1869. L’œuvre à réaliser avait été confiée à Clair Tisseur, architecte plus connu par ses œuvres littéraires publiées sous le pseudonyme de Nizier de Puitspelu. Il construisit une église de style romano-byzantin. On lui imposa un clocher bien peu roman et d’une hauteur exagérée : mais il fallait que la nouvelle église se voit de loin. Par contre, l’escalier monumental prévu devant le portail ne fut jamais réalisé.
Le nouveau sanctuaire fut consacré en 1863 par le Cardinal Caverot.Tony Tollet orna l’intérieur de peintures très académiques et Louis Bégule en dessina les vitraux.
(Louis Jacquemin –Histoire des églises de Lyon, 1983)
13:38 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : église saint-bernard, croix-rousse, canuts, lyon, christianisme, catholicisme | 
dimanche, 05 février 2012
Ciel de suie
On a souvent comparé Lyon à une ville du Sud, vantant sa lumière et sa pierre gallo-romaine. Mais c'est trop vite céder aux charmes trompeurs de l'été. L'hiver, Lyon retrouve sa lumière native et sa nature véritable, quand sous le sortilège de son dieu qui lui vint un jour d'Irlande ou des brumes de Norvège, elle se met à ressembler à Bruges ou Dublin, sous la robe incontestable d'une fille du Nord.
De là vient cette passion froide et cette fidélité extrême qui sommeille au fond du tempérament lyonnais, si l'on en croit toute la littérature écrite en ce pays-là. Tempérament que nul n'a mieux exprimé qu'Henri Béraud dans son roman Ciel de Suie.

06:27 Publié dans La table de Claude | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : henri béraud, littérature, lyon, lug, italie, irlande | 
vendredi, 13 janvier 2012
Bref sabbat
Fin de fêtes pour les sapins. Scènes désormais courantes de la consommation souveraine, qui n’émeut personne, plus même les enfants. C’est sur une place de Lyon, au côté d’un abribus, les gens balancent leur arbre que des bennes viennent charger au petit matin.

Sauf que cette année, des loubes les enflammèrent le soir venu. Torche crépitant tout soudain, les sapins. Brûler la teuf, disent-ils. L’abribus a eu chaud quelques minutes. Une dizaine de pompiers quand c’est presque fini, dispersent les braises. Reste un cercle de sable noirci, trace d'un sabbat dérisoireet bref.

00:05 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : noël, sapins, société, lyon | 














