dimanche, 27 octobre 2013
Я ЕСТЬ -JE SUIS -
Je suis installe sur le plateau des Célestins l’histoire d’une ville, Komsomolsk-sur-Amour, dont la légende raconte qu’elle a été construite par une jeunesse communiste enthousiaste alors qu’elle est l’œuvre d’abord des déportés au goulag puis celle des prisonniers de la seconde guerre mondiale. Ce secret des origines, à force d’être tu, est tombé dans un oubli soigneusement entretenu par les officiels, mais tout aussi soigneusement conservé par la mémoire familiale de ses habitants. De cet oubli, Tatiana Frolova extirpe la parole de ses personnages qui développent les uns après les autres le fil de leur histoire, remontant au pire jusqu’aux grands-parents, au mieux jusqu’aux arrière grands-parents : après ou plus loin, on ne sait rien, on ne sait plus. C’est encore l’oubli.
Mais ce que l’on comprend très vite, c’est que le grand mystificateur qui a orchestré jadis cette rupture est le même que celui qui aujourd’hui alimente encore cet oubli : l’Etat. Pour faire face (ou front), à ce dernier, il n’est que l’être de chaque individu qui vient se dire tour à tour dans une nudité de parole quasi artisanale (documentaire), d’où ce titre, « Je suis ».
« L’histoire de la ville de Komsomolsk-sur-Amour, patrie du Teatr KnAM, est symptomatique de la façon dont la mémoire collective se cultive à partir d’une histoire passée sous silence, dont on ne donne qu’une image positive.» explique Tatiana Frolova. «Staline était un criminel mais sa tombe demeure dans la nécropole de la Place Rouge et, chaque année, les victimes du culte de la personnalité viennent honorer sa mémoire, accompagnés de très jeunes gens »
De Staline à Poutine, le fil conducteur est ainsi l’entretien politicien du mythe au cœur même de ce qui, par ailleurs, le dénonce : c’est la force inouïe de la propagande de parvenir à faire oublier ce paradoxe. Et c’est le pouvoir de l’image (la représentation) de rendre possible la propagande. C’est là que le propos du spectacle croise une réflexion qu’on pourrait dire universelle sur (bien au-delà du cas russe) ce media qui rend partout possible toute dictature, dès lors qu’il est mis au service de l’oubli : l’image elle-même.

La première image sur laquelle travaille Frolova est ce fameux quatrième mur placé, depuis Diderot, au cœur même de la représentation théâtrale. Elle l’investit durant toute la durée du spectacle en y projetant paroles, photos, dessins d’enfants, prières, manifestes, témoignages, ombres chinoises, et parfois même le reflet du public en train de le (se) regarder. Mais en même temps qu’elle l’utilise à la manière d’un écran de cinéma, elle en maintient aussi l’artifice puisqu’à travers lui on continue de voir les acteurs, tantôt occupés à jouer une scène, tantôt à manipuler ou dessiner sur une table de verre ce qui est projeté sur l’écran, dans un dispositif parfaitement brechtien de distanciation : le spectacle dénonce ainsi l’image en train de se faire. Après avoir ainsi occupé et maintenu simultanément le quatrième mur, Frolova le perce de façon fort efficace pour prendre à parti parfois le public, en questionnant frontalement : « qui répondra de tous ces crimes ? », ou, mieux encore, en affirmant que personne parmi ceux qui regardent le spectacle n’aurait eu la force de supporter la pression terrifiante du KGB.
De chaque côté de ce quatrième mur, Tatiana Frolova expose les images quasiment fixes de deux visages, à l’intérieur de deux écrans, qui soulignent la prééminence de la technologie moderne, principale vecteur d’images. Côté cour, celui d’un vieillard (Bernard Noël), côté jardin, celui d’un enfant. Façon de nous rappeler, la prééminence de l’outil de propagande dans la vie personnelle, voire intime, de chacun d’entre nous, de sa naissance à sa mort. Comme Kantor parlait « d’objet pauvre », on aurait envie devant ce que Forlova appelle un « théâtre documentaire » de parler alors d’image pauvre. Car ainsi exposées ces images finissent par acquérir un statut particulier dans la représentation : arrachées à la réalité non plus de la vie, mais du spectacle, elles témoignent, à leur façon, du mal qu'elles font.
Tout comme l’objet dans l’esthétique de Kantor, elles disent le rapport au monde, à la fois pauvre et dérisoire, de chaque personnage ; elle dénoncent aussi le véritable oppresseur, ce processus que Debord nomma la séparation, et qui est ici au cœur même de la mise en scène. Une étrange harmonie s’installe peu à peu entre les trois acteurs et les images d’eux-mêmes, comme si leur parole et leur effort de mémoire ne pouvaient s’extirper pleinement de l’oubli produit par leur représentation simultanée.
Ce questionnement sur l’image trouve par ailleurs sa forme au fur et à mesure qu’on avance dans le spectacle et que se crée sur scène un univers poétique spécifique : les bandes de gaze servant à effacer les traces de feutres rouges, assimilées à des pansements ensanglantés, par exemple. Ou bien les semelles-couche-culottes usitées, et les chapkas enturbannées, dans une leçon pleine d’humour pour survivre emmitouflé dans le grand froid.
Puis il devient pleinement critique, lorsque le spectacle suggère l’idée très significative qu’il y aurait un lien entre la maladie d’Alzheimer et la transformation du temps individuel autrefois vécu en histoire collective désormais établie en images. « Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation », disait Debord. Tatiana Forlova rajoute qu’Alzheimer, pourrait être le fruit de cette séparation. Et c’est alors que son spectacle trouve son véritable centre de gravité et sa pleine originalité,: « La première personne qui est venue voir Alzheimer lui a dit : je me suis perdue moi-même. », nous rappelle-t-elle. C’est pourquoi, dans la logique démente du système qui nous gouverne, soigner l’Alzheimer, ce ne peut être que le propager plus encore, jusqu’à une sorte de macabre solution finale, parodie de retour à la civilisation : dressage des vieux malades comme celui des enfants avec imposition d’une autorité, privation de la liberté, fixation d’habitudes, bref, perpétuation de la même dictature … A cet instant, le théâtre de Forlova marmonne, dans le sens noble du terme que le texte lui-même confère à ce mot, le théâtre de Kantor.
Une citation (lue par l’enfant) du livre de Bernard Noël, Le livre de l’oubli, clôt le spectacle : « Depuis l’invention des medias et leur emploi généralisé, il ne s’agit plus d’orienter l’espace mental, mais de l’occuper et de le vider de tout autre contenu que celui des spectacles qu’on y projette. Rien ne fut jamais aussi efficace pour soumettre les têtes que ce décervelage qui remplace pensée et imagination par le flux des images. L’oubli n’y peut rien, et il est temps de se demander s’il n’est plus lui-même devenu l’instrument de cette privation de sens »
Ce n’est pas le moindre mérite de cet insolite théâtre-documentaire de Tatiana Forlova (ni sa moindre prouesse) que de donner à cette privation de sens une signification à la fois philosophique et esthétique, tout en serrant au plus près l'expérience vécue et racontée des personnages que nous sommes.

Tatiana Frolova - photo Kirill Khanenkov
Я ЕСТЬ -JE SUIS - Cie : Teatr KnaM - Coproduction -Festival Sens Interdits - les Célestins, Théâtre de Lyon , Théâtre de Poche - Genève , Scène nationale André Malraux, Vandoeuvre-lès-Nancy Mise en scène de Tatiana Frolova, avec Elena Bessonova, Dmitry Bocharov, Vladimir Dmitriev, spectacle en russe surtitré Au théâtre des Célestins de Lyon, du 26 octobre au 30 octobre et du 5 au 9 novembre 2013
10:55 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Я ЕСТЬ, je suis, tatiana frolova, théâtre, lyon, célestins, teatr knam, komsomolsk-sur-amour, spectacle, oubli, bernard noël, propagande, staline, russie, poutine, goulag, kantor | 
samedi, 19 octobre 2013
Poïpoïgrotte et autres arts montables
Les Grecs ne connaissaient que deux procédés de reproduction mécanisée de l’œuvre d’art : le moulage et la frappe. Les bronzes, les terracottes et les médailles étaient les seules œuvres d’art qu’ils pussent produire en série. Tout le reste restait unique et techniquement irreproductible. Aussi ces œuvres devaient-elles être faites pour l’éternité. Les Grecs se voyaient contraints, de par la situation même de leur technique, de créer un art de valeurs éternelles. C’est à cette circonstance qu’est due leur position exclusive dans l’histoire de l’art, qui devait servir aux générations suivantes de point de repère. Nul doute que la nôtre ne soit aux antipodes des Grecs.
Jamais auparavant les œuvres d’art ne furent à un tel degré mécaniquement reproductibles. Le film offre l’exemple d’une forme d’art dont le caractère est pour la première fois intégralement déterminé par sa reproductibilité. Il serait oiseux de comparer les particularités de cette forme à celles de l’art grec. Sur un point cependant, cette comparaison est instructive. Par le film est devenue décisive une qualité que les Grecs n’eussent sans doute admise qu’en dernier lieu ou comme la plus négligeable de l’art : la perfectibilité de l’œuvre d’art. Un film achevé n’est rien moins qu’une création d’un seul jet ; il se compose d’une succession d’images parmi lesquelles le monteur fait son choix - images qui de la première à la dernière prise de vue avaient été à volonté retouchables. Pour monter son Opinion publique, film de 3 000 mètres, Chaplin en tourne 125 000. Le film est donc l’œuvre d’art la plus perfectible, et cette perfectibilité procède directement de son renoncement radical à toute valeur d’éternité. Ce qui ressort de la contre-épreuve : les Grecs, dont l’art était astreint à la production de valeurs éternelles, avaient placé au sommet de la hiérarchie des arts la forme d’art la moins susceptible de perfectibilité, la sculpture, dont les productions sont littéralement tout d’une pièce. La décadence de la sculpture à l’époque des œuvres d’art montables apparaît comme inévitable.
Walter Benjamin, L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique,1935

Poïpoïgrotte, à Grigny
20:22 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grigny, poïpoïgrotte, art contempôrain, lyon, walter benjamin | 
dimanche, 06 octobre 2013
Le Président de Michel Raskine
Au centre du texte du Thomas Bernhardt et dans les propos du président lui-même se niche la comparaison entre l’art politique (le premier dans sa hiérarchie) et l’art dramatique (celui qui vient juste après, avant les Beaux-Arts et tous les autres): Le dispositif imaginé par Raskine pour la mise en scène du Président, actuellement au théâtre de la Croix-Rousse, tient tout entier dans cette assimilation d’un art par un autre : le trône et l’estrade, lieux symboliques du pouvoir, se dressent devant les spectateurs entre deux vestiaires où deux comédiens (Marief Guittier et Charlie Nelson) vont endosser les peaux successives de leurs deux personnages : la Présidente, le Président. A leur côté, un troisième officiant, régisseur à la fois du palais et du théâtre, comme l’indique sa tenue. Et une multitude de petits pantins hauts de quelques centimètres afin de figurer les personnages secondaires, parmi lesquels la bonne de la présidente, le colonel victime du premier attentat et le masseur. Ce parti pris de théâtre dans le théâtre culmine lors du dénouement lorsque, vêtu du même tee-shirt que le régisseur, Charlie Nelson contemple la mise en bière de son personnage sur l’estrade en bois comme s’il la mettait en scène, tout en jouant du saxo.
Le texte de Bernhardt n’a rien perdu de sa force depuis 1975, bien au contraire : «En chaque individu, il y a un anarchiste », y compris dans le Président et la Présidente, qui ont enfanté le Fils qui menace de les tuer. Y compris chez les militaires, les domestiques. Y compris chez les curés et les médecins, dont il est vain de croire qu’ils pourraient former un rempart contre les risques galopants qui menacent le pouvoir. « Ambition, haine, rien d’autre » : c’est le fameux leitmotiv, auquel se rajoute « la peur » dans la bouche du président, qui hante la scène comme le palais et court d’un bout à l’autre du texte de l’auteur autrichien : survivre aux attentats qui déciment peu à peu le Régime et ses dignitaires, tel est donc l’enjeu de ce couple présidentiel qui justifie leurs monologues successifs, lesquels s’énoncent devant le spectateur telles deux longues phrases ponctuées autant que hachées par les répétitions : manière pour les personnages de communiquer leur isolement, leurs obsessions de se dire, et surtout leur incapacité à communiquer entre eux.
Survivre et non pas vivre, non pas régner : Jadis tragique, la figure de l’ordre est devenue comique, car la classe dirigeante, nous apprend le texte, meurt finalement d’elle-même, de son exposition et de sa corruption. De son auto-érosion.
« On oublie souvent, déclara Raskine dans un interview, que Thomas Bernhardt est un survivant. Il aurait dû mourir à 18 ans dans un sanatorium ; les médecins n’ont jamais compris comment il a survécu à tant de difficultés d’ordre médical. Il a survécu. Je pense qu’il a mis la barre à une telle hauteur d’exigences qu’on est tiré vers le haut ».
Dans Le Président, en effet, la survie est à la fois un thème burlesque et le moyen de la satire. On répète souvent que la pièce a été montée pour la première fois au Schauspielhaus de Stuttgart en 1975, alors que s’ouvrait le procès de la bande à Baader. On se souvient moins souvent que cette année 1975 fut aussi celle où Thomas Bernhardt entreprit le premier volume de sa longue suite autobiographique avec son premier volet, L’Origine :
« Lui-même est incapable de transformer même en un seul instant de sommeil son état d’épuisement encore bien plus grand, l’état d’un blessé perpétuel », peut-t-on lire dès les premières pages de ce récit. Or c’est bien cette rencontre entre la comédie du pouvoir et la tragédie de la survie qui confèrent aux deux personnages de la pièce leur épaisseur toute particulière, toute bernhardienne, mais aussi plus classique, plus universelle qu’une simple pièce au motif politique : c’est ce que soulignent la mise en scène de Raskine, comme la performance des deux comédiens, sur le fil d'un bout à l'autre du spectacle. Un beau et vrai moment de théâtre, en ce moment-même à la Croix-Rousse.

Marief Guittier Photo © Loll Willems
Théâtre de La Croix-Rousse, jusqu'au 11 octobre 2013
19:43 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : le président, thomas bernhard, michel raskine, théâtre, croix-rousse, lyon, littérature | 
mardi, 01 octobre 2013
La brume lyonnaise est un empire
Lyon s'est réveillée ce matin sous des vapeurs brumeuses, celles qui conviennent à ses reliefs, ses pierres, ses toits. C'est un beau début d'octobre, prometteur. Les vieux Lyonnais savent que c'est là son visage instinctif, le nordique, le celtique, le romantique également, qui ne pisse pas de sueur salée, mais se délecte de ses humides enchantements. Le moindre pavé devient alors propice au souvenir, dans l'épaisseur du sentiment.

Jadis, des poètes locaux un peu bourrus avaient fait de ce gris l'âme de leur ville, brume qui convient autant à l'effort de vivre qu'à la reconnaissance d'exister. A elle seule, elle donne sens aux carreaux des maisons, patine aux grilles des caves et pose d'inimitables reflets sur les croix de nos églises. En fermant l'horizon extérieur - et l'on voudrait presque que ce soit pour jamais - elle ouvre aux risques de l'âme l'aventure de sa vapeur et celle de son humidité. La brume lyonnaise est un empire. Chambre de chacun calfeutrée sur la pierre, enrobant mystère de sa toison bouclée répandue autour des branches, prometteuse caresse ivre de ses fleuves et filant par nos narines, joie fusant en cris suraigus par la gorge des gones qui courent dans les préaux.
photo Blanc Demilly
10:16 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : lyon, poème, littérature, brume d'octobre | 
mercredi, 25 septembre 2013
En sursis
Le plan social des librairies Chapitre qui prévoyait la suppression de 271 postes en France, et la liquidation du magasin de Bellecour (l’ancien Flammarion) a été suspendue. La librairie lyonnaise est donc en sursis.
En sursis également le petit théâtre d’André Sanfratello où nous jouâmes notre Colline aux canuts il y a déjà longtemps. Une subvention en moins (22 000 euros) de la DRAC, et l’Espace 44 joue sa survie. Une pétition adressée à la ministre de la culture peut être signée ICI.
En sursis, on le sent par ailleurs dans l'air de cette époque, tant de choses. Le durcissement de la société en général, les difficultés croissantes des gens, l'absence de visée, l'implantation du technologique en tous lieux, l'effacement d'une culture plurielle au profit de cet usage du divertissement de masse dont les pouvoirs aussi bien politiques qu'économiques usent et abusent ; tout cela fait que des habitudes s'estompent, des usages s'effacent, des lieux disparaissent. En sursis, par exemple, après celui de Lyon et celui de Marseille, le Grand Hôtel-Dieu de Paris.
On pourrait, mais je n'en ai pas le cœur, dresser un inventaire à la Prévert assez facilement en faisant une petite veille sur le web de tout ce qui, encore vivant, demeure en réalité en sursis. A commencer, dirait le philosophe, par soi-même. Mais justement. La tradition voulait que, face à nous qui passons, se dressât le monde, qui reste. Les dominants politiques de la planète ont, depuis un certain temps, programmé la disparition du monde traditionnel derrière ce qu'ils appellent le changement. Le monde, comme entité culturelle stable, est donc en train de s'émietter doucement. Et tous les individus sont sommés, dans cette évaporation, de positiver. Car leur dit-on, à eux qui ne sont que de passage, et alors qu'on a déjà programmé leur remplacement : "vous êtes la valeur étalon, vous êtes le citoyen référent, vous êtes le centre stable de toute cette agitation". C'est un monde inversé, comme en Iowa où l'on apprend que, par souci de non discrimination, les aveugles ont désormais le droit de porter une arme comme les voyants. Un de nos brillants politiques, n'en doutons pas, nous dira bientôt que l'Iowa est à la pointe du progrès. Au nom de la déraison des Droits de l'Homme, les droits de l'homme aussi, partout, sont en sursis.
05:15 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : espace44, librairie chapitre, bellecour, lyon, théâtre | 
dimanche, 01 septembre 2013
Septembre, leur fiction
L’aube de ce matin annonce celle de septembre, magnifique, quand tout se tait
Dans la fraîcheur alpine de l’automne en train de tourner sur les toits
Le sens des jours. Les abus de l’été vont cessant
Il faut garder au cœur cet instant pour avancer plus loin sauf
Dans la reprise des hommes qui aspirent à l’événement
Le séisme des crises et le bruit des bottes hantent à l’horizon
Leur fiction
Comme si pour se hisser au plus haut degré de leur histoire
Les petits gouvernants étaient à jamais nostalgiques de notre mort
Dans l’amas déliquescent de sociétés de peuples et d’événements
Mais leur histoire n’est pas celle de ce matin dont la chair frémit vers le recommencement
Qui mènera les racines des arbres et le museau humant des bêtes par le prochain hiver
Et à qui seul je donne le nom et reconnais le pouvoir de permanence.
07:10 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : septembre, poème, littérature, lyon | 
mardi, 18 juin 2013
Le teint du ciel
En même temps, il te faut tes obsessions, pour survivre. Tes tocs. Et même une bonne névrose. Tous ces gens bien normaux t’ont toujours saoulé. Sans contacts. Leur teint… Tu n'aurais su par où les sculpter. Toi, tu n’as jamais porté cravate ni complet veston. Tu n’aimes que les vues du ciel. Il n’y a que lui pour porter haut le gris de ses humeurs sans être fade.
Comme lui, il te faut tes ritournelles, ton arrogance et ton geste de fermeture. Ta suavité. Le changement te gave. Proteste. Conserve. N’hésite pas à tout sauver. Dégorge. Regorge. Matière qui respire. Sans les cieux tiens, néant.
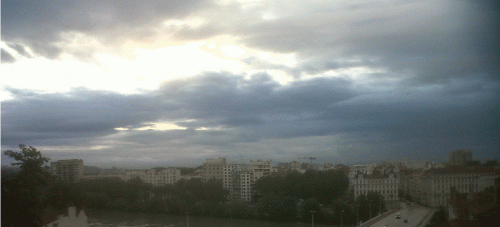
10:23 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, poésie, lyon | 
dimanche, 09 juin 2013
Un futur maire pour Lyon ?
Tout le monde donnait gagnant Georges Fenech et c’est finalement l’ancien député Michel Havard qui a remporté la primaire UMP lyonnaise pour les municipales, beaucoup moins médiatisée que la parisienne. Gérard Collomb aurait souhaité pour plusieurs raisons affronter le premier : d’une part parce que Fenech est un candidat plus droitier ; d’autre part parce qu’il était parachuté de l'extérieur quand Havard a grandi à Lyon. Or la prime au lyonnais est une vieille tradition ici. Avec Havard – un inconnu sur le plan national – Collomb a senti que ce serait sans doute plus compliqué d’emporter un troisième mandat, surtout par les temps qui courent. La campagne se jouera donc au centre, ce qui laissera sans doute de la place aux deux extrêmes pour faire émerger des listes au 1er tour. Mais Lyon étant ce qu’elle est, mon petit doigt me dit qu’à l’arrivée, Michel Havard a de sérieuses chances d’en devenir le futur maire. Mon petit doigt me dit aussi que Gérard Collomb n'a pas fini, dans les mois qui viennent, de critiquer la politique gouvernementale.

Ce qui est drôle, c’est que tous les autres candidats du premier tour, Nora Berra, qui n’avait réuni que 9%, Emmanuel Hamelin qui en avait réuni 14% s’étaient désistés pour son concurrent Georges Fenech qui en avait, lui, rassemblé 35%. Ce dernier avait même le soutien de l’ancien maire Michel Noir. On regardera de loin tous ces braves gens se ranger derrière le plus jeune poulain qui a triomphé des combines d'appareil, à moins qu’ils aient décidé de lui savonner la planche, ce qui en politique est toujours possible, mais vu le contexte national, guère probable.
23:33 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : michel havard, lyon, politique, municipales | 
jeudi, 23 mai 2013
Locustarum examen
Le printemps, c’est la saison des asperges, des cerises, des fraises et des examens : au marché de la Croix-Rousse, les maraichers se plaignent tous de la pauvreté de leur récolte. L’éducation Nationale, elle, demeure ponctuelle dans sa production saisonnière de pensums. Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’on crève de chaud par 40°, il y en a pour tout le monde, élèves, étudiants, professeurs. Ecrits puis oraux, avec des lots conséquents de copies et d’exposés tous la plupart du temps similaires puisqu’à l’école on n'apprend depuis toujours, c’est bien connu, qu'à faire, dire et penser comme tout le monde, tantôt en rangs, tantôt en ronds..
Ce matin donc, je m’en vais examiner.
Et comme j’aime bien savoir ce que je fais quand je fais quelque chose, j’ai suivi la piste à travers les siècles de ce terrible mot examen, utilisé aussi bien dans le domaine judiciaire que le médical, l’économique ou le scolaire. J’ai donc ouvert mon Gaffiot – une Bible irremplacée, et voici ce que je découvre : Le sens premier du terme latin examen est essaim d’abeilles, puis par dérivation troupe. Gaffiot, décidément, toujours à propos ! Il donne comme exemple Juvenum examen (Horace, Odes, 1, 35 [J’ai toujours aimé la précision des citations, Félix Gaffiot herborise autant qu’il fait de la grammaire]), qu’il traduit par troupe de jeunes gens. Au passage, apprécions ce locustarum examen, si tragiquement véridique, recueilli chez Tite Live, 42, 10,7 : nuée de sauterelles.
Comment le mot en vient-il à son troisième sens dans l’Enéide du bon Virgile (12, 725) ? Ne me le demandez pas, Gaffiot n’en dit rien. Il enregistre, simplement : aiguille ou languette d’une balance, et de là, action de peser, contrôle.
Le moderne Robert donne comme étymon le latin exigere, peser. Sans plus.
Mais Gaffiot, à l’article exigo, rappelle que ce même verbe à lui-même pour étymon ago (agir). Le premier sens de exigo (ex ago) étant pousser hors de, chasser, puis, mener à terme et enfin mesurer, régler.
Ainsi se comprend le fait que le terme ancien ait pu signifier en même temps les troupes ou les nuées (ce qui sort hors de) et l’instrument qui sert à peser. Finalement, le mot français examiner contient la forme latine verbale (contrôler) et nominale (les troupes). Examiner, cela revient à peser les sauterelles, pour ne pas dire autre chose.
C’est sans rapport aucun, mais je trouve très engageante cette vue de Lyon, prise du haut de la montée de la Grande Côte.
06:22 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : latin, examen, gaffiot, éducation nationale, lyon, croix'rousse, etymologie | 










