dimanche, 27 octobre 2013
Я ЕСТЬ -JE SUIS -
Je suis installe sur le plateau des Célestins l’histoire d’une ville, Komsomolsk-sur-Amour, dont la légende raconte qu’elle a été construite par une jeunesse communiste enthousiaste alors qu’elle est l’œuvre d’abord des déportés au goulag puis celle des prisonniers de la seconde guerre mondiale. Ce secret des origines, à force d’être tu, est tombé dans un oubli soigneusement entretenu par les officiels, mais tout aussi soigneusement conservé par la mémoire familiale de ses habitants. De cet oubli, Tatiana Frolova extirpe la parole de ses personnages qui développent les uns après les autres le fil de leur histoire, remontant au pire jusqu’aux grands-parents, au mieux jusqu’aux arrière grands-parents : après ou plus loin, on ne sait rien, on ne sait plus. C’est encore l’oubli.
Mais ce que l’on comprend très vite, c’est que le grand mystificateur qui a orchestré jadis cette rupture est le même que celui qui aujourd’hui alimente encore cet oubli : l’Etat. Pour faire face (ou front), à ce dernier, il n’est que l’être de chaque individu qui vient se dire tour à tour dans une nudité de parole quasi artisanale (documentaire), d’où ce titre, « Je suis ».
« L’histoire de la ville de Komsomolsk-sur-Amour, patrie du Teatr KnAM, est symptomatique de la façon dont la mémoire collective se cultive à partir d’une histoire passée sous silence, dont on ne donne qu’une image positive.» explique Tatiana Frolova. «Staline était un criminel mais sa tombe demeure dans la nécropole de la Place Rouge et, chaque année, les victimes du culte de la personnalité viennent honorer sa mémoire, accompagnés de très jeunes gens »
De Staline à Poutine, le fil conducteur est ainsi l’entretien politicien du mythe au cœur même de ce qui, par ailleurs, le dénonce : c’est la force inouïe de la propagande de parvenir à faire oublier ce paradoxe. Et c’est le pouvoir de l’image (la représentation) de rendre possible la propagande. C’est là que le propos du spectacle croise une réflexion qu’on pourrait dire universelle sur (bien au-delà du cas russe) ce media qui rend partout possible toute dictature, dès lors qu’il est mis au service de l’oubli : l’image elle-même.

La première image sur laquelle travaille Frolova est ce fameux quatrième mur placé, depuis Diderot, au cœur même de la représentation théâtrale. Elle l’investit durant toute la durée du spectacle en y projetant paroles, photos, dessins d’enfants, prières, manifestes, témoignages, ombres chinoises, et parfois même le reflet du public en train de le (se) regarder. Mais en même temps qu’elle l’utilise à la manière d’un écran de cinéma, elle en maintient aussi l’artifice puisqu’à travers lui on continue de voir les acteurs, tantôt occupés à jouer une scène, tantôt à manipuler ou dessiner sur une table de verre ce qui est projeté sur l’écran, dans un dispositif parfaitement brechtien de distanciation : le spectacle dénonce ainsi l’image en train de se faire. Après avoir ainsi occupé et maintenu simultanément le quatrième mur, Frolova le perce de façon fort efficace pour prendre à parti parfois le public, en questionnant frontalement : « qui répondra de tous ces crimes ? », ou, mieux encore, en affirmant que personne parmi ceux qui regardent le spectacle n’aurait eu la force de supporter la pression terrifiante du KGB.
De chaque côté de ce quatrième mur, Tatiana Frolova expose les images quasiment fixes de deux visages, à l’intérieur de deux écrans, qui soulignent la prééminence de la technologie moderne, principale vecteur d’images. Côté cour, celui d’un vieillard (Bernard Noël), côté jardin, celui d’un enfant. Façon de nous rappeler, la prééminence de l’outil de propagande dans la vie personnelle, voire intime, de chacun d’entre nous, de sa naissance à sa mort. Comme Kantor parlait « d’objet pauvre », on aurait envie devant ce que Forlova appelle un « théâtre documentaire » de parler alors d’image pauvre. Car ainsi exposées ces images finissent par acquérir un statut particulier dans la représentation : arrachées à la réalité non plus de la vie, mais du spectacle, elles témoignent, à leur façon, du mal qu'elles font.
Tout comme l’objet dans l’esthétique de Kantor, elles disent le rapport au monde, à la fois pauvre et dérisoire, de chaque personnage ; elle dénoncent aussi le véritable oppresseur, ce processus que Debord nomma la séparation, et qui est ici au cœur même de la mise en scène. Une étrange harmonie s’installe peu à peu entre les trois acteurs et les images d’eux-mêmes, comme si leur parole et leur effort de mémoire ne pouvaient s’extirper pleinement de l’oubli produit par leur représentation simultanée.
Ce questionnement sur l’image trouve par ailleurs sa forme au fur et à mesure qu’on avance dans le spectacle et que se crée sur scène un univers poétique spécifique : les bandes de gaze servant à effacer les traces de feutres rouges, assimilées à des pansements ensanglantés, par exemple. Ou bien les semelles-couche-culottes usitées, et les chapkas enturbannées, dans une leçon pleine d’humour pour survivre emmitouflé dans le grand froid.
Puis il devient pleinement critique, lorsque le spectacle suggère l’idée très significative qu’il y aurait un lien entre la maladie d’Alzheimer et la transformation du temps individuel autrefois vécu en histoire collective désormais établie en images. « Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation », disait Debord. Tatiana Forlova rajoute qu’Alzheimer, pourrait être le fruit de cette séparation. Et c’est alors que son spectacle trouve son véritable centre de gravité et sa pleine originalité,: « La première personne qui est venue voir Alzheimer lui a dit : je me suis perdue moi-même. », nous rappelle-t-elle. C’est pourquoi, dans la logique démente du système qui nous gouverne, soigner l’Alzheimer, ce ne peut être que le propager plus encore, jusqu’à une sorte de macabre solution finale, parodie de retour à la civilisation : dressage des vieux malades comme celui des enfants avec imposition d’une autorité, privation de la liberté, fixation d’habitudes, bref, perpétuation de la même dictature … A cet instant, le théâtre de Forlova marmonne, dans le sens noble du terme que le texte lui-même confère à ce mot, le théâtre de Kantor.
Une citation (lue par l’enfant) du livre de Bernard Noël, Le livre de l’oubli, clôt le spectacle : « Depuis l’invention des medias et leur emploi généralisé, il ne s’agit plus d’orienter l’espace mental, mais de l’occuper et de le vider de tout autre contenu que celui des spectacles qu’on y projette. Rien ne fut jamais aussi efficace pour soumettre les têtes que ce décervelage qui remplace pensée et imagination par le flux des images. L’oubli n’y peut rien, et il est temps de se demander s’il n’est plus lui-même devenu l’instrument de cette privation de sens »
Ce n’est pas le moindre mérite de cet insolite théâtre-documentaire de Tatiana Forlova (ni sa moindre prouesse) que de donner à cette privation de sens une signification à la fois philosophique et esthétique, tout en serrant au plus près l'expérience vécue et racontée des personnages que nous sommes.

Tatiana Frolova - photo Kirill Khanenkov
Я ЕСТЬ -JE SUIS - Cie : Teatr KnaM - Coproduction -Festival Sens Interdits - les Célestins, Théâtre de Lyon , Théâtre de Poche - Genève , Scène nationale André Malraux, Vandoeuvre-lès-Nancy Mise en scène de Tatiana Frolova, avec Elena Bessonova, Dmitry Bocharov, Vladimir Dmitriev, spectacle en russe surtitré Au théâtre des Célestins de Lyon, du 26 octobre au 30 octobre et du 5 au 9 novembre 2013
10:55 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Я ЕСТЬ, je suis, tatiana frolova, théâtre, lyon, célestins, teatr knam, komsomolsk-sur-amour, spectacle, oubli, bernard noël, propagande, staline, russie, poutine, goulag, kantor | 
mercredi, 08 décembre 2010
Kantor et l'abstraction
Drôle de hasard, alors que je vais passer pour la énième fois à des étudiants cet après-midi le film de Benis Bablet, « Le théâtre de Tadeusz Kantor », je découvre que ce dernier est mort il y a pile vingt ans, un 8 décembre 1990, durant les répétitions de Aujourd’hui c’est mon anniversaire.
Du dadaïsme, mais aussi de l’extrême précarité dans laquelle il a commencé, Kantor a pris ce goût pour l’objet pauvre, « incapable de servir, dit-il, bon à jeter aux ordures, débarrassé de sa fonction vitale, nu, désintéressé, artistique, appelant la pitié et l’émotion ».
Mais à présent, Kantor et son théâtre me semblent désormais si loin de nous : en parler devient difficile. Lui-même, lorsqu’il commente son œuvre est souvent répétitif ou confus.
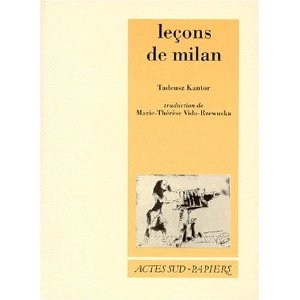
Pour retrouver ce théâtre, le plus difficile est de s’abstraire. S’abstraire de tout ce qui forme le monde aujourd’hui, et des débats dans lesquels nous nous empêtrons. S’abstraire aussi de la scène contemporaine, du spectaculaire et de la technologie qui y règnent. « La professionnalisation théâtrale de plus en plus marquée conduit à sa défaite », disait le maestro dans sa première leçon à Milan. (1)
C’est dans cette leçon qu’il insiste longuement sur cette notion d’abstraction. L’abstraction de Kantor n’est pas l’utopie de la forme pure, jadis prônée par le constructivisme. Elle en est même, dans son souci de révélation du concret le plus théâtral, le contraire absolu : s’il la définit d’abord comme le manque d’objet, l’absence de figure humaine, c’est pour justifier immédiatement la nécessité de leur retour : ainsi n’en finissent pas de revenir à nos mémoires les bancs de la Classe morte ou la roue de char du Retour d’Ulysse, porteurs non plus d’une fonction dans le monde réel mais d’une émotion sur la scène. En ce sens, Kantor a très vite cessé d’être plasticien pour devenir charnellement metteur en scène. « Je voudrais qu’ils regardent et qu’ils pleurent » répète-t-il souvent dans son entretien avec Denis Bablet. Ils, ce sont les spectateurs. Nous.
Quand ce n’est pas un objet, c’est un mouvement, un cercle, une ligne droite, ou la simple répétition d’un geste qui incarnent ce qu’il appelle l’abstraction.
Mais l’abstraction, là encore, n’est abstraite que pour mieux donner corps, voix, mouvement aux personnages. Elle demeure la condition d’existence de leur concret (non spectaculaire) sur la scène.
Il faut pour comprendre cela voir à nouveau et entendre encore cette parade de l’enfance morte dans l' Umarla klasa (la classe morte - suivre le lien sur Youtube). Ces vieillards pathétiques portant sur leurs épaules le poids de leur enfance martyrisée, de leurs illusions bradées, et revenant sur les bancs de l’école pour encore une fois ânonner une leçon qu'ils savent dérisoire, mais qui demeure leur dernier rempart contre la mort, sont restés gravés en moi comme un souvenir de théâtre impérissable.
Placer ainsi au centre de sa démarche l’abstraction, c’est aller évidemment à l’opposé du spectaculaire, lequel privilégie la vitesse, la variété, l’enchaînement. Rien de plus logique, dès lors, que la 12ème leçon de Milan, sous-titrée « avant la fin du XXème siècle » (et qui constitue le testament de Kantor peut-on dire) oppose à la démarche de l’abstraction autant celle de la consommation que celle de la communication.
Cet extrait de la dernière leçon de Milan, daté de 1986 :
« LA CONSOMMATION OMNIPOTENTE
Tout est devenu marchandise. La marchandise est devenue dieu sanguinaire. D'effrayantes quantités de nourriture qui nourriraient le monde entier; et la moitié de l'humanité meurt de faim; des montagnes de livres que nous n'arriverons jamais à lire; les hommes dévorent les hommes, leurs pensées, leurs droits, leurs coutumes, leur solitude et leur personnalité. Des marchés d'esclaves organisés à une formidable échelle. On vend des gens, on achète, on marchande, on corrompt. Création : ce mot cesse d'être un argument sans appel.
Et voici un autre visage de la FUREUR de notre fin de siècle : LA COMMUNICATION OMNIPOTENTE.
On manque de place pour les originaux qui marchent à pied (il paraît qu'un tel moyen de locomotion aide à penser). Des vagues et des fleuves de voiture se déversent dans les appartements. On manque d'air, d'eau, de forêts et de plantes. La quantité d'êtres vivants croît de façon effarante : des hommes .... Continuons : La COMMUNICATION qui s'accorde parfaitement avec les chemins de fer, les tramways, les autobus, a été jugée comme le concept le plus adéquat et le plus salutaire pour l'esprit humain et pour l'Art. Communication omnipotente ! son premier mot d'ordre : la VITESSE, s'est rapidement transformé en un cri de guerre sauvage de peuplades primitives. La devise est devenue ORDRE. Le monde entier, toute l'humanité, toute la pensée de l'homme, tout l'ART doivent exécuter docilement.
Tout devient obligatoirement uniformisé, égalisé et... SANS SIGNIFICATION. »
(1) Editées chez Actes Sud en mai 1990, les douze leçons de Milan, traduites par Marie-Thérèse Vido-Rzewuska ont été composées de juillet à novembre 1986. Tadeusz Kantor.
19:05 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : kantor, théâtre, umarla klasa, la classe morte, littérature | 
lundi, 28 juillet 2008
La parade de l'enfance morte
« Je dois dire ce mot : instruire. S'instruire. Je n'ai pas honte de ce mot. J'ai étudié depuis le début, dès que j'ai décidé de devenir peintre.. Ma création était toujours découverte de faits que je ne connaissais pas. C'était, en quelque sorte, des études. C'était un voyage, découvrant de nouvelles terres; le but s'éloignait toujours, je laissais derrière moi des pays conquis... Les Artistes doivent étudier, découvrir, reconnaitre et laisser derrière eux des régions conquises. »
(Tadeusz Kantor- Leçons de Milan, Actes sud papiers, 1990)
C'est encore Tadeusz Kantor, lui-même, qui définit le mieux son théâtre :
« Œuvre qui n'exhale rien, n'exprime rien, n'agit pas ne communique rien, n'est pas un témoignage ni une reproduction, ne se réfère pas, à la réalité, au spectateur, ni à l'auteur qui est imperméable à la pénétration extérieure, qui oppose son opacité à tout essai d'interprétation, tournée vers NULLE PART, vers INCONNU n'étant que le VIDE, un «TROU» dans la réalité, sans destination, et sans lieu, qui est comme la vie passagère, fugitive, évanescente, impossible à fixer et à retenir, qui quitte le terrain sacré qu'on lui a réservé, sans rechercher des arguments en faveur de son utilité.
Qui EST, tout simplement, qui par le seul fait de son AUTO-EXlSTENCE MET TOUTE RÉALITÉ ENVIRONNANTE DANS UNE SITUATION IRRÉELLE ! (on dirait «artistique»). Quelle fascination extraordinaire dans cette inattendue RÉVERSIBILITÉ ! »
Kantor est né en 1915 à Wielopole, bourgade polonaise, d'un père juif converti au catholicisme. Le nom de Kantor est indissociable de celui de sa troupe de Cracovie Cricot 2, refondée en 1955. Cette troupe et les comédiens qui la composent, sera sa chair, son cri, son argile, ses monstres. En France la découverte de la Classe morte en 1977, inspirée de Bruno Schulz et de Witkiewicz, sera un choc fondateur. Cette cohabitation entre les poupées de cire et les humains vêtus de noir abolit notre orgueil de vivants. Chacun porte sur son dos l'enfant qu'il fut, et qu'il a laissé mourir. Ces êtres, chacun pris dans son obsession (berceau, vélo, pion amorphe, soldat coucou dérisoire,...), pointent le doigt en l'air vers un ciel vide et terrifiant. Un traité des mannequins que d'autres appellent par exagération des hommes se tisse de pièce en pièce : La pieuvre (1956), Cirque (1960), Le petit Manoir (1961), Le fou et la nonne (1963), la poule d'eau, Les mignons et les guenons (1973), La classe morte (1975), Où sont les neiges d'antan (1979), Wielopole-Wielopole (1980), Qu'ils crèvent, les artistes (1985), Je ne reviendrai jamais (1988), Ô douce nuit (1990). Beaucoup sont des mises en scène du grand Witkiewicz.
Kantor a réussi à incorporer dans la totalité de son œuvre, que ce soit la peinture, le dessin ou le théâtre, l'histoire du combat qu'il avait mené au nom de son âme d'artiste et aussi pour gagner le ravissement des spectateurs. L'art du XXème siècle était déchiré entre deux pôles : l'utopie de la forme pure prônée par le constructivisme, une vision rationnelle bien ordonnée, et la tradition littéraire du symbolisme, nostalgie d'un art rempli de significations et d'émotions. L'un des plus grands acquis de Kantor consiste à relier ces deux tendances et à soumettre les symboles et l'émotion à la discipline rigoureuse de la forme. « Je voudrais qu'ils regardent et qu'ils pleurent » - répétait-il - et il parvenait à hypnotiser, d'une manière mystérieuse, les spectateurs. Pendant ses spectacles des gens pleuraient sous toutes les latitudes : au Japon, en Argentine, à Paris. Sans d'ailleurs connaître notre tradition ou notre langue ; sans avoir connu la biographie ou les commentaires de l'auteur, ils se sont livrés à l'émotion jusqu'aux larmes. Ainsi, le petit village perdu quelque part en Galicie - lieu reconstruit avec des bribes de la mémoire et avec des photographies déteintes - est devenu le centre du monde, le portrait troublant du siècle passé : avec sa cruauté et son héroïsme, avec la tragédie de l'Holocauste, avec le drame de l'asservissement. Le siècle de la guerre et de la mort, celui des utopies audacieuses et des révolutions artistiques : tout cela a trouvé une expression exceptionnelle dans l'œuvre de Kantor ; son art est en fait un témoignage personnel et en même temps universel. Et ce n'est qu'aux plus grands artistes que revient ce privilège. (Krystyna Czerni)
Kantor est mort le samedi 8 décembre 1990 à Cracovie, en préparant les répétitions de Aujourd'hui c'est mon anniversaire. La troupe joue quand même. Une chaise vide, une écharpe, le chapeau, Marie encore plus blanche que d'habitude, les jumeaux les yeux rougis. Kantor est là, il regarde. L'économie de la mort est florissante. Dans son testament méticuleux il fait de chaque spectateur-lecteur son légataire universel : « Si la maison s'effondre, les archives doivent rester».
Kantor : un extrait de La Classe Morte, l'entrée en scène de la parade de l'enfance. On ne se lasse pas de la regarder, tant la musique est envoutante, la scénographie obsédante, sous l'unique lampe à suspension.... A son pupitre, le maître d'école et metteur en scène, à deux pas toujours de ses comédiens, comme une matière qu'on ne peut lâcher trop longtemps. Kantor, le visage attentif et lointain, tel celui de James Joyce, l'œil d'aigle, comme taillé dans l'airain. Voilà une belle figure de l'exigence, de la recherche, de la lenteur, de l'Idéal également, aussi saugrenu que celui puisse paraître de prime abord. KANTOR. Voici ce que, dans les Leçons de Milan (1986) il dit, peu de temps avant de mourir, d'abord de la consommation, puis de la communication :
« LA CONSOMMATION OMNIPOTENTE
Tout est devenu marchandise, La marchandise est devenue dieu sanguinaire. D'effrayantes quantités de nourriture qui nourriraient le monde entier; et la moitié de l'humanité meurt de faim; des montagnes de livres que nous n'arriverons jamais à lire; les hommes dévorent les hommes, leurs pensées, leurs droits, leurs coutumes, leur solitude et leur personnalité. Des marchés d'esclaves organisés à une formidable échelle. On vend des gens, on achète, on marchande, on corrompt. Création : ce mot cesse d'être un argument sans appel.
Et voici un autre visage de la FUREUR de notre fin de siècle : LA COMMUNICATION OMNIPOTENTE.
On manque de place pour les originaux qui marchent à pied (il paraît qu'un tel moyen de locomotion aide à penser). Des vagues et des fleuves de voiture se déversent dans les appartements. On manque d'air, d'eau, de forêts et de plantes. La quantité d'êtres vivants croît de façon effarante : des hommes .... Continuons : La COMMUNICATION qui s'accorde parfaitement avec les chemins de fer, les tramways, les autobus, a été jugée comme le concept le plus adéquat et le plus salutaire pour l'esprit humain et pour l'Art. Communication omnipotente ! son premier mot d'ordre : la VITESSE, s'est rapidement transformé en un cri de guerre sauvage de peuplades primitives. La devise est devenue ORDRE. Le monde entier, toute l'humanité, toute la pensée de l'homme, tout l'ART doivent exécuter docilement.
Tout devient obligatoirement uniformisé, égalisé et... SANS SIGNIFICATION. »
Pour suivre, sur Kantor :
http://solko.hautetfort.com/archive/2008/04/26/kantor-et-mallarme.html
12:37 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : théâtre, kantor, la classe morte, littérature, cricot2 | 
mercredi, 09 juillet 2008
Tadeusz Kantor
« Je dois dire ce mot : instruire. S'instruire. Je n'ai pas honte de ce mot. J'ai étudié depuis le début, dès que j'ai décidé de devenir peintre.. Ma création était toujours découverte de faits que je ne connaissais pas. C'était, en quelque sorte, des études. C'était un voyage, découvrant de nouvelles terres; le but s'éloignait toujours, je laissais derrière moi des pays conquis... Les Artistes doivent étudier, découvrir, reconnaitre et laisser derrière eux des régions conquises. »
(Tadeusz Kantor- Leçons de Milan, Actes sud papiers, 1990)
C'est encore Tadeusz Kantor, lui-même, qui définit le mieux son théâtre :
« Œuvre qui n'exhale rien, n'exprime rien, n'agit pas ne communique rien, n'est pas un témoignage ni une reproduction, ne se réfère pas, à la réalité, au spectateur, ni à l'auteur qui est imperméable à la pénétration extérieure, qui oppose son opacité à tout essai d'interprétation, tournée vers NULLE PART, vers INCONNU n'étant que le VIDE, un «TROU» dans la réalité, sans destination, et sans lieu, qui est comme la vie passagère, fugitive, évanescente, impossible à fixer et à retenir, qui quitte le terrain sacré qu'on lui a réservé, sans rechercher des arguments en faveur de son utilité.
Qui EST, tout simplement, qui par le seul fait de son AUTO-EXlSTENCE MET TOUTE RÉALITÉ ENVIRONNANTE DANS UNE SITUATION IRRÉELLE ! (on dirait «artistique»). Quelle fascination extraordinaire dans cette inattendue RÉVERSIBILITÉ ! »
Kantor est né en 1915 à Wielopole, bourgade polonaise, d'un père juif converti au catholicisme. Le nom de Kantor est indissociable de celui de sa troupe de Cracovie Cricot 2, refondée en 1955. Cette troupe et les comédiens qui la composent, sera sa chair, son cri, son argile, ses monstres. En France la découverte de la Classe morte en 1977, inspirée de Bruno Schulz et de Witkiewicz, sera un choc fondateur. Cette cohabitation entre les poupées de cire et les humains vêtus de noir abolit notre orgueil de vivants. Chacun porte sur son dos l'enfant qu'il fut, et qu'il a laissé mourir. Ces êtres, chacun pris dans son obsession (berceau, vélo, pion amorphe, soldat coucou dérisoire,...), pointent le doigt en l'air vers un ciel vide et terrifiant. Un traité des mannequins que d'autres appellent par exagération des hommes se tisse de pièce en pièce : La pieuvre (1956), Cirque (1960), Le petit Manoir (1961), Le fou et la nonne (1963), la poule d'eau, Les mignons et les guenons (1973), La classe morte (1975), Où sont les neiges d'antan (1979), Wielopole-Wielopole (1980), Qu'ils crèvent, les artistes (1985), Je ne reviendrai jamais (1988), Ô douce nuit (1990). Beaucoup sont des mises en scène du grand Witkiewicz.
Kantor a réussi à incorporer dans la totalité de son œuvre, que ce soit la peinture, le dessin ou le théâtre, l'histoire du combat qu'il avait mené au nom de son âme d'artiste et aussi pour gagner le ravissement des spectateurs. L'art du XXème siècle était déchiré entre deux pôles : l'utopie de la forme pure prônée par le constructivisme, une vision rationnelle bien ordonnée, et la tradition littéraire du symbolisme, nostalgie d'un art rempli de significations et d'émotions. L'un des plus grands acquis de Kantor consiste à relier ces deux tendances et à soumettre les symboles et l'émotion à la discipline rigoureuse de la forme. « Je voudrais qu'ils regardent et qu'ils pleurent » - répétait-il - et il parvenait à hypnotiser, d'une manière mystérieuse, les spectateurs. Pendant ses spectacles des gens pleuraient sous toutes les latitudes : au Japon, en Argentine, à Paris. Sans d'ailleurs connaître notre tradition ou notre langue ; sans avoir connu la biographie ou les commentaires de l'auteur, ils se sont livrés à l'émotion jusqu'aux larmes. Ainsi, le petit village perdu quelque part en Galicie - lieu reconstruit avec des bribes de la mémoire et avec des photographies déteintes - est devenu le centre du monde, le portrait troublant du siècle passé : avec sa cruauté et son héroïsme, avec la tragédie de l'Holocauste, avec le drame de l'asservissement. Le siècle de la guerre et de la mort, celui des utopies audacieuses et des révolutions artistiques : tout cela a trouvé une expression exceptionnelle dans l'œuvre de Kantor ; son art est en fait un témoignage personnel et en même temps universel. Et ce n'est qu'aux plus grands artistes que revient ce privilège. (Krystyna Czerni)
Kantor est mort le samedi 8 décembre 1990 à Cracovie, en préparant les répétitions de Aujourd'hui c'est mon anniversaire. La troupe joue quand même. Une chaise vide, une écharpe, le chapeau, Marie encore plus blanche que d'habitude, les jumeaux les yeux rougis. Kantor est là, il regarde. L'économie de la mort est florissante. Dans son testament méticuleux il fait de chaque spectateur-lecteur son légataire universel : « Si la maison s'effondre, les archives doivent rester».
Kantor : un extrait de La Classe Morte, l'entrée en scène de la parade de l'enfance. On ne se lasse pas de la regarder, tant la musique est envoutante, la scénographie obsédante, sous l'unique lampe à suspension.... A son pupitre, le maître d'école et metteur en scène, à deux pas toujours de ses comédiens, comme une matière qu'on ne peut lâcher trop longtemps. Kantor, le visage attentif et lointain, tel celui de James Joyce, l'œil d'aigle, comme taillé dans l'airain. Voilà une belle figure de l'exigence, de la recherche, de la lenteur, de l'Idéal également, aussi saugrenu que celui puisse paraître de prime abord. KANTOR. Voici ce que, dans les Leçons de Milan (1986) il dit, peu de temps avant de mourir, d'abord de la consommation, puis de la communication :
« LA CONSOMMATION OMNIPOTENTE
Tout est devenu marchandise, La marchandise est devenue dieu sanguinaire. D'effrayantes quantités de nourriture qui nourriraient le monde entier; et la moitié de l'humanité meurt de faim; des montagnes de livres que nous n'arriverons jamais à lire; les hommes dévorent les hommes, leurs pensées, leurs droits, leurs coutumes, leur solitude et leur personnalité. Des marchés d'esclaves organisés à une formidable échelle. On vend des gens, on achète, on marchande, on corrompt. Création : ce mot cesse d'être un argument sans appel.
Et voici un autre visage de la FUREUR de notre fin de siècle : LA COMMUNICATION OMNIPOTENTE.
On manque de place pour les originaux qui marchent à pied (il paraît qu'un tel moyen de locomotion aide à penser). Des vagues et des fleuves de voiture se déversent dans les appartements. On manque d'air, d'eau, de forêts et de plantes. La quantité d'êtres vivants croît de façon effarante : des hommes .... Continuons : La COMMUNICATION qui s'accorde parfaitement avec les chemins de fer, les tramways, les autobus, a été jugée comme le concept le plus adéquat et le plus salutaire pour l'esprit humain et pour l'Art. Communication omnipotente ! son premier mot d'ordre : la VITESSE, s'est rapidement transformé en un cri de guerre sauvage de peuplades primitives. La devise est devenue ORDRE. Le monde entier, toute l'humanité, toute la pensée de l'homme, tout l'ART doivent exécuter docilement.
Tout devient obligatoirement uniformisé, égalisé et... SANS SIGNIFICATION. »
Pour suivre, sur Kantor :
http://solko.hautetfort.com/archive/2008/04/26/kantor-et-mallarme.html
08:10 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : théâtre, littérature, kantor, art, écriture | 
samedi, 26 avril 2008
Kantor et Mallarmé
Du 25 Juin au 25 juillet 1986, Tadeusz Kantor a dirigé un séminaire à l’Ecole d’Art Dramatique de Milan. Chanceux furent les douze élèves qui y participèrent. Chanceux, ô combien ! « Les Artistes doivent étudier, découvrir, reconnaître et laisser derrière eux les régions conquises. » Le texte de ces 12 leçons, dites « de Milan » existe, on le trouve dans la collection Papiers d’Acte Sud.: « Votre étude ne sera pas scolaire, elle doit être créative », dit-il en apéritif aux douze chanceux présents ces jours-là. Un artiste assène Kantor, « n’est pas un professionnel comme un autre ». Pire : «la professionnalisation théâtrale de plus en plus marquée conduit à sa défaite (il parle alors du théâtre en général). » Pour lui, rien n’est pire que cette assurance froide, lucide et somme toute irréprochable du technicien qui en effet est devenu maître de son art. Cette mise en garde contre l’acteur professionnel rappelle un peu le dégoût qu’exprimait au début de l’autre siècle Anatole France dans une bonne vieille phrase de spectateur, à propos du Guignol de la rue Vivienne et de ses comparses en bois et en tissu : « Je leur sais un gré infini de remplacer les acteurs vivants. Les acteurs vivants me gâtent la comédie. J’entends les bons acteurs. » Cela rappelle aussi cette boutade de Gordon Craig, au début du siècle : «Il faudrait que tous les acteurs meurent de la peste. »
Kantor fit en effet disparaître les acteurs, au sens traditionnel du terme. L’abstraction qu’il évoque sans cesse dans les Leçons de Milan, et qui est le contraire de l’incarnation, au sens où on dit «qu’un acteur a bien joué son rôle », cette abstraction n’est pas si éloignée de celle à laquelle revient sans cesse Mallarmé dans sa Crise de vers « Je dis : une fleur ! », proclamait ce dernier « et musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tous bouquets » Et en effet, comme Mallarmé abolit la performance ordinaire du mot pour le montrer à la tribu sous un jour qui rende un sens plus pur, un jour essentiel, disait le maître des mardis, le maître de Milan abolit la performance ordinaire de l’acteur afin de montrer par cette abolition les contours grotesques et pathétiques de l’être humain, dans une abstraction presque sacrée. Car ce n’est bien, en définitive, que lui, l’être humain, qui l’intéresse, l’être humain, cet objet pauvre dont Tadeusz Kantor se fit, sa vie durant, le montreur, - au sens où il y eut un temps, dans les villages de Pologne, de nulle part, d'ici et d’ailleurs, des montreurs d’ours. L’abstraction dont il parle, ce n’est jamais que cela, le corps de l’acteur ou bien la silhouette de l’objet retirés du circuit de la consommation, exposés comme le fut le ready made de Duchamp, exhibés, mais jamais représentés, tout comme le mot de Mallarmé, retiré de la conversation, et comme pris dans le gel, « le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui… », acteurs, objets, mots, signes visibles, palpables jamais absolument ou définitivement compris…
01:05 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, littérature, kantor, mallarmé, leçons de milan | 









