mercredi, 20 février 2008
Le foot, c'est que du bonheur...
« Fuyez le lieu commun… » : tel était le conseil de James Joyce aux jeunes écrivains. « Dès que vous entendez quelqu'un en proférer un auprès de vous, fuyez ». Facile à dire ! Mais fuir où et par où ? Et où aller ? En quel lieu de la Terre, Seigneur, en quel lieu de l'esprit ? Léon Bloy n'essaya pas de fuir ceux de son temps, lui. Au contraire, il les regardait bien en face, yeux dans les yeux, et en dressa une exégèse méticuleuse qui parut en deux tomes. Petite pioche dans l'index : Dieu n'en demande pas tant ; les affaires sont les affaires ; les enfants ne demandent pas à venir au monde ; tout le monde ne peut pas être riche ; bien faire et laisser dire ; être poète à ses heures …
Les locutions patrimoniales de la Belle Epoque étaient des formules bourgeoises, dixit Bloy dans sa préface.
A l'époque, ces formules circulaient de bouches en bouches ; de boutiques en boutiques et de paillassons en paillassons. On ramassait les premiers à l'école. On en trouvait aussi dans les colonnes des journaux, certes. Et dans les pages des meilleurs romanciers sans doute aussi. Cependant, la vitesse de propagation du virus demeurait sans doute raisonnable. Aujourd'hui, le lieu commun est d'origine essentiellement médiatique. En bonne place, on trouve évidemment les lieux communs politiques, et nous connaissons tous certains candidats de second tour qui eurent récemment l'art et la manière d'en gaver les Français pour une saison. Les lieux communs journalistiques. Les lieux communs du show-business, et ceux du monde économique. Les lieux communs cinématographiques. Ecrans, véhicules commodes. Ne pas se laisser contaminer par eux, depuis que la libre expression de tout un chacun et l'égalitarisme souverain les ont faits se répandre avec une même audace dans tant de bouches, c'est une entreprise quasiment aussi impossible que de respirer de l'air pur dans une métropole un jour de pic de pollution.
Tiens, ce soir, Lyon-Manchester, Ligue des champions à Gerland. A la limite, on s'en fout de qui va gagner, parce que de toute façon, depuis déjà une bonne dizaine d'années, non ? … « Le foot, c'est que du bonheur! »
Le foot, c’est que du bonheur ; Remarquez comment on a ôté le « ne » et gardé le « que », histoire de donner un air positif à ce qui reste en grammaire, même restrictive, une négative. La phrase a du coup l'air positif qui convient à l'époque (le foot c'est du bonheur). Pourtant ce n'est pas que ça, mais cela il ne faut pas le dire. Chacun sait que c'est aussi des magouilles, par exemple. Allez voir Courbis il en sait quelque chose. Et puis du fric - oh beaucoup de fric ! - Mais dans le stade, comme dans l'église, non, ça ne se dit pas. On dira donc que c'est le jeu, rien que lui qui (n)'est que du bonheur.
Du coup des tas de petits gamins essayent de trouver le bonheur en tapant le plus jeune possible dans le ballon. Taper dans le ballon le plus jeune possible, c'est un peu comme sucer le micro dès son plus jeune âge, ça laisse quelques espoirs à des parents de s'assurer une retraite paisible. J'ai écrit une connerie ? Oui. Parce que l'argent, bien sûr, ça ne fait pas le bonheur. L'exploit sportif, si. Le foot, c'est que du bonheur...
19:00 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : football, lieu commun, léon bloy, solko | 
samedi, 16 février 2008
Reporters des années trente
« Trop souvent, j’ai écrit trop vite, pour de l’argent » regrettera Joseph Kessel (1) lorsque, couvert d’honneurs, il sera en 1963 élu à l’Académie Française. Singulier aveu, qui rejoint le regret constant d’Albert Londres de n’avoir pu trouver, entre deux reportages, le temps d’écrire autre chose … que des reportages. Un roman, déclare-t-il publiquement ? « Cela suppose qu’on s’arrête un moment, et j’ai bien peur de ne m’arrêter jamais ». (2) Dans une France où la presse demeure le seul accès à l’information, où le champ de la curiosité populaire augmente incessamment, les opportunités fourmillent pour qui a du talent, des idées, du culot. Sur le monde des Lettres, règnent les lois de la vitesse, de l'opportunisme, de l’argent. « La guerre avait appris à lire aux Français … Cet accroissement imprévu du nombre des acheteurs de livres explique les rapports nouveaux qui s’établirent entre auteurs, éditeurs et librairies. » raconte Galtier Boissière.(3)
Dans les colonnes de quotidiens dont les tirages impressionnent aujourd’hui (Le Petit Parisien, par exemple, tire à deux millions d’exemplaires), « une plume qui marche » est un produit providentiel, que s’arrachent les directeurs. La parole devient une forme de marchandise. Le phénomène n'est certes pas nouveau : Henri Béraud cependant, le constate avec ironie (4) :
« Lousteau vivait d’écrire un article par semaine. Tant de facilité émerveillait et effrayait Barbey d’Aurevilly. Un article par jour ne suffit plus à nourrir son auteur. Il lui faut, à présent, se colleter avec l’idée qui s’échappe ; il doit saisir à la gorge sa propre pensée. Il se règle lui-même comme un luminoir à écrits. Il s’use. Il jette au vent le meilleur de lui-même. »
Joseph Kessel, Albert Londres, Henri Béraud : trois reporters de l'entre deux-guerres, dont les destins divergents prennent chacun racine sur ce même Vieux Continent, celui d'après le Traité de Versailles et d'avant le Rideau de Fer. Une terre véritablement engloutie, à présent. Continent sillonné par des express aux couleurs rouges et bleues, aux couloirs déserts et tapissés sous les lampes en veilleuses par les portes de sleepings aux judas bien clos. Europe à multiples langues et multiples monnaies. De l'Arc de Triomphe à la porte de Brandebourg, c’est alors l’affaire d’une petite journée pour un train hennissant sur ses rails. Albert Londres n'est jamais revenu de son voyage en Chine en 1932. Henri Béraud est mort tristement, après son long et scandaleux emprisonnement au bagne de l'île de Ré, en 1958. Kessel, quant à lui, s'est éteint progressivement en 1979, au coin de son feu et les pieds dans ses pantoufles. Quant à cette Europe, leur Europe, elle a donné naissance au mythe du petit reporter dont le trop lisse Tintin demeure de nos jours une sorte d'icone hygiénique.
1 Yves Courrière, Joseph Kessel ou sur la piste du lion
2 Interview à Gringoire du 19 juillet 1929, cité par Pierre Assouline dans la biographie que ce dernier consacre à Albert Londres.
3.Jean Galtier Boissière Mémoires d'un Parisien
4. Henri Béraud Le Flaneur Salarié
08:30 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, journalisme, galtier boissière, béraud, reportages, albert londres | 
vendredi, 15 février 2008
Terrasse technologique
Dansait-il sur une terrasse
Large et dominant la cité technologique
Lui qui, le dernier, embrassa la cathédrale ?
On ne saurait le dire parmi les réseaux
Où galope un reflet d'étincelles
Mais dans les tissus de nos tissus
Et dans les gènes de nos gènes
Nous sentons bien qu'électriques
Le spectre de son baptême
Et le frisson de son argot
Encore villonnement vivants
Sillonnent jusqu'à l'épuisement
Les lignes de nos testaments

08:25 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : poésie, poèmes, villon, solko, cathédrale | 
jeudi, 14 février 2008
Mais où sont les polémistes d'antan
 Le 9 novembre 1944, Georges Bernanos rédige un article, « La France dans le monde de demain », que je relisais ce matin. (1) Et tandis que le bus tournait dans les rues sombres de la ville où ne se distinguait vraiment que le rond des lampadaires dans une brume sale et de pollution, je me disais que les polémistes de naguère croyaient encore à la possibilité de bousculer la société par le moyen d'un livre. (« J'ai la conviction de parler au nom d'un grand nombre de Français » écrit Bernanos). De quelque bord qu'ils fussent, ils croyaient à leur cause. (« O vous qui me lisez, commencez par le commencement, commencez par ne pas désespérer de la Liberté ») Tels les anciens soldats, ils allaient, armés de figures, de lyrisme et de naïveté dans le sillon de leurs lignes. S'ils n'étaient pas tous prets à « mourir pour des idées », du moins croyaient-ils que la parole avait encore le pouvoir d'alerter les hommes, qu'il suffisait pour cela de mettre le paquet, voire d'en rajouter une louche. Extrait de cet article de Bernanos, contre la « civilisation des machines » à laquelle il oppose ce qui reste de la civilisation des Droits de l'Homme :
Le 9 novembre 1944, Georges Bernanos rédige un article, « La France dans le monde de demain », que je relisais ce matin. (1) Et tandis que le bus tournait dans les rues sombres de la ville où ne se distinguait vraiment que le rond des lampadaires dans une brume sale et de pollution, je me disais que les polémistes de naguère croyaient encore à la possibilité de bousculer la société par le moyen d'un livre. (« J'ai la conviction de parler au nom d'un grand nombre de Français » écrit Bernanos). De quelque bord qu'ils fussent, ils croyaient à leur cause. (« O vous qui me lisez, commencez par le commencement, commencez par ne pas désespérer de la Liberté ») Tels les anciens soldats, ils allaient, armés de figures, de lyrisme et de naïveté dans le sillon de leurs lignes. S'ils n'étaient pas tous prets à « mourir pour des idées », du moins croyaient-ils que la parole avait encore le pouvoir d'alerter les hommes, qu'il suffisait pour cela de mettre le paquet, voire d'en rajouter une louche. Extrait de cet article de Bernanos, contre la « civilisation des machines » à laquelle il oppose ce qui reste de la civilisation des Droits de l'Homme :
« L'énorme mécanisme de la Société moderne en impose à vos imaginations, à vos nerfs, comme si son développement inexorable devait tôt ou tard vous contraindre à livrer ce que vous ne lui donnerez pas de plein gré. Le danger n'est pas dans les machines, sinon nous devrions faire ce rêve absurde de les détruire par la force, à la manière des iconoclastes qui, en brisant les images, se flattaient d'anéantir aussi les croyances. Le danger n'est pas dans la multiplication des machines, mais dans le nombre sans cesse croissant d'hommes habitués, dès leur enfance, à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. Le danger n'est pas que les machines fassent de vous des esclaves, mais qu'on restreigne indéfiniment votre Liberté au nom des machines, de l'entretien, du fonctionnement, du perfectionnement de l'Universelle Machinerie. Le danger n'est pas que vous finissiez par adorer les machines, mais que vous suiviez aveuglément la Collectivité - dictateur, Etat ou Parti - qui possède les machines, vous donne ou vous refuse la production des machines. Non, le danger n'est pas dans les machines, car il n'y a d'autre danger pour l'homme que l'homme même. Le danger est dans l'homme que cette civilisation s'efforce en ce moment de former ».
Où en sommes-nous, soixante quatre ans plus tard ? A lire le bouquin d'Olliver Dyens, La condition inhumaine, qui se veut une réflexion critique sur ce même sujet, nous serions en plein marasme. Nous serions devenus, au centre des machines qui nous font naître, nous surveillent, nous guérissent, nous alimentent, nous instruisent, construisent nos villes et nos maisons, « une machine qui palpite »... La polémique s'arrête sur cette belle vue de l'esprit. En comparant l'écriture de Bernanos et celle de Dyens. on voit à quel point la technique (contre laquelle pestait Bernanos) a intégré, via la promotion de la linguistique et celle des sciences humaines, l'espace de la littérature comme celui de l'édition. Si bien que, ô vaste ironie, ô vaste fumisterie, même la pensée critique- même la polémique-, est devenue une technique. Je ne suis pas en train de dire que les polémistes du passé écrivaient sans technique : ils maîtrisaient évidemment toutes les règles de l'éloquence. Mais ils ne se laissaient pas, du moins les meilleurs d'entre eux, maîtriser par elle. Leur démonstration donnait encore à entendre la voix de leur passion, celle de leur désir, celle de leur colère. La sincérité de Bloy, malgré -et même contre le langage-, est, par exemple, évidente. Celle de Bernanos ne l'est pas moins. Si je trouve, dans l'édition contemporaine, si peu de polémistes dignes de ce nom, n'est-ce donc pas à cause « de cet homme habitué dès son enfance à ne désirer que ce que les machines peuvent donner », cet homme que cette civilisation s'est efforcé, depuis une cinquantaine, d'années de former ?
(1)Il se trouve en annexe dans l'édition de poche de La France contre les robots.
11:35 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : polémistes, polémique, bernanos, bloy, littérature | 
mardi, 12 février 2008
Saturation d'écrits
L'écrit se perd. C'est un constat effectué par tous ceux dont le métier est de se pencher sur des copies. Et pourtant, direz-vous, la société dans laquelle nous vivons est saturée de toute sorte d'écrits. Ecrits lapidaires, approximatifs, fautifs autant que multiples et bariolés. Ecrits identitaires ou communautaristes, brandis sur des écrans ou du papier, comme le sont de simples images. Ecrits pub, écrits slogan, écrits gros-titres... Partout, des écrits ; des écrits, cependant, que plus personne de visible ni d'incarné ne produit jamais sous nos yeux. Je me souviens, il y a déjà une bonne dizaine d'années de cela, m'être fait arracher un chèque des mains par la caissière d'une pizzeria qui - au demeurant - n'était pas des meilleures : "ne le remplissez pas, la machine s'en chargera...." Impression bizarre d'avoir presque pissé contre l'autel ou enfreint le protocole de je ne sais quelle cérémonie de fourmis. Etait-il désormais obscène d'écrire en public ? Et la machine s'est chargée d'écrire, en effet, le montant du chèque à ma place. Rien que du banal.
Rien que du banal que les enfants voient sans cesse se produire autour d'eux. Qui écrit encore, de façon réelle et régulière, de vrais textes dignes d'intérêt dans sa vie quotidienne ? Dans la saturation d'écrits qui nous environne, nous perdons collectivement l'écriture. Il n'y a bien que les collégiens, les lycéens et les étudiants auxquels d'indélicats conservateurs demandent encore de produire du texte écrit, et encore, pas toujours de façon manuscrite. Les résultats, maintes fois décrits autant que décriés, sont des résultats le plus souvent catastrophiques. Et le mouvement est irréversible. Car nous avons quitté la civilisation de l'écrit : l'écrit avait besoin d'espace, de temps, de nature, d'individus libres, autonomes, conscients, cultivés et singuliers. L'espace se restreint, le temps coagule, la nature se transforme, la culture se massifie, que dire des individus libres, autonomes, conscients, singuliers ? L'écrit ne pouvait se maintenir que dans un monde nuancé - où sont les nuances, dans la civilisation techno-médiatique de masses dans laquelle nous sommes entrés. Notre perception du monde est à la fois trop lourde et trop rapide pour l'écrit. Bien sûr, demeurent les irréductibles dont je fais partie - pour combien de temps, ou plutôt pour combien de générations ? Maîtriser correctement la langue écrite est encore perçu par beaucoup d'hommes et de femmes comme un acte encore nécessaire, certes. Mais nécessaire à sa survie, pas à sa vie. Un acte certes encore nécessaire, mais, déjà, un acte qui n'est plus du tout fondamental. Or un acte qui n'est plus perçu comme fondamental, dans quelque civilisation que ce soit, est condamné, à plus ou moins long terme, à disparaitre : « a quoi ça sert? » s'interrogent en effet en chœur les plus nombreux, qui sont toujours ceux que Bernanos appelait les imbéciles." Ainsi s'effaça de la mémoire du peuple l'habitude de croire et de prier, lorsque le système imposé à tous l'exigea de chacun. Car je suis convaincu que, de la même façon qu'on m'ôta le chèque à remplir des mains, on retira le livre de prières de celles de mes ancêtres. Avec de semblables arguments. Ainsi va la civilisation. Tant qu'à la fin elle se brise.
16:50 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : écriture, littérature, langue française, bernanos | 
lundi, 11 février 2008
La démocratie du spectacle
NON ! Quelle manchette ! Le soir du 29 mai, malgré la hauteur du résultat, il n'y eut pourtant pas particulièrement de liesse populaire dans les rues. On s'attardait un peu devant les écrans (PPDA, Chabot, Pujadas, la même clique, toujours...). Et puis, le peuple qui s'était prononcé alla se coucher.
« Vive l'Europe, vive la France »... Hier, un président français, pour la première fois dans l'Histoire du pays, conclut ainsi l'une de ses interventions. Teint terreux, coupe de sergent-chef, le ton parfaitement faux-cul et l'œil libidineux de l'avocat véreux touchant ses honoraires: Vive l'Europe ? Un Persan de Montesquieu qui observerait les convulsions médiatiques de ce pays y perdrait son latin. Quoi ? Ce pays qui a dit Non à l'Europe libérale, publiquement désavoué trois ans plus tard par son propre "dirigeant" ? Quel funeste désaveu ! Dans la formule conclusive de ce pseudo-président, où donc, au fait, est passée la République ? Ainsi va la démocratie du spectacle, le « show politique », lequel « must go on »... Est-ce une nouveauté ? Rouvrons donc les Mémoires d'Outre-Tombe", Troisième Partie, XII, 8. Chateaubriand décrit l'indifférence avec laquelle le peuple accueille la nouvelle du départ de Charles X pour Prague, peu après les Trois Glorieuses de 1830 :
« Dans ce pays fatigué, les plus grands événements ne sont plus que des drames joués pour notre divertissement : ils occupent le spectateur tant que la toile est levée et, lorsque le rideau tombe, ils ne laissent qu'un vain souvenir ».
Sauf que, dirons les plus inquiets d'entre nous, ce n'est pas un roi qui s'en va tristement en exil cette fois-ci, mais une certaine légitimité de la souveraineté populaire.
Sarkozy a beau jeu de se targuer de ses 53 %, plus récents que les 54,67 du référendum (un résultat en chasse l'autre), pour affirmer cyniquement qu'il « fait ce pour quoi il a été élu ». Ceux qui ont voté pour lui, et dont la préoccupation première n'est, certes pas l'application du Traité de Lisbonne, apprécieront. Dans les coulisses, le PS, qui s'y croit déjà, fait mine de s'abstenir et applaudit. Cette démocratie spectaculaire, en sa majorité comme en son opposition, n'est même plus écœurante. Elle est mortifère. Elle porte les traces de la mort, de sa propre mort et de la mort de tous ceux qui se livrent à ses icones. Car un feuilleton politique, bien vite, en chasse un autre. Une série supplante une série. Au nom de la politique de l'audimat dont elle use et abuse, la série Sarkozy touche à ses limites. Une autre suivra sans doute. A quand, le grand réveil du politique ?
08:40 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : europe, sarkozy, chateaubriand, montesquieu | 
mardi, 05 février 2008
La disparition
Que dire de ces livres plats, sans relief, sans profondeur, dont la société du spectacle nous inonde ? Quel intérêt y avait-il, déjà, à lire un ouvrage consacré à la pauvre existence de Rachida Dati ? A celle, non moins exaltante, de Cécilia Sarkozy ? Et quel nouvel intérêt y aurait-il à se pencher sur l'un de ceux qui racontent la vie de Carla Bruni ?
Je remarque au passage que le e muet, qui laisse de façon si douce en suspens à l'oreille une consonne, ou bien qui lui permet de s'essoufler lentement dans un bruissement vaporeux, le e muet est bizarrement (ou tragiquement) absent du nom des femmes du président. Le n om et le prénom de chacune de ces dames qui ne donnent pas dans la nuance, au contraire, ne possèdent qu'une voyelle claironnante et sonnant sec en finale. Comme, entre parenthèses, celui de leur mentor Nicolas Sarkozy qui ignore aussi abruptement qu'un claquement de porte la tendre suggestion et la fine délicatesse du e muet si caractéristique de la langue de Bossuet (qu'il écorche d'ailleurs tant qu'il le peut). De la plus fermée (A, noir) à la plus ouverte (I rouge, disait Arthur.), les voyelles des femmes du président et du président lui-même sont donc sans mystère, sans ambiguïté, sans profondeur. Starlettes, tout au plus. De là à dire que celles et celui qui les portent sont, de même ....
om et le prénom de chacune de ces dames qui ne donnent pas dans la nuance, au contraire, ne possèdent qu'une voyelle claironnante et sonnant sec en finale. Comme, entre parenthèses, celui de leur mentor Nicolas Sarkozy qui ignore aussi abruptement qu'un claquement de porte la tendre suggestion et la fine délicatesse du e muet si caractéristique de la langue de Bossuet (qu'il écorche d'ailleurs tant qu'il le peut). De la plus fermée (A, noir) à la plus ouverte (I rouge, disait Arthur.), les voyelles des femmes du président et du président lui-même sont donc sans mystère, sans ambiguïté, sans profondeur. Starlettes, tout au plus. De là à dire que celles et celui qui les portent sont, de même ....
Cette disparition ferait en tout cas une bonne intrigue pour un Pérec post-moderne qui aurait du temps à perdre à broder sur la vie de tous ces êtres insipides dont le destin n'est que de passer de rayons en rayons, tout en empochant un maximum de blé. Signes éphémères, pauvres livres de vent... "L'Art s'intéresse à l'objet pauvre, disait Tadeusz Kantor, pour le faire passer de la poubelle à l'Eternité." Belle formule inspirée du dadaïsme et du ready-made, façon Duchamp. Et pour de vrai, ni le banc de la Classe Morte, ni la roue du char du Retour d'Ulysse, ni le pistolet de Marcel Duchamp ne sont entièrement passés à la poubelle. Qui aurait, pourtant, la folie de vouloir sauver de la consommation frénétique dont ils sont les repoussants emblèmes tous ces haïs, icones si vertigineusement et si tragiquement vides et indignes du moindre e muet ?
17:30 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : politique, littérature, société, voyelles | 
lundi, 04 février 2008
Un monde en toc
Assiégé par des rebelles, un palais présidentiel tremble. Dans un autre, un avocat véreux épouse une courtisane liposucée. Seul sur un banc, un homme lit la philosophie d'un Grec ancien, qu'on vient de lui fourguer avec le journal du soir. Au magasin bio du coin, une cliente antipathique se fait tirer son sac par un malfrat malin. Le lendemain, un club breton de CFA 2 sort d'une compétition footballistique pourrie un club pro. Quelques jours auparavant, le conseil d'administration d'une banque avait reconduit son PDG qui venait pourtant de laisser partir en fumée rien moins que 7 milliards d'euros. Ce qu'on retient des primaires aux Etats-unis, c'est que pour être noir, il faut quand même être né d'une mère blanche afin de partir à l'assaut de la Maison du même adjectif. Tout ça ne nous dit pas l'heure, assurément. Mais quand même.
On ne peut imaginer à ce jour le nombre de mères de famille âgées de la cinquantaine qui rêvent de voir leur progéniture, mâle ou femelle, s'imposer enfin à un jeu de téléréalité. Compensation narcissique ? Economique ? 78 millions d'euros, c'est le budget d'un film érigé à la gloire de la connerie française et diffusé dans le monde entier. Un traité rejeté par référendum est ratifié en catimini par des députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles. Tous plus ou moins maqués dans une loge ou dans une autre. Cela ne sera que le énième calamiteux traité de Versailles. Celui-ci, nous dit-on, n'est qu'un mini. Comme les fourmis. Pendant ce temps, des millions de consommateurs de démocratie participative s'activent à préparer les élections municipales à venir, comme si ça devait changer quelque chose à leur morne existence. Dame, vous disent-ils, un maire, c'est un élu de proximité avec lequel on peut causer. Soit.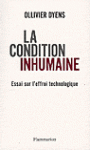 Mais tout ça ne nous dit toujours pas l'heure.
Mais tout ça ne nous dit toujours pas l'heure.
A quoi bon, me direz-vous l'heure, l'heure ? « Nous disparaissons ». Tels sont les premiers mots d'un essai qui vient de paraître chez Flammarion (voir ci-contre). Analyse brillante, par son auteur canadien Ollivier DYENS, de la relation qui s'est tissée entre chacun d'entre nous et ceux que Georges Bernanos appelait déjà, en 1944, "les robots". Analyse brillante mais in fine décevante car finalement impuissante. Cet auteur, comme beaucoup de verbeux officiels, ne sort du rang que pour mieux aller y occuper une place un peu plus en tête au box-office des centres de distribution d'objets culturels. Le tout guidé par "l'effroi technologique" qui n'a pas l'air de le terroriser tant que ça, ni intellectuellement, ni moralement, ni spirituellement : car s'il n'y a rien à faire, véritablement, qu'être cette "machine qui palpite", alors pourquoi avoir écrit ce livre ? Et où sont passés les polémistes d'antan ? Techniciens, le seraient-ils devenus jusqu'aux confins de leurs lacunes? A ce rythme-là, le monde en toc ira, par nos soins, proliférant, en effet... Et qu'importe l'adjectif qu'un petit malin ira plaquer sur le mot condition. Cette prolifération, quand chacun d'entre nous et tout ce que nous consommons en fait partie, n'est plus même une condition. A quel point Beckett avait, non pas vu ( Qui voit ? Où sont les voyants, où sont les visionnaires ? ), mais subi - et décrit - juste ! Sous le ciel gris d'un monde en toc, pour se faire un chapeau de paille, toute l'actualité du monde, et tous les essais qu'on peut écrire à son sujet, ne suffit plus.
14:06 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : société, actualité, culture, politique, critique, littérature, beckett | 
samedi, 02 février 2008
chandeleur
Aujourd'hui, Chandeleur, jour de la Purification de la Vierge, rappelle la Légende Dorée de Jacques de Voragine. Marie, qui n'avait nullement besoin d'apporter son enfant au Temple, céda pourtant à la Loi des hommes, par une vertu où se mêlent obéissance et humilité. C'est ce qui permit à Syméon de composer le cantique qui porte son nom :
« Car mes yeux ont vu le salut / que tu préparais à la face des peuples / lumière qui se révèle aux nations / et donne gloire à ton peuple Israël... »
Sans doute sommes-nous loin du temps où les jeunes filles du peuple achevaient ce jour-là leur neuvaine du même nom, par la récitation fervente de laquelle elles espéraient découvrir en vision le visage de l'époux qu'elles rencontreraient par la suite, afin d'être certaines de ne pas rater l'âme sœur. Charles Nodier, qui fit un conte fantastique de cette coutume, ne reconnaîtrait donc plus Montbéliard. Sans doute sommes-nous loin aussi des processions plus ou moins festives et carnavalesques du Moyen Age, durant lesquelles de graves et songeuses Vierges Noires vêtues et coiffées pour l'occasion de leurs plus beaux atours étaient promenées le long de rues mal pavées.
Le Perce-neige
Violette de la Chandeleur,
Perce, perce, perce-neige,
Annonces-tu la Chandeleur,
Le soleil et son cortège
De chansons, de fruits, de fleurs ?
Perce, perce, perce-neige
A la Chandeleur.
On ne sait pas trop quelle mouche piqua Robert Desnos le jour où il composa cette comptine. Elle est néanmoins bel et bien de l'auteur de Rrose Sélavy. Fête des crêpes au moins autant que fête des cierges, Chandeleur, jusque dans les trois syllabes de son nom (au contraire d'Epiphanie, par exemple) a gardé dans sa consonance quelque chose de la naïveté de sa formation populaire. Chandeleur : On dit bien que si l'hiver ne meurt pas ce jour-là, il prend vigueur...
07:50 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : chandeleur, robert desnos, jacques de voragine | 









