lundi, 29 juin 2009
Je classe, tu classes, nous classons...
L'Unesco vient de classer seize nouveaux sites au Patrimoine mondial de l'humanité. Le phare Brigantium, dit le phare d’Hercule à cause de ses 55 mètres de haut ce qui, du temps des Romains, représentait encore quelque chose. Ce phare est situé à l’entrée du port de la Corogne, en Espagne. La légende prétend qu’Hercule, après avoir liquidé le géant Gyrion, aurait entérré le chef de ce dernier dans les fondations même du bâtiment et qu’il aurait ensuite installé lui-même le miroir réfléchissant du sommet. Les ruines de Loropeni, situées sur le territoire du Burkina Faso rejoignent pendant qu’il en est encore temps le vénérable classement. Le palais du financier Alfred Stoclet à Bruxelles, construit entre 1907 et 1911, temple avant-gardiste de l’Art Nouveau à l’époque de l’Art Déco, le système hydraulique de la ville de Shushtar dans le Khuzestân, les quarante-tombes de la dynastie Joseon en Corée du Sud, dans les Andes le site archéologique de Caral-Supe, le centre historique de Levoca en Slovaquie, l’aqueduc gallois au nom imprononçable (Pontcysyllte) qui depuis 1805 traverse la rivière Dee, au-dessus de la vallée de Llangollen, à Santiago l’ancienne ville coloniale Ribeira Grande, la Chaux-de-Fonds et sa fabrique horlogère, la saline de Salins les Bains… toutes ces réalisations plus ou moins humaines tombent également dans l’escarcelle de l’UNESCO. On classe aussi des montagnes : En Chine, le mont Wuhtaï et ses 53 monastères ; au Kirghizistan, la montagne sacrée de Suleiman-Too, au croisement de plusieurs routes de la soie. En Italie, la Chaine alpine des Dolomites ; et pour finir, on classe aussi de l’eau : La mer des Wadden, mer côtière qui longe les Pays Bas et le Danemark ; aux Philippines, les atolls du parc naturel de Tubbataha.
Tout ceci est très politiquement correct, très joli.
Très.
En tous points conforme avec la maladie des temps, qui consiste à se fabriquer une bonne conscience à coups de dossiers administratifs. Pour qui connait l’administration, c’est risible. Classera-t-on également la banquise et ses ours blancs, le Gulf-Stream et ses beaux tourbillons, l’Amazonie et ses oiseaux multicolores, la lune et ses croissants mélancoliques ?
Jusqu’à ce jour abominable où nous découvrirons, malades et blasés, qu’on vient de classer l’air non pollué, que seuls les touristes fortunés auront le droit de respirer…
22:44 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : unesco, patrimoine mondial, actualité, politique, alfred stoclet, loropeni, pontcysyllte, mer des wadden, la chaux-de-fonds | 
dimanche, 28 juin 2009
Jules Janin, Lyon et le lieu commun du rêve
L’écrivain stéphanois Jules Janin, né en février 1804 est surtout connu pour l’Ane mort et la femme guillotinée. En 1838, alors qu’il s’apprête à partir à Venise, il consacre à Lyon quelques lignes, au lyrisme à la fois académique et désuet. On y retrouve tous les clichés romantiques que les écrivains de la Monarchie de Juillet puis du Second Empire, illustres ou inconnus, au premier rang desquels il faut citer Lamartine, Michelet, Stendhal, Baudelaire, développèrent tour à tour à propos de la capitale rhodanienne : ceux de la cité laborieuse, ceux de la ville songeuse. Lyon, ville « antithèse », avec ses deux fleuves et ses deux collines, celle qui travaille (Croix-Rousse) et celle qui prie (Fourvière). J’ai déjà publié le texte de Jules Michelet sur « les deux collines », celui de l’Illustration, journal parisien, qui est un chef d'oeuvre du genre . Certes, le cliché peut finir par énerver, lasser. Néanmoins, ceux qui ont souvent promené leur ennui dans cette ville ont peut-être remarqué qu’il est aussi de teneur architectural : ne trouve-t-on pas trace aussi de ce labeur de « bêtes de somme » dans l’architecture, la pierre des quais, des façades ou le fer des grilles ? Et dans ce qui demeure des fleuves et des vergers ou des ruines gallo-romaines dans la cité actuelle, ne pioche-t-on pas encore trace du rêve enfoui d'un berger virgilien ?

14:51 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, lyon, voyage à venise, jules janin, saône, rhône, poésie | 
samedi, 27 juin 2009
Chronique de la fin du mois de juin et de la common decency
Ambiance lourde de fin, planant sur la ville, alors que les débats de comptoirs deviennent, les dernières journées de juin aidant, des débats de terrasses : fin de quoi ? On ne sait trop. Passé le solstice d’été, les jours déclinent, et peut-être est-ce cette fin qu’on commence à ressentir avec ce qui nous reste de feuilles et de racines dans le système nerveux, nous les humains. Les jours déclinent, et voilà que nous retournons vers l’hiver aussi surement qu’un nouveau-né marche vers sa mort, dût-il vivre centenaire. L’hiver approche, donc, et l’on sait déjà qu’il sera fatidique non seulement à de nombreux petits vieux, mais aussi un peu à tout le monde, grippe porcine annoncée. Le gouvernement, toujours prévoyant, a commandé l’enregistrement d’un trimestre entier de cours, de la primaire à la terminale, pour le cas où on se verrait obligé de fermer les écoles. La télévision sur l’estrade, et hop ! L’institut et le prof dans la boîte, et hop ! J’apprends en porcinant. Depuis le temps que les élèves prennent leurs profs pour des postes de télé, ils pourront enfin – s’ils ne meurent tous pas du vilain virus annoncé – les mater d’une oreille distraite et les écouter d’un œil dissipé, en bouffant des peanuts et des sucreries.
Remarquez faut pas rigoler trop haut, car on ne sait toujours pas jusqu’à quel point tout ça, c’est de l’esbroufe ou non. Nous sommes trop déshabitués aux grandes épidémies des temps jadis. « Le choléra, note le grand Chateaubriand dans la quatrième partie de ses Mémoires, sorti du Gange en 1817, s’est propagé dans un espace de deux mille cents lieues du nord au sud, et de trois mille cinq cents d e l’orient à l’occident : il a désolé quatorze cents ville, moissonné quarante millions d’individus. On a une carte de la marche de ce conquérant : il a mis quinze années à venir de l’Inde à Paris ; c’est aller aussi vite que Bonaparte : celui-ci employa à peu près le même nombre d’années à passer de Cadix à Moscou, et il n’a fait périr que deux ou trois millions d’hommes. »
19:52 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : alexandre vialatte, common decency, guillaume apollinaire, chateaubriand | 
mercredi, 24 juin 2009
Maurice Moissonnier
Il était né le 26 juin 1927 ; il est mort le 24 juin 2009, à deux jours de son anniversaire. Les lyonnais connaissaient surtout Maurice Moissonnier en raison de son travail d’historien sur le mouvement de 1831 des canuts. Après un mémoire de fin d’études sur La Commune à Lyon, il a fait paraître successivement Les Canuts, Vivre en travaillant ou mourir en combattant, Joseph Benoit, confessions d’un prolétaire et surtout La révolte des canuts (Editions sociales, 1975) qui, à la suite des ouvrages de Fernand Rude (Le mouvement ouvrier à Lyon – 1944 et C’est nous les canuts ) a fait autorité en la matière. Il a collaboré à de multiples revues, écrit de nombreux articles, participé à la rédaction de la France Ouvrière (Ed de l’Atelier, 1995) et aux publications de l’Institut CGT de l’Histoire sociale Rhône Alpes.
Maurice Moissonnier a été une figure fidèle du PCF français. Agrégé d’histoire, il a enseigné, au lycée Antoine Charrial, dans ce 3ème arrondissement de Lyon, à l’époque bien plus populaire qu’à présent. Son dernier ouvrage, inachevé, comprend deux tomes parus aux éditions Aleas (Lyon) : Tome I – Le front populaire ; Tome II, Déclin et mort du Front populaire. En raison de sa maladie, il a dû interrompre la rédaction des tomes suivants initialement prévus (Guerre et occupation, résistance et Libération). Je me souviens de Maurice Moissonnier comme d’un homme chaleureux, ouvert, passionné par le débat et la controverse : Pensées à sa femme Henriette, et à ses enfants.
22:11 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (23) | Tags : maurice mossonnier, lyon, histoire, mémoire ouvrière, esprit canut | 
mardi, 23 juin 2009
Stasiuk & les zlotys de son enfance
Andrzej Stasiuk est le premier auteur publié que je connaisse à développer un chapitre entier (C’est dans Fado, j’y reviendrai) sur les billets (de banque) disparus au profit de l'euro. Il s'agit des zlotys polonais.
Cela ne peut que susciter chez moi un intérêt très vif puisque, juste avant le passage à l’euro, j’ai couru les numismates pour récupérer le plus grand nombre de séries possibles de billets en francs ou anciens francs. Non pas par esprit de spéculation, ni de collection, mais vraiment par esprit de conservation. Distingo ! Je les ai ensuite classés dans un bel album. Il m’a vite semblé, en feuilletant ensuite cet album, voir défiler plusieurs pages de l’histoire de France du XXème siècle. Comme une sorte de bande dessinée. Belle Epoque, guerre de Quatorze, Années Folles, Seconde guerre Mondiale, Trente Glorieuses, Années Quatre-vingts… Et pour la première fois, ces images m’ont ému. Je me suis mis à songer à tous ces gens qui les avaient trimballées dans leurs poches, tous ces « francs » aussi morts que« ces francs » étaient démonétisés. A tous ces morts, ces disparus, ces anonymes. Un peu comme si ces vieilles images qu’ils avaient eues en poches, métonymiquement, les ramenaient jusqu’à moi. Expérience de l’imaginaire, bien sûr, fort troublante : le chiffre qui cessait d’être chiffre pour se muer en lettre, la valeur qui changeait de registre et, d'économique, devenait poétique. Par comparaison, ce jeune euro tiré au laser…
Cela a donné naissance a plusieurs textes ou nouvelles, dont quelques-uns figurent sur ce blog (voir colonne de droite, Nouvelles & les Anciens Francs), d'autres dans mes cartons.
Je suis content de voir que Andrzej Stasiuk ne dit rien de différent. Comme un camarade ou un frère. Cela régale toujours une partie de soi de sentir qu’on n’est pas le seul à ressentir ce qu’on ressent. Je suppose que cela n’a pas échappé à la discrète et malicieuse amie qui m’a offert ce livre, véritable hymne à la mémoire par ailleurs (j’y reviendrai)
Mais pour l’heure, je tiens juste à parler de ce chapitre sur les billets de banque (le dix-septième), envisagés, et c’est très rare (à ma connaissance, il n’y a que Béraud qui le fit durant ses reportages d’entre-deux guerres), comme un signe poétique.
Je regrette de ne pouvoir lire le texte en polonais, car je sens que la traduction fait perdre beaucoup de cette correspondance entre la lettre et le billet que le texte tisse, si j’ose dire. Stasiuk décrit d’abord le billet rouge de cent zlotys, l’architecture industrielle qui en constitue l’arrière plan. « comme si toute la scène se déroulait dans un au-delà prolétarien »C’est, dit-il, « le billet dont je me souviens le mieux parce que mon père travaillait à l’usine ». Voilà. Quelque chose d’essentiel et de très bref est dit là. « Mon esprit d’enfant s’imaginait que l’usine rémunérait son travail avec des images d’elle-même »
Puis il passe aux autres valeurs des séries de son enfance : cinquante, vingt, cinq-cents, mille… Et fort justement, Stasiuk déchiffre à partir des alphabets de ses zlotys ce que j’ai déchiffré à partir de ceux de mes francs : une relation de sens, créée quotidiennement entre l’homme qui figure sur le billet (vieux rois et leurs couronnes, héros nationaux,, écrivains…) et celui qui le trimballe dans sa poche quotidiennement. Entre vivants et morts. Entre récitants et recités. La présence presque impalpable du quotidien et de l’histoire à travers ces billets, à la puissance évocatrice soudain libérée : « Dans mon pays, dit-il, quand les temps sont incertains, on a l’habitude de se référer à la culture, domaine où les défaites ne sont pas si évidentes qu’en économie ou en politique ».

Stasiuk jette un œil désabusé sur les euros. Il a raison. Comment faire autrement ? Il écrit ceci : « Je regarde les euros et je me demande quelle histoire ces billets permettront de raconter. Je me demande quelle histoire y liront les habitants de mon village, par exemple. Ce que leur diront ces fenêtres et ces ponts dans le temps et l’espace, tout ce gothique, cette renaissance, ce baroque et cet art nouveau en nuances floues et pastel. Il n’y a pas de visage sur ces billets, pas d’objets, rien qui rappelle la vie quotidienne… »
Je ne sais plus qui a dit la même chose, de manière plus prosaïque, certes, et plus définitive : L’euro ne sera jamais qu’une monnaie de consommation. Triste sort… « Ces billets à la beauté pâle et universelle feront que l’argent deviendra une valeur abstraite détachée de la réalité, de l’aspect concret du travail, de l’échange de marchandises et de services réels. » Et Stasiuk de prophétiser : « nous recevrons de l’argent fantomatique pour ne pas produire des choses dont personne ne veut »
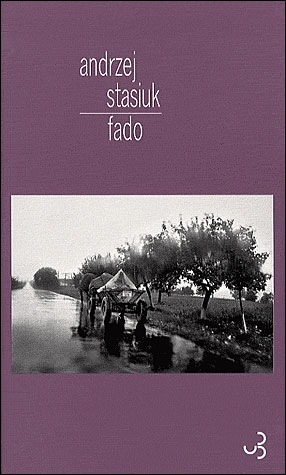
08:39 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : andrzej stasiuk, fado, litterature, zlotys, billets, politique, europe, pologne, numismatique | 
dimanche, 21 juin 2009
Suceurs de micros
Le podium est installé sur la place. Pour quelques instants encore, il est permis d’entendre encore le frémissement du vent dans le feuillage des platanes. Quelques secondes seulement. Le groupe Mabite et Moncul va procéder à ses essais sonores pour la fête ordinaire de la musique. Une fête d’Etat : Dans ses opuscules de propagande distribués aux citoyens soumis, la mairie dit que c’est un événement exceptionnel.
L’un des chanteurs est arrivé. Entre les baffles, il prend un air d’importance pour tapoter d’un doigt sur son micro. « Test, test, test… » dit-il, d’un air de singe inspiré. Quand il ne répète pas « test », il répète « eh ! eh ! eh ! » Original ? Le voici dans son univers. Ou plutôt dans son fantaaaasme : quand il était petit, il voyait déjà ses grands cons de pères faire ça à la télé. Inspiré, à voir sa gueule, il l’est effectivement avec, pour lui, l’élégance du bermuda flottant autour de hautes quilles. A ses côtés, quelques femelles commencent à se trémousser du cul en levant les bras. Exceptionnel ? Quand elles étaient petites, elles voyaient déjà à la télé leurs conasses de mères faire à peu près ce genre de truc, en bans soumis, soudés. Rien de plus banal que tout ça. Quel boucan ! Tout juste vingt-huit ans que ce genre de conneries perdure. A présent, tous les pigeons, toutes les corneilles se sont barrés à tire-d’aile. Les chats de la place rampent sous les voitures et cherchent une planque. Ce soir, ce sera rempli d’humains mutants, pressés les uns contre les autres, tous sapés avec le même goût. La jeunesse qui ne fait au fond que ce que les plus vieux ont voulu qu’elle fasse, la jeunesse qui imite non plus ce qu’elle a pu lire, mais ce qu’elle a vu à la télé. Super.
« Il viendra un temps où naitront aux hommes des enfants qui n’atteindront que l’âge de dix ans. Et avec ces hommes, des filles de cinq ans seront fertiles. La terrible insignifiance de cette culture des hommes de dix ans, déjà un peu partout perceptible, pourrait être symbolisée par un juke-box à pile atomique, car l’appareillage scientifique et technique le plus avancé y est au service des pulsions infantiles de l’humanité »
C’est Lewis Mumford qui a écrit cela, dans Les Transformations de l’homme » (1956), essai réédité l’an dernier par l’Encyclopédie des Nuisances. Dans l’avant-dernier chapitre (« La culture Mondiale »), il rappelle un mot de Wells : « L’esprit est au bout du rouleau ». Eh oui ! On ne saurait mieux dire.
La Culture Mondiale, c’est le règne des suceurs de micros, (comme les appelait ma vieille mère-grand). Et pour ces epsilons là, sans technologie, il n’est pas, même dans la fête, de salut.
Ne parlons plus d’esprit…
Sur ce, moi, je me barre.
12:10 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : musique, fête de la musique, politique, littérature, actualité, société | 
Fête de la musique (2)
Dans un article sur les lieux de loisirs, Orwell annonçait déjà en 1946 le débilitant usage que la société industrielle faisait déjà de la musique. Après avoir recensé les principales caractéristiques de ce genre de lieux (On n’y est jamais seul, on n’y fait jamais rien par soi-même, on n’y est jamais en présence de végétation sauvage ou d’objets naturels, la lumière et la température y sont toujours réglées artificiellement), il notait que «La musique y est omniprésente ». Et voici la suite de son développement : « La musique - et de préférence la même musique pour tout le monde - est l’ingrédient le plus important. Son rôle est d’empêcher toute pensée ou conversation, et d’interdire tous les sons naturels, tels que le chant des oiseaux ou le sifflement du vent, de venir frapper nos oreilles. La radio est déjà utilisée consciemment à cette fin par une quantité incroyable de gens (…) Je connais des gens qui laissent la radio allumée pendant tout le repas et qui continuent de parler en même temps juste assez fort pour que les voix et la musique se neutralisent. S’ils se comportent ainsi, c’est pour une raison précise. La musique empêche la conversation de devenir sérieuse ou simplement cohérente. Cependant que le bavardage empêche d’écouter attentivement la musique et tient ainsi à bonne distance cette chose redoutable qu’est la pensée. »
George Orwell, « Les lieux de loisir », Tels, tels étaient nos plaisirs, 1946, réèd. ; Encyclopédie des Nuisances, mai 2005
1971 : C’est l’année où Georges Steiner fait paraître ses « notes pour une redéfinition de la culture », Dans le Château de Barbe Bleue. Il y épingle les causes de « la nouvelle barbarie contemporaine », au premier rang desquels cette musique qu’on entend d’un bout à l’autre du monde et par laquelle, reprenant l’argument d’Orwell, les humanités vont cesser peu à peu d’occuper la place déterminante qu’elles avaient jusqu’alors dans la culture humaine, pour être remplacées par le son : « Le bureau où j’écris ce texte est situé dans les bâtiments d’une grande université américaine. Les murs vibrent doucement au rythme d’une musique déversée par plusieurs haut-parleurs, dont l’un tout proche. Les murs vibrent à l’oreille ou au toucher environ dix-huit heures par jour, parfois vingt quatre. Peu importe que ce soir de la pop music, de la folk music, ou du rock. Ce qui compte, c’est cette vibration envahissante, du matin au soir, et tard dans la nuit, brouillée par le bourdonnement des timbres électroniques. Toute une portion de l’humanité, âgée de treize à vingt-cinq ans, passa sa vie baignée dans ce vibrato lancinant. Le martèlement du rock et du pop se referme comme une coquille. Lire, écrire, conserver, étudier, ces activités autrefois enveloppées de silence, s’inscrivent maintenant dans un champ de stridence."
(Georges Steiner, Dans le Château de Barbe-Bleue, Gallimard, 1971)
Parmi les opposants les plus récalcitrants à cette putain de Fête de la Musique, se trouve bien sûr Philippe Muray : Homo Festivus (1996) dénonce le « chaos festif et touristique » dans lequel ce genre de manifestation fait vivre le citoyen. Dès 1992, Muray révèle les impostures de cette Fête de la musique. Voici un extrait de « Synthés sans frontières », un article publié en 1992 dans l’Idiot International et repris dans le chapitre « Télé et châtiment » (Désaccord Parfait, Gallimard, Tel, 2000)
« La musique est devenue une maladie, depuis qu’on l’impose comme le signe par excellence de la grande Réconciliation planétaire. Lang, auquel un excès bovaryque de mauvaises lectures romanesques a sans doute fait croire que le monde enchanté de la culture existait, est d’ailleurs l’un des hommes qui a le plus fait, depuis longtemps, pour rendre haïssables des choses qui, au départ, avaient tout pour être aimées ou supportées (la photo, le livre, Rimbaud, les musées, etc.) à condition qu’on ne les transforme pas en objets de célébration, donc en instruments de persécution.
C’était une fête de la non-musique, à l’extrême rigueur, qu’il fallait instaurer. Un jour sans le moindre son ! Une heure sans tambours ni trompettes ! Dans un univers que le bruit de la musique a englouti, c’était la seule chose qui avait un peu d’allure. Et puis non, il ne fallait rien faire du tout, rien instaurer du tout. La « fête » est toujours une obligation qu’on crée, un devoir de réciprocité que l’on impose, donc une attaque contre ce qui reste de liberté individuelle. »
(Philippe Muray, « Synthés sans frontières », Désaccord Parfait, Gallimard, Tel, n° 305)
10:44 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : george orwell, george steiner, philippe muray | 
samedi, 20 juin 2009
Fête de la musique (1)
La mairie de Lyon se fout de la gueule de qui ? Je reçois hier une « lettre » signée d’elle, et se présentant comme la coordinatrice de la fête de la musique ; après avoir rappelé bêtement le caractère bon enfant de cette pseudo-fête organisée en plein air dans toute la ville (mâchon musical, stands d’association, ludothèque, spectacle de danse et pour finir concert festif) un peu à la façon d’un voisin indélicat qui va fêter son anniversaire à la con et prévient les voisins, elle (la mairie) poursuit en s’excusant : « cette manifestation, nous en sommes conscients, est susceptible de générer des nuisances sonores pour les habitations du voisinage. Nous vous prions en conséquence de nous en excuser par avance pour les désagréments occasionnés et comptons sur votre compréhension à l’occasion de cet événement exceptionnel. »
Quelques remarques :
-La mairie parle « des habitations du voisinage » alors que le boucan sera partout et, après leurs manifestations musicales, va se poursuivre jusqu’à l’aube, dans des débordements qui ne seront bien évidemment pas encadrés et laisseront les rues du centre dans un état indescriptible (voir le billet « fête de la merde » ( qui date de 2006) en lien.
-La mairie parle d’un événement exceptionnel alors que rien ne l’est moins que cette "fête" banale, répétitive et désormais programmée dans le calendrier, au même titre qu’une autre (on croule sous l’ordinaire des fêtes). Cette fête, qui obéit à la politique de divertissement populaire préconisée par la Trilatérale est suivie les doigts sur la couture par toutes les municipalités pour, dit-on, le bien et la liberté des populations.
La mairie clôt sa lettre en disant : « nous vous prions d’agréer, madame, monsieur, l’expression de notre sincère considération ».
La mairie se fout de la gueule de qui ?
21:36 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : musique, fête de la musique, politique, lyon, mairie de lyon | 
vendredi, 19 juin 2009
Bétise et lieux communs
Notre quotidien, quel qu’il soit (& qui que nous soyons), nous ramène toujours aux mêmes tâches, aux mêmes pensées, aux mêmes remarques, déterminant notre vision du monde et le rapport souvent cliniquement désabusé que nous nourrissons avec lui. Cela m’a toujours frappé, la manière dont un médecin dit toujours « les malades » ou « les patients », un commercial ou un commerçant « les clients », un professeur « les élèves », un concierge « les résidents », un théâtreux « les spectateurs », un politique « les électeurs» et au final, pour parler de tous ceux qui ne sont pas encore tombés entre ses pattes, un gardien de morgue « les vivants ». Généralement, à cette portion de l’humanité avec laquelle sa profession le met en contact, avec ce qu’il est commun d’appeler « les autres » on accole une caractéristique générale : ainsi, les malades deviennent de plus en plus procéduriers, les résidents de plus en plus sales, les élèves de plus en plus nuls, les vivants (sans doute) de plus en plus nombreux, etc.… (1) C’est un effort quotidien de ne pas se laisser enfermer dans ce type de représentations, et dans l’ensemble des lieux communs qui vont avec. L’écrivain Rémi de Gourmont, dans sa réflexion sur les lieux communs (2), définit cet effort comme étant une « dissociation des idées » trop rapidement accolées l’une avec l’autre. Effort que je répugne une fois sur deux à faire, je l’avoue, tant je vois qu’autour de moi, peu de gens y consentent. Si par exemple une part de moi vit avec l’idée que les élèves sont nuls, c’est d’une part parce que je lis depuis trop longtemps leurs copies, d’autre part parce que ça m’arrange de le penser. Cela m’arrange doublement : d’une part, cela me permet de penser cette nullité comme une sorte de fatalité. D’autre part, lorsque j’en rencontre qui ne le sont pas, cela crée une bonne surprise. Une excellente, même ! Dans son essai, Rémi de Gourmont poursuit : « L’homme associe les idées non pas selon la logique, selon l’exactitude vérifiable, mais selon son plaisir et son intérêt. C’est ce qui fait que la plupart des vérités ne sont que des préjugés. »
Ainsi pense-t-on trop vite et trop souvent que c’est la simple bêtise qui est à l’origine de la plupart des lieux communs : trop rarement, parce que sans doute cela nous dérange, que c’est, en effet, le plaisir ou l’intérêt.
(1) Un professeur me manifestait l’autre jour sa surprise devant le choix précoce (fin de seconde) d’une de ses élèves qui veut être thanatologue : Après réflexion, nous avons convenu que c’était un bon choix qui, au vu du sort qui nous attend tous et vu le nombre que nous sommes, risque de la mettre durablement à l’abri du chômage.
(2) Rémi de Gourmont, La culture des Idées (1900)
18:42 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, rémy de gourmont, culture des idées, lieux communs, préjugés, éducation | 









