lundi, 31 octobre 2011
L'argent des écrivains
"Il y a peu, j’ai reçu un exemplaire du livre fort intéressant et utile de sir Stanley Unwin, La Vérité sur l’édition, qui a été publié à plusieurs reprises depuis 1926 et a récemment été étoffé et remis à jour. Je l’apprécie tout particulièrement parce qu’il rassemble certains chiffres qu’on aurait du mal à trouver ailleurs. Il y a un an ou deux, dans un article pour Tribune concernant le coût de l’imprimé, j’ai essayé de deviner le coût moyen annuel des livres dans ce pays et je l’ai estimé à une livre par personne. Il semblerait que j’avais visé trop haut. Voici les chiffres des dépenses nationales pour 1945 :
Boissons alcooliques : £ 685 millions
Tabac : £ 548 millions
Livres : £ 23 millions
Autrement dit, le citoyen britannique dépense en moyenne environ 2 pence par semaines en livres, alors qu’il dépense presque 10 shillings en boisson et en tabac. Je suppose que ce très noble chiffre de 2 pence doit inclure l’argent dépensé pour les manuels scolaires et pour d’autres livres achetés, pour ainsi dire, par obligation. Comment s’étonner alors que, en réponse à un questionnaire envoyé il y a quelque temps par le magazine Horizon qui demandait à vingt et un poètes et romanciers le meilleur moyen de gagner sa vie pour un écrivain, aucun d’entre eux n’a dit simplement qu’il pourrait la gagner en écrivant des livres ?"
George Orwell
« Combien dépense-t-on pour les livres ? » - 13 décembre 1946 –
A ma Guise, Agone 2008

Orwell
22:13 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : george orwell, a ma guise, littérature | 
dimanche, 21 juin 2009
Fête de la musique (2)
Dans un article sur les lieux de loisirs, Orwell annonçait déjà en 1946 le débilitant usage que la société industrielle faisait déjà de la musique. Après avoir recensé les principales caractéristiques de ce genre de lieux (On n’y est jamais seul, on n’y fait jamais rien par soi-même, on n’y est jamais en présence de végétation sauvage ou d’objets naturels, la lumière et la température y sont toujours réglées artificiellement), il notait que «La musique y est omniprésente ». Et voici la suite de son développement : « La musique - et de préférence la même musique pour tout le monde - est l’ingrédient le plus important. Son rôle est d’empêcher toute pensée ou conversation, et d’interdire tous les sons naturels, tels que le chant des oiseaux ou le sifflement du vent, de venir frapper nos oreilles. La radio est déjà utilisée consciemment à cette fin par une quantité incroyable de gens (…) Je connais des gens qui laissent la radio allumée pendant tout le repas et qui continuent de parler en même temps juste assez fort pour que les voix et la musique se neutralisent. S’ils se comportent ainsi, c’est pour une raison précise. La musique empêche la conversation de devenir sérieuse ou simplement cohérente. Cependant que le bavardage empêche d’écouter attentivement la musique et tient ainsi à bonne distance cette chose redoutable qu’est la pensée. »
George Orwell, « Les lieux de loisir », Tels, tels étaient nos plaisirs, 1946, réèd. ; Encyclopédie des Nuisances, mai 2005
1971 : C’est l’année où Georges Steiner fait paraître ses « notes pour une redéfinition de la culture », Dans le Château de Barbe Bleue. Il y épingle les causes de « la nouvelle barbarie contemporaine », au premier rang desquels cette musique qu’on entend d’un bout à l’autre du monde et par laquelle, reprenant l’argument d’Orwell, les humanités vont cesser peu à peu d’occuper la place déterminante qu’elles avaient jusqu’alors dans la culture humaine, pour être remplacées par le son : « Le bureau où j’écris ce texte est situé dans les bâtiments d’une grande université américaine. Les murs vibrent doucement au rythme d’une musique déversée par plusieurs haut-parleurs, dont l’un tout proche. Les murs vibrent à l’oreille ou au toucher environ dix-huit heures par jour, parfois vingt quatre. Peu importe que ce soir de la pop music, de la folk music, ou du rock. Ce qui compte, c’est cette vibration envahissante, du matin au soir, et tard dans la nuit, brouillée par le bourdonnement des timbres électroniques. Toute une portion de l’humanité, âgée de treize à vingt-cinq ans, passa sa vie baignée dans ce vibrato lancinant. Le martèlement du rock et du pop se referme comme une coquille. Lire, écrire, conserver, étudier, ces activités autrefois enveloppées de silence, s’inscrivent maintenant dans un champ de stridence."
(Georges Steiner, Dans le Château de Barbe-Bleue, Gallimard, 1971)
Parmi les opposants les plus récalcitrants à cette putain de Fête de la Musique, se trouve bien sûr Philippe Muray : Homo Festivus (1996) dénonce le « chaos festif et touristique » dans lequel ce genre de manifestation fait vivre le citoyen. Dès 1992, Muray révèle les impostures de cette Fête de la musique. Voici un extrait de « Synthés sans frontières », un article publié en 1992 dans l’Idiot International et repris dans le chapitre « Télé et châtiment » (Désaccord Parfait, Gallimard, Tel, 2000)
« La musique est devenue une maladie, depuis qu’on l’impose comme le signe par excellence de la grande Réconciliation planétaire. Lang, auquel un excès bovaryque de mauvaises lectures romanesques a sans doute fait croire que le monde enchanté de la culture existait, est d’ailleurs l’un des hommes qui a le plus fait, depuis longtemps, pour rendre haïssables des choses qui, au départ, avaient tout pour être aimées ou supportées (la photo, le livre, Rimbaud, les musées, etc.) à condition qu’on ne les transforme pas en objets de célébration, donc en instruments de persécution.
C’était une fête de la non-musique, à l’extrême rigueur, qu’il fallait instaurer. Un jour sans le moindre son ! Une heure sans tambours ni trompettes ! Dans un univers que le bruit de la musique a englouti, c’était la seule chose qui avait un peu d’allure. Et puis non, il ne fallait rien faire du tout, rien instaurer du tout. La « fête » est toujours une obligation qu’on crée, un devoir de réciprocité que l’on impose, donc une attaque contre ce qui reste de liberté individuelle. »
(Philippe Muray, « Synthés sans frontières », Désaccord Parfait, Gallimard, Tel, n° 305)
10:44 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : george orwell, george steiner, philippe muray | 
lundi, 24 novembre 2008
Creative writing
Il parait qu'aux Etats Unis comme en Grande Bretagne, les creative writing ont le vent en poupe. C'est le Monde des Livres, celui daté de vendredi 21 novembre, qui l'affirme. Bigre. Sur une pleine page, Florence Noiville s'entretient avec plusieurs spécialistes de la chose. Un professeur, tout d'abord, du nom Amy Bloom, « professeur de creative writing à Yale ». Mes respects, professeur !
Amy Bloom commence par livrer une vision pour le moins caricaturale du travail d'écriture à la française : « En France, vous avez tendance à considérer que l'on nait écrivain » (je ne sais pas d'où il tire cette idiotie). C'est une vision romantique des choses (Ah, je vois ! d'une mauvaise compréhension de quelques poèmes de Musset, les Américains et le second degré, c'est vrai que c'est toujours difficile ...) La Grâce tombe sur l'auteur comme, à la Pentecôte, les langues de feu sur les apôtres... (Oui oui, bien sûr, les Français s'imaginent tous ça ... sont d'ailleurs tous - moi et toi compris, lecteur - des demeurés mentaux) ... Passons. Certains "auteurs" se font payer, apprend-on plus avant dans l'article, 150 000 euros annuels pour apprendre de la technicité littéraire à des gens qui les sollicitent. Non, je rêve ! Moi, je me pince, en lisant ça. Sérieux ? Autre chose : « 70 % des universités anglaises possèdent un cours de creative writing. » Pour elles, c'est en train de devenir une matière à part entière, si ! si ! Il paraît que ça peut même sauver la filière Lettres ! Catastrophe ! Imagine-t-on Stendhal ou Proust, Dostoiëvsky ou Joyce, Balzac ou Céline apprenant à l'écrire à l'Université ... De quoi se fendre en quatre de rigolade, non ? En même temps, ils ne manquent réellement pas d'air, ces techniciens de l'écriture ! Vous me direz qu'il faut bien occuper les imbéciles, comme le disait le bon Bernanos, et qu'ils sont légions. Certes. La suite : « La sélection, pour rentrer dans ces ateliers, s'effectue sur un manuscrit de 5000 mots, une lettre de motivation et de solides références. » Là j'ai la nausée. Une lettre de motivation, les gars, un projet d'écriture solide, quoi ! Ce qu'en dit Russell Celyn Jones, un autre zozo directeur du programme de Birbeck University, à Londres : « Le choix n'est pas difficile. En cinq minutes, je peux vous dire qui a le sens de la langue et qui ne l'a pas » (Tiens, le sens de la langue serait inné ? on naîtrait écrivain, à présent...).
De l'aveu de leurs propres directeurs, les gens qui s'adressent à ces ateliers n'auraient « jamais ouvert un bouquin ». Est-ce si étonnant ?
Je ne connais, pour ma part, d'autre façon d'apprendre à écrire que d'ouvrir des bouquins, pourtant. Des vrais bouquins, bien sûr.. Des bouquins d'auteurs. Comme le fit Calaferte dans son usine crapoteuse : Car l'autorité va se chercher dans les textes, à l'ombre des Grands, surtout pas sur les bancs de l'école. L'autorité, c'est l'auteur, pas la technique. Cette fièvre de technicité est désolante, ridicule, et de surcroit obscène, comme tous les marchés de dupes. Etrange ironie que ce tourisme littéraire à l'adresse des ambitieux, des vaniteux et des désœuvrés de tous poils, des Trissotin et des Bélise de tous âges : c'est la star academy versus littéraire, ça promet. Les lecteurs disparaissant, les auteurs (ou du moins ceux qui passent pour tels dans notre monde dément) devront, pour survivre, "apprendre" à écrire à ceux qui ne liront désormais jamais plus leurs livres, trop occupés qu'ils seront à littéraliser leur petit moi. Le marché de l'autofiction a encore de beaux jours devant lui. Car Florence Noiville conclut ainsi son article : « Ces cours seront désormais un point de passage obligé dans le paysage littéraire britannique. C'est là que se fait l'editing, c'est à dire le travail de mise au point et de polissage des textes.... »
Bref, on apprend à naître auteur, comme ailleurs à être journaliste ou politicien ... Orwellien au possible, au pays de Sa majesté, non ?
Cela me rappelle un alexandrin que j'avais crayonné sur le trottoir d'une rue, il y a longtemps, très longtemps. Quand je croyais encore qu'on pouvait, oui, comme au temps de l'heureux mal-être (1), exprimer un peu de sa révolte et faire la manche en un même élan :
Combien m'achetez-vous ce bel alexandrin ?
(1) Expression de Lephauste, dont je recommande la lecture à tous des textes "à rebrousse-poil" sur Humeur Noirte. Par ces tristes temps de malheureux bien-être, c'est salutaire.
06:06 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (30) | Tags : creative writting, george orwell | 
jeudi, 13 novembre 2008
De la surveillance comme lieu commun
Faut-il n'avoir pas grand chose à faire ni de ses jours ni de sa matière grise pour consacrer du temps à la lecture des blogues de profs... Il parait pourtant que le Ministère de l'Education Nationale fait surveiller les dits blogues, quelle nouvelle ! Risible, non? Quelques 220.000 euros consacrés à ce magnifique effort civique par les deux barons de Grenelle qui, par ailleurs, ne cessent de pleurnicher sur le peu de sous qui reste dans les caisses et envisage des coupes de postes draconiennes dès septembre prochain... Il s'agirait, plaident Xavier Darcos et Valérie Pécresse, de mieux comprendre le mécontentement éventuel des troupes, afin de l'anticiper en ces temps de rudes réformes à venir. Dans le but d'"anticiper et d'évaluer les risques de contagion et de crise", les ministres souhaitent se saisir des informations « qui préfigurent un débat, un risque opinion potentiel, une crise ou tout temps fort à venir dans lesquels les ministères se trouveraient impliqués ». Avec un égard particulier pour les « vidéos, pétitions en ligne, appels à démission, [qui] doivent être suivis avec une attention particulière et signalées en temps réel ». Eh bé ! Il y aurait donc des sous au Ministère, un "budget surveillance". Tiens, tiens... Bonne nouvelle. Si les capteurs de l'Education Nationale passe par là, je leur dis que la vie est belle, et merci patron, chantaient les Charlots, on est tous contents de travailler pour vous, on est heureux comme des fous...
(pièce jointe : le cahier des clauses particulières complet, aussi appelé CCP
08:16 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : george orwell, surveillance, éducation nationale | 
samedi, 25 octobre 2008
Abolir les distances
Je trouve dans A ma guise de George Orwell une réflexion intéressante sur un lieu commun aux reins solides encore dans le siècle où nous sommes : Abolir les distances. Ce joli monstre, qui daterait d'avant 1900 et de la belle invention de la locomotive à vapeur, était alors le lieu commun claironné par tous les progressistes forcenés, à « l'optimisme assez naïf ». Or ce lieu commun suggère qu'en étant parvenu à abolir les distances, les inventions modernes auraient facilité en parallèle la « disparition des frontières ». En 1944 Orwell qui constate qu'avec « l'avion et la radio », le lieu commun a passé sans encombre la guerre de 1914-1918 et le renforcement des nationalismes, jusqu'à survivre au déclenchement d'une seconde guerre mondiale, n'a pas de mal à démonter qu'au contraire, « les inventions modernes ont eu une conséquence inverse ». Bien loin d'abolir les distances, elles les ont réduites, enfermant au contraire chacun chez soi, et hypothéquant toute facilité de voyages sur la planète.
Cette réflexion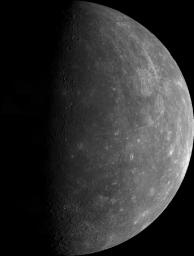 de l'auteur de 1984 devrait intéresser au plus haut point ceux qui, au moment du « passage au nouveau millénaire », s'enflammèrent inconsidérément pour le « village global » et autres métaphores éculées, et s'inquiètent à présent de la montée des nationalismes. J'ai rencontré à l'époque des adultes très sérieux, répétant comme des perroquets les slogans publicitaires pour la Toile qui se mettait en place, et disant, avec cet air un peu niais, un peu naïf - on ne sait jamais quel adjectif utilisé dans leur cas : « Avec Internet, les distances sont abolies, on peut converser avec le monde entier. » Abolir les distances a même donné naissance à cette époque aussi démente que ridicule à un autre lieu commun, inepte et récurrent dans toutes les bouches et sur toutes les pages publicitaires de propagande : »
de l'auteur de 1984 devrait intéresser au plus haut point ceux qui, au moment du « passage au nouveau millénaire », s'enflammèrent inconsidérément pour le « village global » et autres métaphores éculées, et s'inquiètent à présent de la montée des nationalismes. J'ai rencontré à l'époque des adultes très sérieux, répétant comme des perroquets les slogans publicitaires pour la Toile qui se mettait en place, et disant, avec cet air un peu niais, un peu naïf - on ne sait jamais quel adjectif utilisé dans leur cas : « Avec Internet, les distances sont abolies, on peut converser avec le monde entier. » Abolir les distances a même donné naissance à cette époque aussi démente que ridicule à un autre lieu commun, inepte et récurrent dans toutes les bouches et sur toutes les pages publicitaires de propagande : »
Ont-ils, depuis, rencontré « le monde entier », tous ces braves affamés de rencontres aux quatre coins de l'univers ? Tandis qu'en effet, toute distance virtuelle était abolie dans l'esprit un peu simple de milliards d'individus persuadés de vivre dans un seul monde ( in one world) , le terrorisme devenait sur Terre, avec les images du 11 septembre diffusées dans le monde entier, une sorte de fait de société, rendant de plus en plus justifiable le contrôle des déplacements réels des personnes et des biens, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières. Et il a y a fort à parier que la crise du capitalisme, elle aussi générée par ce merveilleux développement des technologies modernes, débouche sur un renforcement plus strict encore des divers nationalismes, en Occident comme en Orient. Si au moins le développement et la circulation des idées en avaient été facilitées, on pourrait encore, sur la balance delaruesque ou bégaudesque du pour et du contre, peser en faveur du pour. Mais c'est justement à cette époque-là qu'on a vu fleurir ce qu'on a vite appelé « la pensée commune », sorte de vox populi faussement intellectualisée par des journalistes et des prétendus intellectuels, entretenue par des sondages conçus à la va-vite, le tout pour qualifier dorénavant l'opinion publique au XXIème siècle, siècle charmant où nous sommes : dans cette opération de passe-passe aussi dangereuse que tristounette, les distances ont été si bien abolies que la pensée universelle s'est muée en pensée planétaire, l'humanisme en humanitaire, le citoyen en consommateur, la réflexion en exhibition d'opinions, la culture en divertissement, la santé en capital, l'art en produit, l'école en loft, j'en passe (et des meilleures) : 1984, quand tu nous tiens par la barbichette ...
13:23 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : george orwell, internet | 
vendredi, 17 octobre 2008
A ma guise
Agone vient de publier les quatre-vingts chroniques écrites par George Orwell de décembre 1943 à février 1945, puis de novembre 1946 à avril 1947, pour le journal Tribune. La traduction est de Frédéric Cotton et de Bernard Hoepffner, l'édition est enrichie d'une préface de Jean Jacques Rosat, d'une postface de Paul Anderson, d'un glossaire et d'un index afin de se repérer dans le contexte de ces années-là. Le livre s'appelle A ma guise, titre de la chronique.
Orwell y discute des sujets les plus variés, en associant généralement par trois un thème de société, un thème littéraire, un thème politique : un couplet de God save the King, le maquillage féminin, le déclin de la nouvelle, les métaphores mortes et les injures mal traduites, la littérature sur commande, le nationalisme écossais, les vertus et les limites de la nationalisation, qu'est-ce que le fascisme ?... En parcourant ces chroniques, on se trouve projeté dans les coulisses de 1984,  dans la conscience d'un homme qu'inquiètent l'avènement de la bureaucratie, le pouvoir grandissant de la radio, la dissolution de l'esprit critique dans les démocraties.
dans la conscience d'un homme qu'inquiètent l'avènement de la bureaucratie, le pouvoir grandissant de la radio, la dissolution de l'esprit critique dans les démocraties.
« Lorsqu'on examine ce qui s'est passé depuis 1930, il n'est pas facile de croire à la survie de la civilisation » (La une des quotidien et l'irrationalité du monde")
« Ce que révèlent les annonces matrimoniales, c'est la terrible solitude des habitants des grandes villes » ("Les annonces matrimoniales")
« Quand on voit ce qu'il est advenu des arts dans les pays totalitaires, et quand on voit la même chose arriver ici, de manière un peu plus voilée, par l'intermédiaire du ministère de l'Information, de la BBC, des studios de cinéma - des organismes qui non seulement achètent de jeunes auteurs prometteurs, les châtrent et les mettent au travail comme des mules, mais réussissent en outre à enlever tout caractère individuel à la création littéraire en la transformant en un processus de travail à la chaine, la perspective n'est pas encourageante. »
(L'Artiste dans la société bureaucratique moderne")
J'ai pioché au hasard, et en feuilletant rapidement ce petit livre qu'on vient de m'offrir, ces quelques citations.
17:56 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : george orwell, a ma guise | 









