vendredi, 31 juillet 2009
Le chêne de Jaslo
Cela se passe dans une petite ville en Pologne, Jaslo dans les Basses-Carpates, au carrefour des rues Kosciuszko et Kollataj. Là vit un chêne, planté depuis soixante-sept ans. Voilà qu’on découvre soudainement que ce chêne est un arbre subversif. En effet, il a été planté là le 20 avril 1942, en l’honneur d’Hitler, le jour de son anniversaire. Un témoin raconte : « J’avais alors 13 ans. J’ai vu des notables allemands planter cet arbre. Il y avait même un orchestre militaire. Ils ont sorti l’arbre d’une malle ornée de svastikas ».
Branle bas de combat.
La mairesse, une certaine Maria Kurowska, [élue du parti Droit et justice] prend le premier rang de la croisade. Il y aurait dans le pays d’autres cadeaux de ce genre, avance-t-elle. « Hitler attachait beaucoup d’importance aux rituels et aux symboles », rappelle l’historien de service, un certain Grzegorz Kucharczyk, membre de la commission d’histoire de l’Allemagne et des relations germano-polonaises de l’Académie des sciences de Pologne. Le monsieur est érudit : il sait que «dans la mythologie germanique, le chêne symbolisait la force. Il y a peu, on a découvert en Allemagne des chênes plantés selon le tracé d’une croix gammée ». Vinzou !
 La municipalité décide donc d’abattre le chêne, sous le prétexte qu’en 1944, les Allemands ont chassé la population de Jaslo et détruit la ville. Seuls en réchappèrent une partie de la salle de sport et ce chêne là, le chêne de Hitler.
La municipalité décide donc d’abattre le chêne, sous le prétexte qu’en 1944, les Allemands ont chassé la population de Jaslo et détruit la ville. Seuls en réchappèrent une partie de la salle de sport et ce chêne là, le chêne de Hitler.
« On ne peut pas défendre un arbre offert par un homme aussi horrible», argumente Maria Kurowska. Se rend-elle compte à quel point ce qu’elle dit est idiot ? Pas sûr. Moi, franchement, ces gens-là m’effraient plus encore que les gens qu’ils condamnent. Car qui fait l’ange fait la bête. Et je ne suis pas certain que quelqu’un qui confond un arbre et un nazi ne soit pas capable de voter demain pour un dictateur dément.
Je me souviens qu’à l’occasion de la sortie d’un film sur Hitler que je n’ai pas vu, il y a un ou deux ans, un film dont j’ai beaucoup entendu parler, des bien-pensants s’indignaient qu’on pût montrer Hitler comme un brave homme chérissant sa femme et son chien. Bien sûr, le « débat » (si à ce point d’âneries on peut encore appeler cela des débats, même Delarue, dans ses grandes heures, ne fait pas si indigent, Ségolène, peut-être ? Enfin, passons…), le débat a pénétré les classes. Hitler était-il un homme ?
A ma connaissance, oui. J’ai dû expliquer à ces « jeunes » occidentaux qu’Hitler n’était pas un martien, que oui oui, c'était bien un être humain, tout comme eux. Cette petite fable est révélatrice de la difficulté que nos sociétés ouatées ont à penser le mal. Surtout le mal humain (Humm : Vous en connaissez un autre ?NDRL)
Je me suis retrouvé à expliquer à ces élèves que non, bien sûr, l’être humain n’était pas non plus cette créature angélique qu’un rousseauisme mal digéré a fait confondre avec je ne sais quelle beauté céleste et innocente qui aurait tous les droits, et à laquelle ils aiment s'identifier. Que oui les nazis, bien sûr, bien sûr, étaient bien nés sur la Terre et pas débarqués de la planète Mars, que non, non, on n’avait jamais vu des arbres défiler au pas cadencé, (ni se jeter en hordes sur les autoroutes et les aéroports, au risque de bousiller l’écosystème), mais que des humains faisaient ça ...
Eh bien je me trompais !
Car preuve est faite que si : il y a des arbres méchants, il y a des arbres nazis. Des arbres méchants et nazis au point de devoir être abattus. CQFD.
Pour en revenir, donc, à la sotte mairesse, une fois que l’arbre sera abattu, elle voudrait planter un autre chêne (un gentil) en mémoire des officiers polonais fusillés en 1940 à Katyn par les Soviétiques. Arbre juste contre arbre injuste, vilain chêne contre bon chêne. Il parait qu’un rabbin du Canada offre depuis l’hospitalité au malheureux chêne discriminé.
A une époque, la Fontaine en aurait fait une fable.
Plus près de nous, Brassens chantait encore les malheurs du Grand Chêne.
Aujourd’hui …
Il y a peut-être une solution : qu'on fusille tous les êtres humains nés un 20 avril, anniversaire de la naissance du grand méchant loup. Car on ne sait jamais : mieux vaut prévenir que guérir.
Un certain Hérode, il y a fort longtemps, pratiquait déjà ce genre de politique préventive. Mais lui, dans l'autre sens.
Qui a dit qu'un arbre ne se connaît pas misérable, mais que l'homme, lui, le plus faible roseau de la nature, était un roseau pensant ?
13:51 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : jaslo, le chêne de jaslo, maria kurowska, le grand chêne de brassens, hitler, le chêne et le roseau | 
jeudi, 30 juillet 2009
Dans l'éternité d'Internet
« Enfin, je l'ai achevé cet ouvrage que ne pourront détruire ni la colère de Jupiter, ni les flammes, ni le fer, ni la rouille des âges ! Qu'il arrive quand il voudra ce jour suprême qui n'a de pouvoir que sur mon corps, et qui doit finir de mes ans la durée incertaine : immortel dans la meilleure partie de moi-même, je serai porté au-dessus des astres, et mon nom durera éternellement. Je serai lu partout où les Romains porteront leurs lois et leur Empire; et s'il est quelque chose de vrai dans les présages des poètes, ma renommée traversera les siècles; et, par elle, je vivrai. »
En relisant la fin des Métamorphoses, tout à l’heure, je songeais à la ressemblance entre ces deux termes, l’internet et l’éternité.
L’un vient de l’anglais inter/net (et devrait donc se dire, en français, « l’entre-réseaux »).
L’autre, du latin aeternitas, néologisme cicéronien forgé sur aevitas (l’immortalité).
In-ternet, ex-ternet : Troublante coïncidence phonétique, hasard des rencontres d’étymons ?
L’un semble bien être le contraire de l’autre.
Or c’est bien, in fine, au fil de ces réseaux du seul instant que nous jetons nos mots.
Ces réseaux contraires à cette éternité à qui Ovide, s'il confiait au seul instant les dons de sa semence, prenait garde de confier les dons de sa plume...
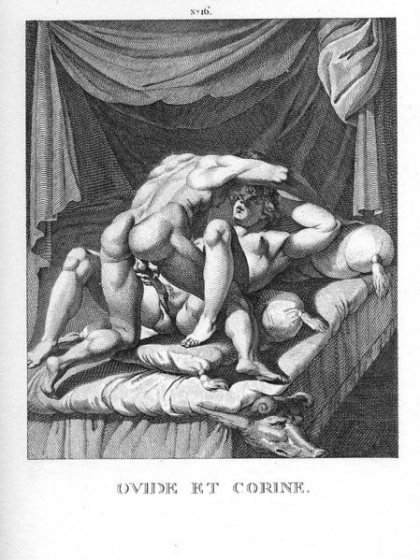
De toute façon, c'est bien au latin (la langue du seul et véritable empire) qu'il faut revenir, si l'on veut comprendre le sens des choses et des mots, et non pas à cet épouvantable anglo-américain dans lequel le monde s'est fourvoyé :
inter/nete : inter, préposition pouvant signifier parmi, mais aussi ensemble et nete : substantif féminin servant à nommer la plus haute corde de la lyre.
Ensemble, sur la plus haute corde de la lyre ...
19:46 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : ovide, littérature, les métamorphoses, jeux de mots, internet, réseaux, elle n'est pas retrouvée l'éternité | 
mercredi, 29 juillet 2009
Léon Boitel et la décentralisation littéraire
S'il m'arrive souvent d'être critique à l'égard des institutions culturelles lyonnaises, je sais aussi mettre parfois de l'eau dans mon vin. A preuve, ce chapeau bien bas que je tire devant le travail effectué par la Bibliothèque Municipale de la Part Dieu qui a mis en ligne un petit bijou, vraiment, pour tout amateur d'archéologie littéraire lyonnaise. Ce petit joyau n'était jusqu'alors consultable qu'en salles, voici que je découvre qu'il est en ligne : il s'agit de la Revue du Lyonnais, parue de 1835 à 1924, avec quelques interruptions et un changement de nom à la clé. Je republie donc cet article consacré à son fondateur, un écrivain imprimeur fort injustement oublié du nom de Léon Boitel, en insérant les liens permettant de regagner les collections en ligne.
« C’est en flattant les hommes et les peuples qu’on les perd ». Somptueuse formule, que je trouve sous la plume d’un romantique aujourd’hui parfaitement oublié : En 1830, Léon Boitel, qui confesse l’âge de George Sand, de Nerval ou de Musset, entreprend non sans quelque mal à Paris des études que son père, un pharmacien de Rive-de-Gier, aurait volontiers aimé voir aboutir. C’est alors qu’éclatent tout d’abord les sifflets de la Révolution d’Hernani, puis les coups de canons de celle de Juillet. En 1826, à peine âgé de vingt ans, Boitel n’a-t-il pas déjà fait jouer aux Célestins un vaudeville dans le goût de l’époque, Le Mari à deux femmes ? Mais les Célestins ne sont pas la Comédie Française, et les émeutes de canuts pas des révoltes nationales. Il n’empêche. A la banquette et à la thériaque de l’apothicaire, le jeune homme préfère l’appel mélodieux de la muse. Adepte de la « décentralisation littéraire », en laquelle il voit l’avenir de la littérature nationale et républicaine, il regagne donc sa province natale pour se porter acquéreur, dès 1831, d’une imprimerie sise au 36 quai Saint-Antoine à Lyon.
21:10 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, lyon, bibliothèque de la part-dieu, romantisme, revue du lyonnais, léon boitel, revues | 
lundi, 27 juillet 2009
Jean Reverzy, Lyon & la "chose littéraire"
Le 9 juillet 1959, (il y a de cela cinquante ans), Jean Reverzy mourait soudainement, à l’âge de quarante-cinq ans. Nous allons quitter le mois de juillet 2009 dans quelques jours, et, à ma connaissance, la ville de Lyon et ses prétendues instances culturelles seront passées à côté de cet anniversaire. En ligne, je ne trouve qu’un mince article du Progrès. A moins qu’une lecture confidentielle n’ait été organisée à la sauvette par quelques obscurs bénévoles dans un bistrot associatif ? Tandis qu’à Saint-Brieuc, par exemple, il y a un lycée Louis Guilloux, un boulevard Louis Guilloux, un prix Louis Guilloux – & je suis le premier à reconnaître que l’œuvre de cet écrivain mérite cette reconnaissance, alors qu’à Manosque, il y a un centre Jean Giono, un collège Jean Giono, ici, à Lyon, il n’y a rien, rien, rien… Jean Reverzy, Louis Calaferte, Henri Béraud, voyez-vous, mesdames messieurs, ça n’a jamais existé. Ce qui existe, ici, c’est Aulas et Bocuse. Et puis les Nuits Sonores, Tout le Monde dehors, et autre vacarme intempestif… Je retrouve ici trois citations de trois autres auteurs, passés eux aussi à la trappe, et je m’attriste de voir à quel point elles pourraient être d’actualité :
« La Chose littéraire a toujours semblé ici une sorte de maladie honteuse et le fait de bohêmes entachés de sadisme ! »
Tancrède de Visan, Sous le Signe du Lion, 1935
« Chez nous, on n’a pas l’enthousiasme très bruyant, surtout lorsqu’il s’agit de littérature. »
Marcel Grancher, Vingt ans chez Calixte, 1940
« Ces deux mots, gloire et talent, bannis de la langue lyonnaise, étaient considérés comme des vocables anarchiques, qui menaçaient la discipline des boutiques et des maisons de commerce, la suprématie des coffres-forts. »
Gabriel Chevallier, Chemins de solitude, 1946
Pour Béraud, même s’il n’est pas recevable (le fut-il pour Céline ?), on vous sort l’argument de la collaboration. Renault, Berliet, les Lumière, Guitry, Bousquet, tant d’autres, n’est-ce pas, on ferme les yeux. Mais Béraud, cinquante ans après, ah ! crime de lèse majesté. Il paraît donc normal que les articles de Gringoire éclipsent la Gerbe d’Or, Les Lurons de Sabolas, Ciel de Suie, Qu’as-tu fait de ta jeunesse, livres auxquels un adolescent de dix-sept ans a fort peu de chance d’avoir accès. Quant à la boulangerie natale, elle n’est même pas honorée d’une plaque.
Mais Reverzy, a-t-il collaboré ? Quel mal ont fait Le Passage, Place des Angoisses, Le Mal du Soir ? Pas de rue non plus à ma connaissance, un petit square dans le troisième, m’a-t-on dit… Ce n’est pas que je sois un fada des commémorations, expositions, plaques de rues et tutti quanti. Mais je constate que c’est, dans ce peuple d’amnésiques incultes et mickaël-jacksonnisés que nous sommes devenus, une façon efficace d’entretenir la mémoire, de solliciter des rééditions, des travaux universitaires, des intérêts particuliers, de la curiosité, de la vie, quoi ! Et je dis que je préférerais vivre dans une ville qui conduirait son touriste de Perrache aux Jacobins en le promenant de la rue Jean Reverzy à la rue Henri Béraud, plutôt que de le balader en terrains connus, de la rue Victor Hugo à la rue Emile Zola. Mais non : la municipalité et les édiles lyonnaises vont ainsi : pépères et consacrées, sans risques ni remous, de loges en buffets et d’alcôves en salons, accessoirement de droite à gauche, en vérité, bien au centre, n'est-ce pas : c’est triste, tout sauf littéraire, à vrai dire.
12:33 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, lyon, jean reverzy, reverzy, calaferte, béraud, culture, livres | 
dimanche, 26 juillet 2009
Nevermore
Je crois en l'originalité de ma mélancolie
Jean Reverzy (Introduction à la sincérité et à la subtilité de mon Nevermore - 1931)

Photo de Théodore Blanc et d'Antoine Demilly
14:07 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : jean reverzy, nervermore, poe, melancolie, littérature, photographie, blanc demilly, lyon | 
vendredi, 24 juillet 2009
Blanc Demilly
Théodore Blanc (1898 – 1985) & Antoine Demilly (1892-1964) ont laissé dans tous les intérieurs bourgeois lyonnais trace de leur passage en immortalisant durant toute leur carrière les palpitants événements qui jalonnent une existence : b aptême, première communion, fiançailles, mariage… Leur association a pour origine leur union réciproque, chacun à une fille d’Edouard Bron (1860-1939), qui en avait deux. Le premier, dit Théo, avait épousé Marcelle, le second, dit Tony, Adrienne. Edouard Bron, pour les profanes, c’était ce photographe qui, depuis 1893, tenait boutique au 31 rue Grenette. De 1921 à 1962, les deux gendres prirent sa succession, conjuguant leurs compétences d’entrepreneurs (ils eurent jusqu’à plus de trente employés) et leurs talents d’artistes. Il semble, après les frères Lumière, que Lyon ait aimé ces couples d’hommes imposant une griffe et dirigeant avec brio une boutique familiale.
aptême, première communion, fiançailles, mariage… Leur association a pour origine leur union réciproque, chacun à une fille d’Edouard Bron (1860-1939), qui en avait deux. Le premier, dit Théo, avait épousé Marcelle, le second, dit Tony, Adrienne. Edouard Bron, pour les profanes, c’était ce photographe qui, depuis 1893, tenait boutique au 31 rue Grenette. De 1921 à 1962, les deux gendres prirent sa succession, conjuguant leurs compétences d’entrepreneurs (ils eurent jusqu’à plus de trente employés) et leurs talents d’artistes. Il semble, après les frères Lumière, que Lyon ait aimé ces couples d’hommes imposant une griffe et dirigeant avec brio une boutique familiale.
En parallèle de ces portraits alimentaires, Blanc Demilly devint très vite une signature estimée dans le domaine de la photo d’art. Spécialisés dans le genre du paysage, spécialement du paysage lyonnais, les deux beaux-frères étendirent au nu, à la nature morte et à la photo de reportage leurs compétences. L’audace de leurs contre-plongées, contre-champs, contre-lumières, motifs décentrés, passait alors pour novatrice, pour ne pas dire révolutionnaire.



En matière technique, ils furent les pionniers du 24/36 et les premiers à utiliser des petits appareils, comme le Leica et le Rolleifex. En avril 1935, au de la rue président Carnot, dans le quartier Grolée, ils bousculèrent le milieu lyonnais en ouvrant une galerie d’art exclusivement consacrée à la photo. Ils eurent l’intelligence de s’ouvrir autant au milieu politique, dominé par la stature d’Herriot, qu’aux milieux intellectuel et artistique (les peintres, les éditeurs et les écrivains), notamment, ce qui leur permit de devenir les illustrateurs de nombreuses œuvres. Entre 1933 et 1935 seront publiées en 12 fascicules successifs plus d’une centaine de leurs images «Aspects de Lyon», imprimées en superbe héliogravure à tirage limité. Ils publieront également des ouvrages sur d’autres régions de France ou des pays étrangers, créeront un «Bulletin mensuel Blanc et Demilly» et deviendront les maîtres d’œuvre du prestigieux Bal annuel du Palais d’Hiver, présidé par l’incontournable Herriot, avec attribution d’un prix à leur nom. Dans le même temps, leurs œuvres côtoient celles de Kertesz, Doisneau, Brassaï, Man Ray, Sougez dans les magazines internationaux.
Blanc Demilly c’est ainsi le modèle d’une réussite, le témoignage d’une époque, et le charme encore opérant d’une vraie poésie du regard.

11:39 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : photographie, blanc demilly, rue grenette, noir et blanc, argentique, nu, aspects de lyon, lyon | 
mercredi, 22 juillet 2009
Café Corneille
Jean Jacques Nuel a de l’humour. Il se déclare incapable d’écrire autre chose que des nouvelles absurdes. Dans l’une de ses nouvelles, justement, titrée La Donne, il s’amuse à convertir en euros le titre du roman de Roger Vailland, 325 000 francs. Ce qui donne, apprend-t-on, 545 euros et 93 centimes. En voilà, du titre européen ! En bon collectionneur des anciens francs, je ne peux qu’être séduit.
D'une nouvelle à l'autre, les corbeaux et les corneilles l’inspirent tout autant : « Toute sa vie, écrit-il, on ne fait que développer quelques phrases conçues à l’adolescence, on leur cherche une suite, on les poursuit, on court jusqu’à la fin après son œuvre. » (L'Année des corbeaux)
Nuel aime James Joyce. Cela nous fait un sérieux point commun. Il aime aussi Béraud. Cela nous en fait un sérieux autre. Et puis enfin, il a écrit un ouvrage fort intéressant sur Joséphin Soulary, un parnassien lyonnais qui travaillait à la préfecture le jour, composait des poèmes la nuit, et habitait un fort jolie maison avec vue sur le Rhône, sur les contreforts de la Croix-Rousse.
Si je vous parle de lui aujourd’hui, c’est que six de ses textes sont consultables gratuitement sur Feedbooks. Il suffit pour cela de suivre le lien et de se rendre sur son blog, L'Annexe Outre un nouvelliste talentueux, vous rencontrerez un chroniqueur attentif, l’Annexe étant la bible des lecteurs et amateurs de revues depuis déjà pas mal de temps.
 Sa nouvelle, Café Corneille, évoque avec beaucoup de justesse le charme désaffecté d’un quartier lyonnais, celui qui entoure la Préfecture. Il y est aussi question de l’étrange saisie du réel que constitue tout travail d’écriture. Ecriture qui, avec Nuel, rime avec Préfecture (Soulary oblige ?) : Dans un café-Corneille où ne se trouvent point les oeuvres de Corneille, l’auteur s’y croque lui-même, en étant narrateur, en étant personnage, le tout dans une curieuse mise en abyme qui tourne au huis-clos fascinant sous l'objectif final de ... De qui au juste ? Allez donc voir vous-même.
Sa nouvelle, Café Corneille, évoque avec beaucoup de justesse le charme désaffecté d’un quartier lyonnais, celui qui entoure la Préfecture. Il y est aussi question de l’étrange saisie du réel que constitue tout travail d’écriture. Ecriture qui, avec Nuel, rime avec Préfecture (Soulary oblige ?) : Dans un café-Corneille où ne se trouvent point les oeuvres de Corneille, l’auteur s’y croque lui-même, en étant narrateur, en étant personnage, le tout dans une curieuse mise en abyme qui tourne au huis-clos fascinant sous l'objectif final de ... De qui au juste ? Allez donc voir vous-même.
Jean-Jacques Nuel a publié un roman, Le nom (éditions A contrario, 2005) ainsi que deux recueils de nouvelles et de textes courts : La gare (éditions Orage-Lagune-Express, 2000) et Portraits d’écrivains (éditions Editinter,2002).
13:29 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : jean-jacques nuel, préfecture, littérature, café corneille, nouvelles, l'annexe | 
mardi, 21 juillet 2009
Le Grand Troupeau
Jean Giono a écrit le Grand Troupeau en 1931, pour exorciser les souvenirs d’une guerre qu’il a vécue parmi d’autres, quelques quinze ans plus tôt, et dont il ne parvient pas, comme ces autres, à guérir. « On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la Volupté », phrase très célèbre de Louis Ferdinand Céline, tout au début du Voyage au bout de la nuit, et qui résume le mal intime de cette génération d’hommes qui sont allés au front. Dans Refus d’obéissance, texte écrit en 1934, vingt ans après la première mobilisation, Giono avoue :
« Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe des fois deux jours ou trois sans y penser et brusquement, je la revois, je la sens, je l’entends, je la subis encore. Et j’ai peur. »
Jean Giono écrit le Grand Troupeau parce que, comme d’autres, il sent que reviennent des temps obscurs. « Nous retournons dans la guerre ainsi que dans la maison de notre jeunesse » : ainsi s’ouvre le magnifique essai du très lucide Georges Bernanos, « Les enfants humiliés » rédigé en 1939. Est-ce un hasard si des historiens parlent aujourd’hui, pour évoquer cette période qui s’étale de 14 à 44, de guerre de Trente Ans ?
Jean Giono écrit donc un roman pacifiste. Car il est devenu viscéralement pacifiste. Ecrire un roman sur la guerre est une entreprise d’autant plus délicate que beaucoup sont déjà sortis[1], que le débat sur leur nécessité a été ouvert avec pertinence par Jean Norton Cru[2], qu’avec le temps « l’Horreur s’efface ». Il faut donc que ce roman se démarque des autres, ait une approche susceptible d’intéresser non seulement des anciens combattants, mais un lectorat nouveau.
[1] Gabriel Chevallier vient de publier La Peur (1930) ; Ma Pièce, de Paul Lintier, Le Feu, de Barbusse, datent de 1916 ; Les Croix de Bois (Dorgeles) de 1919 ;
[2] La publication de son livre Témoins date de 1929
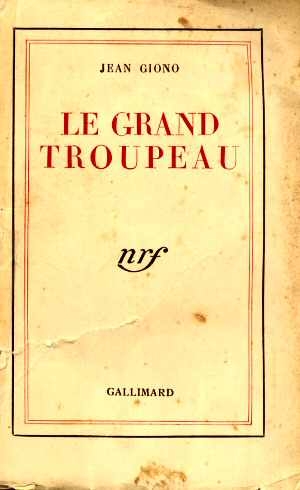
13:35 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : le grand troupeau, jean giono, littérature, guerre de quatorze, jean norton cru | 
dimanche, 19 juillet 2009
Les corneilles de Condate
Si vous avez déjà visité Lyon, peut-être connaissez-vous l’amphithéâtre des Trois Gaules, à mi-hauteur de la colline de Condate. Je dis peut-être, car ce lieu demeure fort peu visité, bien moins que ne l’est en tout cas le théâtre romain de Fourvière, lequel est situé sur la colline d’en face, berceau de Lugdunum.
Il fait avouer que c’est de manière un peu exagérée que nous disons, à Lyon, l’amphithéâtre des Trois Gaules : De même qu’il ne reste plus grand-chose des Trois Gaules, seules demeurent quelques pierres de ce malheureux amphithéâtre. Un spectre d’amphithéâtre, devrait-on proférer, malheureuse carrière providentielle dont les pierres recyclées ont servi à bâtir toute la ville médiévale, ses couvents, ses auberges et ses églises ; dès lors, qui s’attend à voir surgir un amphithéâtre au coin de la rue Terme ne découvre un peu plus haut qu’un maigre enclos de terre battue, à peine plus large qu’un court de tennis qui perce la colline, où ne subsistent que quelques gradins, épars et irréguliers. Et pour barrer la perspective, l’ancienne et fort laide école des beaux-arts au-dessus ; à ses côtés, le modeste reliquat du jardin des plantes, pentu, sinueux et bucolique.
D’un point de vue historique, cet endroit est cependant beaucoup plus riche que le théâtre de la colline d’en face.
Pour une raison politique, tout d’abord : c’est en ce lieu que l’empereur Claude fit lire son fameux discours au sénat, plaidant devant tout ce que l’Empire contenait de dignitaires soupçonneux la cause de la Gaule Chevelue. Vous dire combien cette phrase, la première fois que je l'ai entendue, m’est apparue littéralement auréolée de mystères et de poésie, comme une sorte de haïkaï ou de formule surréaliste, à l’heure de l’assassinat de Kennedy, de la guerre froide et de la conquête de l’espace: « il faut sauver la Gaule Chevelue… »
Pour une raison religieuse, ensuite. Car d’après la lettre d’Eusèbe de Césarée, c’est bien sur cette terre que les martyrs de Lugdunum (dont les plus célèbres demeurent l’évêque Pothin et la jeune esclave Blandine) furent persécutés en 177. Jean Paul II s’était donc recueilli parmi ces vestiges lors de son passage entre Rhône et Saône, en 1986. En visite à Lyon pour quelques jours, Batholomée 1er pouvait-il faire moins que s'y rendre à son tour ?
A dix-huit heures trente, ce samedi dix-huit juillet, la mairesse du 1er arrondissement était bien solitaire devant les hautes grilles vertes qui ferment ordinairement l’entrée du site archéologique (ce terme est désormais plus juste, plus adéquat, vous l’aurez compris) pour accueillir le patriarche de Constantinople, qu'accompagnait le Cardinal Barbarin. Trois ou quatre policiers, quelques badauds. Les habituels pigeons, l’œil rond, fixement orangé, à l’affut d'une pauvre nourriture sur le sable ou le goudron secs.
Arrivent enfin les gens d’église (ils étaient tout au plus une bonne vingtaine, accompagnant qui leur patriarche et qui leur cardinal). Le Primat des Gaules présente au Patriarche de Constantinople Madame la Mairesse du Premier Arrondissement. Félicitations, lui dit celui-ci, d'un ton amusé. Ce qui me fait sourire. Entouré de tous ces hommes vêtus de longues robes noires, elle apparait soudain dans le soleil couchant bien primesautière et, telle Perette sur sa tête ayant un pot au lait, « légère et court vêtue » dans l’enceinte austère et séculaire, avec son tee-shirt et sa robe à carreaux cessant juste à mi-cuisses. Marche par marche, je grimpe l’escalier raide qui permet de surplomber le site. Les deux gardes du corps du Patriarche, en costume-cravate (ce qui, sur cette scène, les rend fort peu discrets) jettent quelques coups d’œil en ma direction. Je croise, au milieu des escaliers, une espèce de neo-baba en jean trop large et coiffure affricaine, l'oeil trop bierreux pour en croire ses yeux : Le Patriarche entame un chant que le Cardinal et toute l’assistance reprend; le neo-baba se cramponne à sa canette tandis que la mairesse d'arrondissement, sage et diplomate, attend que cessent les chants religieux. Sous sa coiffe noire, Bartholomée 1er est un somptueux septuagénaire à la barbe lisse et authentiquement blanche, dont la belle allure - malgré la petite taille - n’inspire pas le moindre schisme, je vous assure. Un personnage comme échappé d'une icone orientale, là, parmi nous. Et puis arrive l’heure des discours. Je tourne à droite, parvenu au sommet de l’escalier.
Dans la nuée bleu-gris de cette fin d’après midi, la silhouette presque fantomatique de Fourvière, en face de nous. Cette visite... Fort discrète, à franchement parler. Un événement historique, dira-t-on néanmoins : la toute première fois qu’un patriarche de Constantinople, plaçant ses pas dans la trace de ceux d’un pape, vient bonnement saluer ce quartier jadis populaire, qui fut celui de mon enfance.
Dans quelques instants, tout le monde va se retirer : Gens de mairie en leur mairie, gens d’église en leur évêché, gens de la sécurité dans leurs hôtels. La concorde des trois-Gaules, certes... Celle des deux églises, pas moins, bien sûr... Le soir va bientôt tomber. Ne resteront, une fois de plus, que les pierres.
Lorsque se refermeront les hautes grilles vertes, quelques marginaux avinés viendront achever de se biturer sur les bancs du jardin des plantes mitoyen. D'eux aussi, la nuit sera victorieuse. Puis ce sera un matin neuf. Des corneilles, en grand nombre, piétineront le sable de cette enceinte millénaire et sacrée : l’oiseau noir, l’oiseau, dit-on, de Lug, celui dont à l’aube, les cris sont de colère. Leurs pattes griffues de propriétaires jalouses auront tôt fait de disperser les empreintes de tant d’humaines éminences. Les fondaisons silencieuses des alentours, tout frémissantes du silence du vent, préserveront une journée de plus, dans l’abri recroquevillé de leurs branchages, imperceptible et sauvage, le vrai mystère de Condate.
21:34 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : condate, cardinal barbarin, patriarche de constantinople, amphithéâtre des trois gaules, histoire gallo romaine, empereur claude | 









