samedi, 18 juillet 2009
Le patriarche Bartholomée 1er à Lyon
Le 7 mai 1274, et pour plusieurs semaines, à l’appel efficace du pape Grégoire X (1271-1276) se réunit le deuxième concile général de Lyon. De nombreux seigneurs, cinq cents évêques, soixante abbés de monastères, plus de mille ecclésiastiques et plusieurs représentants de l’église d’Orient se retrouvèrent à cette occasion sous les voutes toutes neuves de la primatiale Saint-Jean. Les chroniques stipulent que « toute la foule lyonnaise n’avait pu prendre place dans l’église, que les ponts et toute la place étaient noirs de monde ». Philippe le Hardi, roi de France, s’était lui aussi déplacé pour entendre le souverain pontife lire l’épitre que les prélats de l’église d’Orient lui avaient adressée, et qui admettait la réunion des églises grecques et latines sous son autorité. Il me plait d’imaginer dans la pénombre un peu humide la frêle stature de Grégoire X contemplant les croix des deux églises qu’on déposait aux deux extrémités du grand autel, et de l’imaginer, comme les chroniques le racontent, pleurant de joie non loin des remous de la Saône, tandis que George Acropolite, grand logothète, s’avançait, sans doute grave, au centre de la cathédrale et prononçait devant l’autel, sans doute ému, le serment par lequel il renonçait au schisme et acceptait la suprématie de Rome. Quel moment ! Il me plait d’imaginer ensuite le lent défilé des ambassadeurs des églises de la Grèce signant alors l’acte solennel qui avait été préparé, les chœurs et les canons éclatant, et toute cette théâtralité si magique, dont seul le catholicisme le plus séculaire a le secret.
Ce concile, l’un des plus importants du Moyen Age, fut endeuillé par la disparition de deux bons docteurs : l’angélique Thomas d’Aquin, qui mourut en s’y rendant ; le séraphique Bonaventure, qui mourut quelques jours avant sa fin, au couvent des Cordeliers où il était hébergé. C’est à la perpétuation de cette mort inopinée qu’on doit l’église Saint-Bonaventure.
Il me plait de songer aux pierres du Vieux Lyon et à celles de sa vieille primatiale, dont on ne se doute jamais véritablement, nous, les vivants de bref passage, à quel point elles sont effectivement vieilles. Il me plait de songer à ces pierres sous ce jour historique et auréolé par une légende embaumée d’encens, comme dans ces albums enluminés, où l’on nous racontait sur du papier épais, jadis, la vieille histoire du bon royaume de France. Il me plait d’arpenter la rue Saint-Jean, de glisser ma mortelle silhouette entre les façades séculaires de ces bâtisses, de cheminer d’un bord à l’autre de la gargouille centrale, fermant les yeux sur les déambulations empesées des touristes obèses et bruyants qui s’y trainent, d’oublier les commerces de bric et de broc et de laisser littéralement mon imaginaire aller entendre sonner les cloches, comme au temps du concile de Grégoire, voir les bannières aux vives couleurs et les étendards rutilants, et renifler les encens.
Je raconte tout cela parce qu’aujourd’hui samedi 18 juillet à dix-sept heures, le cardinal Barbarin célèbrera une messe dont le patriarche œcuménique Bartholomée 1er, de passage à Lyon pour deux jours, prononcera l’homélie. Cet événement fort rare qui, pour beaucoup n’aura aucune incidence - voire même aucune existence, pour quelques-uns heureusement ranimera durant quelques minutes un fort vieux songe et une histoire haute en panache, le songe et l’histoire de tous ces hommes aujourd’hui bien poudreux qui ont édifié le palais épiscopal, dont seul demeure actuellement la cathédrale Saint-Jean ainsi que sur le bord de Saône, tout le reste de cette vieille cité gallo-romaine et chrétienne. L’histoire de leur culture, laquelle passe par celle de leur tradition et croise le chemin de leur religion - qu’on le veuille ou non, nous, modernes, notre héritage.

Le patriarche oecuménique Bartholomée Ier
21:42 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : bartholomée 1er, orthodoxie, primatiale saint-jean, concile de 1274, actualité, histoire, lyon, religion | 
vendredi, 17 juillet 2009
Mais où sont les polémistes d'antan ?
Le 9 novembre 1944, Georges Bernanos rédige un article, « La France dans le monde de demain », que je relisais ce matin. (1) Et tandis que le bus tournait dans les rues sombres de la ville où ne se distinguait vraiment que le rond des lampadaires dans une brume sale et de pollution, je me disais que les polémistes de naguère croyaient encore à la possibilité de bousculer la société par le moyen d'un livre. (« J'ai la conviction de parler au nom d'un grand nombre de Français » écrit Bernanos). De quelque bord qu'ils fussent, ils croyaient à leur cause. (« O vous qui me lisez, commencez par le commencement, commencez par ne pas désespérer de la Liberté ») Tels les anciens soldats, ils allaient, armés de figures, de lyrisme et de naïveté dans le sillon de leurs lignes. S'ils n'étaient pas tous prêts à mourir pour des idées, du moins croyaient-ils que la parole avait encore le pouvoir d'alerter les hommes, qu'il suffisait pour cela de mettre le paquet, voire d'en rajouter une louche. Extrait de cet article de Bernanos, contre la civilisation des machines, à laquelle il oppose ce qui reste de la civilisation des Droits de l'Homme :
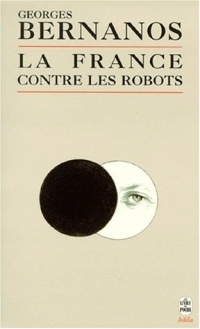
« L'énorme mécanisme de la Société moderne en impose à vos imaginations, à vos nerfs, comme si son développement inexorable devait tôt ou tard vous contraindre à livrer ce que vous ne lui donnerez pas de plein gré. Le danger n'est pas dans les machines, sinon nous devrions faire ce rêve absurde de les détruire par la force, à la manière des iconoclastes qui, en brisant les images, se flattaient d'anéantir aussi les croyances. Le danger n'est pas dans la multiplication des machines, mais dans le nombre sans cesse croissant d'hommes habitués, dès leur enfance, à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. Le danger n'est pas que les machines fassent de vous des esclaves, mais qu'on restreigne indéfiniment votre Liberté au nom des machines, de l'entretien, du fonctionnement, du perfectionnement de l'Universelle Machinerie. Le danger n'est pas que vous finissiez par adorer les machines, mais que vous suiviez aveuglément la Collectivité - dictateur, Etat ou Parti - qui possède les machines, vous donne ou vous refuse la production des machines. Non, le danger n'est pas dans les machines, car il n'y a d'autre danger pour l'homme que l'homme même. Le danger est dans l'homme que cette civilisation s'efforce en ce moment de former ».
Où en sommes-nous, quelquessoixante quatre ans plus tard ? A lire le bouquin d'Olliver Dyens, La condition inhumaine, qui se veut une réflexion critique sur ce même sujet, nous serions en plein marasme. Nous serions devenus, au centre des machines qui nous font naître, nous surveillent, nous guérissent, nous alimentent, nous instruisent, construisent nos villes et nos maisons, « une machine qui palpite »... L'homme, autrement dit, cet homme dont Bernanos redoutait la venue serait là. Cet homme, ce serait vous, moi, nous. Fort de ce constat, Olliver Dyens arrête là la polémique, sur cette belle vue de l'esprit.
En comparant l'écriture de Bernanos et celle de Dyens, la pensée de l'un et le simple constat de l'autre, on voit à quel point la technique a intégré, via la promotion de la linguistique et celle des sciences humaines, l'espace de la littérature comme celui de l'édition. Si bien que, ô vaste ironie, ô vaste fumisterie, même la pensée critique- même la polémique-, est devenue une technique. Je ne suis pas en train de dire que les polémistes du passé écrivaient sans technique : ils maîtrisaient évidemment toutes les règles de l'éloquence. Mais ils ne se laissaient pas, du moins les meilleurs d'entre eux, maîtriser par elle. Leur démonstration donnait encore à entendre la voix de leur passion, celle de leur désir, celle de leur colère. La sincérité de Bloy, malgré -et même contre le langage-, est, par exemple, évidente. Celle de Bernanos ne l'est pas moins.
Si je trouve, dans l'édition contemporaine, si peu de polémistes dignes de ce nom, n'est-ce donc pas à cause « de cet homme habitué dès son enfance à ne désirer que ce que les machines peuvent donner », cet homme que cette civilisation s'est efforcé, depuis une cinquantaine d'années, de former ?
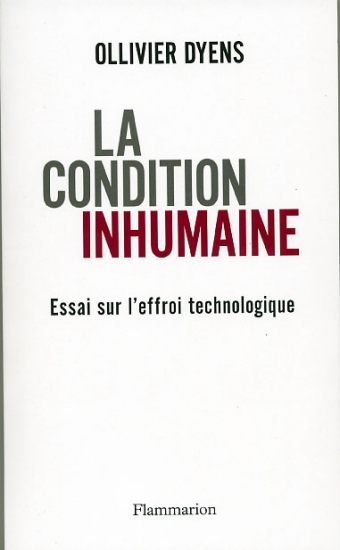
(1)Il se trouve en annexe dans l'édition de poche de La France contre les robots.
01:27 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : bernanos, bloy, béraud, polémique, polémiste, dyens | 
mardi, 14 juillet 2009
Le Montchat de Louis Calaferte
Louis Calaferte est né un 14 juillet. Le quatorze juillet 1928. Il est mort le 2 mai 1994, laissant derrière lui une œuvre littéraire trop souvent résumée au seul Septentrion ou à la seule Mécanique des Femmes. Comme c’est en passe de devenir une habitude, il me plait de me souvenir de son anniversaire de naissance, tandis que claquent un peu partout des pétards qui n’ont plus, convenons-en, grand-chose de révolutionnaire. Cette année, je publie un texte inconnu et touchant de lui, qu’il écrivit en 1957 pour une revue lyonnaise, et dans lequel il évoque l’un de ses retours dans la maison d’enfance de Montchat, quartier du 3ème arrondissement de Lyon, où Guite, sa mère, l’attend. Il écrit ce texte a vingt-neuf ans.

"J’étais assis dans le 24, Cordeliers-Vinatier. Je revenais à mon point de départ : Place Henri, Lyon, 3ème arrondissement. On ne me reconnaissait pas. Pourtant, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais enfin chez moi, en sécurité, à l’abri, au bien-être. Les soirs de trop gros cafard, j’avais fait, les yeux fermés, mille et mille fois ce petit trajet entre la place Henri et la rue Roux-Soignat où ma chère Guite m’attendait toujours. Oh, ce n’est rien, ni luxueux ni vaste. C’est un quartier de petits commerçants et de petits retraités. Les choses qu’on aime ne sont jamais bien grandes pour les autres. Il faut le miracle de l’amour pour tout magnifier. C’est un coin du monde où les gens sortent des chaises sur le pas de leurs portes en été, bavardent de fenêtre en fenêtre, savent tout les uns des autres, astiquent leurs voitures d’occasion chaque samedi pour l’unique sortie du dimanche… C’est un coin du monde comme partout au monde d’où il n’est jamais sorti ni célébrités ni idées révolutionnaires et probablement personne n’en parlera après moi ; il n’y a ni curiosités ni monuments, ça n’attire pas et à partir de neuf heures du soir, c’est vide sous les lumières froides, un peu désolé, assoupi et tranquille. Il y a même un terrain vague, quelque part, pas loin. Le dernier sans doute. L’ultime. Comme un ilot de poésie ancienne, surannée…
Un millier de braves gens, de petites gens, habitent là depuis trente, quarante, cinquante ans. Au moins d’août, le soir, ils vont en famille respirer l’odeur d’un tilleul, assis sur les bancs de la place d’Arsonval, à l’autre bout de la rue, c’est dire …
Voilà Lyon, pour moi. Quand je suis depuis trop longtemps à l’étranger, c’est à ce minuscule point de la terre que je pense, tout seul, avec des kilos de mélancolie bien aigre dans le cœur.
Ma plaie secrète."
Louis Calaferte, « Lyon 3ème arrondissement » Lyon a 2000 ans, 1957
10:40 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : montchat, louis calaferte, ligne 24, littérature, culture, actualité | 
dimanche, 12 juillet 2009
La savonnette de juillet
Ce que je connais le mieux d’elle, c’est la fente qui sépare chacun de ses orteils. Entre l’un, entre l’autre, je vais, je viens tandis qu’elle me balade. Du premier coup d’œil, je reconnais chaque interstice où je séjourne, je sais la cavité molle de chacun. Je lèche avec ardeur leurs mauvaises odeurs, jusqu’à l’extinction totale de chacune.
C’est elle qui m’a choisie. Je sentais, roucoula-t-elle, le camélia. D’elle, pourtant, excepté ses orteils, je n’ai jamais touché autre chose que la jolie menotte avec laquelle elle se saisit de moi, afin de me faire mousser contre un gant. L’hommage qu’à son beau corps je voudrais rendre, je ne peux l’entreprendre qu’à distance, fière lorsqu’un peu de ma mousse se distribue sur ses formes qu’elle modèle inlassablement, triste que ce lointain contact n’engage jamais tout mon être à moi, qu’elle rejette à chaque fois sur le bord de la baignoire, avec une délicatesse que rend plus cruelle encore son indifférence.
Ce peu de moi qu’elle étale lestement contre sa peau, qu’il lui soit le plus caressant ! le plus proche de ces bains d’autrefois qu’enfant, elle prenait, lorsqu’une simple bulle de savon crevée dans un rai de lumière, les yeux tout grand ouverts, l’émerveillait ; ou qu’un bibelot en plastique qu’elle faisait aller parmi des monts mousseux flottants comme des cygnes, faisait coin-coin. J’essaie bien. Mais quelle, parmi mes tentatives quotidiennes, pourrait briser l'héraldique mépris qu’elle manifeste à mon égard ? Mon corps se durcit et par endroit se creuse. Je ne connais que ses orteils et la paume de sa main.
Pourtant, que j’eusse aimé glisser longtemps le long de ses jolis seins roses, ronds et fermes, sur la contrée de ses reins et tout le long de ses fines longues jambes, qu’elle déploie hors du liquide, qu’elle masse avec lenteur avec le tissu du gant sur lequel je m’évapore ! Que j’eusse moi-même aimé me répandre sur le bas-ventre qu’elle a juste un peu dodu, que j’eusse aimé fourré ses lèvres, me perdre en sa brune et bouclée toison, dénichant moi-même la trace des secrétions qui s’y nichent. Experte, comme je le suis devenue de ses orteils, je le serais de son sexe bombé : Le bouton vif sur lequel parfois ses doigts s’attardent, le lustrer de tout mon corps ! De rien, elle ne se doute. Comment pourrait-elle entendre l’humble regret qu’un peu de ma mousse chuchote à sa peau tandis que l’eau chasse ce peu, encore et encore, vers l’égout ?
Quelles pensées sont donc les siennes, tandis qu’elle me dépose, encore baveuse de la friction que je viens de subir, sur le reposoir en inox ? Il m’est venu quelques gerçures, craquelant d’un bout à l’autre de ma longueur toute la sécheresse de ma silhouette. Dans ce monde étranger et sale qu’elle explore, tout, pourtant, la menace. Ce peu de camélia que de moi, chaque matin, elle emporte, ce peu de moi en chaque pore de sa peau, empreinte furtive que j’ai su graver en elle et dont, pas plus que l’air qu’elle respire, elle ne se soucie vraiment, j’aimerais qu’il la protège, un peu à la manière d’une combinaison en matière isolante. Tout : elle accumule en une journée de bureau tant de saloperies sur sa jolie peau : Ce n’est même plus un monde sale, c’est un monde dégueulasse et puant, infect, foutu, mortel, oui, c’est cela. S’en doute-t-elle ? Mortel à un point qu’elle ne peut soupçonner. Si la propreté qu’elle trouve à mon contact pouvait, à l’image de sa beauté, ne pas mourir…
Mais tout passe : voilà que mon parfum même, d’un matin à un autre, de ma surface de plus en plus restreinte, s’estompe, imperceptiblement. A l’évidence, il me faut m’en convaincre : Le tissu du gant rouge sur lequel elle éparpille à présent le maigre reliquat de moi-même, tel un voile jusqu’à la fin, d’elle, me sépare : je n’étreindrai jamais toute ma dame.
.

13:58 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (23) | Tags : littérature, nouvelles et textes brefs, savonnette, fine amor, juillet | 
samedi, 11 juillet 2009
Décompressé
18° à Lyon. Ciel couvert. Temps fort agréable pour le marché. Le farniente. Qui se souvient encore de la désolation de 2003 ? Pourtant, sent-on, la fureur caniculaire pourrait ressurgir. Tributaires. Le feu, soudainement, 30, 35, 40°… Puis tout aussi soudainement, 18, 15, 13°… Météo yoyo. Plaisir de voir des herbes, et les feuilles des arbres, d’un aussi beau vert. Entre l’été pourri et l’été qui brûle, c’est vite vu. Et donc ?
Comme la température. Décompression.
11:30 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : météo, temps, décompression | 
mardi, 07 juillet 2009
A l'enterrement d'une star...
Fin des épreuves du bac de français (pour tout le monde) : Un élève m’explique, cet après-midi, que Meursault (l’Etranger de Camus pour replacer les choses en contexte), est condamné à la fin du récit pour n’avoir pas pleuré pendant l’enterrement de sa mère au début (du récit), bien plus que pour avoir tué l’Arabe (au milieu du récit - tout le monde connait l’histoire, je passe…). Je lui demande d’approfondir : on en vient à se dire que « la société ne supporte pas qu’on ne partage pas le même pathos qu’elle ». (elle, « la société, notre société… » glissons) Très bien, très bien. Quand on n'est pas un monstre, ou un étranger, en effet, on pleure à l'enterrement de sa mère. On s’attarde un peu sur ce qu'est le pathos, qui diffère de la raison, et c’est bien dommage, c’est par là que bien des malheurs adviennent, si, si, les méchants dictateurs et tout ça, tout ça, c'est la faute aux gens qui ne réfléchissent pas et se laissent persuader... je finis par lui demander si, dans la société actuelle, il ne se sent pas, lui, parfois, un peu « étranger » à tout ce qui s'entend, se dit, se voit. Il se rabroue : « Ah non, tout va très bien, je me sens parfaitement intégré ! ». Diable. J’ai touché un endroit sensible, dirait-on. Cela fonctionne donc, l’éducation citoyenne ! Perfide, j’en rajoute : "Mais tous ces gens qui pleurent ou vont pleurer durant la retransmission de l’enterrement de qui vous savez, ce soir, ils sont bien solidaires dans le pathos, non, et plus tellement vigilant dans leur raison, non ?" Silence. Comme il est inconvenant de ne pas pleurer à l’enterrement de sa mère, serait-il devenu aussi inconvenant de ne pas s’affliger de la disparition anecdotique d’une star internationale ?
Silence … Peut-être qu’après tout, tous ceux qui ne pleurent pas à l’enterrement de Mickaël sont des criminels en puissance (des fachos, on dit, je crois...) Ah Mickaël ! Peter Pan ! Bon p'tit gars... Allez savoir.
Silence, silence, silence. Eh oui! L'intégration de l'étranger a si bien réussi que même la part la plus réfractaire, la plus étrangère au monde est désormais consentante.
Vous avez donc encore le droit de ne pas pleurer à l'enterrement de la star (espèce de sans-coeur !) : Mais faites gaffe ; la planète toute entière vous regarde. Et vous le fera payer un jour, peut-être ...
22:06 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : jackson, musique, bachot, enterrement, actualité | 
lundi, 06 juillet 2009
Rotrou, Guilloux, même combat
Deux jours encore d’interrogations. Plus que deux jours. Me disais, vendredi soir, l’esprit essoré à force de revivre la même-même scène (« votre convocation s’il vous plait, votre papier d’identité, vous prendrez ce texte de votre liste… vous avez une demi-heure… ») et d’entendre en gros, les mêmes-mêmes choses dans la bouche de gens qui se ressemblent (des parents qui se ressemblent tous plus ou moins ne pouvant faire, au fond, que des enfants qui se ressemblent tous moins ou plus, eh oui, c'est ainsi) – ronron rassérénant autant que révoltant - , me disais, plus la peine de s’illusionner, qu’il n’y a plus aucune issue dans cette société de masse… Et que le bachot - comme le permis de conduire et le droit de vote – n’est plus qu’un ticket tristounet pour entrer dans le cinéma du monde libre (Et quel cinéma ! Finie la petite salle de quartier, vaste complexe, partout, même film de Tokyo à Dubaï, nom de Dieu ! - et pour mardi, c'est déjà prévu, même enterrement pour tous !). Me disais que je n’avais été au mieux, durant ces trois derniers jours d’interrogations, qu’un moniteur d’auto-littéraire, ou un assesseur de bureau de bac. Comme on voudra. Remplisseur de formulaires, parfaitement lisse.
Là-dessus, j’ai passé le week-end à relire Le Sang Noir de Louis Guilloux, œuvre que j’étudierai l’an prochain en classe avec des élèves, quels que soient ceux qu’on m’attribuera, après tout. Comme l’Education nationale est faite : une année s’achève tout juste, qu’il faut programmer la prochaine : les autoroutes de l’éducation, et comment faire autrement, là-aussi ? Dans tous les établissements scolaires, ça turbine à l’heure actuelle autour des répartitions de classes et des emplois du temps des uns et des autres. Et drôlement, ça turbine. Jonglage avec des blocs horaires, des salles et des étages, et des options de ceci, de cela. On ferme le quatorze juillet, réouverture au premier septembre. C’est tout pareil, partout : service public. Tout n’est affaire, dans cette société, que de gestion des masses : de la crèche au crématorium, nous ne serons bientôt plus que du personnel de surveillance ou de divertissement.
Pour tenir le coup, voilà donc, Le Sang Noir. Et pour faire bon poids bonne mesure, en œuvre théâtrale, je ferai lire aux élèves et j’étudierai avec eux Le Véritable Saint-Genest de Rotrou. Si j’étais directeur de salle, je la monterais bien, cette pièce. Mais je suis un metteur en scène sans salle. L’une des plus justes, des plus troublantes qui fut écrite. L’essence du romanesque comme l’essence du théâtre, le roman labyrinthe & la pièce miroir : Guilloux, Rotrou, même combat ? de quoi perdre pied de brefs instants, ou leur en donner l’illusion, malgré le système technologique qui les mène, eux, moi, vous et le monde ; Cripure, Genest, même œuvre et même chant :
« J’ai vu, Ciel, tu le sais, par le nombre des âmes
Que j’osai t’envoyer par des chemins de flammes
Dessus les grils ardents et dedans les taureaux
Chanter les condamnés et trembler les bourreaux… »
Le véritable Saint Genest, Rotrou – (II,4)
Ci-dessous, Louis Guilloux, par Cabu

19:46 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : théâtre, littérature, éducation, bachot, rotrou, louis guilloux, saint-genest, cripure, alléluia | 
samedi, 04 juillet 2009
Lisbeth
Il ferait chaud. Plus chaud encore qu’aujourd’hui. La bouteille de whisky serait sous la banquette. Lisbeth me soufflerait à l’oreille : c’est avec ça que plus d’un a combattu la page blanche... Dans un coin de la librairie, une vieille Remington, devant un panneau de vieilles affiches. Attirés par les soldes, les clients flâneraient dans les rayons, mais très peu achèteraient. Nous obligeant juste à les suivre du regard, c’est si vite piqué, un bouquin… Quand j’étais étudiante, me dirait Lisbeth … Oui, je sais bien, moi itou : la fauche…
Dehors, les perches des bus roulant à l’électricité ; leur klaxons, comme des dindons, et puis ce glissement très spécial des pneus sur l’asphalte. On vend plus rien, me souffle Lisbeth à l’oreille. Encore un whisky ?
Dans les années soixante, la librairie marchait bien. L’ancien propriétaire, je te dis que ça… J’arrive même plus à payer une femme de ménage. Y’a tellement de poussière à l’étage, moi-même, j’achèterais pas les livres que je vends…ça, qui fend le cœur, hein ?
T’as pas eté voir ? Juste, je jette un coup d’œil là-haut. Plein d’éditions originales à 20 %. Des volumes avec envoi. Je dis non de la tête.
C’est pas la peine, je fais.
Lisbeth est peut-être une des dernières à cloper dans sa boutique. La fumée va avec les livres, c’est son arrangement à elle. Elle a pas tort. La fumée a toujours été bien avec les livres. Jadis, un écrivain qui fumait pas était un hygiéniste ou un économiste, et donc tout le contraire d’un écrivain, garanti. Un client âgé demande la biographie d’un peintre. A côté de lui, se tient une femme très maigre, cramponnée des deux mains aux brides d’un large sac qui touche presque le sol. Anorexie, ça. Lisbeth opine. Elle dit rien, son mari demande toujours des trucs impossibles et de toutes façons, les rares fois où j’avais en boutique ce qu’il voulait, il n’a pas acheté.
Je trempe les lèvres dans mon whisky. Je les regarde qui s’en vont, ce couple, curieux. Ils ont le même dos. Lui à cause de l’âge, elle à cause de la maladie. Une chemise flottante et une robe à motifs qui recouvrent les omoplates saillantes comme les statues de l’ile de Pâques.
Lisbeth rallume encore une clope. C’est gentil d’être passé, dit-elle.
Je n’ose rien lui dire. Je regarde la moquette, ça et là, qui ne tient plus sur le plancher. Râpée. Les étagères où les livres, même eux, dirait-on, s’ennuient à porter les siècles anciens qui n’intéressent plus le chaland. Il parait que cette librairie date de l’Empire. Le premier… Tout ça sent le sapin.
Tu viendras aider pour l’inventaire ?
J’opine.
Il fera chaud. Livre par livre, nous cocherons des listes. Ce sera l’occasion de faire le ménage. Juste un chouya. Comme chaque année. Je me retourne avant de passer l’angle de la rue.
Lisbeth est déjà retournée à sa banquette. La bouteille est juste dessous.
A suivre : Lisbeth II :
19:29 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : librairie, whisky, bouquinistes | 
vendredi, 03 juillet 2009
Comme Cripure ?
« Et pour couronner l’ouvrage, s’envoyer la corvée du bachot, faire passer leur examen à ces petits messieurs, pauvres gosses volés, dupés, scandaleusement. Il se prêterait à la comédie, toujours complice. Et même, il tirerait profit de la circonstance. Il ne pensait pas seulement en effet au dérisoire bénéfice des quelques francs alloués par copie corrigée – ce qui ne faisait jamais une grosse somme, mais enfin, c’était toujours bon à prendre – mais à un profit plus réel : il irait, comme d’habitude, prendre pension à l’Alcazar. Tous les ans dans la saison du bachot, quand il lui fallait aller à Sernen faire passer l’oral, session qui durait plusieurs jours, c’est à l’Alcazar qu’il prenait pension, c'est-à-dire au bordel »
Louis Guilloux (Le Sang noir) pp 141- 142, folio (souci professoral du détail)

la tronche à George Palante,
qui servit de modèle (partiellement) à Louis Guilloux
pour le personnage de Cripure
06:58 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cripure, george palante, le sang noir, littérature, bachot, actualité, théâtre | 









