mercredi, 13 janvier 2016
Manifestation (6)
VI
« Ne vous modelez pas sur le temps présent » : l’exhortation de saint Paul aux Romains ne pouvait mieux résumer ce besoin de mise à l’écart qu'il ressentait par rapport aux fous furieux qui dirigeaient le pays. La légèreté avec laquelle la « laïcité à la française » traitait le fait religieux depuis quelques mois le laissait en effet pantois. Un tel aveuglement pouvait-il être involontaire ?
Un président qui, le même jour (le 11 janvier 2015), dresse le panégyrique de la République pour finir la soirée dans une synagogue et qui, un an plus tard, après avoir dénoncé les méfaits d’un état islamique radical, va boire le thé dans une mosquée tout en se prétendant « père de la nation » (le 11 janvier 2016), courant les religions comme autant de marchés électoraux, c'était non seulement inconséquent, stupide, mais surtout dangereux au plus haut point. Car ce président irresponsable engageait non seulement sa parole, mais celle aussi du pays ; sa sécurité, mais aussi celle du peuple qu’il représentait si mal depuis quatre ans sur la scène internationale. Il serait temps de le démissionner Seigneur, songea Jérôme, en poussant la poste de son modeste appartement.
Il préférait, et de loin, la posture lucide de son prédécesseur qui, dans son discours du Latran avait déclaré en décembre 2007 que « l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur ». Sarkozy, lui, avait au moins compris en quoi le républicanisme ne peut être une religion. On peut reprocher beaucoup de choses à la droite française, mais pas au moins cette posture clownesque de curé laïc, adoptée par les Cazeneuve, Taubira, Valls, Belkacem, et autre Tartuffe inconditionnels du vivre ensemble. Il ne leur manquait à tous, décidément, qu'un nez de clown pour ressembler à Bozo, pensa-t-il en se servant un verre de muscadet. Méritaient-ils sa fureur ? Non pas... Mais ils étaient dangereux. Fous dangereux. Là était tout le problème. Et lui, que pouvait-il, sinon subir, subir et subir ? « La mort des pauvres est la fin d’une corvée », écrivait Louis Guilloux dans Les Batailles Perdues.
C’était certes un vœu pieu de désirer que toutes les religions cohabitent, mais il aurait fallu pour cela une théologie plus sérieuse que la ribambelle de lieux communs, érigés en loges, que leur servaient matin, midi et soir les médias à la botte du régime. Il aurait fallu plus de culture véritable que n’en avaient ces pitres formatés par les grandes écoles, plus de réelle ouverture à l’autre que ces discours de façade rédigés par des communicants, plus de courage, enfin, que n’en avaient ces girouettes qui passent d’un discours à un autre comme on change de préservatifs. Car non, marmonnait Jérôme en vidant son muscadet, la vie des pauvres ne peut être une corvée.
Saint Paul, évidemment parlait d’or lorsqu’il invitait les Romains à ne pas se modeler au temps présent, mais à se laisser transformer par le renouvellement de l’intelligence afin de discerner la volonté de Dieu : « ce qui, disait-il, est bon, agréable et parfait ». Au fond, c'est tout le Régime qui était corrompu, qui prétendait assurer la protection et la sécurité en faisant régner l'arbitraire et la terreur, rien de neuf sous le soleil, de Pilate à Hollande...
« Les Lumières, professait jadis Kant, c’est la sortie de l’homme de sa propre minorité, dont il est lui-même responsable ». Version décalquée et dégradée de ce que Christ le Doux avait inauguré en inventant l’homme libre : « «Le salut, c’est la sortie de l’homme de son propre péché, dont il est lui-même responsable. » De toute évidence, l'athéisme post-moderne niait l’une et l’autre proposition : l’homme devait demeurer dans sa propre minorité et dans son péché à la fois. Plus d'issue par la verticalité, et plus non plus par l'horizontalité : La preuve ? Tout ce que le locataire autiste de l'Élysée trouvait à proposer face au « malaise de la jeunesse » était … Un livret de citoyenneté ! Le collège à vie, autrement dit, et le droit d'élire tous les cinq ans son délégué... Mais il est vrai que ce président-là n'avait pour seul charisme que celui d'un principal de collège.
-(A SUIVRE)

CONVERSION DE PAUL
08:00 Publié dans Des nouvelles et des romans, Manifestation | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, christianisme, islam, religion, république, laïcité, saint paul, épitre aux romains, bible, littérature, louis guilloux | 
samedi, 27 octobre 2012
Les ténèbres électrisés
Quand venait le soir autrefois et que je regardais la ville, tout ce qui l’entourait restait plongé dans les ténèbres. La ville n’était qu’un ramassis de vieux toits et de clochers : le clocher pointu de Nazareth, celui de l’hôpital, le dôme de la gare, les deux tours carrés de l’église Saint-Michel sur l’une desquelles pendant plus de quatre ans, jour et nuit, une sentinelle allemande monta la garde. Certaines nuits sans lune étaient si noires que si nous devions sortir après le couvre-feu, il nous arrivait de nous perdre et de tâter les murs. Quel bonheur, quelle surprise quand les lumières se sont remises à briller ! Il y a maintenant trente ans et de plus en plus de lumières. Faut-il les croire ?
Autrefois, j’entendais siffler les trains. Je voyais le train de Paris tout rutilant courir au fond de la nuit. Je ne le vois plus. Je ne l’entends plus siffler. Selon l’orientation des vents, j’entendais l’heure tinter au clocher de notre vieille cathédrale Saint-Etienne. Que s’est-il passé ?
Sur le plateau, là où s’édifie à présent la cité industrielle, on ne voyait que des champs et, parmi eux, un grand champ de colza. Je ne me lassais pas d’en regarder les moissons onduler au vent du soir. Le champ de colza, comme tout ce qui l’entourait, a disparu, à la place s’élèvent aujourd’hui de grands ensembles. Le soir, on dirait des blocs de cristal transpercés de lumière. La vieille ville est bien noire sous les orgueilleux lampions, toute consentie, toute résignée. Plus les lumières se multiplient autour d’elle plus elle se recroqueville, plus elle se cache, comme une vieille femme qui se ramasse sous un capuchon. A quoi rêve-t-elle ? Et où sont passées la vieille rue des Champs-Gibet et la rue de la Clouterie ? La rue des Filotiers ? La rue des Tanneurs ? Rien ne dure. Nous avons encore notre rue aux Toiles et notre rue Charbonnerie qui fut la rue des Charbonniers, notre rue de la Mare-au-Coq et la rue de la Fontaine Sucrée – mais pour combien de temps encore ? Ce qui reste de la vieille ville est comme un tison qui s’éteint au bout de quinze cents ans ! (…)
Le soir en regardant les lumières de la ville, je me souviens d’avoir ouï dire que, du temps de mes grand-pères, les rues n’étaient éclairées que par des lampes à huile, et encore ne les allumait-on pas les soirs de lune – mais sont arrivés les becs de gaz, et je me souviens fort bien de l’allumeur de réverbères, avec sa grande perche sur l’épaule, et la poire qu’il pressait pour faire la flamme, et après le gaz, la fée électricité et et les grandes lumières partout que c’en est une féerie. Oui mais sommes-nous mieux qu’avant ? Vend-on encore les pauvres gens ?
Louis Guilloux, L’herbe d’oubli, 1984

Lyon, fête des Lumières, édition d'hier ou de demain...
18:34 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : louis guilloux, fête des lumières, lyon | 
jeudi, 07 janvier 2010
Camus et la pauvreté
« Presque tous les écrivains français qui prétendent aujourd’hui parler au nom de prolétariat sont nés de parents aisés ou fortunés. Ce n’est pas une tare, il y a du hasard dans la naissance, et je ne trouve cela ni bien du mal. Je me borne de signaler au sociologue une anomalie et un objet d’études. On peut d’ailleurs essayer d’expliquer ce paradoxe en soutenant, avec un sage de mes amis, que parler de ce qu’on ignore finit par vous l’apprendre.
Il reste qu’on peut avoir ses préférences. Et pour moi, j’ai toujours préféré qu’on témoignât, si j’ose dire, après avoir été égorgé. La pauvreté, par exemple, laisse à ceux qui l’ont vécu une intolérance qui supporte mal qu’on parle d’un certain dénuement autrement qu’en connaissance de cause. Dans les périodiques et les livres rédigés par les spécialistes du prolétariat, on traite souvent du prolétariat comme d’une tribu aux étranges coutumes et on en parle alors d’ne manière qui donnerait aux prolétaires la nausée si seulement ils avaient le temps de lire les spécialistes pour s’informer de la bonne marche du progrès. De la flatterie dégoutante au mépris ingénu, il est difficile de savoir ce qui, dans ces homélies, est le plus insultant. Ne peut-on vraiment se priver d’utiliser et de dégrader ce qu’on prétend défendre ? Faut-il que la misère toujours soit volée deux fois ? Je ne le pense pas. Quelques hommes au moins, avec Vallès et Dabit, ont su trouver le seul langage qui convenait. Voilà pourquoi j’admire et j’aime l’œuvre de Louis Guilloux, qui ne flatte ni ne méprise le peuple dont il parle et qui lui restitue la seule grandeur qu’on ne puisse lui arracher, celle de la vérité. »
Préface de La Maison du Peuple (ré.ed 1947) de Louis Guilloux
En 1947, précisément, Albert Camus et Jean Grenier rendirent visite à Louis Guilloux Ils passèrent d’abord par Rennes, Combourg, Saint-Malo. Puis arrivèrent à Saint-Brieuc. Louis Guilloux conduisit Camus sur la tombe de son père, Lucien Camus, blessé grièvement lors de la bataille de la Marne en 1914, qui avait été rapatrié à l’hôpital de fortune installé dans l’école du sacré Cœur de Saint-Brieuc, et qui était mort à 29 ans.
L’année suivante, c’est Guilloux qui fit le voyage pour Sidi-Madani, en Algérie. En 1949, Albert Camus imposa au comité de lecture de Gallimard Le Jeu de Patience, grâce auquel, en empochant le Renaudot, Louis Guilloux put enfin sortir de l’ombre à cinquante ans : le livre de format in-octavo comportait plus de 800 pages de 48 lignes à raison de 65 signes par ligne. Plus de 300 personnages : impubliable aujourd’hui, assurément D’ailleurs, on ne le trouve pas même en collection de poche folio…
14:21 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : albert camus, louis guilloux, littérature | 
mercredi, 14 octobre 2009
14 octobre 1980
Mort de Louis Guilloux, un jour de pluie, à Saint-Brieuc.
"Quand venait le soir autrefois et que je regardais la ville, tout ce qui l’entourait restait plongé dans les ténèbres. La ville n’était qu’un ramassis de vieux toits et de clochers : le clocher pointu de Nazareth, celui de l’hôpital, le dôme de la gare, les deux tours carrés de l’église Saint-Michel sur l’une desquelles pendant plus de quatre ans, jour et nuit, une sentinelle allemande monta la garde. Certaines nuits sans lune étaient si noires que si nous devions sortir après le couvre-feu, il nous arrivait de nous perdre et de tâter les murs. Quel bonheur, quelle surprise quand les lumières se sont remises à briller ! Il y a maintenant trente ans et de plus en plus de lumières. Faut-il les croire ? Autrefois, j’entendais siffler les trains. Je voyais le train de Paris tout rutilant courir au fond de la nuit. Je ne le vois plus. Je ne l’entends plus siffler. Selon l’orientation des vents, j’entendais l’heure tinter au clocher de notre vieille cathédrale Saint-Etienne. Que s’est-il passé ?
Sur le plateau, là où s’édifie à présent la cité industrielle, on ne voyait que des champs et, parmi eux, un grand champ de colza. Je ne me lassais pas d’en regarder les moissons onduler au vent du soir. Le champ de colza, comme tout ce qui l’entourait, a disparu, à la place s’élèvent aujourd’hui de grands ensembles. Le soir, on dirait des blocs de cristal transpercés de lumière. La vieille ville est bien noire sous les orgueilleux lampions, toute consentie, toute résignée. Plus les lumières se multiplient autour d’elle plus elle se recroqueville, plus elle se cache, comme une vieille femme qui se ramasse sous un capuchon. A quoi rêve-t-elle, si elle rêve ? Et où sont passées la vieille rue des Champs-Gibet et la rue de la Clouterie ? La rue des Filotiers ? La rue des Tanneurs ? Rien ne dure. Nous avons encore notre rue aux Toiles et notre rue Charbonnerie qui fut la rue es Charbonniers, notre rue de la Mare-au-Coq et la rue de la Fontaine Sucrée – mais pour combien de temps encore ? Ce qui reste de la vieille ville est comme un tison qui s’éteint, au bout de quinze cents ans !(…)
Le soir en regardant les lumières de la ville, je me souviens d’avoir ouï dire que, du temps de mes grand-père, les rues n’étaient éclairées que par des lampes à huile, et encore ne les allumait-on pas les soirs de lune – mais sont arrivés les becs de gaz, et je me souviens fort bien de l’allumeur de réverbères, avec sa grande perche sur l’épaule, et la poire qu’il pressait pour faire la flamme, et après le gaz, la fée électricité et les grandes lumières partout que c’en est une féerie. Oui mais sommes-nous mieux qu’avant ? Vend-on encore les pauvres gens ?"
Louis Guilloux, L’herbe d’oubli, 1984
Les articles à propos de Louis Guilloux consultables au fil de ce blog :
- A propos de l'émission Apostrophes que B.Pivot lui a consacré :
http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/13/louis-guilloux-franc-tireur.html
- Une lecture du Pain des Rêves :
http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/18/louis-guilloux-et-la-chronique.html
- Une lecture du Sang Noir :
http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/17/louis-guilloux-l-esprit-de-fable-3.html
-Une lecture de La Confrontation :
http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/15/louis-guilloux-l-esprit-de-fable-22.html
- Louis Guilloux et l'esprit de fable:
http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/14/louis-guilloux-l-esprit-de-fable.html
- D'une guerre l'autre
http://solko.hautetfort.com/archive/2009/09/23/louis-guil...
06:25 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, louis guilloux, saint-brieuc, l'herbe d'oubli, romans | 
vendredi, 25 septembre 2009
Louis Guilloux : d'une guerre l'autre
Nous saluons l'un des événements majeurs de cette rentrée littéraire, la parution dans la collection In quarto de Gallimard (et ce à quelques semaines de l'anniversaire de sa mort) de plusieurs récits de Louis Guilloux. Le volume en question, préfacé par Philippe Roger, comprend la Maison du peuple & Compagnons, Labyrinthe, qu'on ne trouvait jusqu'alors que dans les "Cahiers rouges" de Grasset, ainsi que Douze balles en breloques, OK Joe, Le sang Noir et L'herbe d'oubli (publiés par la Blanche et pour seulement quelques titres en folio). Les préfaces de Camus (La maison du peuple) et Malraux (Le sang noir) complètent le volume.
On pourra s'étonner du ridicule du titre (D'une guerre l'autre), calqué sur l'expression célinienne, devenue une véritable tarte à la crême et le trait d'un snobisme autant salonnard que pseudo-universitaire fort irritant, titre que Louis Guilloux, j'en suis certain, aurait détesté. Il n'empêche. Pour ceux qui connaissent et apprécient l'oeuvre de Louis Guilloux comme pour ceux qui, à travers cette ré-édition partielle (pourquoi n'y figure pas Le Pain des Rêves ? ) la découvriront, c'est une excellente initiative. L'occasion également de rappeler les articles consultables sur ce blogue à propos de l'oeuvre, majeure, de Louis Guilloux

Les articles à propos de Louis Guilloux consultables au fil de ce blog :
- A propos de l'émission Apostrophes que B.Pivot lui a consacré :
http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/13/louis-guilloux-franc-tireur.html
- Une lecture du Pain des Rêves :
http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/18/louis-guilloux-et-la-chronique.html
- Une lecture du Sang Noir :
http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/17/louis-guilloux-l-esprit-de-fable-3.html
-Une lecture de La Confrontation :
http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/15/louis-guilloux-l-esprit-de-fable-22.html
- Louis Guilloux et l'esprit de fable:
http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/14/louis-guilloux-l-esprit-de-fable.html
10:45 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : louis guilloux, d'une guerre l'autre, philippe roger, littérature, gallimard quarto, saint-brieuc, solko | 
lundi, 06 juillet 2009
Rotrou, Guilloux, même combat
Deux jours encore d’interrogations. Plus que deux jours. Me disais, vendredi soir, l’esprit essoré à force de revivre la même-même scène (« votre convocation s’il vous plait, votre papier d’identité, vous prendrez ce texte de votre liste… vous avez une demi-heure… ») et d’entendre en gros, les mêmes-mêmes choses dans la bouche de gens qui se ressemblent (des parents qui se ressemblent tous plus ou moins ne pouvant faire, au fond, que des enfants qui se ressemblent tous moins ou plus, eh oui, c'est ainsi) – ronron rassérénant autant que révoltant - , me disais, plus la peine de s’illusionner, qu’il n’y a plus aucune issue dans cette société de masse… Et que le bachot - comme le permis de conduire et le droit de vote – n’est plus qu’un ticket tristounet pour entrer dans le cinéma du monde libre (Et quel cinéma ! Finie la petite salle de quartier, vaste complexe, partout, même film de Tokyo à Dubaï, nom de Dieu ! - et pour mardi, c'est déjà prévu, même enterrement pour tous !). Me disais que je n’avais été au mieux, durant ces trois derniers jours d’interrogations, qu’un moniteur d’auto-littéraire, ou un assesseur de bureau de bac. Comme on voudra. Remplisseur de formulaires, parfaitement lisse.
Là-dessus, j’ai passé le week-end à relire Le Sang Noir de Louis Guilloux, œuvre que j’étudierai l’an prochain en classe avec des élèves, quels que soient ceux qu’on m’attribuera, après tout. Comme l’Education nationale est faite : une année s’achève tout juste, qu’il faut programmer la prochaine : les autoroutes de l’éducation, et comment faire autrement, là-aussi ? Dans tous les établissements scolaires, ça turbine à l’heure actuelle autour des répartitions de classes et des emplois du temps des uns et des autres. Et drôlement, ça turbine. Jonglage avec des blocs horaires, des salles et des étages, et des options de ceci, de cela. On ferme le quatorze juillet, réouverture au premier septembre. C’est tout pareil, partout : service public. Tout n’est affaire, dans cette société, que de gestion des masses : de la crèche au crématorium, nous ne serons bientôt plus que du personnel de surveillance ou de divertissement.
Pour tenir le coup, voilà donc, Le Sang Noir. Et pour faire bon poids bonne mesure, en œuvre théâtrale, je ferai lire aux élèves et j’étudierai avec eux Le Véritable Saint-Genest de Rotrou. Si j’étais directeur de salle, je la monterais bien, cette pièce. Mais je suis un metteur en scène sans salle. L’une des plus justes, des plus troublantes qui fut écrite. L’essence du romanesque comme l’essence du théâtre, le roman labyrinthe & la pièce miroir : Guilloux, Rotrou, même combat ? de quoi perdre pied de brefs instants, ou leur en donner l’illusion, malgré le système technologique qui les mène, eux, moi, vous et le monde ; Cripure, Genest, même œuvre et même chant :
« J’ai vu, Ciel, tu le sais, par le nombre des âmes
Que j’osai t’envoyer par des chemins de flammes
Dessus les grils ardents et dedans les taureaux
Chanter les condamnés et trembler les bourreaux… »
Le véritable Saint Genest, Rotrou – (II,4)
Ci-dessous, Louis Guilloux, par Cabu

19:46 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : théâtre, littérature, éducation, bachot, rotrou, louis guilloux, saint-genest, cripure, alléluia | 
mercredi, 01 juillet 2009
Batailles Perdues ?
La puissance de la littérature, c’est d’abord de dire le commun. Le commun dans ce qu’il a d’original, bien sûr, j’entends par là de non copié sur ou de non recopié de ou, à présent, de non "copier-coller"… Se souvenir de notre unicité commune.
Cette très belle phrase de Marcel Proust, que Louis Guilloux avait recopié en exergue sur l’un des cahiers où il écrivit, en 1934-1935 son très très beau roman, Le sang noir : «Ce que nous n’avons pas eu à déchiffrer, à éclaircir par notre effort personnel, ce qui était clair avant nous n’est pas à nous. Ne vient de nous-mêmes que ce que nous tirons de l’obscurité qui est en nous, et que ne connaissent pas les autres. »
Et puis aussi la formule percutante trouvée et mise en bandeau lors de la première parution du Sang Noir : « La vérité de cette vie, ce n’est pas qu’on meurt, c’est qu’on meurt volé ».
Je pensais à cela en arpentant les travées du cimetière de la Guillotière. Puis, chez un bouquiniste de la rue Juiverie, près de la gare Saint-Paul, j’ai trouvé l’adaptation que Guilloux a faite du Sang Noir pour le théâtre, qu'il a tout bonnement nommée Cripure, et que Marcel Maréchal a jouée dans les années soixante. Si loin de nous déjà, comme sourds, bien que sensibles, au temps. Le vingtième siècle se retire peu à peu, avec ses batailles. Drôle de journée. Un ami que j’ai rencontré hier après midi à l’enterrement de Maurice Moissonnier où furent longuement évoqués, bien sûr, les luttes et les combats populaires du vingtième siècle m’a dit, l’air absent : « il nous reste du grain à moudre ». Et comme il regardait le cercueil qui allait descendre dans l’incinérateur, je n’ai pas compris s’il voulait dire : il y a encore des luttes à mener ou bien il nous reste aussi à mourir. Etrange malentendu. Dieu sait que la mort n’est pas une mince affaire, et que cette société horrible et sa détestation de tout ce qui n’est pas spectacle immédiat ne nous aide pas à nous y préparer sereinement. Je regardais les assistants se disperser par grappes dans l’allée centrale, et je songeais pourtant à quel point, dans ce siècle technologique et dément, chacun d’entre nous aurait besoin du philosophe.
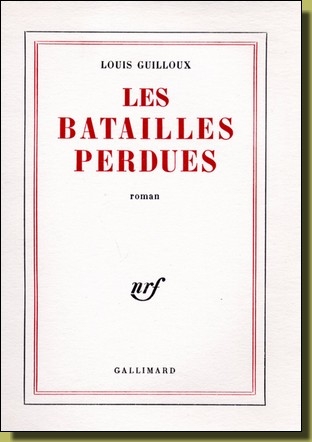
00:09 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature, louis guilloux, cripure, politique, cimetière, mort | 
samedi, 18 octobre 2008
Louis Guilloux et la chronique
Bien que Le Pain des rêves se présente à nous comme un récit d’apparence autobiographique, tous ses personnages appartiennent à ce que Louis Guilloux appelle sa Chronique, et qui prendra jour en 1949 dans Le Jeu de Patience. Une chronique est « un recueil de faits historiques, rapportés dans l’ordre de leur succession » (Petit Robert). Le genre connaît ses heures de gloire durant le haut Moyen Age avec Froissart et Joinville, qui fixent dans leurs chroniques (Vie de Saint Louis) les exploits de leurs Rois, ceci afin de laisser trace de leurs passages dans l’histoire des hommes.
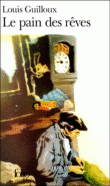 Dans Le Pain des Rêves, cependant il ne se passe rien. Rien de dramatique, rien qui soit digne d’être conté : un vieil homme coud. Il coud toute la journée, toute la semaine, tout le mois et toute l’année. Son petit-fils le regarde. Il regarde l’homme qui coud, « cette gravité plus pathétique que celle du penseur » et il rêve que son grand père est un roi. Ou plutôt, non, je corrige : « Ce n’était pas un roi, mais le Roi. Le roi lui-même enfermé depuis des années dans un cachot, autrefois une écurie, et qu’on venait de délivrer» Nous sommes à Saint-Brieuc, à la charnière entre le dix-neuvième et le vingtième siècle. Avec les démolitions des vieilles maisons du XVème siècle transformées en taudis, « l’esprit d’une nouvelle époque soufflait son chemin dans les ruines » L’enfant découvre l’école, les fêtes religieuses et militaires qui scandent l’année, le théâtre l’injustice sociale : il découvre ce qu’il appelle « la diabolique fantaisie du monde ». Sorte de petit chose l’enfant ne comprend pas pourquoi sa mère et son grand père sont si pauvres, pourquoi son frère est infirme, pourquoi, aux yeux de toute la ville, il fait partie des voyous de la rue du Tonneau. Puis le grand père meurt. Survient une étrange cousine, la cousine Zabelle, qui va s’occuper désormais de lui. Entre en scène un premier amour. Bientôt, l’enfant va entrer, lui, au lycée.
Dans Le Pain des Rêves, cependant il ne se passe rien. Rien de dramatique, rien qui soit digne d’être conté : un vieil homme coud. Il coud toute la journée, toute la semaine, tout le mois et toute l’année. Son petit-fils le regarde. Il regarde l’homme qui coud, « cette gravité plus pathétique que celle du penseur » et il rêve que son grand père est un roi. Ou plutôt, non, je corrige : « Ce n’était pas un roi, mais le Roi. Le roi lui-même enfermé depuis des années dans un cachot, autrefois une écurie, et qu’on venait de délivrer» Nous sommes à Saint-Brieuc, à la charnière entre le dix-neuvième et le vingtième siècle. Avec les démolitions des vieilles maisons du XVème siècle transformées en taudis, « l’esprit d’une nouvelle époque soufflait son chemin dans les ruines » L’enfant découvre l’école, les fêtes religieuses et militaires qui scandent l’année, le théâtre l’injustice sociale : il découvre ce qu’il appelle « la diabolique fantaisie du monde ». Sorte de petit chose l’enfant ne comprend pas pourquoi sa mère et son grand père sont si pauvres, pourquoi son frère est infirme, pourquoi, aux yeux de toute la ville, il fait partie des voyous de la rue du Tonneau. Puis le grand père meurt. Survient une étrange cousine, la cousine Zabelle, qui va s’occuper désormais de lui. Entre en scène un premier amour. Bientôt, l’enfant va entrer, lui, au lycée.
Toute l’intrigue du Pain des Rêves tourne autour de cette question que l’enfant qui grandit se pose malgré lui : pourquoi sommes-nous si pauvres ? Le récit explore ainsi toute l'ambiguïté offerte par le titre : Parle-t-on du pain dont on rêve ou du rêve dont on se nourrit ? du pain fait rêve ou du rêve fait pain ? La déchristianisation en cours du pays transforme le statut même du pauvre, le regard dont on l'enrobe comme celui qu'il pose sur lui-même et ses semblables.
Cela, Charles Péguy et Léon Bloy l'ont également noté. Rien de plus éloquent, à cet égard, que cette remarque de Bloy : "Le comble de la misère humaine, c'est la haine du pauvre par les pauvres." L'apprentissage de l'enfant-narrateur, dans cette France de 1905, consistera donc à placer tous ses efforts pour ne pas laisser cette misère morale le contaminer. "Je doute qu'aucun amour vaille celui des pauvres, écrit Guilloux. Le nôtre était un amour religieux. Nous savions que cet amour-là n'était possible qu'à l'intérieur d'une certaine catégorie, qu'il n'était propre qu'à de certains êtres, vivant dans des conditions définies : les nôtres. (...) Oui, nous savions, et peut-être même était-ce ce que nous savions le mieux, que cet amour tirait sa plus grande force du fait qu'ailleurs, nous n'étions pas aimés."
(Le Pain des rêves, première partie)
Si l’on peut parler, à propos du Pain des Rêves de chronique, c’est en référence à ce souci constant de Guilloux, à la fois de parler vrai et d’offrir à ses personnages l’abri de sa mémoire. Comme beaucoup d’écrivains de sa génération Louis Guilloux a conscience d’appartenir à un monde dont on a dit beaucoup de mensonges et qui est voué à la dissolution : le monde du petit peuple, celui dont il est issu. L’homme du peuple : le romantisme lyrique et le naturalisme scientiste qui, tour à tour, en ont fait un motif littéraire, un thème bourgeois, l’ont soit mythifié, soit caricaturé, soit transfiguré. Hugo, ce n’est « qu’un grand et beau mensonge » nous dit Louis Guilloux. Or, ce mensonge demande une réparation. Ecrit en pleine période d’Occupation allemande, Le Pain des Rêves, récit d’enfance, galerie de portraits, début de la longue chronique qui occupera toute la suite de l’œuvre, jusqu’à L’Herbe d’Oubli, aura été cette nécessaire réparation.
11:46 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : louis guilloux, le pain des rêves, saint-brieuc | 
mercredi, 15 octobre 2008
Louis Guilloux : La Confrontation
La parution de La Confrontation, en 1968, ne précède que de quatre mois les événements de mai. Un des personnages, le maçon Philippe, ne les annonce-t-il d’ailleurs pas lorsqu’il s’écrie : «Après six mois de grève générale, il faudra bien réviser le problème une fois pour toutes. » Mais les événements ne dureront qu’un mois, et c’est dans un silence consterné que Louis Guilloux voit, à la télévision, son vieil ami Malraux descendre les Champs Elysée à la tête du cortège des « réactionnaires », la main dans celle de Michel Debré. Il garde alors le silence, comme, au retour du voyage de 36 en URSS, et au contraire d’un autre ami, André Gide, il s’était tu. Il sait depuis longtemps qu’il n’est ni un homme du spectacle, ni un homme de l’instantané : « J’ai laissé le journal », se contente de déclarer le narrateur de La Confrontation devant les événements contemporains : guerre du Vietnam, incidents raciaux aux Etats-Unis, dictature militaire en Grèce. « Quel beau siècle que le nôtre ! », se contente-t-il de remarquer. Ce récit bref sonne-t-il, dans l’œuvre ardemment militante, l’heure du retrait ? « Si un homme de vingt-cinq ans a quelque chose à dire aux autres, ce n’est probablement pas ce qu’il dira à trente-cinq et, à plus forte raison, ce que dira un homme de quarante ou cinquante ans » (1) , note-t-il dans les brouillons de L’herbe d’oubli. Or il a alors soixante neuf ans.
Depuis 1962, il a en tête l’idée de raconter l’histoire d’un « détective recherchant quelqu’un qui est l’homme même qui s’est adressé à lui ». Ainsi écrit-il alors, « celui-ci connaîtra indirectement son passé et ce qu’il a été dit de lui ». La confrontation initiale est donc, dans l’esprit de l’auteur, celle d’un homme avec son image publique. L’intrigue du roman met en effet en scène un ancien journaliste, sollicité par un certain Germain Forestier à enquêter sur un certain Gérard Ollivier. Le premier ayant perdu le second de vue, il désire, avant de lui léguer une somme importante, savoir s’il en est digne. Le récit se présente comme le rapport oral que le journaliste narrateur chargé de l’enquête (je) livre à son terme à son commanditaire, durant une nuit entière, dans la petite chambre de bonne qu’il habite en plein quartier latin, et qui du coup s’adresse directement au lecteur (vous). Ce dernier s’aperçoit très rapidement que cette voix narrative n’est qu’un habile truchement qui ne masque qu’à peine la personne de l’auteur lui-même ; toujours dans L’herbe d’oubli, ce dernier note :
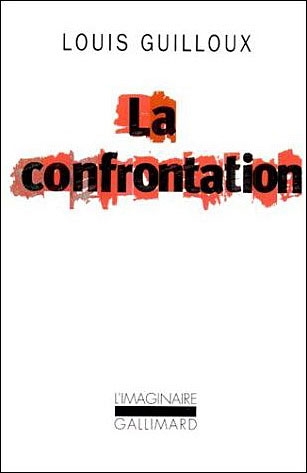 « La distance entre le personnage et la personne paraît énorme. Mais ne peut-on tout bonnement décider que cette distance-là peut aisément se réduire jusqu’à disparaître dans une fusion complète, que bon nombre de romans ne sont guère autre chose que des Mémoires déguisés, que nombre de « mémoires » constituent une matière romanesque à l’état but, enfin que si l’on n’éprouve pas l’envie de se mettre un masque, on peut tout aussi bien, en s’épargnant le mal d’inventer, raconter ce qu’on a vu et su (…), à condition qu’on ait le courage de dire partout la vérité, même et surtout quand l’amour propre voudrait qu’on l’habille ? Il faut que les choses vous soient devenues comme indifférentes dans la distance qui vous en sépare, qu’elles cous apparaissent à vous-même comme étant arrivées à un autre, et que, en tout cas, il ne s’agisse jamais de se vanter. » (2)
« La distance entre le personnage et la personne paraît énorme. Mais ne peut-on tout bonnement décider que cette distance-là peut aisément se réduire jusqu’à disparaître dans une fusion complète, que bon nombre de romans ne sont guère autre chose que des Mémoires déguisés, que nombre de « mémoires » constituent une matière romanesque à l’état but, enfin que si l’on n’éprouve pas l’envie de se mettre un masque, on peut tout aussi bien, en s’épargnant le mal d’inventer, raconter ce qu’on a vu et su (…), à condition qu’on ait le courage de dire partout la vérité, même et surtout quand l’amour propre voudrait qu’on l’habille ? Il faut que les choses vous soient devenues comme indifférentes dans la distance qui vous en sépare, qu’elles cous apparaissent à vous-même comme étant arrivées à un autre, et que, en tout cas, il ne s’agisse jamais de se vanter. » (2)
Dans son roman, la question de la vérité n’est pas posé en terme de « Mémoires », mais en terme de « biographie » : Très vite, en effet, l’apparente intrigue policière tourne court pour se déliter dans le décor anodin d’une petite ville de province, Laval, et ses nombreux bars. Rien ne se passe et, « de la rue Sainte Catherine au boulevard Thiers », déclare le narrateur, « je tenais les deux bouts de la chaîne ». Comment le lecteur s’intéresserait-il plus longtemps à une enquête que dédaigne aussi ouvertement celui-là même qui la conduit ? Le banal, le fortuit, l’anecdotique occupent ironiquement le devant de la scène, réservé en principe dans ce genre de récit à l’action, au drame, au suspens : « plus aucune envie de me mettre à l’ouvrage, je vous assure ». La plaisanterie du voisin écossais du narrateur à propos du biographe enterré à côté de l’auteur éclaire la démarche poétique que prend le récit lorsque l’imagination « qui s’est mise en branle » le transforme en hasardeuse introspection intérieure : pour le journaliste enquêteur, il ne s’agit pas, en effet « de reconstituer un fait, les circonstances d’un délit, voire d’un crime (…) mais de reconstruire… une âme, en somme d’établir… une biographie ». Le narrateur, biographe d’un personnage imaginaire, rencontre alors un ami de celui sur lequel il enquête, « petit pédant » qui lui a dédié une pièce, « Le Monument ». Le héros fantomatique, véritable Arlésienne de ce roman, en est-il digne ? Telle est la confrontante question qui se pose bel et bien à Guilloux lui-même depuis que, l’année précédente, il a reçu le prix national des Arts et des lettres pour l’ensemble de son œuvre, telle est la question centrale de l’enquête menée entre fiction et réalité : peut-on, lorsqu’on est né pauvre, devenir riche et demeurer digne (revers de la question est-on digne de devenir riche ?) Faut-il accepter l’argent (Philippe, le maçon, affirme que non), la gloire, la consécration quand « le bordel est partout » ? « Il m’a semblé tout à coup que je devenais le jouet d’un immense canular » déclare J/L Boutier au fur et à mesure que se déroule son enquête désinvolte. Ou bien : « Vous n’allez pas me dire que je suis vieux jeu ». Ou encore « Quel abîme entre le Je et le Il. Peut-il être comblé ? » La question du personnage comme la figure même de l’auteur sont alors au cœur des préoccupations littéraires des jeunes romanciers, tous marqués par « l’ère du soupçon » ; et devant ces partisans de la modernité, le vieux rusé de Saint-Brieuc sait qu’il fait figure de vieux romancier, sympathique mais décalé. Un changement de ton ? Certes, la critique de l’époque a failli s’y tromper, tant la fusion progressive des trois personnages en un seul (celui de l’auteur) est un brouillage énonciatif propre à la littérature des années soixante. Mais la mise en abyme, la « confrontation » dans l’écriture même du roman entre deux procédés, celui de l’écrivain « du temps passé étudiant le milieu dans lequel il va camper son personnage » et celui qui consiste à tromper le lecteur par de nouvelles techniques narratives n’est-il pas plutôt, pour reprendre un mot du texte un « canular », un pastiche avant l’heure d’une « modernité » dont le pessimisme doux de l’auteur se raille : « Je me suis mis au nouveau roman pour ne pas me rouiller tout à fait », soupire le narrateur avant de revenir à l’essentiel, car pour lui, la question demeure évidemment sociale : « qui manque de pain ne rêve plus d’autre chose, et quelle est la première des choses ? Le pain ou le rêve ? ». Le lecteur du Pain des rêves, du Jeu de patience, du Sang noir et des Batailles perdues reconnaît là une voix qui ne se reconnaît que par ce qu’elle dit, et qui n’a d’autre souci que de répondre à la nécessité historique de son temps, même s’il doit contredire d’apparentes nécessités littéraires : A l’heure où la littérature se sépare de l’Histoire, épargnons-nous le mal d’inventer :
« Il faut faire avec ce qu’on a, écrit dans La ville cet auteur discret, qu’à l’heure de la mondialisation en cours il est plus que jamais nécessaire de redécouvrir, « non se venger mais venger les siens et pourtant n’offenser personne inconsidérément, dire la vérité quoiqu’il en puisse coûter à soi et aux autres, payer ses dettes, instruire les petits enfants en racontant comme au coin du feu à la vieille mode et sans trop se demander si on ne va pas radoter, si on n’a pas déjà raconté ailleurs ce qu’on s’apprête à raconter aujourd’hui ».
Telle pourrait être le sens de cette dignité qui fait tout l’enjeu de l’enquête. Il faut en définitive écouter ces petites vieilles, pauvres voisines du narrateur et de l’auteur lui-même, dont les pas ponctuent le roman et en forment la magistrale conclusion : « n’entends-tu pas comme des bruits de chaînes qu’on secoue ? » Cette œuvre dont on pouvait croire qu’elle sonnât le glas de l’écriture militante nous semble en définitive, parce qu’elle marque en la pastichant l’insignifiance de toute autre tentative aux yeux de l’auteur, constituer de par son titre même, La confrontation, une ultime œuvre de résistance.
07:54 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : louis guilloux, littérature, culture, la confrontation, saint-brieuc | 









