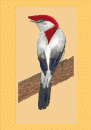mercredi, 06 mars 2013
Un héros picaresque
Félix avait longtemps refusé de s’engager dans une quelconque activité, traînant sa nonchalance d’un job sans importance à un autre sans intérêt. Les années cinquante le permettaient. Viré de l’Institution Saint-Christophe de Paray-le-Monial en classe de quatrième pour avoir été à l’origine d’un incendie de broussailles dans le parc, il avait été recueilli par sa grand-mère maternelle, qui possédait encore une petite propriété à La Clayette en Brionnais, vestige d’une fortune en partie défunte. La vieille dame ne le garda chez elle qu’un été. Elle parvint dès l’octobre de la même année à le placer comme apprenti jardinier au château de La Chaize, car une de ses amis d’enfance y avait épousé un majordome. Le château avait été construit en 1674 par François de la Chaize, frère cadet du fameux Révérend Père qui avait été conseiller de Louis XIV. Il avait offert par la suite son patronyme au cimetière le plus célèbre de France.
La propriétaire qui l’avait accueilli au château descendait directement du comte Pierre François de Montaigu. Celui-ci avait hérité du domaine élevé par le Roi Soleil au rang de marquisat, alors qu’il était ambassadeur de Louis XV à Venise, et avait eu pour secrétaire particulier Jean Jacques Rousseau. Ce dernier a beau parler du comte de Montaigu comme d’un pingre de peu de charisme et de très mauvaise foi dans ses Confessions, cela n’empêchait pas la marquise de Montaigu de claironner fièrement le nom et tous les titres du bonhomme, dès qu’elle évoquait l’un de ses ancêtres en public.
Félix avait séjourné jusqu’à sa seizième année au château, sous l’autorité d’un maître maigre et sec, aux mœurs ambigus avec les jeunes apprentis. Tous bichonnaient le Jardin à la française du château, l’un des plus purs du pays, un joyau de Le Nôtre disait ce maître en redressant le dos et arquant le sourcil. Bien que Félix n’ait jamais eu de tabou à parler des plaisirs du sexe, il resta toujours allusif sur ce qu’il avait souffert alors des mœurs libertines de ce bonhomme sous la charmille en arcades du potager, où légumes et feuillages pendaient en festons. En quittant aussi brusquement le château, il se condamnait à un destin à la Jean-Jacques, en un siècle autrement moins philosophique où le vagabondage n’avait souvent d’autre issue que le commerce.
Mais sa grand-mère était morte entre-temps. Oncles et tantes avaient fait comprendre à l’orphelin que le monde était vaste autour de la Bourgogne, et qu’il se ferait un tort infini de n’en pas explorer les plus extrêmes recoins. Ces oncles et tantes-là, tous propriétaires terriens, murmuraient quand on évoquait devant eux son nom, qu’il fallait un raté dans toutes les familles, et que la leur avait pondu celui-ci. Le raté en question, tout enclin à les satisfaire, prit alors son balluchon, et un train de nuit pour Paris.
Au petit matin, un étrange mousquetaire l’accueillait gare de Lyon. Coiffé d’un chapeau noir à plumes blanches et vêtu d’une longue cape noire, avec des rubans de soie, il faisait la Une de Paris-Match. On aurait dit Elisabeth II d’Angleterre. « Paris acclame la reine », titrait France-Soir. Avec son maigre pécule, Félix, qui arpenta d’abord les boulevards puis les rues plus encaissées et encombrées de la rive droite, eut du mal à se trouver une chambre hôtel, tous les établissements bon marché du Paris touristique étant pris d’assaut. Il passa donc sa première nuit à la belle étoile, et put croire que les feux d’artifice tirés sur la Seine en l’honneur de la jeune reine, l’étaient pour son bon plaisir.
Il parcourut beaucoup les rues que Paris lui ouvrait tout grand cette nuit-là, pour se tenir éveillé, d’une part, mais aussi parce que « un homme qui n’a plus de famille à dix-sept ans, n’a non plus personne pour encombrer son chemin » se disait-il, découvrant ce qu’il n’avait jusqu’alors connu qu’à travers quelques descriptions balzaciennes glanées au fil de ses classes, quelques images en noir et blanc dérobées à des films, et les témoignages de la comtesse de Montaigu : le boulevard Bonne Nouvelle, la porte Saint-Martin, la rue Saint-Denis, le coin des Halles, l’île de la Cité, Notre-Dame dans l’obscurité. Il était une heure du matin passé lorsqu’il entra dans un bistrot ouvert jusqu’à l’aube, place de la Contrescarpe, là même où « les clochards dansent tous en rond », chanta Brel un jour.
14:01 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, félix, la clayette, rousseau, elisabethii, france soir, paris match | 
mardi, 05 mars 2013
Déni de l'histoire
Impression confuse que le pays s’enfonce dans le déni de l’Histoire. Le président normal, le président qui dort, tente une synthèse mièvrement théâtrale de Mitterrand/Chirac (mariage pour tous/ salon de l’agriculture) tout en faisant comme si Sarkozy n’avait jamais existé (« tu ne le reverras plus »). Piètre acteur, sordide tacticien, il voudrait revenir à 2007, effacer l’affront, la blessure, ignorer le chômage et la crise, les lachetés européennes, les compromissions de tout poil, rassembler le personnel politique et les goûts d’alors, momies ranimées, Ségolène comprise. S’étonne de tomber si vite et si bas dans les sondages. Péché d’aveuglement.
La CGT, après avoir appelé à voter pour lui, manifeste contre lui. Tout rentre dans l’ordre des défilés carnavalesques et dans le sommeil des contestations convenues. Chacun son rôle dans la farce, Thibault et Parisot compris.
Pendant ce temps-là, il se passe des choses graves à Athènes, à Rome, à Lisbonne, à Madrid.
On attend les élections des députés européens de 2014 avec curiosité.
15:58 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : cgt, thibault, france, politique, europe | 
vendredi, 01 mars 2013
Main courante
L’écriture d’un roman est avant tout affaire de choix.
Si l’on ne veut pas perdre trop de temps avec ces foutus personnages qui ne sont soumis, eux, à aucune loi de gravité, il faut leur en donner une, il faut devenir leur gravité. Trancher dans leur gras, dans leur vif, dans leur existence. Etre un faiseur d’intrigues, ce qui dans le monde réel est l’activité la plus sordide, la plus détestable qui soit.
Les lecteurs d’à présent n’apprécient pas les descriptions. Avouons, à leur décharge que la culture de masses a aplati sans ménagement autour de nous les reliefs des anciennes sociétés. La pension de maman Vauquer (un avant-goût des Choses de Pérec) relèverait de la pire des provocations au lecteur de l’ère Ikea. Un peu comme faire un baise-main à Caroline Fourest à la sortie d’un mariage pour tous.
« Pour expliquer combien ce mobilier est vieux. crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchot, borgne, invalide, expirant, il faudrait en faire une description qui retarderait trop l'intérêt de cette histoire, et que les gens pressés ne pardonneraient pas. » (Les connaisseurs de Balzac apprécieront au passage l’emploi du conditionnel.)
Bref, le lecteur actuel ne pardonne pas en effet les longues descriptions, parce qu’il vit dans un monde dont les formes et les paysages standardisés offrent un intérêt de plus en plus limité, ce qui restreint davantage les choix du romancier au moins autant que ça simplifie la vie du sociologue. Disons que ça ne lui laisse que des options.
Autre débat, et de taille celui-ci, la part laissée aux lieux communs
Le roman étant le genre commun par excellence, il est évident qu’on ne peut, n'en déplaise à James Joyce, en extraire totalement le lieu commun. Ce serait d’ailleurs héroïque : il faudrait que le romancier lui-même ne soit pas un homme commun, ce qui est tout sauf le cas.
Tout, en ce domaine comme en d’autres, étant affaire d’ingrédients, on en revient à la question délicate du choix. Se démarquer du lieu commun (rebaptisé en novlangue pensée unique) est nécessaire pour faire œuvre d’originalité. S’en démarquer trop est malhabile en termes de marketing éditorial. Porte étroite pour les faux-monnayeurs, éluderait Gide, façon d'être ludique.
La question du lieu commun croise aussi celle du vocabulaire. Nous vivons dans un temps où il est hasardeux, par exemple, d’employer des verbes trop compliqués, je veux dire autres que faire, dire, voir, entendre, vouloir, pouvoir et niquer ; même remarque pour les noms, les adjectifs et les adverbes. Les mots simplifiés peuvent servir à mettre en valeur un terme moins courant. On parlera alors d’effet poétique, mais il ne faut pas en abuser. Nous sommes en temps de crise, ne l'oublions surtout pas.
Il semble que la marotte du critique contemporain soit le rythme. Un rythme qui n’est plus affaire de périodes, d’assonances ou d’allitérations mais (héritage de Céline) de ponctuation. En gros, il faut faire bref et binaire. Quelque chose comme 1 0 00 11 000 111 et ainsi de suite.
Nous sommes passés de l'ère de la plainte à celle de la main courante. Là, on ne nous a guère laissé le choix.
14:52 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, romanesque | 
jeudi, 28 février 2013
Romanesque Vatican
Un conclave va s’ouvrir. Contre les portes de la Sixtine, le très moderne « droit à l’information », qui n’est souvent qu’une variante habile de l’antique curiosité (le premier degré de l’orgueil, un péché, nous dit-on), va venir buter pendant plusieurs jours, pendant que les hommes en mozettes rouges délibèreront, prieront et voteront. Les militants de la modernité vont réclamer un pape à leur convenance, qui tienne compte de la fameuse « évolution de la société » (1), les spécialistes des religions vont proposer de brèves analyses aux normes des contraintes des plateaux télé (2), les communicants vont produire des formules et des images, et les journalistes vont faire des micros-trottoirs à la sortie des messes en attendant la fumée blanche place Saint-Pierre.
Le conclave avec son rituel, son protocole, sa théâtralité est un objet éminemment romanesque. Comme l’est d’ailleurs, dans l’Italie en crise, l’Europe en crise, la planète en crise, l’étrangeté du Vatican lui-même, véritable OVNI de la Trinité dans un temps qui ne sait plus penser qu'en binaire : « La plus vieille loi d’élection du monde est la loi en vertu de laquelle le pouvoir pontifical a été transmis de saint Pierre au prêtre qui porte aujourd’hui la tiare : de ce prêtre vous remontez de pape en pape jusqu’à des saints qui touchent au Christ ; au premier anneau de la chaine pontificale se trouve un Dieu », écrit Chateaubriand, alors ambassadeur à Rome (3)
Du Da Vinci Code au Vatileaks, cet univers vivant en huis-clos reste une inépuisable source de fantasmes et de rumeurs diverses. Rien de très neuf, me direz-vous, les soupçons d’homosexualité et de blanchiment d’argent étant déjà présents chez Du Bellay au XVIe siècle
Si je monte au Palais, je n'y trouve qu'orgueil,
Que vice déguisé, qu'une cérémonie,
Qu'un bruit de tambourins, qu'une étrange harmonle,
Et de rouges habits un superbe appareil :
Si je descends en banque, un amas et recueil
De nouvelles je trouve, une usure infinie,
De riches Florentins une troupe bannie,
Et de pauvres Siennois un lamentable deuil (4)
Dans la figure du cardinal électeur se télescopent la mémoire séculaire de la Tradition et l’imaginaire moderne qu’elle ne cesse de heurter, par son seul et heureux maintien. Rajoutons le fait que le cardinal est un être de liturgie, dans un monde numérisé qui ne tolère plus que de l’opinion et de la communication. Or, rien n’est plus contraire à l’opinion que la liturgie. Or, rien ne résiste mieux à la communication que la liturgie : C’est pourquoi jamais la liturgie ne fut si nécessaire.
Je souris toujours quand j’entends des experts dire que le Vatican « a des problèmes de communication ».
Les mules rouges de Benoit XVI tiennent de l’icône, quand tous nos logos d’entreprise demeurent à peine des signes. Communiquer « au reste du monde » par une fumée noire ou blanche l’élection d’un nouveau pape relève à la fois du primitif et de l’universel. Toutes les caméras qui diffuseront via des satellites fort sophistiqués au monde entier l’image de cette simple fumée sont comme déjà prises à leur propre piège (et au sien).
« Il y a dans cette ville plus de tombeaux que de morts. Je m'imagine que les décédés, quand ils se sentent trop échauffés dans leur couche de marbre, se glissent dans une autre restée vide, comme on transporte un malade d'un lit dans un autre lit. On croirait entendre les squelettes passer durant la nuit de cercueil en cercueil » écrit également Chateaubriand (3), en évoquant les vestiges de la première basilique de Constantin, ceux du cirque de Caligula et de Néron, et ceux de la nécropole romaine du 1er siècle après J.C. sur quoi repose le Vatican.
Il n’y a en réalité, dans ce monde qui a perdu le sens du feuilleté, c'est-à-dire de l’équilibre entre la tradition et la modernité, l’innovation et la culture, la tension vers le futur et la mémoire du passé, peu d’êtres aussi poétiques qu’un cardinal, peu de lieux aussi romanesques que le Vatican. Je le dis sans ironie aucune.

1 J’entendais tout à l’heure l’inénarrable Caroline Fourest protester contre le fait que le Vatican soit une monarchie et qu’aucune femme n’y exerce le pouvoir…
2 L’inénarrable Pujadas disant « merci pour votre analyse » à un expert venu énoncer trois banalités, c’est toujours un grand moment
3 Mémoires d’Outre Tombe, III, deuxième époque, Livre 9, chapitre 3 « conclaves », Chateaubriand
4 Regrets, sonnet 80, Du Bellay
5 Mémoires d’Outre Tombe, III, deuxième époque, Livre 9, chapitre 9 « promenades »
21:34 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : benoitxvi, rome, vatican, italie, conclave, religion, catholicisme | 
mercredi, 27 février 2013
Impressionnant vieillard solitaire
Drôle de moment : Benoit XVI lit ses notes, assis sur un siège blanc. Devant les cardinaux réunis (parmi lesquels se trouve son successeur), il rappelle que « La personne qui accepte le ministère pétrinien n’a plus de dimension privée ». Cent mille personnes sont rassemblées là, place Saint-Pierre, un grand nombre de chaines de télévision retransmettent l’instant. Silence. Et je me dis que le catholicisme conserve un sens du spectacle vivant assez étonnant et presque à contre courant, dans ce monde fait de bruit et de fureur. Il explique : « J’ai toujours su que la barque de l’Eglise n’est pas la mienne, n’est pas la nôtre »
Silence de tous les fidèles rassemblés, au centre de cette place et de cette mise en scène, Impressionnant vieillard solitaire, que matraquent les cameras, en route pour l’isolement final. Fascinant, cette alliance de tradition et de modernité, du rite millénaire et de la simplicité de l'instant.
« Je vous demande de vous souvenir de moi devant Dieu », dit-il en français.
12:04 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : benoitxvi, vatican, rome, catholicisme | 
mardi, 26 février 2013
Italie, mal votée
« Italie ingouvernable », qu'on entend, qu'on voit ça, partout. Grosses capitales. Les Italiens auraient mal voté. Chiens d’Italiens. A quoi ça pense, un italien ?
Déjà en 2005, les Français avaient mal voté. Cons de Français. Rien de plus bouché qu'un français. Deux, peut-être.
Sans compter les Espagnols et les Grecs. Putains d’Espagnols. Pourris de Grecs. Y'a qu'au parlement belge que ça pense encore, faut dire.
Avec ça, elle est où, la conscience européenne, sur l'air du plus jamais ça ? Mangent leurs cravates, les europhiles.
Il Cavaliere, le retour… Fait chier tout le monde, celui-là, avec son pognon, ses liftings, son pré carré de putes et de sénateurs. Sans compter l’intrus, l’olibrius, un amuseur, un populiste, peut-il en être autrement, messieurs dames ? Un Coluche qui tiendrait à la fois du Le Pen et du Mélenchon, disent les chroniqueurs.
Au sens strict, ça donne un monstre, tout ça, non ?
Electeurs, électrices, de sacrés mal-pensants en démocratie postmoderne Enfin pas tous. Le crétin, c’est toujours qui glisse pas le bon bulletin. Le bon bulletin, c'est l'bulletin citoyen…
Or la citoyenneté, comme la couille, ça pend à gauche, naturellement. De ce côté que pousse la bonne morale, normalement, comme de la vermine.
Feraient mieux de se demander pourquoi Grillo + Berluconi parviennent à faire une majorité chez les Latins, face à leur désastre.

Grèce corrompue. Italie ingouvernable. Espagne au bord du gouffre. France rance.
Les investisseurs grondent. Les Bourses dévissent. L'Allemagne hause le sourcil.
C'est l'oeuvre de qui, un tel bordel ? Ce serait pas la zone, le truc ingouvernable ?
11:44 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : italie, berlusconi, beppe grillo, zone euro, france, politique | 
samedi, 23 février 2013
La bonne attitude
Il redoutait constamment qu’on lui volât quelque chose : son parapluie, son portefeuille, sa femme, ses idées. Aussi consacrait-il une bonne partie de son salaire à se munir d’infinies précautions pour entretenir autour de lui un halo de sécurité, sans lequel il n’eût pu survivre dans la jungle : un toit et quatre murs, quelques automatismes, de nombreuses assurances, un certain nombre d'objets et certaines marottes
Son jumeau, au contraire, péchait par excès de confiance : il laissait tout traîner, tout faire, tout dire, cultivant sans chercher à le faire et le plus souvent sans même s’en rendre compte une façon d’être absent au monde, à tout, à tous, à toutes, que ceux qui le connaissaient mal prenaient pour du dédain. Ce n’était que sa ruse à lui pour conserver le bonheur.

Colonne d'Olomouc à Prague
crédit photo Strogoff
21:17 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, poésie | 
mercredi, 20 février 2013
Les enfants se sont endormis
J’étais très curieux de cette Mouette argentine, ré-écrite et revisitée par Daniel Veronese, après Les Trois Sœurs (Un homme qui se noie) et Oncle Vania (Espionne une femme qui se tue). Il y a comme un jeu farceur dans cet exercice qui invite à la comparaison avec l’original tout en se proposant d’exister par soi-même. Daniel Veronese gère cette tension avec beaucoup d’habileté, en jouant de plusieurs dépaysements :
Une transposition dans une durée bien plus courte, avec un texte très resserré, des monologues raccourcis, des répliques rajoutées, qui signent le passage du verbe de 1895 à la parole de 2013.
L’utilisation de costumes contemporains – ou atemporels, et d'un décor dénué de tout signe de richesses, loin de la vaste propriété de Sorine, une table, deux canapés, quelques chaises, un ensemble plutôt précaire.
Il y a surtout la transposition dans une autre langue, l’espagnol, un autre continent, l'Amerique du Sud
Et c’est troublant, pour un français, de recevoir cette Mouette ainsi repliée sur soi, en cet accent du Sud et en ce décor aussi dépouillé que passe-partout.
Une fois le code et la convention acceptés, intégrés, la mise en situation crée un effet de sourdine aussi théâtral que déconcertant, comme si le sens de ce classique enfoui sous la langue russe retrouvait dans la psalmodie espagnole et ce lieu quelconque une autre étrangeté que celle que nous lui connaissions, et une nouvelle liberté.
L'attention se concentre du coup sur ce qui demeure essentiel chez Tchekhov comme chez Veronese, c’est-à-dire les personnages, et derrière ce qu’ils rêvent d’être, leur nudité, leur fatuité et leur ennui, ce qui les rend au sens plein humains, universels.
Au centre de la pièce, il y a toujours Nina. Nina, la mouette, qui tombe amoureuse non de Trigorine, l’écrivain de passage, mais de l’idée qu’elle se fait d’un auteur, d’une façade. Elle dit qu’elle est actrice, mais en même temps, on sait qu’ici encore elle sera toujours la mouette, le personnage dans laquelle Trigorine l’a distribuée, un rôle qu’il faut jouer. Au centre de la pièce, il y a toujours le théâtre et sa mise en abîme, avec la pièce de Treplev elle aussi ramenée à l’essentiel : « les hommes, les lions, les aigles et les perdrix… », quelques mots récités le plus sobrement possible. Et cette dialectique du comédien jouant un personnage lui-même un comédien.
Au centre de la pièce, il y a toujours l’amour inassouvi de chacun, enfin, un amour insensé fait de la nostalgie d’un Dieu perdu, qui conduit au dénouement tragique qu’on sait.
Véronèse explique que La Mouette est une pièce chorale : Ce sont dix personnages dont quatre sont centraux, et aucun vraiment secondaire, dit-il. Dans l’espace unique, triangulaire et clos de sa mise en scène, c’est bien cela qui saute aux yeux durant toute la pièce, et qu’on garde en mémoire : la circulation de la parole entre dix personnages qu’on ne dira pas en quête d’auteur, mais en quête l’un de l’autre à travers la fiction de la comédie qu'ils se jouent, et le décalage temporel d’un siècle et d’un pays à l’autre. Et cela ne manque pas de second degré, lorsque Treplev lance par exemple que si le père du personnage est l’auteur, sa mère est l’acteur, ou qu'on ouvre le quatrième mur pour mieux rétablir le huis-clos où s'arrime l'étrange dialogie entre Tchékhov et notre temps.

© Catherine Vinay
Les enfants se sont endormis d’après La Mouette de Tchékhov, à voir au Théâtre de la Croix-Rousse jusqu’au 22 février 2013
Adaptation et mise en scène Daniel Veronese Avec Ernesto Claudio, Boris Alekseevich Trigorin Marcelo D’Andrea ,Evguenii Serguevich Dorn Claudio Da Passano,Semion Semionovich Medvedenko Lautaro Delgado, Konstantin Gavrilovich Treplev María Figueras, Nina Sarechnaia
Pablo Finamore, Ilia Schamraev Ana Garibaldi, Mascha Marta Lubos, Polina Andreevna María Onetto, Irina Nikolaevna Arkadina Javier Rodriguez, Piotr Nikolaevich Sorin
Durée : 1h30 En espagnol surtitré en français
00:21 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : les enfants se sont endormis, daniel veronese, lamouette, tchekhov, théâtre, lyon, littérature, croix-rousse | 
mardi, 19 février 2013
Ebauche pour une mise en scène du fragment Thalia d'Hypérion
Beauté fort rarement égalée dans la littérature que cette première version d’Hypérion, publiée dans la revue Thalia de Schiller en 1794. Le texte, comme la version définitive, est placé sous la garde d’Ignace de Loyola, avec cet épigraphe est dominerait le décor de façon à la fois évidente et énigmatique, comme la signalétique dans un aéroport : « non coerceri maximo, contineri tamen a minimo » (ne pas être limité par le plus grand, n’en tenir pas moins dans les limites du plus petit).
Entre ces deux attitudes, dont Hölderlin compose à sa manière deux idéaux soumis à la libre volonté de chacun et dont il esquisse ses deux personnages, le vide, dont je demanderai à mon technicien lumières de jouer sans retenue ; le spectateur et la perception qu’il développerait de lui-même ne serait au fond qu’une intention arcboutée entre ces deux pôles : « Nous ne sommes rien, c’est ce que nous cherchons qui est tout ». Hypérion et ses multiples autres, répandus dans la salle...
« J’ai peur pour toi quand je te vois si sombre et violent » s’écrie Mélite (1) devant Hypérion, auquel elle intime l’injonction très romantique de continuer à l’aimer sans néanmoins satisfaire son désir : « Dis à ton cœur que c’est en vain qu’on cherche la paix hors de soi quand on ne peut se la donner d’abord » : Toujours ce malentendu amoureux entre une forme de paix qui serait la satisfaction du désir, et une autre d’où, en amont, naîtrait le désir. Vertige du commencement, désolation d’en finir. Le dialogue, l’écriture se nichant dans le précaire équilibre entre les deux. Les mouvements des deux acteurs aussi, ce qu’en terme pédant on appelle la proxemie, à concevoir à partir de cette phrase. Se toucher de loin, autrement dit. S’écarter de près.
« Et comment des mots pourraient-ils apaiser la soif de mon âme ?», confesse Hypérion ou Hölderlin, fondus dans une même lettre, une même voix. Sur scène, l’acteur hésiterait devant cette phrase : simple remarque ontologique ou bien hurlement de douleur ? Il y a des deux, justement. Je demanderai à l’acteur de faire entendre les deux. Qu’il se débrouille et surtout qu’il ne se contente pas d’être technique. Ceux qui croient tout résoudre par la technique ont tué ce qu’Hölderlin et les siens nommaient le sentiment, c'est-à-dire l’art. Le paradoxe du comédien et ses multiples gloses étant leur funeste alibi.
Le projet du spectacle pouvant se déplier à partir de cette phrase d’Hypérion : « je rêve d’abolir le fardeau de la finitude (décor) qui bafoue la sainteté de notre amour (lumières) et, pareil à un homme enterré vivant, mon esprit se révolte contre les ténèbres qui le tiennent captifs (diction, jeu). Remarques et hurlements.
Il y aurait à prendre en compte le temps du spectacle, sa durée. Le fragment Thalia d’Hypérion comporte, dans l’édition de Pléiade, 20 pages (de 113 à 123). Pas question de retrancher un seul mot. Il faudrait concevoir la durée comme la progression d’une souffrance inouïe, perceptible jusque dans l’haleine des acteurs. La durée, comme une sorte de mime : « Comme si tout le mal de l’existence provenait de la seule rupture d’une unité primitive », indique le poète dans sa langue si maladroite. Quand un comédien ouvre la bouche, n’est ce pas ce qu’il fait ? Rompre d’avec le silence, et puis grimacer quelque chose, jusqu’à se tordre les muscles de souffrance ? Maladresse des corps comme réponse à la finitude des mots.
Le moment d’applaudir. Retour au point liminaire, en somme, toutes les préoccupations individuelles et sociétales en moins. Un texte serait passé par là. Moment d’applaudir : Sorti de l’obscurité et enfin recentré sur soi-même, le public se bouge quand même un peu, accepte de vivre (« Il est beau que l’enfant ne domine rien, alors même que la mort est à la porte »), il applaudit, geste si possible empli de ferveur, façon de répondre à la plainte du poète :
« Hélas, le Dieu en nous est toujours pauvre et seul. Où trouvera-t-il ses pareils ? Ceux qui furent, et seront là un jour ? A quand le grand revoir des esprits ? Car je le crois, nous fûmes tous réunis, autrefois. Bonne nuit Bellarmin. Demain, ma plume sera plus calme ».

Plaine de Beotie vue du Mont Citheron, où s'achève Le fragment Thalia
(1) Laquelle deviendra Diotima dans la version finale
11:38 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : théâtre, hypérion, thalia, littérature, holderlin, schiller, romantisme |