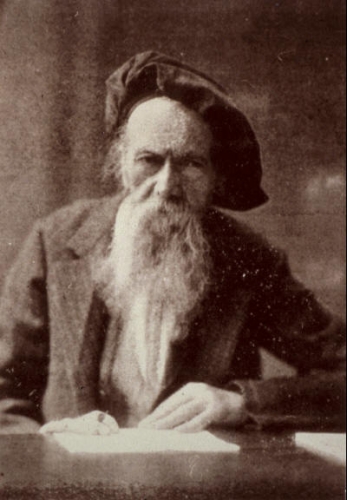dimanche, 04 décembre 2011
Le plus beau billet du monde (3)
III
Polo, il a respiré un grand coup avant de s’endormir et voilà que maintenant, ses ronflements montent plein le galetas. Autour de nous je devine les zigues par milliers, en train de récupérer leurs défroques de la veille, descendre leur bol de café ou se brosser les chailles : toujours les mêmes hardes d’employés ; leur ville, j’imagine pas d’y installer campement, c’est chômeur que j’y suis depuis que j’ai quitté les études et la trentaine arrivée, ça me paraît tenir du destin.
Alors, je songe à lui, place Clichy, je songe au Sébastien. Il sort tout juste du métro, l’air encore niais des provinciaux frais débarqués. C’est le printemps, forcément. Cette scène-là, elle n’est possible qu’au printemps, dans le bleuté tièdard qui refile l’illusion aux vieux matous d’un possible recommencement à leurs turpitudes.
Mais lui a tout juste vingt ans et se dit qu’à Pigalle, ça pourrait forcément qu’aller mieux. Le Topol, Saint-Lago, Ménilmuche, la Courtille, comme dans les chansons de Fréhel, c’est plein d’occases dont il rêve, à pas cracher dessus, la coco, les cinoches américains, les Alfa Roméo milanaises, les milliardaires russes et les gerces aux yeux qui brillent sous le faux des projos, le tout comme dans un roman de Carco : c’est la toute fin des années folles et, même si partout autour, comme on dit dans le Temps, le feu couve, il les tient ses vingt ans, le Sébastien.
- Montre voir, aurait dit Polo à cet instant, si la bourrique ne ronflait pas à briser la verrière. Comme d’habitude, je le lui aurais tendu pour sûr.
Il m’aurait alors expliqué d’un ton doux, comme s’il causait à Sébastien lui-même : « Tu vois, là, la gonzesse, avec son petit châle mauve sur les épaules, en train faire le rade devant le parc de Versailles ? T’en as jamais tenu entre tes bras, hein, des gonzesses comme ça ? Ni vraiment froissé des liasses dans tes poches, des billets flambant neufs comme çui-ci, pas vrai ? »
J’opinerais à la place de Sébastien qui n’est plus là pour le faire. Mais en avril 1935, quelle tronche dut-il tirer quand il a découvert ce billet entre ses pognes, devant le visage de cette Cérès taillé à la serpe. Saisi, le Sébastien, forcément, et plus encore lorsqu’en le retournant, il est tombé sur Mercure, le Mercure de trois quarts et en tunique bleue. Un petit crème sur la place, sûr qu’il se prit ça, ce matin d’avril-là, pour l’observer tranquille, son fafiot. De tout près.
Bon c’était bien ça le chic du genre de l’époque, remarque, commenterait Polo l’ironique. Transformer les nanas en mecs et les mecs en nanas : le tout sur un patron de lithos grecques, trafiquées à la Cocteau dans un parfum de Chanel. Le résultat : cet androgyne à tête de cinquante francs. Comment t’appelles ça, toi le savant ? A l’identique. Ouais, ricanerait-il.
Reproduction à l’identique de façon à ce que le motif du verso coïncide avec celui du recto : même motif, quand on regarde le papier par transparence : A l’identique, gonzes et gonzesses bouillant dans la même marmite, tous pareils et bien baisés au défilé des Temps Modernes. La parité dans le même jus de cuisson. Mais Polo ronfle encore et j’observe seul mon billet dans le rayon qui choit, tout oblique, du vasistas.

De toute façon, c’est pas la ressemblance entre la Cérès et le Mercure qui nous soucie, mais bien celle entre le Sébastien et le Mercure, et donc avec Cérès, par ricochets, ça qui a dû l’arrêter. Sa propre gueule sur un billet du pays, et en double exemplaire, ça peut que clouer, non ?
La seule photo que je possède de Sébastien, c’est pendant la guerre, autour de 42/43. En pantalon gris, chemise blanche, avec sept ou huit autres, il sourit pas plus que sur le billet. C’est vrai que ça impressionne, a toujours convenu Polo. Mercure tout craché, ton grand-père, ça impressionne.
Fais voir l’autre billet.
Je lui tendrais le plus beau billet du monde. S’il ne ronflait pas comme un damné sous cette verrière, il commencerait à chercher dedans on ne sait quelle vérité.
Moi, je fermerais les yeux un moment, le cœur qui cognerait, juste pour bien me ressaisir.
A suivre
15:17 Publié dans Des nouvelles et des romans, Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cérès, mercure, reproduction à l'identique, littérature, carco, paris, argot, billets français, anciens francs | 
mardi, 15 novembre 2011
L'écharpe de K
Les ronds se tirent vite. Tout ça n’est pas nouveau, non. Mais depuis peu, ça s’est corsée, la vitesse à laquelle l’argent coule. De plus en plus leste, virevoltante et fatale, la monnaie : tirer sur chaque dépense jusqu’à la fin du mois, c’est devenu une façon d’être seul au monde. On y arrive en tirant par ci, par là, les bouquins, les plaquettes de beurre, les chaussettes. Geste furtif, et hop. Le franc est en train de vivre ses dernières années. Une clique d’économistes parie sur l’euro à venir. Comme ça, tout ça, paraît abstrait, lointain. Situation précaire, certes, que la sienne : tester la méthode torcheculative de Rabelais sur des infirmes moteurs et cérébraux dans une banlieue parisienne dont on vient juste de changer le nom, tu vois, de Les Gonesses à en France, comme si pour améliorer le sort des pauvres il suffisait de changer de nom… Et puis les occuper comme tu peux, les infirmes, ça s’appelle éducateur, il fait le job, comme on dit à présent des footballeurs, alors qu’il n’a même pas le diplôme en poches : avec la rigueur, mot depuis peu entré en fonction, on regarde plus trop nulle part qui fait quoi.
La seule conclusion qu’il en a tirée, c’est qu’au moins pour surnager, s’il doit vivre encore longtemps, durer, et sait-on jamais une vie, parfois ça dure, il faudrait reprendre des études, ces sacrées études qui lui ont toujours tant coûté, comme si tenir en place à écouter des faux savants, non vraiment.
Parce que de véritables études pour lui jusqu’alors, ça restait quand même l'école de la rue, celle de la route, de la scène, et puis les petits jobs par ci, par là, d’usines en administrations, d’hôpitaux en commerces, le boulot, la démerde et la débine à chaque fois remise au lendemain. La scène et le carnet de notes, et toujours tout recommencer. Engagé dans rien, endetté de rien. Survivre en temps de crise. Tenir bon. Rien devoir à personne.
Je raconte donc l’histoire d’un étudiant tardif et fauché. Tu imagineras que la scène se passe au printemps 1986. Cet éternel instable trime donc dans un foyer pour handicapés à Tremblay trois journées de treize heures, avant l’ère de la sinistre Aubry, ça faisait 39, la semaine pour tout dire. Depuis peu, la situation dans le pays s’est durcie. Elle en finira plus de se durcir, au fur et à mesure qu’on ouvrirait les frontières et ferait monnaie commune et qu’on l’aurait dans le cul, la situation. Le bel enfumage. Plus la même insouciance, non : Ni dans la capitale ni ailleurs. A moins que ce soit lui, depuis qu’il a vraiment réalisé dans sa chair de mortel qu’il est tout seul au monde, que c’est leur lot à tous, que se croire en famille c’est quand même un sacré luxe, et que trois rides lui barrent le front, à moins que ce soit lui qui finalement se soit rendu, ait accepté que ça irait peut-être mieux en retroussant les manches et en roulant une bonne fois pour toutes pour sa bosse par les sentiers de l'insertion.
Il a suivi ce jour-là la rue des Ecoles jusqu’à son extrémité, son bout. Il a passé la fière Sorbonne toute de pierres vêtue, le cœur-Villon pincé, il a filé devant le Collège de France dans le jardin duquel rêve, oui c’est le mot vraiment, rêve Montaigne, et comme on n’a pas voulu de son dossier à la Sorbonne –déjà trop vieux – il a poussé jusqu’aux tours si laides en face du Nemrod, ce campus hâtivement bâti. Il a d’abord bu un café, puis deux pour se remonter le moral, ah que n’a-t-il étudié du temps de sa jeunesse folle ? Dans la rumeur des conversations, le cliquetis de cuillers à café dans les tasses vertes que sur leurs plateaux ronds des garçons en pantalons noirs, tabliers blancs, trimballent comme s'il était en train de s'égarer dans une page de Sartre. Un rendez vous avec le Président de Paris VII, rien que ça, à quoi ça ressemble, un président de Paris VII songe-t-il en laissant traîner son regard sur ces tours salies dans la brume qui ressemblent à un coin de banlieue planté par mégarde à deux pas de Notre-Dame.
Finalement ça a marché. Il a fait valoir la compagnie théâtrale créée jadis, l’ouverture rectorale accordée à cette époque, un bouquin édité en 81, plusieurs articles sur une ou deux pièces, tout ça, il n’en revient pas, le président de Paris VII lui a dit : « vous n’allez pas perdre un an pour rien, ça peut faire une équivalence professionnelle tout ce que vous me racontez là, vous n’avez plus de temps à perdre… » Une équivalence professionnelle ? Alors qu’il n’a pas suivi un seul cours, le voilà déjà en deuxième année, le voilà les deux jours de la semaine qui lui restent après les trois perdus chez les handicapés, à suivre un cours sur La Religieuse, un autre sur La Peau de Chagrin, et le plaisir de retrouver ce latin qu’il n’a jamais vraiment égaré depuis son cher et vieux lycée de province, le Pollio de Virgile et le Pro Archia de Cicéron. En septembre, les bombes ont pété rue de Rennes, à la Fnac où il va chercher les bouquins qui lui manquent. Comme c’est curieux, ça. Il lit la Poétique d’Aristote tandis que des passants innocents, non loin, payent la facture d’Eurodif, et Chirac, le soir, avec du sang sur les mains qu’on ne voit pas, mais tous ces rictus qu’on voit : « mes chers compatriotes », on dirait un Homais désappointé. A cette époque, il lit tout le temps, comme on respire. Quand il marche dans Paris, c’est la force des auteurs qui le portent, exactement ça, et lui montrent les magasins d’aujourd’hui, le délabrement dans lequel les êtres sont. Ce qui fait que ce qu’il dit quand il ouvre la bouche n’est pas toujours clair, branché au bon endroit. Qu’importe, se dit-il. Autour de lui, ça ne compte plus. Aucun ne l’aidera à survivre, à trouver salaire et pitance, rien d’autre que lire. Pas de temps à perdre. Plus de temps. Un prof, un jour, en lui rendant une copie lui dit : « vous, il faut passer l’agrégation, et vite… » Comme si tout à coup, au son de cette voix, il rentrait à la maison... Comme si passer l’agrégation n’était au fond qu'une formalité ressurgie du néant.
Le voilà donc dans cet amphi où résonne un cours de licence. Enfin, un cours… On vient de la Sorbonne, on vient de l’ENS, on vient de Censier, de partout pour écouter la star. La star de Jussieu. Même à Paris, flotte quelque chose d’atrocement provincial, se dit-il. Il s’est inscrit à son cours parce qu’il n’a pas de temps à perdre. Les stars l’emmerdent, l’ont toujours emmerdé, celle-ci comme d’autres, on dirait une madame de Bargeton égarée là devant ces Rubempré niais à mourir, mais il paraît que K…, contre un exposé bien ficelé, refile facilement l’unité de valeur. Et ça, il en a besoin. Comme il a besoin de monnaie. La sémiologie et lui, jusqu’alors, les théories du signe… De la Bible jusqu’à James Joyce, rien que ça, a-t-elle annoncé avant de distribuer à tous les auditeurs une liste d’exposés, comme si elle marchait sur la lune.
K… est une fort jolie eurasienne, jadis trotskiste et parvenue avec la grâce d’une papesse de la gauche mitterrandienne dans ce qu’il est convenu de nommer la force de l’âge. Lui, il a tiré au sort « la théorie du signe dans la Logique de Port-Royal ». Diable ! Arnauld, Nicole, et cette affaire de raison janséniste, le jugement. Voilà de quoi l’occuper quand il garderait cette semaine les fauteuils au foyer. Jongler avec les syllogismes. Les mater. Ah, les mots considérés « comme des objets de pensée » et ceux qui ne font que renvoyer « à la forme et à la manière de nos pensées ». Ceux qui et ceux qui ne font que. Tout est là. S’il y a une théorie plausible là-dedans, nous partirons d’une prémisse remarquable, c’est qu’elle ignore l’arbitraire. Au sortir du métro, déjà des bradeurs d’écharpes étalées à même le sol. Il ya toujours eu des vendeurs à la sauvette, des vendeurs de tout, et puis des musiciens. La débrouille. Ces écharpes écossaises, à 20 francs l’une, il en portait d’ailleurs une en ce mois de février – ça devait être 1988 – qui commençait à s'effiler, nouée autour du cou, grise, blanche et noire, et qui gardait son odeur rance et tenace à lui, son propre parfum comme en conserve, qu’il humait dans la journée, comme on hume une superstition. Comme deux chiens affamés, Mitterrand et Chirac allaient se jeter à la gueule l’un de l’autre la libération des otages, toujours cette sale histoire de l’uranium et des millions d’Eurodif, « les yeux dans les yeux je le conteste », on s’en souvient, Dieu-Grenouille serait réélu, et Libération, le journal que lisait K… et dans lequel elle-même et les gus de sa bande écrivaient parfois des articles d’indignés titrerait bravo l’artiste, et le pays berné. La décomposition de l’artiste, comme celle du pays, galopante
Un jour, son tour vint d’aller mendier son 18/20 devant la bruissante assemblée. Pendant que les strapontins claquaient, miroir de poche en main, Julia se refaisait une beauté habile. Car elle commence à avoir l’Eurasie fatiguée, ça se comprend. Derrière elle, le tableau est empli d’équations et sur le bureau est posé le chiffon pour effacer les traces de ceux qui nous ont précédés. C’est ça, la connaissance, un long chemin. Il avance la main pour s’en saisir, de ce chiffon empli de poussière blanche, et au tout dernier moment s’aperçoit qu’en réalité, ce chiffon est une écharpe, une vraie, comme celle qu’il porte à son cou. Une de ces écharpes que les pauvres vendent au noir à des pauvres dans le métro, vingt balles, oui, on disait alors vingt balles, vendre comme on jouerait de la guitare et la porter de longs jours jusqu’à ce qu’elle sente l’odeur, ton odeur. Il hésite.
K… fait une moue et pose sur sa main à lui qu’il vient d’immobiliser devant cette foutue écharpe ? ce maudit chiffon ? il ne sait plus qu’en penser. Elle pose son regard aux longs cils et c’est vrai qu’il est beau et profond, ce regard qu’elle laisse glisser le long de son avant-bras à lui, son bras, sa bouche, ses yeux maintenant, elle le fixe quelques secondes tandis qu’il rosit, pris en flagrant délit de pauvreté. Et elle, l’universitaire qui théorisa si joliment les lois les plus retorses du langage et de la Révolution, d’une voix sèche, sucrée, tombant comme un couperet lâche : « Vous ne pensez tout de même pas que cette écharpe est à moi ? »
Je dédie cette fable à toutes celles et tous ceux qui galèrent pour mener à terme quelques études leur permettant (peut-être) de survivre dans la Jungle.

06:06 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, jussieu, julia kristeva, la logique de port royal, théories du signe, sémiologie, précarité, mitterrand, chirac, politique, société | 
dimanche, 13 novembre 2011
L'initiation de Nicolas Sylvain
Cette nouvelle est une œuvre de jeunesse de l’écrivain Henri Béraud, qui a été publiée en 1912 parmi sept autres dans le recueil Les Morts Lyriques par Basset. Le jeune Béraud (qui signe alors Henry) y manie une prose poétique encore influencée par ses lectures de jeunesse, les symbolistes du siècle précédent, au rang desquels se trouvent Elemir Bourges et Maurice de Guérin. « Nicolas Sylvain était connu comme paysagiste » : Derrière ce personnage de Sylvain se cache la personne de François Vernay, dont Béraud avait publié une biographie en 1909, pour lequel il eut une vértiable admiration, et qui fut le personnage d’une nouvelle entière (« Alors Vernay pleura ») dans un autre recueil de nouvelles publié également en 1912, Le Voyage autour du cheval de bronze. Ci-dessous, l’une des très rares photos de Vernay.
Ce peintre célèbre vivait comme un petit rentier. Il rentrait tous les jours aux mêmes heures, ayant suivi le même chemin. Il habitait depuis 1875 un petit appartement au cinquième, rue Saint-Jacques, et la plupart de ses voisins ignoraient jusqu’à son nom. D’ailleurs, ils se défiaient de cet homme qui, indifférent aux événements du quartier, faisait lui-même ses provisions, ne saluait personne et opposait aux curieux un silence de maniaque.
A l’heure des maraîchers il quittait son logis, un cabas à la main, allant de son pas de vieil ingénu à travers les ruelles toutes bleues et bruissantes de rumeurs matinales. Les venelles familières dont chaque fenêtre s’éveillait à la même heure, les vieux hôtels aux façades ennoblies par les ans, l’air léger courant dans les arbres d’un petit jardin, tout le quartier enfin, par son existence intime et quotidienne, lui rappelait sa province.
Les boutiquiers, cognant le volet, le suivaient du regard. Son air et sa mine excitaient leur curiosité. On supputait pour des légendes le vague de ses allures ; et son ruban rouge étonnait le populaire, e principalement les paysans du marché avec qui il disputait en patois.
Quand il avait rempli sa filoche, il rentrait tout doucement parmi le tohu-bohu du faubourg au réveil, où des chars-à-bancs se croisaient avec des fiacres attardés. A la terrasse d’un cabaret, il demeurait une heure ou deux entre deux caisses de laurier, allumait une pipe, lisait le Petit Journal ; après quoi, il regagnait son atelier.
Ce lieu épousait le silence maussade d’une sacristie. Des portraits de famille ornaient les murs. Sur les meubles polis par l’usage on voyait de ces vases à fleurs qui sont dans les chambres des vieilles filles en province ; des branches de lunaire s’y consumaient. Il y avait encore un bénitier en vieille faïence, du buis et un grand chapeau de pêcheur. Sur toutes ces choses l’ordre régnait semblable à une poussière, et il semblait que le soleil du matin prît lui-même un air de proprette vieillerie en entrant dans cet intérieur.
10:11 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, lyon, henri béraud, françois vernay, les morts lyriques, l'initiation de nicolas sylvain | 
samedi, 01 octobre 2011
Nos cheveux blanchiront avec nos yeux
Essayer d’être une page blanche : c’est une assez jolie expression, l’une de celle que l’on rencontre au fil de la lecture de Nos cheveux blanchiront avec nos yeux, de Thomas Vinau. Sous le double patronage de Blaise Cendrars, bourlingueur devant l’Eternel, et de Victor Hugo, grand père à la barbe fleurie, ce dernier propose un diptyque qui oppose le dehors de son dedans au dedans de son dehors, avec chaque jour « un fil qu’il faut suivre », « une diagonale élaborée dans le paysage ».
Nos cheveux blanchiront avec nos yeux est une succession de textes courts et titrés à la façon d’un recueil de poèmes en prose, articulés en un récit qui tient plutôt du carnet de bord puis du journal intime, au fur et à mesure que le personnage narrateur, tout d’abord nomade, se sédentarise. Ce récit développe une véritable originalité et un solide cousu autour de la vie d’un couple d’abord séparé, puis retrouvé lorsque l’enfant paraît et que, l’éloignement aidant, Sally (le personnage féminin) devient Ma Sally.
« C’est incroyable, le nombre de personnes qui ne se sentent pas chez elles » note Thomas Vinau. On sent bien le parti-pris de ce militant du minuscule, comme il se définit lui-même sur son blog : suivre et capter sans cesse la brillance fugace du présent et de l’instantané, faire de l’instant – et non pas de l’histoire - sa maison et son livre. Voilà pourquoi il est difficile de suivre l’éditeur qui en couverture annonce un roman. Car d’’image en image, le lecteur ne quitte jamais cet incessant présent de narration qui revendique non pas la construction d’une histoire faite d’amas de jours, mais incarne le fil tenu d’un quotidien sans cesse ré-écrit ; et c’est ainsi qu’au fil de la lecture, « les personnages infusent tout doucement en nous comme un sachet de thé dans un verre d’eau tiède » ; sans mémoire, sans passé véritable, mais pourtant dotés d’un corps, d’une voix, dans « les couleurs d’une France lointaine ». Comme on passe subtilement d’un personnage rencontré à un autre, on croise aussi de nombreuses références, d’un Melville (Herman) à un autre (Jean-Pierre) : de la littérature au cinéma, de la chasse à la baleine à celle de bijoux, d'un modèle narratif à un autre : « L’écriture a été pour moi un moyen d’être compatible avec l’existence » avoue le narrateur au terme de son parcours. L’itinéraire auquel ce livre nous convie le prouve.
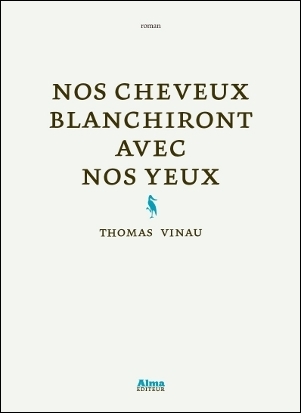
17:57 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : thomas vinau, littérature, nos cheveux blanchiront avec nos yeux | 
lundi, 12 septembre 2011
Le théâtre de Redonnet

"L'illusion était d'ailleurs parfaite, avec un ciel turquoise que j'apercevais par les trouées entre les cimes des pins, les petits crépitements de l'écorce sous l'effet de la chaleur, les gros amas d'aiguilles des fourmillières, le bruissement nerveux d'un peuple invisible d'insectes et, à une dizaine de mètres seulement, l'eau bleue des méandres du Bug (...) Oui, on eût pu s'imaginer, dans cette attitude, être sur une plate-bande maritime, n'eût été ce silence continental, sans jamais le moindre roulement de vagues."
Mais si le narrateur revendique explicitement sa dette auprès de Maupassant, et à une forme de nouvelles trop souvent dites réalistes, l'économie poétique du recueil feint seulement de songer à y revenir : Ah sans doute était-ce le bon temps, ce temps des rivières à l'eau claire, où raconter une petite histoire, une historiette, quelque chose en effet comme une nouvelle ou une chanson, c'était interesser un peu la grande histoire, celle avec un terrible H majuscule ! Tous les lecteurs n'acceptaient-ils pas d'être encore complices de cette belle illusion, laquelle nourrissait encore son écrivain ? Ni la Grande Guerre ni la Shoah n'étaient passés par là, et l'on pouvait encore, comme on met la sardine en boite, mettre en récit le loup ou l'assassin.
Car l'auteur se livre dans son recueil à un drôle de jeu ; on se souvient de la question posée par Adorno : comment écrire un poème après Auschwitz ? Au moment de clore son recueil, Redonnet a l'air soudain de la reprendre à son compte : comment écrire une nouvelle après Lomazy et, pour aller jusqu'au bout de la logique sous-tendue par la chronologie du recueil : comment se plier sans malice à la tradition littéraire du dix-neuvième après le désastre du vingtième ? Devant le raffut des temps présents et l'inénarrable dont ils procèdent eux aussi, mener l'enquête, fignoler la fiction, soigner le style, bref, faire du Maupassant, tout ça n'est-il pas non plus, par delà le fameux mensonge romanesque, qu'une sale idée ? Ainsi, lorsque le narrateur du recueil feint de se plaindre non plus du vertige de la page blanche, mais de celui de l'écran vide, est-on tenté de relire à l'aune de cet étrange dénouement tout ce qui précède d'un autre oeil : dans ce qui pouvait apparaître comme des exercices de style ou de brillants pastiches, on retrouve alors un cheminement qui pas à pas dit le mal dont souffre l'auteur, celui de ne pouvoir écrire en effet comme Maupassant, non qu'il n'en ait le talent, mais qu'il vit tout simplement un autre temps, en un autre théâtre des choses. C'est bien là, me semble-t-il, ce qui justifie l'existence de ce petit livre à l'arôme de cognac Fine Champagne dans cette rentrée littéraire : être en fin de compte, et quoi qu'on en pense, terriblement de son temps.
B. Redonnet : Le théâtre des Choses, 10 nouvelles de France et de Pologne, chez Antidata, 9 euros.
07:18 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature, redonnet, antidata, le théâtre des choses | 
lundi, 04 juillet 2011
Les sens interdits
Telle est la version domestique de l’église Saint-Bernard. Des comme celles-ci, toutes les villes en recèlent. Il faut s’écarter un peu du centre, sillonner les lieux indiscrets pour en découvrir une. Sans doute sont-elles plus particulièrement émouvantes à marée basse, en bordure des plages atlantiques. Quel drame est à l’origine de cet abandon ? Car il s’agit bien, pour les maisons comme pour les hommes, d’abandon ? On, se le demande, malgré l’évidence qui bée là. C’est comme un arôme, qui saisit une partie de l’être bien plus profonde que la narine, et s’enfuit de l’atelier ouvert à tout vent.
Qu’y confectionnait-on ? Que s’y passa-t-il ? Des morts ont quitté cette maison, autrefois ; pieds devant. Une succession difficile est passée par là. Finalement, en l’absence d’héritiers, l’édifice, seul, demeure, lévitant ainsi entre deux époques, telles les persiennes délabrées entre deux espaces, et comme héritier de lui-même. Se lit encore dans l’agencement même de cette façade des traces de bonheur. Une manière de hisser les persiennes au matin, de les rabattre au soir, de guetter par la fenêtre, d’y arroser quelque plante en pot, d’y attendre quelqu’un. Les sens interdits, le roman reste à écrire.
La cheminée fumant en hiver, était-ce il y a si longtemps ? L’abandon protège des indiscrets mieux que l’alarme, la poussière mieux que la caméra. Ici, c’est comme s’il n’y avait plus rien (et l’on sait que c’est faux, dans ce genre de lieux trainent toujours des objets, une chaussure, quelque outil à la cave, des bols ou des assiettes même, laissés dans l’évier) ; ce plus rien possède pourtant une façon unique d’être quelque chose, résidu d’une époque et parfum pâle de gens enfouis.
19:58 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (10) | 
jeudi, 09 juin 2011
Le neveu de personne
-Que faisiez-vous, il y a plus de vingt ans ?
- Moi ? J’écrivais un roman.
-Vous n’aviez pas encore compris que c’était vain ?
-Il m’a fallu l’écrire pour cela.
-Que racontait votre roman ?
-Une vie. Pas la mienne, je vous rassure.
-Laquelle ?
-Celle d’un homme que j’avais rencontré dans la morgue d’un hôpital où je travaillais pour gagner ma croûte. Celle d’un gardien d’amphithéâtre.
-Et que se passait-il dans ce roman?
-Honnêtement, pas grand-chose. Cet homme veillait.
-Mais encore ?
-A un moment il tombait amoureux.
-Et alors ?
-Il résistait.
-Pourquoi ?
-Parce qu’il savait comment tout finit entre deux serpillères.
-Et vous avez trouvé un éditeur ?
-A l’époque, oui.
-Lequel ?
-A quoi bon le nom précis. Non loin de Saint-Sulpice, et de cette magnifique chapelle dont le plafond fut peint par Delacroix. Dans une petite rue en pente.
-Et alors ?
-Dans cette honorable et vieille maison, on m’a proposé d’éditer mon roman, à condition que j’y retouchasse deux trois bricoles.
-Vous avez accepté ?
-Non.
-Vous avaient-ils demandé l'impossible ?
-J’avais conçu l’amphithéâtre comme une véritable métaphore de la conscience. Une architecture inhérente au texte. Aux personnages eux-mêmes. Une véritable métaphore de la conscience du pays qui était en train de disparaître dans les années 80, voyez. Disparaître ! La France des rivières non polluées, où se péchaient des vairons. Cette France dont mon gardien veillait, sans autre raison que la précarité matérielle qui déjà gouvernait son existence, les morts. Ils ont trouvé qu’il y avait trop de métaphores pour un public déjà bien peu « littéraire ». C’est eux qui affirmaient cela, je précise.
-Je vois à votre mine qu’ils ont renâclé pour autre chose.
-Ils m’ont dit : « gardez le principe de votre conscience, mais rendez tout cela plus croustillant. Si votre gardien pouvait coucher un peu, de ci de là, avec ses morts… »
-Vous avez tiqué ?
-Ce n’est pas le mot. J’aurais pu accepter, rentrer dans le circuit, le marché comme on dit. C’était avant Darrieussecq, Beigbeder, Catherine Millet et le reste des guignols… C’était ça, donc, ou bien… Je n’ai pas voulu me vendre. J’ai repris mon manuscrit.
-Quelle vanité !
-J’ai passé les concours d’enseignement. J’ai gardé ma liberté de parole.
-Votre liberté ? Mais si personne ne vous lit ?
-Je n’ai pas besoin qu’on me lise pour pouvoir manger. Ni pour payer mes crédits.
-Et vous ne regrettez pas cette décision ?
-Dans un monde où tout est à crédit, non !
-Ils sont plus riches que vous, les guignols…
-Ils ne viennent pas, non plus, d’où je viens.
-Franchement ?
-A la surface des choses, parfois, évidemment, j’ai de profonds regrets. Ah, tâte-toi le cœur, tâte-toi le cœur, me dis-je ! Car l’enseignement de la littérature, enfin de ce qu’est devenue cette malheureuse littérature française -et je rajoute bien : française - dans ce que sont devenus l’école, les lycées… L’enseignement de la littérature est un métier… A la surface des choses, donc, m’arrivent parfois de profonds et mélancoliques regrets. Mais en mon for intérieur, jamais ! Je n’ai jamais regretté.
-Et aujourd’hui, si on vous proposait à nouveau…
-Quoi ?
-Si on vous proposait…
-Je me sens plus lourd, beaucoup plus opaque qu’à l’époque, blindé. Et aussi beaucoup plus léger. Incroyablement plus décrotté. Si un éditeur me proposait…
- Eh bien ?
- Connaissez-vous la fin du Neveu de Rameau ? C’est un livre extraordinaire, savez-vous ? Un des dix ou quinze bouquins qui s’emporteraient sans réfléchir à deux fois sur l’ile déserte s’il fallait demain déguerpir…. Tout le monde y danse un peu le pas de cette pantomime, savez-vous ? La superbe pantomime des Gueux.
-Continuez !
-On m’a marché sur la queue, et je me relèverai, dit le Neveu au Philosophe incrédule.
-Et alors ?
-Peut-être est-ce ce que je dirai à l’Editeur. Vous m’avez marché sur la queue, et je me suis relevé. Après tout, qu’est-ce qu’un éditeur, quand on a son salaire qui tombe chaque mois ? De quoi avons-nous besoin de lui ? Je lui dirai : marchand…
-Il vous rira au nez
- Je lui dirai : marchand, appartenez-vous toujours à la Compagnie Générale des Eaux, ou quelqu’un d’autre vous-a-t-il encore racheté les bottes, l'assiette et le chapeau ?
-Vous le ferez vous rire au nez, c’est assuré !
- Je lui dirai : allons, allons, je veux voir aussi le pas de votre danse…
- Il vous répondra d’aller vous faire f… dans vos classes bondées !
- Mais je fais cela très bien sans lui, et depuis fort longtemps. Connaissez-vous la dernière phrase du Neveu de Rameau ? J’irai me faire foutre, lui dirai-je, à condition qu’il me la lise.
- Il vous dira vanité !
- Je répondrai ignorance. Allons, allons, petit bonhomme, qu’il me la lise et sur-le-champ! Elle sonne si juste à mon oreille que quand il m’arrive parfois de relire les feuillets de l’Amphithéâtre, je me réjouis tout seul à me la répéter.
-N’est-ce pas vous qui prétendiez qu’écrire un roman vous semblait désormais vain ?
-Que dire alors de l'éditer ?
-Et que dire d’enseigner ?
-Vous touchez-là un sujet délicat. Nous en avons déjà parlé hier, le motif est sans fin. Mais je ne suis, moi, le Neveu de personne. Passez, monsieur mon contradicteur, la nuit qui vous convient. Et n’oubliez pas de lire, à la toute fin…

Le Neveu de personne a été écrit en 2009 (déjà). Je le republie aujourd’hui, en vous invitant également à lire ICI le billet qu’un écrivain consacre, sur son blog, à ses rapports avec divers éditeurs …
10:06 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : littérature, édition, roman, diderot, le neveu de rameau, le gardien d'amphithéâtre | 
mercredi, 01 juin 2011
G.T.
Je m’étais depuis longtemps promis de rendre un hommage particulier à G.T., mais le temps filant, sales semaines qui se suivent, j’avais sans cesse remis à plus tard cette espèce de dette accrochée à la filiation. Que de choses demeurent en friches et trouent la barque parmi nos résolutions, parce que tout simplement nous nageons trop vite et trop mal, en gens pressés dans un siècle sans esprit, cloués à la routine tels des chouettes au cœur vide.
G.T. naquit, fils majeur dans une famille de cultivateurs, le 29 octobre 1834. Sur son extrait de naissance, les âges de son père (trente deux ans) et de sa mère (trente quatre). La première fois qu’il a glissé entre mes pattes, je me souviens m’être dit que ça faisait des parents plutôt âgés pour le dix-neuvième siècle et une famille de paysans : leur jeunesse à tous deux, un espace déjà romanesque, ouvert sur son berceau.
L’Ain, en pleine Monarchie de Juillet, campagne profonde d’un pays chrétien où se parle le patois. Les parents de Guillaume, Antoinette et Claude ont reçu juste ce qu’il faut d’instruction pour être à même de signer les registres : leurs signatures vacillantes, balbutiantes, baveuses, de quoi m’émouvoir, oui. Me semble percevoir le bruit de leurs pas, renifler leurs odeurs et comment dire ? Leurs traces, oui, comme les empreintes du gibier qui s’est enfui, sur le registre des mariages de la commune de Thil, ce 3 février 1862-là. Devant un officier du nom de Jean Martin, dans le canton de Montluel, Guillaume T. comparait à la maison commune en compagnie d’Antoinette M., elle aussi cultivatrice et fille de cultivateurs. La lignée. Le sillon. Ils sont des millions par tous les départements, comme ça, à faire un pays. Il a 27 ans, elle 23.
Conformément aux articles 63 et 64 du code Napoléon, suite à un contrat établi par un certain maître Munier, notaire à Miribel, les voilà qu’on déclare unis au nom de la Loi ! Quel effet ça peut faire, d’avoir 27 ou 23 ans en 1862 ! Tellement facile et tellement niais de s’affirmer tous les héritiers d’Arthur, à présent, pauvres modernes de nous passés par les bancs du lycée ! Arthur, c’était qu’un fieffé fou, un cas, comme disait l’entourage de la mère Rimb’, un extravagant, un inconnu. Mais pour les gens du commun qui furent ma souche, avoir 27 ou 23 ans alors, c’était quoi, comment, cet hier déjà si lointain ?
De l’autre côté de l’Atlantique débute la Guerre de Sécession. En Egypte, se perce le canal de Suez. En Prusse, Bismarck est fait ministre de Guillaume Ier, et par cheu nous, Guillaume et Antoinette se marient nom d’un chien ! Imaginer ces ancêtres bilingues ? Pas possible… A s’attarder sur l’épais trait des lettres appliquées de leurs signatures, même fierté de rustres que j’imagine, pourtant, fiers d’avoir su écrire comme d’avoir gagné l’Université à quelques générations de ça. La France, nation civilisée d’après 89. Sûrs d’être modernes, eux déjà.
Républicains ? Peut-être. Dans la suite du registre de l’Etat-civil, le nom de Guillaume presque partout ; toujours lui qu’on cite en témoin, à titre de cousin ou de voisin, sa griffe quatre ou six fois l’an, sous des avis de naissances, de mariages, de décès. A-t-il lu beaucoup de livres ? Nulle assurance. Le journal, j’en ai l’intime conviction. J’imagine ses pantalons gris à rayures épaisses, ses chemises de coton, ses bretelles à boutons. Sans trop me forcer, j’entends comme son rire
Or nous voici déjà en 1867. Une nouvelle fois, sur le parquet rustique de cette maison commune. Guillaume « présente un enfant de sexe masculin ». C’est le 30 décembre. A son domicile est né un garçon qu’on prénomme aussi Guillaume avant d’aller vider les verres. Guillaume II, donc. On vient de passer Noël. Bientôt l’an neuf.
Se joue-là comme un bonheur épais, collectif, rural, calfeutré dans les rouages de la tradition et sûr de son temps. La poursuite de la race. Cultivateurs, leurs maisons basses sont en pisé, leurs champs bordent le Rhône large qui galope vers la ville, leurs rues sont bordées de platanes et leur église, faite de chapelles bancales autour d’un haut clocher, domine le haut mur du cimetière où veillent les Anciens. Entre Lyon et la Suisse, il y a comme du Jean-Jacques dans leur république agricole.
Ils portent noms Guillaume, mais aussi Claude ou Balthazar. Antoinette, Jeanne ou Claudine. 1867 : s’apprête à leur tomber dessus, avant la grande Boucherie de quatorze qui balayera leur monde, comme un avant-propos douloureux, la première guerre du monde moderne. Guillaume qui sait écrire, continue à signer les avis, d’un geste de plus en plus sûr, qui rythme la vie de la commune. Les saisons recouvrent les champs humides non loin du Rhône. Le fleuve offre ses poissons, mais fait aussi pousser l’arthrose. Le pire et le meilleur, toujours. La République de Paris arrive à son pas. La salope leur offrira le meilleur, et le pire tout autant.
C’est Guillaume qui, un tragique soir de janvier 1863, « à une heure du soir », avait signé à 28 ans l’acte de décès de sa mère. C’est lui qui, dix ans plus tard, aura signé celui de son épouse « âgée de trente quatre ans ». Plus tragique encore, et j’entends derrière ces lignes comme un gros chagrin : on vivait en ce temps là dans les champs contigus de la naissance et du deuil, vieillissant, apprenant à survivre.
En 1884, c’est finalement lui qui trépasse, « au domicile de lui-même », déclare l’avis signé par son beau-frère et par l’instituteur, le trente du mois de novembre à six heures du matin. De quoi meurt-on, en ces temps déjà modernes et pourtant rudes, à cinquante ans, au domicile et quand point l’aube ? Suis tenté d’imaginer la thrombose, la thrombose des cultivateurs, et j’espère pour lui qu’elle fut vraiment foudroyante. Il était le grand-père que mon grand-père, né en 1893, n’a jamais connu. Pourtant, que peu d’ans nous séparent !
Je n’ai reçu de lui, ni murs ni papiers ni paroles ni photo. Que des gènes, un vrai parchemin de silence. Sur lequel était inscrit le pire comme le meilleur, l’écriture et la thrombose, un vif émerveillement, aussi, quoi d'autres... allez savoir ? Au cimetière de Thil, nulle trace de sa tombe et sur les registres, le seul roman de sa signature. La dette était là, pourtant, jusqu’à ce jour. Ce genre de chose qu’on sent qu’il faut aussi régler.
Guillaume T, octobre 1834, novembre 1884. Un siècle tout juste avant Orwell.
Dans la France chrétienne d’alors, on composait à la plume des espèces de faire-part en carton plié : « Il n’a pas connu le repos ici-bas. Priez pour lui, en retour, il priera pour vous ».
Voilà. A ce point d'effacement, la prière est telle une dette, et la dette telle une prière : nombreux ceux qui furent, et dont le portrait le plus juste n'est qu'un champ...

20:09 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature, ain, thil, france, état-civil, hérédité | 
vendredi, 27 mai 2011
Spéléo médicale et mendicité
Hier après-midi, à l’hôpital, me suis payé bien malgré moi une petite séance de techno-spéléo à l’intérieur d’un étroit tube blanc. Une demi-heure coincé là-dedans sans bouger le moindre orteil, dans un tohu-bohu incessant. J’ai eu le temps de me réciter deux fois la tirade de Chrysale des Femmes Savantes (« C’est à vous que je parle, ma sœur… ») qu’une prof de français comme on n’en fait plus nous avait fait apprendre en classe de cinquième (ça date pas d’hier !). Une page entière du fragment « Thalia » d’Hypérion (« Et comment des mots auraient-ils apaisé la soif de mon âme… »), apprise cette fois-ci pour un spectacle monté en 1985… Rien ne se perd, décidément, et l’imagerie médicale, ça ramone drôlement les méninges : une mémoire intacte.
A moins que ça ne soit ce sacré produit qu’ils foutent dans la viande du dedans pour faire contraste, comme ils disent. En tous cas, avec tous les textes que j’ai appris jadis, je me suis tenu en bonne compagnie dans leur tube, sans broncher, patient modèle. Comme quoi le théâtre mène à tout. A un moment donné, me sont revenus Le rat et l’huître de La Fontaine et le Grand Chêne de Brassens. Nickel. Le tout entrecoupé de Inspirez, bloquez. Inspirez, bloquez, pour ponctuer le spectacle.

Quand le spectacle a été fini, le cathéter retiré, le pantalon renfilé, suis resté un moment sur cette large terrasse aérée où j’allais me promener chaque soir il y encore quelques jours. Des types se baladaient en chemise ouverte dans le dos et sur-chausses, traînant leurs pieds à perfusion. Curieux comme on passe d’un état à un autre. Il y a là de très grands malades, qui ne sortiront plus. Je me demande s’ils « tiennent » par leur volonté, ou par celle de la médecine, tant ils sont pris en charge depuis longtemps, remis, soumis à ce temps qui dure, devenus un cas entre les mains d’experts. Le pire comme le meilleur, ici.
Hier, sur la place de la Croix-Rousse, j’ai aperçu de loin, sur un banc, un homme qui était mon voisin de service hospitalier il y a peu. Avec lui, je n’avais échangé que quelques mots, mais quelles paroles, puisque nous avions commencé à marcher à nouveau au même moment ; on s’encourageait du regard en se croisant, « c’est bon pour le moral ». Ça m’a vraiment troublé parce que, là, sur cette place, le voilà assis en train de faire la manche au soleil avec une casquette posée devant lui, l’air intériorisé. Remis apparemment, lui aussi. Je m’attendais si peu à le trouver là, dans cette situation de surplus, que je n’ai su quoi dire ni quoi faire. J’avais dans la poche un billet de 20 euros et une pièce de 2 euros. C’est idiot, mais je me suis vu lui donner ni l’un ni l’autre, comme si ça me dérangeait que nous ne soyons soudain plus du même bord après avoir connu le même sort, et sans avoir non plus pris le temps de sympathiser assez. Bref. Ne sachant plus quelle attitude adopter, je me suis honteusement dérobé. Le « monde », qui refait son effet.
Tout ça me semble être en effet un reflet assez minutieux de l’irréalité dans laquelle la société européenne et sa schizophrénie latente nous plonge sans égards. Inégalité des conditions, égalité des sorts. Valeurs proclamés, comportements tenus. Va et vient. Face et pile. C’est sans doute pour ça que, contre toute décence commune (au sens le plus orwellien du terme) la situation du politicard Strauss-Kahn « émeut » des gens pourtant en apparence sensés, qui le plaindraient presque, dans son 630 m2. Un monde, disait Shakespeare, sorti de ses gonds. Et qui n'y est jamais retourné depuis...
09:41 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : irm, médecine, société, croix-rousse, politique, littérature, théâtre |