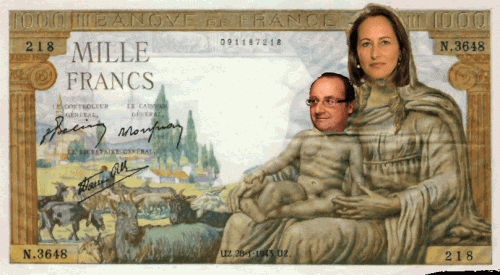mercredi, 27 mai 2015
Nous ne sacrifions rien (3)
Rien, donc, nous ne sacrifions rien, du moins en sommes-nous persuadés. Rien de notre temps, de notre santé, de notre plaisir et de nos porte-monnaie. De temps en temps, pour quelques bonnes causes estampillées République, nous nous fendons de quelques pas, serrés les uns contre les autres pour faire peuple ou image, tels des aveugles. Et l’on se croit forts. Et l’on fait des selfies. Et l’on pense avoir accouché d’un esprit, comme les pygmées autour de leur chaman, dansant au centre de leur village. L’esprit de la République… A l’occasion des rassemblements autour de Charlie, un repaire de folliculaires qui, devenus millionnaires, finiront par s’entretuer, ce fut la dernière trouvaille des nains nantis qui occupent les palais français entourés de journalistes ou de starlettes, et ne méritent même plus qu’on gâche de la salive à leur sujet. De toutes ces marches, de toutes ces messes, la véritable religion est absente, parce que nous ne sacrifions rien, ni de nos mains ni de nos têtes vides, et nous le sentons tous, puisque rien de ces simagrées ne perdure aussitôt que la dure réalité nous étreint de nouveau la gorge. Chimère, que cette religion maçonnique, laïque et républicaine.
Nous ne sacrifions rien, pas même de la matière grise… Et pourtant : en cherchant à nous fourguer leurs valeurs, en les imposant à tous à coups de bombes dans le désert, de congrès dans les zéniths ou de procès dans les médias, ceux qui nous dirigent, les chamans du Veau d’Or, continuent d’organiser un bel enfer dans la cité. Quant à nous, à force de ne sacrifier qu’à leur consommation et à leur divertissement, nous sommes vidés de nos âmes, rien de moins. C'est notre liberté réelle que nous leur offrons. Notre égalité naturelle. Notre fraternité véritable. Nous sacrifions l’Eglise, du moins notre place en Elle car Elle, Elle est garantie ; le murmure de nos faibles vies, pas. C’est du moins ce que nous assurent deux mille ans d’histoire chrétienne. Face à cela, les valeurs républicaines dont se gargarisent ministres et députés ne sont qu’une contrefaçon, vidée par d’habiles manœuvriers du précieux sang du Christ, une vulgaire contrefaçon des vertus authentiquement catholiques qui firent notre civilisation. Une contrefaçon, ça ne vaut rien. Qu’on ne s’étonne pas que l'enthousiasme des foules ne dure pas pour des tels esprits ! L’Eglise est millénaire, la République a vécu ses derniers feux au bout de quelques décennies d'un pouvoir illusoire dans un siècle traversé par deux guerres mondiales, étranglée par l’ogre américain de Maastricht, avec la bénédiction d’un président prostatique, lui aussi obsédé par certaines forces de l’Esprit… La République véritable, le bien commun, appartenait au peuple et était censée s'occuper au mieux des affaires de l'Etat et de la nation. Elle a failli à sa mission triplement, d'une part en bradant la nation, d'autre part en privatisant l'Etat, et dorénavant en singeant une religion panthéiste de je ne sais quels Droits qui seraient universels de l'Homme, droits divinisés à coups de rhétorique pour branquignols comme seuls les empereurs romains savaient le faire de leurs abstractions de pierre quand il s'agissait de se faite porter en triomphe par des imbéciles. Incapable de faire régner la discipline dont elle se réclame, elle ne peut qu'imposer à coups de décrets son ordre factice, parce que vide de tout sacrifice, même piteusement symbolique. Ce faisant, elle se jette d'elle-même dans le discrédit, nouant autour de son propre cou un fil, et le tirant de toutes ses forces un peu plus chaque jour, tandis qu'un peu partout, la colère des peuples jetés dans le vide gronde, avide de futurs et forcément sanglants sacrifices...
Kermit, les forces de l'esprit...
05:44 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, république, religion, 11janvier, mitterrand | 
samedi, 24 mai 2014
Le dernier mensonge d'un trop long règne
« La démocratie est inséparable de la souveraineté nationale», disait De Gaulle. Sur cet extrait du débat entre Philippe Séguin et François Mitterrand de 1992, on voit le premier expliquer au second, en charge pour quelques longs mois encore de la dissolution du pays dans une construction fédérale aujourd’hui bien en cours, pourquoi ces deux notions vont inévitablement de pair. Et c’est édifiant, à la veille d’un vote européen, de réécouter Seguin en train de prévoir l’impuissance des successeurs de ce rusé et matois vieillard (impuissance dont l’actuel locataire de l’Elysée est l’héritier caricatural, à la fois effrayant et ridicule). Lorsque, à la toute fin de l’extrait, Seguin interpelle Mitterrand en mettant en doute la possibilité qu’auront ces successeurs là de mener une politique nationale libre et souveraine, l’assurance avec laquelle Mitterrand affirme : « le traité de Maastricht le permettra» en dit long sur la duplicité de son long règne. Et de fait, il aura fallu le mensonge et l’autorité de ce rusé et matois vieillard pour faire basculer le vote de Maastricht du sinistre côté.
Sur son blog Off-shore Philippe Nauher nous propose de réécouter Philippe Seguin, « dernier homme politique français », lors de son discours contre le traité de Maastricht à l’Assemblée Nationale, cette même année 1992. Ce qui a été fait, disent tous les progressistes, peut être défait. Dont acte.
09:56 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : élections européennes, seguin, mitterrand, europe, france, dictature, souveraineté, otan, usa, démocratie, culture, politique | 
samedi, 01 février 2014
Un fameux numéro de clown
N'est-ce pas comique de réécouter aujourd'hui cet extrait du 1er discours de Mitterrand en campagne à Beauvais, en 1981. C'est là qu'on voit que le pingouin contemporain est très très loin du talent d'orateur de celui qu'il prétend imiter. Il reste qu'en écoutant les propos du maître, on voit quand même que c'était déjà un fameux numéro de clown !
20:56 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mitterrand, politique, orateur, socialisme, imposture, beauvais, 1982 | 
dimanche, 22 janvier 2012
Billet de campagne : Le petit françois
Derrière le petit François, les paturages de la France tranquille, son pays, la Corrèze. Le petit François se doit de faire mieux que les 16 % de Jospin (un point de principe) en 2002 et que les 25 % de Ségolène (un point d'honneur) en 2007. Il est, le petit François, empégué dans beaucoup de légendes, de rêves enchantés qu'il voudrait, faute de mieux, éveiller, dit-il. Le petit François, comme le Grand de 81, voudrait finir gravé dans le marbre.
Pressé, le petit François nous refait en un seul le coup du Mitterrand Président de 81 et de la Génération Mitterrand de 1988. Il appelle ça la Génération Hollande Président, rien que ça. Cherchez le changement. Depuis quinze ans, en réalité, le petit François n'a pas grandi. C'est ça le souci.
Mitterrand Président, trois syllabes, des allitérations, des assonances, ça marchait bien, oui. Mais Génération Hollande Président, ça fait un peu comme deux marques de fromages dans les promos à Auchan. Enfin bon. Moi, ce que j'en dis.
En prime, avec le billet, les deux affiches :

1988
2012 : Cliquer pour agrandir
Le dessin de la fille en bleue au dessus du N de Hollande, c'est une militante socialiste le soir de la victoire ? Et cette typo ? Et ce jaune ? Faire plus moche, est-ce possible ? Le mec qui a fait cette affiche est une taupe de l'UMP, non ?
01:14 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : politique, ps, hollande, 2012, mitterrand, génération hollande président | 
mardi, 15 novembre 2011
L'écharpe de K
Les ronds se tirent vite. Tout ça n’est pas nouveau, non. Mais depuis peu, ça s’est corsée, la vitesse à laquelle l’argent coule. De plus en plus leste, virevoltante et fatale, la monnaie : tirer sur chaque dépense jusqu’à la fin du mois, c’est devenu une façon d’être seul au monde. On y arrive en tirant par ci, par là, les bouquins, les plaquettes de beurre, les chaussettes. Geste furtif, et hop. Le franc est en train de vivre ses dernières années. Une clique d’économistes parie sur l’euro à venir. Comme ça, tout ça, paraît abstrait, lointain. Situation précaire, certes, que la sienne : tester la méthode torcheculative de Rabelais sur des infirmes moteurs et cérébraux dans une banlieue parisienne dont on vient juste de changer le nom, tu vois, de Les Gonesses à en France, comme si pour améliorer le sort des pauvres il suffisait de changer de nom… Et puis les occuper comme tu peux, les infirmes, ça s’appelle éducateur, il fait le job, comme on dit à présent des footballeurs, alors qu’il n’a même pas le diplôme en poches : avec la rigueur, mot depuis peu entré en fonction, on regarde plus trop nulle part qui fait quoi.
La seule conclusion qu’il en a tirée, c’est qu’au moins pour surnager, s’il doit vivre encore longtemps, durer, et sait-on jamais une vie, parfois ça dure, il faudrait reprendre des études, ces sacrées études qui lui ont toujours tant coûté, comme si tenir en place à écouter des faux savants, non vraiment.
Parce que de véritables études pour lui jusqu’alors, ça restait quand même l'école de la rue, celle de la route, de la scène, et puis les petits jobs par ci, par là, d’usines en administrations, d’hôpitaux en commerces, le boulot, la démerde et la débine à chaque fois remise au lendemain. La scène et le carnet de notes, et toujours tout recommencer. Engagé dans rien, endetté de rien. Survivre en temps de crise. Tenir bon. Rien devoir à personne.
Je raconte donc l’histoire d’un étudiant tardif et fauché. Tu imagineras que la scène se passe au printemps 1986. Cet éternel instable trime donc dans un foyer pour handicapés à Tremblay trois journées de treize heures, avant l’ère de la sinistre Aubry, ça faisait 39, la semaine pour tout dire. Depuis peu, la situation dans le pays s’est durcie. Elle en finira plus de se durcir, au fur et à mesure qu’on ouvrirait les frontières et ferait monnaie commune et qu’on l’aurait dans le cul, la situation. Le bel enfumage. Plus la même insouciance, non : Ni dans la capitale ni ailleurs. A moins que ce soit lui, depuis qu’il a vraiment réalisé dans sa chair de mortel qu’il est tout seul au monde, que c’est leur lot à tous, que se croire en famille c’est quand même un sacré luxe, et que trois rides lui barrent le front, à moins que ce soit lui qui finalement se soit rendu, ait accepté que ça irait peut-être mieux en retroussant les manches et en roulant une bonne fois pour toutes pour sa bosse par les sentiers de l'insertion.
Il a suivi ce jour-là la rue des Ecoles jusqu’à son extrémité, son bout. Il a passé la fière Sorbonne toute de pierres vêtue, le cœur-Villon pincé, il a filé devant le Collège de France dans le jardin duquel rêve, oui c’est le mot vraiment, rêve Montaigne, et comme on n’a pas voulu de son dossier à la Sorbonne –déjà trop vieux – il a poussé jusqu’aux tours si laides en face du Nemrod, ce campus hâtivement bâti. Il a d’abord bu un café, puis deux pour se remonter le moral, ah que n’a-t-il étudié du temps de sa jeunesse folle ? Dans la rumeur des conversations, le cliquetis de cuillers à café dans les tasses vertes que sur leurs plateaux ronds des garçons en pantalons noirs, tabliers blancs, trimballent comme s'il était en train de s'égarer dans une page de Sartre. Un rendez vous avec le Président de Paris VII, rien que ça, à quoi ça ressemble, un président de Paris VII songe-t-il en laissant traîner son regard sur ces tours salies dans la brume qui ressemblent à un coin de banlieue planté par mégarde à deux pas de Notre-Dame.
Finalement ça a marché. Il a fait valoir la compagnie théâtrale créée jadis, l’ouverture rectorale accordée à cette époque, un bouquin édité en 81, plusieurs articles sur une ou deux pièces, tout ça, il n’en revient pas, le président de Paris VII lui a dit : « vous n’allez pas perdre un an pour rien, ça peut faire une équivalence professionnelle tout ce que vous me racontez là, vous n’avez plus de temps à perdre… » Une équivalence professionnelle ? Alors qu’il n’a pas suivi un seul cours, le voilà déjà en deuxième année, le voilà les deux jours de la semaine qui lui restent après les trois perdus chez les handicapés, à suivre un cours sur La Religieuse, un autre sur La Peau de Chagrin, et le plaisir de retrouver ce latin qu’il n’a jamais vraiment égaré depuis son cher et vieux lycée de province, le Pollio de Virgile et le Pro Archia de Cicéron. En septembre, les bombes ont pété rue de Rennes, à la Fnac où il va chercher les bouquins qui lui manquent. Comme c’est curieux, ça. Il lit la Poétique d’Aristote tandis que des passants innocents, non loin, payent la facture d’Eurodif, et Chirac, le soir, avec du sang sur les mains qu’on ne voit pas, mais tous ces rictus qu’on voit : « mes chers compatriotes », on dirait un Homais désappointé. A cette époque, il lit tout le temps, comme on respire. Quand il marche dans Paris, c’est la force des auteurs qui le portent, exactement ça, et lui montrent les magasins d’aujourd’hui, le délabrement dans lequel les êtres sont. Ce qui fait que ce qu’il dit quand il ouvre la bouche n’est pas toujours clair, branché au bon endroit. Qu’importe, se dit-il. Autour de lui, ça ne compte plus. Aucun ne l’aidera à survivre, à trouver salaire et pitance, rien d’autre que lire. Pas de temps à perdre. Plus de temps. Un prof, un jour, en lui rendant une copie lui dit : « vous, il faut passer l’agrégation, et vite… » Comme si tout à coup, au son de cette voix, il rentrait à la maison... Comme si passer l’agrégation n’était au fond qu'une formalité ressurgie du néant.
Le voilà donc dans cet amphi où résonne un cours de licence. Enfin, un cours… On vient de la Sorbonne, on vient de l’ENS, on vient de Censier, de partout pour écouter la star. La star de Jussieu. Même à Paris, flotte quelque chose d’atrocement provincial, se dit-il. Il s’est inscrit à son cours parce qu’il n’a pas de temps à perdre. Les stars l’emmerdent, l’ont toujours emmerdé, celle-ci comme d’autres, on dirait une madame de Bargeton égarée là devant ces Rubempré niais à mourir, mais il paraît que K…, contre un exposé bien ficelé, refile facilement l’unité de valeur. Et ça, il en a besoin. Comme il a besoin de monnaie. La sémiologie et lui, jusqu’alors, les théories du signe… De la Bible jusqu’à James Joyce, rien que ça, a-t-elle annoncé avant de distribuer à tous les auditeurs une liste d’exposés, comme si elle marchait sur la lune.
K… est une fort jolie eurasienne, jadis trotskiste et parvenue avec la grâce d’une papesse de la gauche mitterrandienne dans ce qu’il est convenu de nommer la force de l’âge. Lui, il a tiré au sort « la théorie du signe dans la Logique de Port-Royal ». Diable ! Arnauld, Nicole, et cette affaire de raison janséniste, le jugement. Voilà de quoi l’occuper quand il garderait cette semaine les fauteuils au foyer. Jongler avec les syllogismes. Les mater. Ah, les mots considérés « comme des objets de pensée » et ceux qui ne font que renvoyer « à la forme et à la manière de nos pensées ». Ceux qui et ceux qui ne font que. Tout est là. S’il y a une théorie plausible là-dedans, nous partirons d’une prémisse remarquable, c’est qu’elle ignore l’arbitraire. Au sortir du métro, déjà des bradeurs d’écharpes étalées à même le sol. Il ya toujours eu des vendeurs à la sauvette, des vendeurs de tout, et puis des musiciens. La débrouille. Ces écharpes écossaises, à 20 francs l’une, il en portait d’ailleurs une en ce mois de février – ça devait être 1988 – qui commençait à s'effiler, nouée autour du cou, grise, blanche et noire, et qui gardait son odeur rance et tenace à lui, son propre parfum comme en conserve, qu’il humait dans la journée, comme on hume une superstition. Comme deux chiens affamés, Mitterrand et Chirac allaient se jeter à la gueule l’un de l’autre la libération des otages, toujours cette sale histoire de l’uranium et des millions d’Eurodif, « les yeux dans les yeux je le conteste », on s’en souvient, Dieu-Grenouille serait réélu, et Libération, le journal que lisait K… et dans lequel elle-même et les gus de sa bande écrivaient parfois des articles d’indignés titrerait bravo l’artiste, et le pays berné. La décomposition de l’artiste, comme celle du pays, galopante
Un jour, son tour vint d’aller mendier son 18/20 devant la bruissante assemblée. Pendant que les strapontins claquaient, miroir de poche en main, Julia se refaisait une beauté habile. Car elle commence à avoir l’Eurasie fatiguée, ça se comprend. Derrière elle, le tableau est empli d’équations et sur le bureau est posé le chiffon pour effacer les traces de ceux qui nous ont précédés. C’est ça, la connaissance, un long chemin. Il avance la main pour s’en saisir, de ce chiffon empli de poussière blanche, et au tout dernier moment s’aperçoit qu’en réalité, ce chiffon est une écharpe, une vraie, comme celle qu’il porte à son cou. Une de ces écharpes que les pauvres vendent au noir à des pauvres dans le métro, vingt balles, oui, on disait alors vingt balles, vendre comme on jouerait de la guitare et la porter de longs jours jusqu’à ce qu’elle sente l’odeur, ton odeur. Il hésite.
K… fait une moue et pose sur sa main à lui qu’il vient d’immobiliser devant cette foutue écharpe ? ce maudit chiffon ? il ne sait plus qu’en penser. Elle pose son regard aux longs cils et c’est vrai qu’il est beau et profond, ce regard qu’elle laisse glisser le long de son avant-bras à lui, son bras, sa bouche, ses yeux maintenant, elle le fixe quelques secondes tandis qu’il rosit, pris en flagrant délit de pauvreté. Et elle, l’universitaire qui théorisa si joliment les lois les plus retorses du langage et de la Révolution, d’une voix sèche, sucrée, tombant comme un couperet lâche : « Vous ne pensez tout de même pas que cette écharpe est à moi ? »
Je dédie cette fable à toutes celles et tous ceux qui galèrent pour mener à terme quelques études leur permettant (peut-être) de survivre dans la Jungle.

06:06 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, jussieu, julia kristeva, la logique de port royal, théories du signe, sémiologie, précarité, mitterrand, chirac, politique, société | 
lundi, 09 mai 2011
Quelque chose de Mitterrand
Ah, le socialisme à la Tonton ! Impossible de ne pas jeter un regard ironique sur les festivités naphtalinées qui vont encombrer la télé cette semaine à l’occasion des Trente ans du 10 mai 81 ! S’agit-il, avec ce « Quelque chose de Mitterrand », de tenter de susciter des désirs d’alternance et de mythifier la non-histoire du PS français à l’heure où DSK qui débarque en Porsche voudrait que les clés du pouvoir fussent dans la boite à gants ? Le PS, comme l’UMP, n’a jamais été autre chose qu’une machine électorale, un raconteur d’histoires assez simpliste. Changer la vie, disait-il sublime, forcément sublime…
Depuis l’été, la stratégie d’Aubry se borne à expliquer aux Français que leur seul problème, c’est Sarkozy. De marteler que ce qui clocherait chez ce président, c’est sa personne. Une certaine partie de la droite, celle où l’anti-sarkozisme est le plus véhément, lui a prêté main-forte. L’idée est ainsi passée via les medias dans de nombreux esprits. La suite logique de cette première idée, c’est qu’il suffirait de changer la personne pour continuer à sa place la même politique. CQFD.
C’est alors que DSK pointe le bout de son nez avec son expérience de gouvernance économique mondiale incontestable, patron du FMI, pensez-donc ! Les Moscovici et autres Cambabélis apparaissent, au simple nom de Dominique, comme des chats en rut.
On croit les voir déjà à cet instant où, l’Elysée en poche, ils useront de l’expérience de Dominique au FMI comme d’un argument d’autorité pour affirmer, la main sur le cœur, que, tout socialistes qu’ils soient, la seule politique réaliste pour le peuple français sera une politique de rigueur. Parlez-en voire aux Grecs !
Par rapport à ce futur qu’ils espèrent proches, ce lointain passé de mai 81 qu’on célèbre sur toutes les chaînes comme si c’était un événement fondateur se voudrait un âge d’or.
Mitterrand lui au moins était cultivé, entend-on ça et là.
A ce point, il faut reconsidérer l’argument de la non-culture du président actuel, que le récent livre de Franz Olivier Gisbert, M. le Président et le film La Conquête, qui va sortir bientôt, replace à nouveau sur la table, et qu’on a l’air d’opposer à la prétendue culture de François Mitterrand.

Denis Podalydès, interprète de Mitterrand dans Changer la vie
00:17 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : mai 81, mitterrand, politique, denis podalydès | 
lundi, 06 décembre 2010
Décembre 86
L’année 1986 finissante cristallisait de nombreux antagonismes. Depuis le 16 mars, la cohabitation entre le mitterrandisme « rose », déjà bien fané, et la chiraquie à la traîne des autres droites occidentales, instaurait un climat bel et bien faisandé.
Premier ministre depuis le printemps, Chirac devait imposer à la tête de sa majorité l’image d’un chef déterminé. Mitterrand devait de son côté restaurer sa légitimité malmenée par la défaite des socialistes aux législatives de mars ; tous deux, aux aguets l’un de l’autre, se positionnaient déjà en vue de la présidentielle de 1988. Climat détestable.
Le discours sécuritaire commençait à dominer dans tous les médias et à imprégner durablement les esprits, alimenté par ce qu’on appela rapidement à Paris « la vague terroriste » - une série de plusieurs attentats qui venaient de faire 11 morts en tout en septembre : bureau de poste de l’Hôtel de Ville le 8, dans le pub Renault des Champs-Elysées le 14, à la préfecture le 15, devant le magasin Tati rue de Rennes, le mercredi 16.
L’installation du pays dans une politique de rigueur depuis 1983, laquelle n’a jamais cessé depuis, exacerbait le racisme ordinaire, lequel n’a pas non plus décru. Depuis plus d’un an fleurissait la petite main jaune, tandis qu’un certain Le Pen venait en 1984 de passer la barre des 10% à des élections européennes, presque le même score que Georges Marchais, dont le parti perdait d’un coup 9 députés, amorçant sa plongée aux enfers.
Tournant historique.
La cohabitation politique, le discours sécuritaire issu des attentats, le racisme ordinaire : trois maux qui lentement étaient en train de changer le monde, et dont l’insidieux mélange allait tuer un homme. Dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, tabassé par deux CRS voltigeurs au fond d’une allée du 20 rue Monsieur le Prince, devant un fonctionnaire au ministère des Finances médusé par la violence des coups portés, mourait Malik Oussekine.
Le drame se produisait après une manifestation particulièrement stratégique, en plein cœur d’un mouvement d’étudiants dirigé contre la réforme Devaquet. Ce projet de loi, initié par le retour de la droite aux affaires, était l’un des premiers à véritablement tenter d’introduire la logique du privé au sein de l’université (hausse des frais d’inscription et mise en concurrence des universités). A l’époque, on insista sur le fait que Malik Oussekine n’était pas manifestant, comme si le fait d’être manifestant aurait pu justifier le meurtre. A l'époque, le Figaro Magazine osa cette phrase ahurissante : « Après la mort accidentelle du jeune Malik Oussekine, frappé par des policiers, Jacques Chirac retire le projet d'autonomie accrue des universités», et Louis Pauwells s'illustra avec son sida mental. Face à face, la droite la plus con et la gauche la plus pourrie.
Je me souviens d’une manifestation silencieuse spontanée qui, le lendemain du meurtre d'Oussekine, réunit quelques centaines d’étudiants, de la rue des Ecoles à la gare de l’Est, avant le retrait définitif du projet et la messe de cloture du 8 décembre qui mit fin au mouvement dans d’impressionnants cortèges (cf. photo). Cette manifestation du 7 novembre 1986 m’a laissé l’étonnant souvenir d’un bloc de silence compact, traversant le quotidien de Paris, comme un cortège réellement endeuillé par beaucoup d’illusions perdues.
C’est à ce moment-là que l’habile François tourna, vers cette jeunesse dont il fit plus tard sa « génération », un œil de faucon encore vif et si hypocritement paternaliste qu’on l’appela Dieu. Dans son ombre, l’habile Jacques dont les cheveux commençaient à se clairsemer - un faux-dur entouré de vrais professionnels, disait de lui le Président - apprenait à lustrer des pommes.
L’habile Nicolas, lui, avait depuis 3 ans installé son campement à la mairie de Neuilly. De sa première épouse, avant Carla Cécilia, lui naissait un second fils, Jean. Quant à l’habile Ségolène, pour préparer les rencontres internationales de Mitterrand, elle quittait son poste de conseillère municipale à Trouville-sur-Mer dans le Calvados, en raison de « fonctions d’importance croissante à l’Elysée. » Diable… Quoi de neuf sous le soleil ?

Paris, manifestation silencieuse du 8 décembre 1986
20:39 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : malik oussekine, décembre 86, politique, réforme devaquet, chirac, mitterrand |