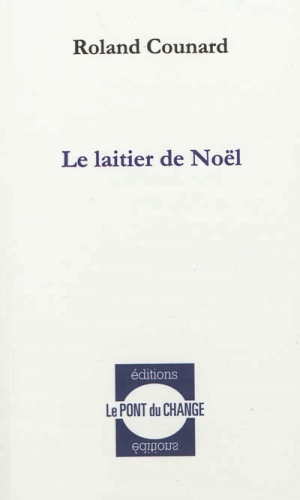mardi, 27 novembre 2012
Ni ce qu'ils espèrent, ni ce qu'ils croient
La gnôle : S’il y a un fil conducteur à ce bref roman d’Elie Treese publié par Allia, c’est bien ça, la gnôle. Boire trop de gnôle, « c’est ce qui fait qu’un péquenot se met à réfléchir ». Et c’est la gnôle aussi, nous dit-on, qui « forge des philosophes merdeux ». Quatre personnages dont Maroubi, le narrateur, « un jeune gars qui voudrait bien faire », quatre personnages venus « faire un travail sur un chantier » : Maroubi, Hadès, Low et Her Majesty.
Leur travail ? Voler du gasoil.
Le gasoil, c’est l’autre fil conducteur du récit, il incarne la quête des personnages puisqu’il s’agit de le siphonner dans des camions au bout de la nuit. Il est le pendant de la gnôle, la métaphore du sens qu’on va mendier auprès des autres, de l’énergie dont il faut se remplir pour que l’action mène quelque part lorsque, comme eux, on se retrouve condamné à la stagnation.
Demeure le chantier, le lieu même du récit. En littérature, un non-lieu est toujours allégorique de quelque chose, de l’œuvre, par exemple, en train de se désirer, de se rêver, de prendre forme, de s’épuiser aussi. Elie Treese est nostalgique d’une écriture qui ne serait pas que du dire conjoncturel, d’une littérature qui ne serait pas que du marketing. Il est adepte de la phrase errante, celle qui sans guillemets récupère d’écho en écho paroles et pensées de chacun de ces personnages immobilisés par le froid dans la répétition, dans le style. Avec eux, on campe en cette écriture, plus qu’on ne la lit. Immobilisé par le froid du non lieu, de la rétention de l’action.
Ce qui attend les hommes après la mort, avança un jour Héraclite, est ni ce qu’ils espèrent ni ce qu’ils croient, et c’est de cette citation que le nostalgique Elie Treese a tiré son titre : Hésitant sans cesse entre deux références, l’écrivain pastiche autant la parole de Steinbeck que la langue de Beckett, sans qu’entre la tentation de l’action et celle de l’absurde, rien vraiment ne se décide. Dans cet étrange statu quo, le texte se déplie. Couverture et incipit :

J'ai planté deux doigts dans la terre et j'ai sorti un peu de cette terre froide et humide et j'ai dit alors on est tous un peu comme ça, on est tous un peu comme cette terre qu'on peut prendre dans la main et serrer dans la main et écarter dans la main jusqu'à ce qu'elle tombe en morceaux sur le sol et j'ai dit aussi ça ferait comme une sorte de tas si d'un coup on se mettait tous à effriter la terre avec nos mains pour voir si on arrive à quelque chose, simplement si on arrive à faire une chose qui sorte un peu de l'ordinaire. J'ai regardé sur le côté et j'ai dit merde Hadès, c'est pourtant vrai qu'elle doit être importante, cette terre, et d'ailleurs, il n'y a rien que j'aime plus que de m'asseoir ici sur les feuilles quand ça fait juste un peu froid au cul, et ça doit ressembler un peu à l'ancien temps, tu sais, l'ancien temps comme tu disais, avec des types qui en avaient parce qu'on n'était pas encore rendus dans un monde de mange-merde...
00:09 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : elie treese, allia, littérature, ni ce qu'ils espèrent ni ce qu'ils croient | 
dimanche, 18 novembre 2012
Le laitier de Noël
Le Laitier de Noël de Roland Counard est un récit d’apprentissage étrangement efficace, à la poésie réaliste et minimaliste. L’histoire se passe dans les années cinquante. Robin, le personnage principal est le narrateur-enfant. Tandis qu'il grandit, ses parents, grands-parents, voisins, prennent corps dans le phrasé par fragments successifs. En ces temps-là, par omission ou pour de bon, on mentait volontiers aux enfants dans les familles : pour leur bien, disait-on; la duplicité et l’inconstance des liens familiaux et sociaux se découvre donc dans un fossé, celui de la fiction qui sépare ce qui se dit de ce qui se fait, au fur et à mesure que l’intrigue se déroule : d’abord un accident, puis un meurtre.
Grandir parmi ces adultes qui sont de tels taiseux revient donc à mener une enquête sur le monde, c’est édifier son propre récit : ce « laitier de Noël », qui arrose de lait des arbres pour qu’ils poussent, entre dans le monde de la parole et de l’action, qu’il découvre être aussi celui du crime, en passant brusquement de l'ignorance à la cruauté. Il signe à chaque fois sa découverte et son apprentissage de la mort d’un litre de lait, laissé auprès du cadavre. Incisif, bref, ludique, poétique et policier, ce récit, qui ne se laisse pas consommer en une seule fois, engage à la relecture. Initialement publié en 1996 par Courant d’ombres, il vient d’être réédité par Jean jacques Nuel aux éditions Le Pont du change. Une des très bonnes surprises de la rentrée.
10:50 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : le laitier de noël, roland counard, le pont du change, littérature, poésie | 
mardi, 10 juillet 2012
Le petit garçon
En face du balcon la ligne d’un immeuble, un immeuble de neuf étages en béton. Sur la moquette, le petit électrophone, un Teppaz avec une pointe qui, dansante, grésille. Cette voix brusque et tendre qui affirme : « Attends, je sais des histoires… ». Il y a bien un homme, c’est le gardien de l’immeuble, et il a l’air idiot. Des histoires ?
De l’autre côté de la porte de sa chambre, une porte en contreplaqué, sa mère qu’il aime va et vient, soucieuse. Parfois elle entrouvre et le regarde, qui écoute cette voix et cette musique, l’esprit vide, l’esprit bien. Leurs yeux se croisent. Il lui sourit. Elle referme la porte. Cela fait des années qu’ils sont comme ça, tous les deux.
Des histoires de gens qui s’aiment. Il n’y pense pas. Il est juste bien à écouter cette voix chaleureuse de Reggiani, comme si une histoire enfouie devait peu à peu surgir de son for intérieur à lui, qui s’ennuie, s’il parvenait à apprendre à se taire. Difficile de se taire, quand on s’ennuie. Il y a tellement d’autres histoires à retenir au collège. L’esprit toujours trop bruyant. A penser. A dire. S’il apprenait à se taire… L’engouement qu’il éprouve pour cette chanson n’est pas un simple effet de mode, non. Une histoire, plutôt, d’où découlerait sa propre vie.
Mélodie. La voix de Reggiani est chaleureuse. Elle lui parle, elle le captive. Il s’y noie. Elle lui raconte en sens inverse une histoire qu’il reconnaît sans la connaître, ça qui lui fait du bien. Une uchronie, diraient certains savants. Cette inversion étrange qui crée un équilibre, un sentiment intime de sécurité, là où le soir, il faut respirer très profondément pour ressentir le calme. Ce n’est qu’un F3, comme on dit, dans un HLM. Mais au moins y possède t il sa chambre sur les murs desquels il peut accrocher ses dessins.
Parti, resté, et lui-même ? Qu’importe le détail. C’était commode alors de se dire que seul l’amour compte. Une phrase du Christ, épinglé sur son petit bureau : « La haine n’a pas d’avenir ». La haine, l’amour : des sentiments nobles ! Des sillons du vinyle se dégage une dramaturgie simple et efficace : un tragédien de formation, ce Reggiani ! Sergio, un parleur, un enjôleur d’italien ! C’est étrange, parce qu’il a l’impression qu’autour de lui les gens ni ne s’aiment vraiment, ni ne se haïssent. Que le Réel est autre. Dans l’autobus, le matin, les gens montrent au chauffeur leur carte d’abonnement. Les gens reviennent le soir. Il faut trouver du travail.
Pourtant, il aimerait que sa mère cesse de tant travailler, comme ça. Tant qu’on travaille comme ça, on a l’impression que ça va. Que tout va bien. C’est ça qu’on tente de lui faire croire, et c’est ça qu’il croit peu à peu la plupart de la journée. Au mois de mai, la grève avait fini par s’éterniser. De temps en temps, comme par exemple en écoutant cette chanson, être à même de croire à nouveau à la haine, à l’amour, aux sentiments nobles.
C’est un absent qui lui parle. Quelqu’un qu’il imagine. Tout est opaque et il ne distingue pas bien les traits de ce visage. Reggiani, bien sûr, n’est qu’un masque. Un bon comédien. Si grandir sera s’éloigner davantage, il ne faudra pas oublier ce qui se dit, se chante et se mesure en lui tant qu’il écoute en boucle la promesse qui lui est faite, bien moins futile que celle, politique, de ce pauvre mois de mai…
Le petit garçon, Serge Reggiani, 1968
00:01 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : le petit garçon, serge reggiani, mai 68 | 
mardi, 29 mai 2012
Jean Antoine Meyrieu (2)
Jean-Antoine avait conservé le parfum de la ferme dans le sel de sa peau. Il avait beau se tenir à présent droit au métier, loin de la terre, des bêtes, de la dépendance au temps qu’il fait, et de toute les inquiétudes dont il avait vu se creuser en quelques saisons le front de Jean-Claude, dès qu’un peu de chaleur se saisissait du chahut de l’atelier, l’odeur du paysan, faite de bouses, d’orages et de foins, montait encore d’entre le cuir de ses cuisses et celui de ses aisselles. Tandis qu’il surveillait l’agnolet, son esprit brouillé galopait alors vers ce temps qu’il avait cru perclus dans le tréfonds de soi-même. Ce n’était ici que les odeurs de la fosse d’aisance et celles des eaux ménagères stagnant entre les pavés de la cour que la sueur au travail attrapait contre soi jusqu’au soir, et dont elle emplissait le coton de ses nuits. Une odeur aigrelette qui avait tout enrobé et contre laquelle luttait la sueur de sa mémoire. Là-bas ! Se pouvait-il d’être d’humeur si tournante ? Mais le regard d’Etiennette mère, lorsqu’il avait quitté Aveyze, un regard à trancher un clou, l’avait fait citadin quoiqu’il lui en coutât pour le restant de ses jours
Pour lutter contre ça, il y avait le soir. Quand la journée était tirée, il allait retrouver le calme en quelque coin esseulé d’où l’on voyait la ville s’épandre à ses pieds. Ce confluent où s’entassaient des toits de tuiles à boc et tabac et qui n’avait jamais été qu'un mythe hostile et lointain pour son père défunt, ses reins confus de crampes lui donnaient sens : il avait gagné d’y être recensé chaque année dans le territoire des Grandes Terres, auprès d’Etiennette dont bientôt le ventre allait s'emplir. Il tendait le bras, clignait de l’œil puis, entre le pouce et l’index portés vers le vide, enserrait l’une et l’autre rive de la Saône, ce pont de pierre.si imposant de l’autre côté de l’eau mais d’ici presque malingre comme une planche en bois par-dessus un ruisseau : voilà, c’était ça, ce n’était que ça et c’était tout ça à la fois le sentiment d’être en ville, sentir bruissant autour de soi tous ces compagnons à l’œuvre, se dire puissant de leurs forces amoncelées là, de tous leurs métiers multipliés jusqu'à la plaine par les quatre coins de l’horizon…

Pont de Saône, daguérréotype, 1843
16:40 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jean antoine meyrieu, littérature, lyon, pont de saône | 
lundi, 16 avril 2012
Étiennette Chillet
Etiennette Chillet aimait ces jours d’avril, quand au plus fort de la journée, le thermomètre de la remise grimpait quelques heures à 13°. Cette fraîche douceur lui paraissait donner sens aux bas de laine et à la longue jupe de coton qui recouvraient depuis longtemps ses jambes été comme hiver. C’était un temps pleinement pascal, comme si longtemps encore après le Samedi saint, les minutes de tous les hommes eussent dû encore s’étirer dans l’absence et dans le gris, et comme si le curé n’avait pas retiré les longs draps des statues des chapelles, ni distribué à larges brassées son buis béni, et qu’il faille en son cœur attendre et attendre encore l’improbable retour d’un Amour Tout-Puissant, sans être dupe de la feinte des bourgeons, du pépiement matinal des oiseaux et du rougeoiement de la chair des filles et des garçons.
L’écran du ciel brumeux se fermait derrière les granges de La Chivas, celles-là même derrière lesquelles toute la nuit avait roulé un vent qu’elle avait senti meurtrier, malgré la chaleur de l’édredon. L’herbe sentait bon la pluie, et la pluie, bon l’herbe. A son carreau, Etiennette Chillet emplissait d’air ses poumons, et sous son tablier bleu nuit, ses maigres côtes formaient comme un relief heureux.
Et puis qu’aurait-elle été faire à la ville, de toute façon ? A force d’écouter mugir la violence des saisons, n’avait-elle pas compris qu’elles seraient jusqu’au bout le seul changement notable, et que celui des hommes était aussi méprisable que leurs opinions ? Tenter fortune pour le bonheur des marchands comme ses deux aînés qui se rompaient la colonne sur des métiers treize heures par jour avaient appris à le faire à leurs propres enfants, quelle vanité ! Son instinct n’avait toujours prétendu qu’au solide, et la ville n’avait à offrir que de l’éphémère.
Là, veilleuse au hameau, elle se sentait de la chair des escargots en leurs coquilles, une de sa race et fière de s’être entêtée. « Le roi Philippe, c’est ainsi qu’avec mépris l’avait nommé le bon curé d’Aveyze, le roi Philippe ne sentira jamais l’honneur de la France et la cire vive dont son peuple est bâti. » Rien, dans cette verte et tendre nature, ne présage l’égalité. Elle le voyait bien, Etiennette, sans même avoir à le théoriser comme un monsieur en habit noir. Tout, au contraire, est variété. Laisser espérer cette sotte chimère, aux citadins naïfs que sa lignée deviendrait à force par la lecture des journaux et l’écoute des discours politiques, telle est la tromperie de Philippe, que les politiciens les plus dangereux ne cesseront d’imiter. Le pisé de sa bâtisse formait bonne coquille. Combien tout cela prendrait-il pour s’effondrer ?
Etiennette Chillet ferma les paupières. Que lui importait, après tout, la marche de ce monde ? Elle était de mil sept cent quatre vingt-huit, d’un autre temps. L’empereur qui était passé sur leurs rêves ne leur avait rien appris, et le neveu qui l’avait imité non plus, tous dorénavant, galopaient en troupeaux furieux vers leur perte. Jadis, il y a si longtemps, le monde était empli de vivants qu’elle avait vu filer, à petits feux parfois, ou d’autres brusquement, comme ce boulanger de Bessenay qu’on avait découvert pendu dans sa grange à foins, et qui n’avait que trente quatre ans. Ses doigts avaient beau être raides, elle les sentait encore alertes et glissant sur le chapelet. La brume qui s’apprêtait à enserrer leur monde serait d’une étrange matière, opaque et gluante telle un songe confus. Au-delà, malgré l’acuité de ses pupilles et l’appréciation de son âge avancé, elle ne voyait pas, elle ne savait plus. Là où tous projetaient de stupides espoirs, elle n’éprouvait que les morsures de l’attente.

17:45 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : politique, présidentielles, bessenay, etiennette chillet, littérature | 
vendredi, 09 décembre 2011
Le plus beau billet du monde (7)
Voilà, finit par murmurer Polo, c’est ce matin là que je l’ai vu la dernière fois. J’ai trouvé son message le lendemain, dans lequel il me confiait son billet sans autre explication. Très souvent, il m’avait dit que le plus difficile n’était pas de vivre ou de mourir, mais bien proprement, de disparaître. Ils ont la manie du recensement, mais avec les disparus, ils sont bien emmerdés : c’est le nombre le plus difficile à établir, disait-il. Celui des disparus.
«J’ai attendu toutes ces années pour vous porter le porter, son billet, parce que je savais pas trop si on pouvait compter sur vous. Comment dire ? Un trois cents francs Clément Serveau dans cet état de conservation, vous comprenez, je sais combien ça coûte, même un peu gribouillé. »
A présent, le conserver intact, ça devenait difficile. Trop durs, les temps, pour un vieux pauvre comme lui. Et on risquait de pas en voir la fin. A travers la vitre fumée du bureau, les yeux baissés, Polo contemplait les jolis escarpins de Rita, qu’elle croisait comme sur une affiche. «On risque bien de pas en voir la fin, répéta-t-il d’une voix plus sourde.
«Il faudrait ne jamais le vendre, vous comprenez. On ne sait jamais ce qui peut arriver par la suite. Je veux dire : il n’est pas mort, il est simplement disparu. Il faudrait pouvoir conserver ce billet, quoi qu’il arrive. »
Rita contemple ce vieil homme à la bille ronde, aux yeux plissés, au galurin cabossé sur la tête. Quand il lui a demandé si elle se souvenait de Patrick, et du plus beau billet du monde, elle n’a hésité que peu de temps. Bien sûr, bien sûr. Ce Patrick un peu romanesque. Elle se souvenait l’avoir attendu longtemps un matin à l’agence. Il lui avait promis de passer, en effet. En effet.

Du temps encore a filé, depuis. Du temps. Chaque soir en rentrant chez elle, Rita passe devant les vitres propres de la brasserie d’Alésia. Beaucoup sont attablés seuls, leur portable à portée de main. Elle ne peut s’empêcher d’y jeter un œil, si jamais quelqu'un... En quelques décennies, les gens ont-ils tellement changé ?
Depuis peu, cependant, elle évite. On gagne correctement sa vie, c’est sûr, dans la numismatique. Pour cette raison, elle n’a pas encore eu besoin de s’en séparer, du joli cadre en verre qui trône sur une étagère, dans la cuisine du petit appartement de Montparnasse, dont elle aura fini de payer les traites dans dix-sept ans. Elle se le dit souvent, pour s’empêcher de croire qu’elle le conserve par superstition. En même temps, depuis peu, le secteur aussi connait la crise. Putain de Maastricht. Putain de pognon. Putain d’époque. Ridicule, la superstition. Mais c’est une vraie question : Que vaut Montparnasse, sans Mercure et Cérès ?
Elle non plus n’avait plus jamais eu la moindre nouvelle de Patrick. Est-il même encore de ce monde ? Et depuis, aucune de Polo. Drôles de gars, ces deux là. Et leur plus beau billet du monde, auquel elle a fini, elle aussi, par s’attacher. Un spécimen, disait-il, oui, maintenant, elle comprenait. Surchargé, ça c’est un comble ! Elle comprenait, à force d’y lire chaque matin, tandis qu’elle vidait son café au lait en grignotant du muesli, écureuil tragique et post-moderne, ces trois mots là rédigés à l’encre bleue : je vous aime.
Fin
08:30 Publié dans Des nouvelles et des romans, Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, billets français, montparnasse, numismatique | 
jeudi, 08 décembre 2011
Le plus beau billet du monde (6)
Le lendemain, ce serait déjà lundi. L’histoire, le temps passent trop vite. Et souvent comme sans moi, sans nous. J’ai toujours été coupé en deux avec ça. Une part qui veut régner dans le monde des hommes, inscrire sa marque, être aimé des femmes. L’autre qui surtout veut s’en garder et rester méconnu de tout ce beau monde. Discret comme le souffle. Noli me tangere.
Le bout de cette nuit viendrait, c’était inévitable, et j’avais promis de porter mon billet à Rita. Quelques gouttes de pluie tombaient sur la verrière, imitant des pas d’oiseaux. Passants, nous sommes. A l’idée que j’allais bientôt m’en défaire, je me mis une fois encore à penser à la silhouette élancée de Saint-Pierre du petit Montrouge, ce dimanche de juillet 1950.
Sébastien n’aurait jamais dû se rendre à la brocante d’Alésia ce matin-là, s’il n’y avait eu cette histoire de commode à retaper de toute urgence pour une baronne neurasthénique de Neuilly. Mais Gaby n’avait rien en stock et lui avait demandé de repasser en fin d’après-midi. Il avait remonté toute la rue des Plantes, puis l’avenue du Maine, puis avait achevé de se vider la tête en se prenant pour James Stewart devant les images de La Flèche brisée. C’était l’été, la rue de la Gaité était quasiment déserte au sortir du cinéma.
Habitué à traîner ainsi dans Paris, de longs dimanches comme celui-ci durant les cinq ans qui venaient de s’écouler, arpentant aussi bien la rue Monge que celle des Pyrénées, la rue de Courcelles que celle de Vaugirard, après une nuit parfois passée à moitié blanche, parfois à l’heure de midi, Mercure indécis ne devant plus compter désormais sur le seul hasard pour retrouver Cérès égarée, piégé par la dimension de Paris et les cataclysmes du siècle.
Il était revenu finalement à la brocante d’Alésia et avait conclu avec Gaby d’une date de livraison. Gaby avait tenu à lui montrer une collection de sabres dont il venait de se porter acquéreur. Sans plaisanter, le coup de fusil de la semaine. Les deux hommes avaient plaisanté un moment, discutant westerns tout en fumant du gris. Bientôt, il fut huit heures à l’horloge de Saint-Pierre. C’est comme ça que tout est arrivé, je murmure. Polo opine du galurin.
Sébastien est finalement entré dans la brasserie. Il est entré juste pour passer un coup de fil à la concierge et lui demander de laisser la porte d’entrée entrebâillée comme elle le fait souvent, en glissant dessous une page pliée du journal de la veille. C’est au moment où il dit ça qu’il la voit dans un miroir, qui le regarde.
Quand il s’est attablé face à elle, pourquoi aurait-elle eu le moindre mouvement de surprise, le moindre geste de recul. Au contraire. A l’un comme à l’autre, rien ne parut aussi évident que l’un, que l’autre. Et les conversations autour d’eux continuèrent comme si de rien n’était. Gauthier conserverait-il longtemps son maillot jaune ? La Seleçao KO devant l’Uruguay ! L’entrée de la RFA au Conseil de l’Europe. Fallait bien finir par le boucler, le grand cercle de la paix.
Cette jeune femme qui n’était attablée que depuis dix minutes, on aurait tout simplement dit qu’elle ne l’avait attendu que dix minutes, et qu’ils s’étaient quittés au matin. Au matin même. Le garçon venu prendre leur commande, sûr que c’est ça qu’il s’était dit, dès qu’il vit Sébastien assis face à elle. Un peu comme ces volutes de fumée qui se stabilisent au-dessus des têtes en un beau plafond de nuage gris, tout rentrait dans l’ordre ; comme si rien jamais n’avait été diverti, comme si l’errance et ses arabesques par les rues de Paris n’étaient plus de mise. Autour, on ne les remarquait, on ne les voyait plus, qui commençaient à s’aimer sous un plafond de lumière art-déco, dans le brouhaha diffus de cette fin de dimanche à la brasserie d’Alésia.
Qu’a-t-il pu lui dire à cet instant ? Elle seule l’a su, hein !
Elle seule l’a su, reprend Polo.
Ils sont restés tout le temps d’un premier repas face à face. Et le temps qu’ils se dévisagent comme des amants déjà, la brasserie se vidait. La brasserie se vidait peu à peu. Il y avait des tables qui restaient sans clients, dont on avait retiré les couverts et mis les nappes en boule. D’autres désertes pareillement, mais dont les couverts sales demeuraient encore sur des nappes un peu tâchées, avec des serviettes pendant dans le vide. Les forcenés du dernier métro qui occupaient les dernières banquettes commençaient tous à fatiguer.
Forcément, à un moment, il a dû lui parler du turban qu’elle portait, ce turban magnifique aux épis d’or qui semble tenir tout seul sur ses tresses, mais qu’une large broche nacrée maintient sur le bandeau du devant. Mauve, le bandeau, mauve. Forcément, il lui a parlé de la beauté extraordinaire de ses yeux. Des yeux de braise, oui, tout à fait.
Quand on glisse le billet sous une lampe, on la voit bien poindre, cette lueur orangée plus vive dans le regard. De braise scintillant. C’est comme ça qu’il la regardait, ce dimanche de juillet. C’est dans ce chatoiement qu’elle l’a toujours vu aussi, reprit Polo.
Nous nous taisons un moment.
Et puis, oui, oui, je fais.
L’ovale de son visage était impeccable. Le nez parfaitement droit. La peau toute lisse. Ce jaune orangé qui point dans son regard, n’est-ce pas tout autant celui des épis, des épis de blés dont Cérès est couronnée ? C’est le même or. Cérès, qu’avait enfin connue Mercure.
A force de se vider, ne resta bientôt plus qu’eux dans la salle. Et le billet, je dis. Le temps passe. Le billet ?
T’inquiète pas, je me souviens de tout encore, fait Polo. Je me souviens.
Quand le garçon est venu avec l’addition, ils en avaient chacun un en main à s’offrir. Et flambant neufs encore. Chacun tendit le sien comme un trophée, levant très haut le bras, en ne se quittant pas des yeux, riant même, un peu. Cela faisait des années qu’il n’avait pas ri un peu. Un seul suffisait à payer les deux repas. Le garçon a pris celui de Sébastien et ne lui a rendu que quelques pièces. Alors, comme elle tenait encore le sien entre ses doigts fins, il l’en a retiré doucement, il a demandé au garçon un stylo bleu. Tout ce manège, elle l’a suivi d’un air émerveillé, comme si vraiment elle avait su ce qu’il allait faire. Des yeux de braise. Et forcément, elle le savait, puisqu’elle était venue là elle aussi par hasard, après des mois et des années d’attente, après avoir tant sillonné la ville, et que cela faisait des années que Cérès n’avait pas ri un peu.
Alors il a écrit ce que tu vois sur le billet d’un seul trait, conclut Polo, d’un seul, au dessus des signatures, ces mots dans l’emplacement que la Banque de France n’avait laissé blanc que pour ça.
Il raconte bien, Polo. Il est bon, Polo. Elle a éclaté de rire, littéralement. Je suis certain qu’elle était vraiment heureuse. « Je le conserverai toujours auprès de moi, a-t-elle dit. C’est le plus beau billet du monde. » Après, dis-je d’une voix de plus en plus douce tant elle me paraît lointaine, et j’entends alors les gouttes qui tombent comme des pas d’oiseaux sur la verrière, après ça leur appartient.
A suivre
05:44 Publié dans Des nouvelles et des romans, Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : saint-pierre du petit montrouge, alésia, littérature, billets français, anciens francs, clément serveau, james stewart, la flêche brisée | 
mardi, 06 décembre 2011
Le plus beau billet du monde (5)
V
Je peux l'imaginer, Sébastien, démobilisé, ne connaissant dans Paris que peu de gens vraiment, seul dans la chambre meublée qu’il louait pour un billet de cinq mille, en train de n’espérer qu’en une pauvre image toute neuve, qu’il décidait de conserver précieusement chaque journée proche de son cœur jusqu’à ce qu’il trouvât celle qui lui ressemblait.
1945. La date exacte… L’échange ordonné par le Général se faisait par séries de lettres, et comme Sébastien passait dans les dernières, son tour dut être vers le mercredi 13 juin. Dans la France ruinée de l’époque, y’avait queue rue Croix-des-Petits-Champs, queue de gens ordinaires tous en file avec leur pognon à la main, de gens fatigués de tout, de la guerre, des queues, des aboiements politiciens de tous bords, à attendre, à s’entreregarder, à siffloter Fleur de Paris. Certains avaient même apporté des pliants. Au milieu d’eux, il se sentait très seul.
Le moment qui compte fut celui-ci. Lorsqu’il tendit ses coupures démonétisées au guichet de la Banque de France et qu’une caissière en échange lui offrit à nouveau sa gueule, une fois encore, sa propre gueule sur un billet à masque de Mercure, un Mercure cette fois-ci de profil sur un bifton de trois cent balles. Aurait-il donc un sosie, un sosie qui posait pour les graveurs de la Banque de France ?
Ce qui dut le frapper ce jour-là, Sébastien, tandis que plein de monde attendait derrière lui qu’il ait fini de compter ses billets, c’est que cette grâce juvénile qui n’avait pas abandonné les traits de Mercure commençait à laisser tomber les siens. Ce cou puissant, ce nez droit, cette ligne grecque, cette peau sans ride, ce regard sans amertume, ce crâne ailé, sa jeunesse : voilà que le trois cents francs de remplacement la lui balançait d’un coup en pleine gueule lui qui pour toute avenir se voyait foncer à présent vers les temps les plus noirs du monde. Il eut un moment d’hésitation, forcément, et puis, il retourna le billet.
Alors là, c’est la première fois, et c’est pour de bon, que Sébastien tomba amoureux, niaisement, sans crier gare, comme dans les chansons de coin de rues. Là, pile, quand il découvrit le visage de la Cérès du trois cents francs Serveau, rue Croix-des-Petits-Champs, ce jour de juin 45, quand la France entière échangeait ses billets.
Pas un portrait à l’identique trafiqué, cette fois-ci. Pas comme sur le billet des années trente.
Non, pas une espèce de sosie, qu’un dessinateur économe aurait cloné à son image.
Mais un vrai visage, un visage autre, qui lui convenait. Un beau visage ovale et doux. Sur les petits rectangles blancs tout neufs qu’on lui distribue, son double. Pas son sosie. Son double. Son double féminin, authentifié exact par les signatures conjointes d’un caissier général et d’un secrétaire général. Sa promise. Comme s’il avait fallu toutes ces années pour qu’elle apparût enfin, non pas rafistolée à partir d’une des côtes de Mercure, mais libre, authentique, singulière, étrangère, mystérieuse, autre, pleinement. Cérès.
Quelle était cette inconnue ?
Il se retourna, sur le point de demander à un concierge de la rue Croix-des-Petits-Champs le nom du modèle qui aurait posé sur ce billet. Peut-être se trouvait-elle là, parmi cette file immense de gens qui, malgré leur fatigue, portaient tous sans le dire la même impression étrange d’avoir survécu au pire, la même joie d’être rescapé. C’était d’abord cette joie et cette joie seule, la joie de la victoire et celle de la Libération.
Peut-être cette femme était-elle encore parmi eux. Fébrile, il observait chaque trait, chaque visage. Peut-être aussi n'avait-elle pas survécu.
A suivre
16:35 Publié dans Des nouvelles et des romans, Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : échange des billets 1945, clément serveau, libération, littérature, billets français, anciens francs | 
lundi, 05 décembre 2011
Le plus beau billet du monde (4)
IV
Le billet, ça m’est facile de le montrer à Polo, pourquoi n’ai-je pu à Rita ? Rita, c’est comme un jeu dont je n’ai pas la règle, une société dont je ne sais la langue. Le marché, le produit. Les salons internationaux. Les profits. C’est tout ça, Rita, si attirante de l’autre côté du fossé.
Je n’ai pas pu la première fois, je n’ai pas voulu la seconde, quand elle m’a entretenu de son Américain à la brasserie du Maine. Elle ne zyeutait plus mes manches douteuses, mais tout de go, dans le tintinnabulement joyeux de la fin du service, voilà qu’elle m’appelle son ami : « pas question de m’engager à votre place autrement qu’en promettant à mon contact de lui transmettre vos coordonnées dans le cas d’un accord pour une rencontre durant son escale avant Maastricht… Le plus beau billet, pouffe Rita, il ne sait même pas duquel il s’agit, une épreuve ou un fauté, tout juste qu’il est français… Mon ami, notre prix sera le sien… »
Il va de soi que l’Américain a de quoi payer au-delà de ce que des gens de ma trempe imaginent. Je me rembrunis imperceptiblement lorsque les lèvres de Rita susurrent de telles sommes. Je me rembrunis autant que ça paraît l’égayer. Elle a dû faire des études de commerce, elle exerce un métier. Le petit marc nous monte à la tête. Sûr qu’elle pense me rendre service en m’offrant l’opportunité de m’en débarrasser à de tels prix. Mais tout cela est trop irréel. Et je ne suis pas sûr qu’elle ait bien tout pigé de mon cas personnel.
Tu ferais mieux, me dit Polo d’en tirer le meilleur parti. Rita a le regard brûlant, les doigts fins, la peau qu’on sent tiède, et les courbes nourries capiteuses, comme tu les aimes. Le plus chouette billet, c’est elle, mon salaud. Hilare sous son galurin.

Rien n’est plus mélancolique que des reliefs de fruits de mer sur un plateau cabossé. La nacre effritée des huitres, la glace en train de fondre, les veines blanches, grises et noires du marbre de la table. Autour de cette nature morte, la brasserie se vidait sérieux et les garçons en veste blanche, comme de grandes cigognes, semblaient pressés de rentrer au nid. Qu’avais-je eu besoin d’évoquer ce billet, au bout du compte ?
Lorsque les tables furent vides autour de nous, je lui chuchotai à l’oreille :
« La naissance du trois cents francs Clément Serveau n’est-elle pas à elle seule un roman ? Dessiné l’année d’Hitler en 33, émis celle de Munich en 38, et puis placé en réserve durant toute une guerre mondiale, comme le bon pinard en fût. La Banque de France n’autorisa sa circulation que la paix revenue, lors de l’échange de billets voulu par de Gaulle.»
Lorsque je rajoutai ; un spécimen neuf et surchargé, Rita cessa de faire la moue. Elle aurait voulu l’expertiser. Je dus lui avouer que je ne l’avais pas sur moi.
- Il faut monter chez vous pour toucher le billet, c’est ça ?
Je me suis à nouveau dégonflé, j’ai dit : je vous le porterai lundi à l’agence.
Je suis rentré seul. «Ce billet, faudra que tu le lâches un jour, m’engueula Polo. Il pèse trop sur tes épaules. C’est trop de lierre qui t’assombrit... ».
A suivre
05:48 Publié dans Des nouvelles et des romans, Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, billets français, anciens francs |