samedi, 21 mars 2009
Péguy parlant du peuple
Je cherchais un autre passage de lui. Mais je suis tombé sur celui-ci, que j'avais surligné, il y a bien longtemps :
« De mon temps, tout le monde chantait. Excepté moi, mais j'étais déjà indigne d'être de ce temps-là. Dans la plupart des corps de métiers, on chantait. Aujourd'hui, on renâcle. Dans ce temps-là on ne gagnait pour ainsi dire rien. Les salaires étaient d'une bassesse dont on n'a pas idée. Et pourtant tout le monde bouffait. Il y avait dans les plus humbles maisons une sorte d'aisance dont on a perdu le souvenir. Au fond on ne comptait pas. Et on n'avait pas à compter. Et on pouvait élever des enfants. Et on les élevait. Il n'y avait pas cette espèce d'affreuse strangulation économique qui à présent d'année en année nous donne un tour de plus. On ne gagnait rien. On ne dépensait rien. Et tout le monde vivait.
Il n'y avait pas cet étranglement d'aujourd'hui, cette strangulation scientifique, froide, rectangulaire, régulière, propre, nette, sans une bavure, implacable, sage, commune, constante, commode comme une vertu, où il n'y a rien dire, et où celui qui est étranglé a si évidemment tort.
On ne saura jamais jusqu'où allait la décence et la justesse de ce peuple ; une telle finesse, une telle culture profonde ne se retrouvera plus. Ni une telle finesse et une telle précaution de parler. Ces gens-là eussent rougi de notre meilleur ton d'aujourd'hui, qui est le ton bourgeois. Et aujourd'hui, tout le monde est bourgeois. »
( Charles Péguy, L'Argent - 1913)
22:31 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : charles péguy, littérature, common decency | 
Au café

10:55 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : fumer, mater, brasserie, cafés, société, peinture | 
vendredi, 20 mars 2009
Polémique papale
« Si on n'y met pas l'âme, si on n'aide pas les Africains, on ne peut pas résoudre ce fléau par la distribution de préservatifs : au contraire, le risque est d'augmenter le problème. » Première version : « au contraire on augmente le problème).
Dans les deux cas, si je sais lire, cela signifie : on ne peut réduire la lutte contre le Sida à la distribution des préservatifs. La proposition conditionnelle marquant clairement que l'extinction du fléau ne saurait être réduit à un seul geste technique (« si on n'y met pas de l'âme... »). Ceux qui attendent que le garant d'un dogme séculaire se plie à une idéologie actuelle évidemment l'entendent d'une autre oreille. Mais aucun pape ne peut ouvertement parler comme le chef d'une ONG ou d'un service sanitaire.
On comprend pourquoi Nicolas, Ségolène et autres consorts réduisent leurs déclarations à des propos type sujet/verbe/complément..., à une syntaxe et à un vocabulaire indigents, n'emploient plus ni conditionnel, ni subjonctif, etc... « Tous ensemble, tous ensemble », au moins, tout le monde comprend... Même si ça ne veut plus rien dire.
De l'aveuglement syntaxique à la mauvaise foi idéologique, il n'y a qu'un pas !

10:28 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (35) | Tags : sida, religion, benoit xvi, christianisme | 
jeudi, 19 mars 2009
De manif en manip

Les professionnels de la manif ? de la manip ?
Z'ont bien une tête de damnés de la Terre, trouvez pas ?
Les seuls à être payés un jour de grève,
Ne l'oublions pas.
22:44 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : grève, syndicats | 
mercredi, 18 mars 2009
De l'autorité
« Puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de violence. Pourtant l'autorité exclut l'usage de moyens extérieurs de coercition : là où la force est employée, l'autorité proprement dite a échoué. L'autorité, d'autre part, est incompatible avec la persuasion qui présuppose l'égalité et opère par un processus d'argumentation. Là où l'on a recours à des arguments, l'autorité est laissée de côté. Face à l'ordre égalitaire de la persuasion, se tient l'ordre autoritaire qui est toujours hiérarchique. S'il faut vraiment définir l'autorité, alors ça doit être en l'opposant à la fois à la contrainte par la force et à la persuasion par arguments. La relation autoritaire entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose ni sur une raison commune ni sur le pouvoir de celui qui commande : ce qu'ils ont en commun, c'est la hiérarchie elle-même, dont chacun reconnait la justesse et la légitimité, et où tous deux ont d'avance leur place fixée »
Hannah Arendt, "Qu'est-ce que l'autorité", La Crise de la culture
22:23 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : hannah arendt, autorité, école, enseignement | 
mardi, 17 mars 2009
L'ordre de la décadence
On m'avait parlé de civilisations décadentes, d'empires effondrés, de nations déchues. Je ne me figurais pas comment de tels cataclysmes pouvaient surprendre et renverser des populations entières. Des années d'enseignement m'auront appris à isoler le processus de la décadence. Le processus de la décadence n'est pas un processus violent. Au contraire. Il s'opère en douceur, d'une génération à l'autre, aussi doucement que le principe qui fait par exemple qu'avec la complicité démagogique des élites, on passe (en termes de figures professorales de référence qui font autorité) de Jacqueline de Romilly à François Bégaudeau. C'est un exemple si parlant. Il m'a fallu du temps pour comprendre que la décadence est un phénomène collectivement consenti, et comme institutionnalisé, dans les alcôves des familles comme dans les cabinets ministériels. Processus entrepris, donc, avec la complicité lasse de tous, hommes, femmes, enfants. Masses. Je prends un exemple : Bashung est mort. Soit. Treize ou seize pages dans Libé, m'a t-on dit. Je ne lis plus ce torchon depuis longtemps... Combien pour Gracq, il y a peu ? Un rocker a fait une œuvre, quand un écrivain n'a presque rien fait. Tel est le monde à la morte culture où nous consommons des choses sans intéret ni pérennité, pétrifiés dans notre propre idiotie, tous témoins du processus de la décadence qui alimente nos caisses à tous, parfois horrifiés, la plupart du temps engourdis, et trop, finalement, consentants.
Qui aura la vigueur - non pas de dire, c'est très facile de dire - mais de faire en sorte que dans les lycées de France, les portables, les baladeurs soient interdits, des espaces de lecture et de concentration intellectuels soient recréés, des tenues décentes - pour filles comme pour garçons, - soient éxigées, le tout sous peine d'exclusion immédiate... Qui ? Personne ne le fera, car la décadence est notre œuvre collective, nous en sommes fiers, parents, profs, syndicats, institutions... Tous ensemble, tous ensemble, comme ils chanteront encore jeudi prochain, en défilant sous des ballons et en parodiant des chansons de colonies de vacances... La décadence ne connaissant nulle limite, pas même celles de la manifestation, pas même celles de sa contestation...
21:27 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (35) | Tags : littérature, décadence, éducation, politique, société, actualité | 
lundi, 16 mars 2009
La dédicace au Duce
Après Moscou et Berlin, Henri Béraud publie en 1929 le troisième volet de ses témoignages, « Ce que j'ai vu à Rome ». Il travaille cette fois-ci pour Le Petit Parisien d'Elie Blois. En 1922, il avait déjà couvert, comme on dit à présent, l'événement de la Marcia su Roma. C'est la troisième fois que Béraud interviewe Mussolini. A un an près, ils ont le même âge (43 & 44 ans). Le Français jauge l'Italien, et son "français plein de coquette nonchalance". Il observe aussi un pays dont "les murs parlent" : « Mussolini est partout, en nom comme en effigie, en gestes comme en paroles - et plus encore que Kemal en Turquie, et plus même que Lénine à Moscou » Il est venu prendre la température, « l'air fasciste », comme il le dit lui-même. L'ensemble des vingt sept articles d'abord publiés dans Le Petit Parisien sortent en volume aux Editions de France, fort ironiquement dédicacé à Benito Mussolini :
« Vous m'avez, monsieur le Président, honoré d'une mesure extraordinaire. A cause de mon enquête et par votre ordre, le plus grand journal du monde s'est vu arrêté à la frontière. Aurai-je l'orgueil de penser que mes critiques donnaient à votre dictature assez d'ombrage pour justifier ce terrible vietato ? »
L'enquête romaine faite par le très français Henri Béraud, adjointe à celles conduites précédemment aussi bien à Moscou qu'à Berlin, formerait une trilogie de premier choix pour illustrer les thèses d'Hannah Arendt et de son essai sur le Totalitarisme. Voici, tels quels les mots de Béraud lui-même dans l'avertissement liminaire placé entre la dédicace au Duce et le premier reportage : c'est stupéfiant, et presque désespérant, comme un certain nombre de remarques sont encore d'actualité !
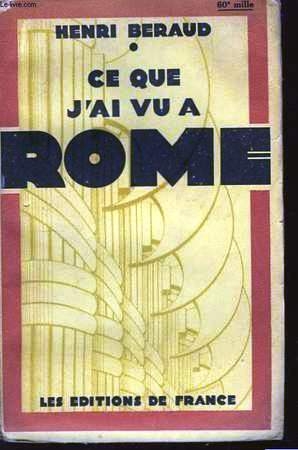
AVERTISSEMENT
« Ce livre, relation sincère d'un voyage au pays fasciste est l'œuvre d'un républicain. L'auteur tient la liberté pour le bien le plus précieux. Il n'a donc pu trouver bon un régime qui, par la voix de son chef, se flatte hautement « de fouler au pieds le cadavre pourri de la déesse Liberté »
Je déteste l'oppression. Et je le dis. Ayant de mes yeux vu ce que le culte de la violence a fait d'un peuple naguère jovial, tolérant et heureux, je souhaite à notre pays d'autres emblèmes que les cordes, les verges et la hache. Je suis antifasciste. Une autorité forte, oui. Mais la discipline peut se concilier avec la liberté. Et même, il n'y a de vraie liberté que dans l'obéissance à des justes lois. On m'a appris cela dès l'enfance, et rien ne m'a montré depuis que le maître d'école s'était trompé.
Cependant on aurait tort de chercher sous mes critiques du Fascisme une approbation plus ou moins déguisée de ce qui se passe chez nous. Rien n'est plus loin de ma pensée. Ni éloge, ni satisfecit ! L'idéal républicain est une chose ; l'état des institutions en est une autre. Ce qu'ont fait de la République l'usure politicienne, la faiblesse des classes dirigeantes, la bassesse des intérêts de clocher et - par la suite de la désaffection à peu près totale de nos élites à l'égard du régime électoral - l'incroyable médiocrité du recrutement parlementaire, la plupart des Français l'aperçoivent, et quelques-uns se dévouent à y remédier.
Si je m'en tiens à mes expériences, l'oligarchie des Chemises noires (non plus d'ailleurs que la dictature du prolétariat) ne me semble pouvoir apporter aux misères des temps un remède meilleur que le mal. Si d'ailleurs la France devait, tôt ou tard, modifier ses institutions, elle en chercherait le progrès dans son histoire et son génie. La grande Inventeuse ne se mettra pas à la remorque. Quoi qu'il advienne, nos fils vivront libres comme nous. Et nous avons dans l'avenir assez de foi pour espérer que jamais notre pays ne devra demander son salut à l'abolition de droits humains sans lesquels la vie ne vaut pont d'être vécue. »
05:42 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature, henri béraud, mussolini | 
samedi, 14 mars 2009
Henri Béraud : Ce que j'ai vu à Berlin
Le second grand reportage d'Henri Béraud publié en volume fut, en octobre 1926, Ce que j'ai vu à Berlin. Après la jeune et inquiétante URSS, donc, la non-moins jeune, et non-moins inquiétante République de Weimar. D'une incertitude, l'autre. «De Paris à Berlin, les trains vont vite. C'est l'affaire d'une petite journée. A peine le voyageur a-t-il perdu de vue l'Arc de Triomphe qu'il aperçoit la Porte de Brandebourg. » Trois ans plus tôt, été 23, c'était l'inflation, celle qui, dit-il ironiquement « fit en Allemagne 60 millions de milliardaires » et « transforma en compteurs toute une nation, et mit une règle à calculs dans le crâne du plus humble balayeur public. » On a, dit-il cent fois décrit « cette époque démente qui rendit le crédit soluble et vit fondre comme du sucre le blockhaus de la fortune bourgeoise ». Ce qui restait de morale, ajoute-t-il, de pudeur et de sentiment fut emporté : «Pour un million de marks, le touriste aux dollars achetait indifféremment une boite d'allumettes ou une nuit d'amour. L'argent, qui n'était plus qu'un signe, avait, chose étrange, acquis un pouvoir irrésistible. Ce papier avili, les gens en avaient plein leurs poches et, ne sachant qu'en faire, ils le convoitaient toujours. Les banques elles-mêmes ne pouvaient prendre au sérieux cette comptabilité astronomique. On ne comptait plus. On ne pouvait plus compter. Un jambon valait 5 trillions 300 milliards de marks. Le fameux boucher de Hanovre tuait pour un complet usagé et faisait manger aux bourgeois ses victimes dépecées... Un beau jour, tout cela prit fin. On brûla la planche à billets sous la chaumière du rentenmark qui s'appelle à présent le mark tout court, et le pays se trouva retourné comme un gant.»

11:15 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : reportage, henri béraud, allemagne, littérature | 
vendredi, 13 mars 2009
Danse du printemps qui vient
Le printemps : on le sent chaque matin qui pousse, grignote, rabote la nuit. Il aura bientôt gain de cause. Pour quelques mois seulement. La ronde des saisons, telle celle d'une vieille, naïve et colorée danse macabre. Tout en bas, on reconnait Adam et Eve. Et tout en haut, leurs enfants dévorés puisque à la fin de la ronde, c'est toujours le tombeau qui aura gain de cause. L'aquarelle est de Johan Rudolf Feyerabend (1779-1814), réalisée en 1806 d'après une fresque de 1440 environ, du couvent des dominicains de Bâle.

18:01 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : danse macabre de bâle, johann rudolf feyerabend | 









