mercredi, 19 mars 2008
De la Terreur et d'autres querelles
Ce week-end, j'ai relu Les Fleurs de Tarbes. Je dis "relu", parce que j'avais déjà visité ce titre, il y a plusieurs années. En musardant sur les quais, il y a quelques mois de cela, j'avais acheté un vieil exemplaire de la NRF, d'un assez bon marché. C'était, me sembla-t-il, un autre temps, voire un temps carrément autre, ce temps où l'on s'indignait que régnât la Terreur dans les Lettres. Que dirait Paulhan quelques soixante-sept ans plus tard ? Chasser le lieu commun, il revient au galop : à la fin du dix-neuvième siècle, Rémy de Gourmont avait dénoncé le règne du lieu commun sur la production littéraire, notamment au sein de la littérature naturaliste de l'époque. Après Flaubert et son Dictionnaire des idées reçues, Bloy en avait brillamment établi l'Exégèse. Le lieu commun, symbole de l'écrivain bourgeois, était en sourdine honni de tous. Alors vint Paulhan qui dénonça la Terreur que tous les pourfendeurs de lieux communs avaient fini par semer autour d'eux. Le serpent se mordit si bien la queue que plus personne ne put dire si, pour pénétrer dans l'enclos d'un jardin public, à Tarbes comme ailleurs, il convenait ou non de se chausser vraiment d'un bouquet. Heureuse époque, que celle où le débat faisait ainsi querelle. Heureuse époque. Après l'Epuration qui liquida sans vergogne quelques auteurs ( je songe notamment à l'excellent Béraud et à sa Croisade des Longues Figures menée avec Kessel, Mac Orlan et Carco contre Saints  Gide, Claudel et autres gallimardeux - cf. "la nature a horreur du Gide"), la Terreur s'est en quelque sorte institutionnalisée via les quelques gurus sacrés incontournables du structuralisme. L'Université fit régner une sorte de Terreur douce sur deux ou trois générations d'étudiants plus ou moins lettrés. Terreur par éclipse ou omission durant quelques décennies, écartant de ses programmes et de ses travaux tous les "réacs" et les "fachos", jusqu'à ce que cette pseudo Querelle des Anciens et des Modernes s'estompe définitivement parce que, pas davantage que de passeports bleus, on n'avait encore besoin de querelles littéraires dans le nouveau monde. Sous l'égide de l'atroce maison Fnac et grâce aux bons soins de Sa majesté Pivot, le livre devint un produit de consommation courante comme un autre, et les écrivains, les membres résignés d'une profession médiatisée comme une autre Si Les Fleurs de Tarbes sont encore réunies en bouquets, c'est en bouquets plutôt secs, il faut le dire, en rajoutant d'un oeil morne hélas ou tant mieux. Des bouquets comme il en trône sur certaines commodes cirées en d'austères appartements méticuleusement entretenus, ou comme il s'en vend à l'encan en quelques arrière-salles de commissaires priseurs mal lunés. Le style, c'était affaire de lectorat. Pas de public.
Gide, Claudel et autres gallimardeux - cf. "la nature a horreur du Gide"), la Terreur s'est en quelque sorte institutionnalisée via les quelques gurus sacrés incontournables du structuralisme. L'Université fit régner une sorte de Terreur douce sur deux ou trois générations d'étudiants plus ou moins lettrés. Terreur par éclipse ou omission durant quelques décennies, écartant de ses programmes et de ses travaux tous les "réacs" et les "fachos", jusqu'à ce que cette pseudo Querelle des Anciens et des Modernes s'estompe définitivement parce que, pas davantage que de passeports bleus, on n'avait encore besoin de querelles littéraires dans le nouveau monde. Sous l'égide de l'atroce maison Fnac et grâce aux bons soins de Sa majesté Pivot, le livre devint un produit de consommation courante comme un autre, et les écrivains, les membres résignés d'une profession médiatisée comme une autre Si Les Fleurs de Tarbes sont encore réunies en bouquets, c'est en bouquets plutôt secs, il faut le dire, en rajoutant d'un oeil morne hélas ou tant mieux. Des bouquets comme il en trône sur certaines commodes cirées en d'austères appartements méticuleusement entretenus, ou comme il s'en vend à l'encan en quelques arrière-salles de commissaires priseurs mal lunés. Le style, c'était affaire de lectorat. Pas de public.
15:50 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paulhan, gourmont, béraud, littérature, critique, culture | 
mardi, 18 mars 2008
Je me prive de rien
Pourquoi me priverais-je ? Mes ancêtres, serfs, esclaves ou gladiateurs, ont été ou se sont tellement privés de tout, jadis. De tout ! Avec les moyens technologiques dont nous disposons dans notre société, je peux assouvir avec un seul ticket en main mes frustrations et celles qu'ils m'ont léguées, concrétiser mes fantasmes ainsi que les leurs. Ah, le marketing ! Par exemple, si je suis une black, je peux me teindre en Marylin pour aller draguer, et si je suis blond, me relooker façon pote avec des tresses africaines sympas sympas. Et tutti quanti. Ce n'est pas un style que j'adopte, c'est leurs voeux que je comble, si si ! Et je me sens bien comme ça. Ni mon esprit que je gave, mais le leur. Devant un tel déluge de merveilles, la notion même de privation m'est insupportable ! Quand je pense que mon grand frère n'avait même pas de portable ! Mon père même pas de GPV ! Et mon grand-père même pas de télé... La famille Même pas, pour tout dire. Je rachète. Je rachète à tour de bras, moi qui suis enfin libre et cultivé. Dites vous bien que mon arrière grand-mère n'a jamais connu la pilule ! Et mon arrière grand-père, qui ne savait pas skier, jamais vu la mer ! Mais comment faisaient-ils ? Pauvres gens ! Comment faisaient-ils ? Il parait qu'ils se lavaient à l'eau presque froide dans des baquets ! Qu'ils péchaient le poisson dans les rivières ! Et qu'au lieu de télécharger de la musique, ils chantaient ! Quelle horreur ! Moi, c'est un tout autre genre. Moi, je me prive de rien.
"Nous oublions toujours, quand nous comparons le passé au présent, de considérer à quel point le présent est débiteur du passé. En naissant, ou quelques années plus tard, nous nous trouvons les maîtres d'un mécanisme immense et compliqué qui nous parait, ou peu s'en faut, faire partie de la nature. Les villes sont à ce point de vue de mauvaises écoles philosophiques. Quand on a vécu en des campagnes où on manque de presque tout, on se fait déjà une meilleure idée du passé. On apprécie mieux la solidité des fondations établies par les générations anciennes. Les mille petites commodités, les petits luxes modernes nous cachent l'essentiel de la civilisation. En avoir été privé, c'est souvent en apprécier l'inutilité. Mais il y a une partie stable, très ancienne, dont l'homme ne pourrait être dépouillé sans cesser d'être l'homme. Or cette partie ancienne, si on y réfléchit, on trouvera qu'elle n'est pas seulement la plus utile, mais qu'elle est aussi la plus belle. "
1 Rémy de Gourmont, "Une loi de constance intellectuelle" - La Culture des Idées.
09:38 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, gourmont, société, culture | 
lundi, 04 février 2008
Un monde en toc
Assiégé par des rebelles, un palais présidentiel tremble. Dans un autre, un avocat véreux épouse une courtisane liposucée. Seul sur un banc, un homme lit la philosophie d'un Grec ancien, qu'on vient de lui fourguer avec le journal du soir. Au magasin bio du coin, une cliente antipathique se fait tirer son sac par un malfrat malin. Le lendemain, un club breton de CFA 2 sort d'une compétition footballistique pourrie un club pro. Quelques jours auparavant, le conseil d'administration d'une banque avait reconduit son PDG qui venait pourtant de laisser partir en fumée rien moins que 7 milliards d'euros. Ce qu'on retient des primaires aux Etats-unis, c'est que pour être noir, il faut quand même être né d'une mère blanche afin de partir à l'assaut de la Maison du même adjectif. Tout ça ne nous dit pas l'heure, assurément. Mais quand même.
On ne peut imaginer à ce jour le nombre de mères de famille âgées de la cinquantaine qui rêvent de voir leur progéniture, mâle ou femelle, s'imposer enfin à un jeu de téléréalité. Compensation narcissique ? Economique ? 78 millions d'euros, c'est le budget d'un film érigé à la gloire de la connerie française et diffusé dans le monde entier. Un traité rejeté par référendum est ratifié en catimini par des députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles. Tous plus ou moins maqués dans une loge ou dans une autre. Cela ne sera que le énième calamiteux traité de Versailles. Celui-ci, nous dit-on, n'est qu'un mini. Comme les fourmis. Pendant ce temps, des millions de consommateurs de démocratie participative s'activent à préparer les élections municipales à venir, comme si ça devait changer quelque chose à leur morne existence. Dame, vous disent-ils, un maire, c'est un élu de proximité avec lequel on peut causer. Soit.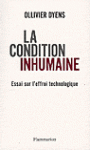 Mais tout ça ne nous dit toujours pas l'heure.
Mais tout ça ne nous dit toujours pas l'heure.
A quoi bon, me direz-vous l'heure, l'heure ? « Nous disparaissons ». Tels sont les premiers mots d'un essai qui vient de paraître chez Flammarion (voir ci-contre). Analyse brillante, par son auteur canadien Ollivier DYENS, de la relation qui s'est tissée entre chacun d'entre nous et ceux que Georges Bernanos appelait déjà, en 1944, "les robots". Analyse brillante mais in fine décevante car finalement impuissante. Cet auteur, comme beaucoup de verbeux officiels, ne sort du rang que pour mieux aller y occuper une place un peu plus en tête au box-office des centres de distribution d'objets culturels. Le tout guidé par "l'effroi technologique" qui n'a pas l'air de le terroriser tant que ça, ni intellectuellement, ni moralement, ni spirituellement : car s'il n'y a rien à faire, véritablement, qu'être cette "machine qui palpite", alors pourquoi avoir écrit ce livre ? Et où sont passés les polémistes d'antan ? Techniciens, le seraient-ils devenus jusqu'aux confins de leurs lacunes? A ce rythme-là, le monde en toc ira, par nos soins, proliférant, en effet... Et qu'importe l'adjectif qu'un petit malin ira plaquer sur le mot condition. Cette prolifération, quand chacun d'entre nous et tout ce que nous consommons en fait partie, n'est plus même une condition. A quel point Beckett avait, non pas vu ( Qui voit ? Où sont les voyants, où sont les visionnaires ? ), mais subi - et décrit - juste ! Sous le ciel gris d'un monde en toc, pour se faire un chapeau de paille, toute l'actualité du monde, et tous les essais qu'on peut écrire à son sujet, ne suffit plus.
14:06 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : société, actualité, culture, politique, critique, littérature, beckett | 
vendredi, 04 janvier 2008
La belle époque du pouvoir d'achat
On parle beaucoup, et à juste titre, de pouvoir d'achat en ce début d'année 2008. Qu'en était-il il y a un siècle ? Voici, à titre indicatif, quelques tarifs concernant les transports, restaurants et spectacles proposés aux Parisiens en 1900 :
TRANSPORTS : Tarif des fiacres à deux places pris aux gares ou dans la rue : 1fr 50 (le jour) pour la course et 2 francs par heure. La nuit, cela grimpe 2fr 25 et 2 fr 50. Métropolitain parisien : Un carnet de dix tickets, en première classe coûte  2fr 50; En 2ème classe 1 fr 50; Une place d'impériales en autobus revient à 15 centimes. En intérieur, c'est 30 centimes. Avec ce billet, on peut effectuer des correspondances dans tout Paris. Bien sûr, la carte orange n'existe pas. Mais on peut emprunter les bateaux mouches pour un prix unique de 10 centimes, du pont d'Austerlitz à Auteuil.
2fr 50; En 2ème classe 1 fr 50; Une place d'impériales en autobus revient à 15 centimes. En intérieur, c'est 30 centimes. Avec ce billet, on peut effectuer des correspondances dans tout Paris. Bien sûr, la carte orange n'existe pas. Mais on peut emprunter les bateaux mouches pour un prix unique de 10 centimes, du pont d'Austerlitz à Auteuil.
RESTAURANTS : Dans un bon restaurant à carte chiffrée du quartier de l'Opéra, voici ce que vous dégustez pour une somme de 10 fr 30 : coquille de saumon ou de turbot ou rouget de vin blanc à la gelée - filet sauté financière aux truffes ou entrecôte aux fonds d'artichauts farcis - meringue glacée aux fraises - fromages divers, 1 bouteille de vin ordinaire, couverts et pourboire. Les étudiants disposent, par exemple, du café d'Harcourt, à proximité de la Sorbonne, qui leur propose un menu complet avec 2 plats, dessert et 1/2 carafe de vin pour 2fr75 à midi et 3 fr le soir.
DIVERTISSEMENTS : Au théâtre, le prix du fauteuil varie entre 5 fr (théâtre Antoine et théâtre Cluny), 8 fr ( Comédie Française) et 14 fr (Opéra). L'entrée des bals publics ( Moulin de la Galette, Moulin-Rouge, Elysées-Montmartre, Salle Wagram...)est de 1fr pour le cavalier et 0,25 pour sa dame. Dans ce qu'on appelle alors les "brasseries de femmes", un bock revient à 30 centimes, tandis que le tarif pour le champagne en cabinet particulier varie de 12 à 15 francs.
10:30 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : statistiques, sondage, société, culture, pouvoir d'achat | 
lundi, 31 décembre 2007
Tables d'antan
Dans ses Oisivetés du sieur Puitspelu, Clair Tisseur inaugure un genre de littérature fort spéciale, la littérature gastronomique. Manger, affirme-t-il, est une chose d’esprit par laquelle l’homme se distingue de l’animal. :
« Car ne soyez point assez sots de croire qu’un bon morceau se goûte seulement avec le palais ; il se goûte bien plus avec l’esprit. Le palais n’est qu’un agent de transmission. C’est comme si vous disiez d’un Raphaël ou qu’un Ruysdaël qu’il se juge avec les yeux. Apprenez que vous jugez d’un plat exactement avec les mêmes facultés de comparaison, de réflexion, de généralisation, qui vous font juger d’une pièce de vers, d’un tableau ou d’un opéra. »
C’est pourquoi il n’est de bon repas qui ne se fasse sans commentaire :
« Car, si vous visitiez un musée en compagnie d’artistes amis, ne vous éclaireriez-vous point de vos impressions et de vos idées respectives ? Et ne croyez point qu’un bon repas ne soit pas le meilleur des tableaux ? Manger d’une bonne chose sans en parler, autant dire que les caresses entre amoureux se peuvent échanger sans doux propos »
Le repas pris en commun, voilà ce qui le rend savoureux :
« C’est grand heur que de manger bien et bon, et boire d’autant, mais qui n’existe qu’à condition d’avoir en face de soi des visages amis ».
Ayant défini ainsi les conditions de la bonne table, Puitspelu affirme que « les dîners lyonnais ont plus que tous les autres en partage ce parfum de la cordialité. »
Quelques années plus tard, Vingtrinier prolonge la chanson un peu sur le même air, avec trois chapitres entiers consacrés, dans La Vie Lyonnaise, au « Ventre de Lyon », à « Lyon à table », au « Gosier de Lyon ». Dans la lignée de Nizier de Puitspelu, il cite avec une sorte de mélancolie admirative les immenses plats chargés de viande, de poissons et de légumes qu’on dévorait sous l’Ancien Régime. Énumérations à la Rabelais de volailles (chapons, poules, poulets, coqs d’Inde, canards, oies, pigeons et paons...), de gibiers à plumes (cigognes, hérons, aigrettes, cygnes, grues, perdrix, cailles, ramiers, tourterelles, faisans, merles et mauviettes, bécasses, becfigues, ortolans, gélinotte de bois, poules d’eau, sarcelles, canetons sauvages, outardes, râles) ou à poils (lièvres, lapins, daims, faons) et de poissons d’eau douce (ablettes, anguilles, barbeaux, brochets, carpes, chatouilles, écrevisses, goujons, lancerons, perches, tanches, truites, ombres...). De quoi se désoler du manque d’opulence des tables démocratiques, conclut-il, « la Révolution ayant coupé l’appétit à ceux dont elle avait épargné la tête. ».
Pouvoir d'achat en berne, moral, dit-on, dans les chaussettes, les Français termineraient mal l'année 2007 ? Tsss tsss... On a, il est vrai, l'impression qu'une majorité parmi eux se réjouissent avec Sarkozy d'avoir échappé à Royal, tandis que l'inverse aurait pu tout aussi bien arriver. Souhaitons-nous une année 2008 pleine de santé, prospérité, bonheur, paix et bonne chère, si les uns veulent bien aller de pair avec les autres. Joyeuses fêtes à toutes et tous.
20:20 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société, lyon, gastronomie, culture, reveillon, sarkozy | 
mardi, 25 décembre 2007
Histoire de dame brune...
Le souci commémoratif n'a jamais été aussi commercial que depuis quelques années.Dans les allées climatisées des centres de distribution de la culture, on voit s'amonceler des compilations d'œuvres d'artistes morts ou sur le point de l'être (je pense à Aznavour et Salvador, par exemple).
Bien sûr, tout n'est pas à jeter dans cet effort à l'adresse du bon public de la société de saturation, qui ne sait plus quoi s'entre-offrir durant cette période mièvre de fêtes de Noël. Ces compilations, ça aide, certes... Je me demande ce qu'en aurait pensé Monique Serf, alias Barbara, dont on s'est souvenu, non sans émotion, durant ce mois de novembre, qu'elle nous avait quittés il y a déjà dix années. A première vue, comme ça, je dirais pas grand bien. Son souci d'éviter les plateaux-télé dans lequel le moindre citoyen lambda à présent se précipite tête baissée, au risque de se prendre les pieds dans les fils d'un projo, fut toute sa vie manifeste. Et la dame avait raison. Cela dit, il fallait bien vivre et aimer. Paradoxe du comédien, non des moindres, la scène est un métier public, dont il convient bien sûr honorer les exigences. N'empêche. Brel, son grand copain, dans le coffret-tombeau qui est à lui aussi dédié, déclare :
« et vous ne trouvez pas indécent, en 1967, que des gens soient encore obligés de montrer leur cul ? » Que dirait, à présent, le Grand Jacques ? Siècle de goujats ! Société de masses...
 « Je ne peux pas me servir des morts qui ne sont pas les miens », déclare la longue dame brune à Denise Glaser, dans un enregistrement bien ancien de Discorama . Notre enfance, ni plus ni moins. Qui a connu un peu Barbara, de fait, sait qu'il y a un avant-Nantes comme un après Nantes. Comme il y aura par la suite un avant Perlimpimpin et un après- Perlimpimpin. Avec beaucoup de délicatesse, de prudence et de talent, Barbara a su approcher un à un tous les éléments de son drame personnel pour l'envelopper derrière une confidence, dont elle apprit à son public qu'elle devait, cette confidence, devenir peu à peu un art - ou n'être pas : La confidence esthétisée, au risque de simplifier tragiquement celle qu'on se fait entre infirmes, très sérieusement, en se livrant ce qu'on appelle des secrets, au coin d'un trottoir. La confidence sublimée par la note et par l'articulation : écoutez-là, puisque c'est aujourd'hui jour de Noël, ar-ti-cu-ler les mots dents, puis gants, par exemple, dans la chanson pleine de légèreté et de gravité (ou de l'alliance des deux) intitulée Joyeux Noël. Ecoutez-là vous dire, yeux dans les yeux : « la so-li-tu-de... »
« Je ne peux pas me servir des morts qui ne sont pas les miens », déclare la longue dame brune à Denise Glaser, dans un enregistrement bien ancien de Discorama . Notre enfance, ni plus ni moins. Qui a connu un peu Barbara, de fait, sait qu'il y a un avant-Nantes comme un après Nantes. Comme il y aura par la suite un avant Perlimpimpin et un après- Perlimpimpin. Avec beaucoup de délicatesse, de prudence et de talent, Barbara a su approcher un à un tous les éléments de son drame personnel pour l'envelopper derrière une confidence, dont elle apprit à son public qu'elle devait, cette confidence, devenir peu à peu un art - ou n'être pas : La confidence esthétisée, au risque de simplifier tragiquement celle qu'on se fait entre infirmes, très sérieusement, en se livrant ce qu'on appelle des secrets, au coin d'un trottoir. La confidence sublimée par la note et par l'articulation : écoutez-là, puisque c'est aujourd'hui jour de Noël, ar-ti-cu-ler les mots dents, puis gants, par exemple, dans la chanson pleine de légèreté et de gravité (ou de l'alliance des deux) intitulée Joyeux Noël. Ecoutez-là vous dire, yeux dans les yeux : « la so-li-tu-de... »
Née en 1930, Monique Serf était, malgré son métier, quelqu'un de discret, quelqu'un - cela me fait drôle de l'écrire - d'un autre siècle. A sa poursuite, j'ai couru un temps les routes de France et de Hollande, et campé non loin de son piano dans le provisoire du théâtre des Variétés ou de Bobino. Son approche de la scène était empreinte de la conscience du temps qui passe, de la mort qui vient, de l'amour qui illusionne, et de l'art, seul capable de figer l'instant de la mort comme celui de l'amour. Recréer chaque soir, comme si le temps qui passe n'avait plus d'incidences, le même rituel, au geste près, au souffle près. Et, derrière le voile de cette maitrise technique, laisser croître en lui l'émotion du spectateur, comme monte la mayonnaise. J'avais vingt ans, et cela m'épatait :
« La scène est un pouvoir, disait-elle. Mais c'est un faux-pouvoir ».
Toute la loyauté, toute l'honnêteté de Barbara est dans cette deuxième phrase. Voilà ce qu'on ne comprend plus trop, aujourd'hui, mitraillés que nous sommes par de faux-artistes technologiquement assistés : Le grand artiste n'est pas là pour mystifier les autres, ni pour les corrompre ou les manipuler : bien au contraire, son art, tout en même temps qu'il mystifie, démystifie. C'est cela le paradoxe. Tenir en haleine pour libérer l'haleine. Elle chantait la mort, l'enfance, l'amour, pour se libérer de la mort, de l'enfance, de l'amour. Toute la carrière de Barbara fut ainsi un long voyage pour aller d'un point A (parler de soi à soi-même devant les autres) à un point C (parler des autres à soi-même devant soi) en passant par un point B (parler de soi aux autres devant soi-même). J'utilise ces concepts soi, soi-même, autre, qui ne sont qu’approximatifs. Il faudrait d'ailleurs en rajouter un quatrième, inventé pour l'occasion, l'autre-même, auquel elle dédia « sa plus belle histoire d'amour. Question chez elle, non pas de sincérité (Dieu que ce mot est exécrable en matière artistique !), mais de moralité. Question, hélas aussi, d'un autre siècle...
08:35 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : noël, barbara, société, chanson, variété, culture, consommation | 
jeudi, 15 novembre 2007
Le novembre des canuts : Les Trois Glorieuses
Arrêtons-nous quelques instants sur ce préfet en uniforme qui gravit la Grande Côte ce matin de novembre 1831 à la tête d’une colonne de la garde nationale, s’en allant à la rencontre du peuple. Louis Bouvier du Molart (1780-1855) n’est pas même cité dans le Dictionnaire des Lyonnaiseries de Louis Maynard, sinon dans l’article consacré à son successeur, Adrien Gasparin. Il faut dire qu’au contraire de ce dernier, Louis Bouvier du Molart ne possède pas de rue à son nom. La Petite histoire populaire de Lyon d’Auguste Bleton ne le mentionne pas davantage.
Le 11 mai 1831, il succède à un autre infortuné jeté aux poubelles de l’histoire, Paulze d’Ivoy, révoqué pour mollesse par Casimir Périer tout juste nommé président du Conseil. Ancien préfet sous l’Empire et les Cent jours, Bouvier du Molart mise sur la popularité dont l’Empereur jouit encore à Lyon (au point que certains le croient réfugié à Philadelphie et préparant un retour) pour imposer d’entrée de jeu l’autorité paternaliste qui sera sa marque de fabrique durant tous les événements. Sa proclamation aux Lyonnais du 17 mai débute par ces mots :
« Lyonnais, vous entendrez une voix qui ne doit pas vous être suspecte. Je n’ai ni servi ni trahi la Restauration. Le seul pouvoir qui jusqu’à notre glorieuse évolution ( il parle de 1830) avait reçu mers serments est celui qui a relevé votre grande ville de ses ruines, et je lui suis resté fidèle jusqu’à la proscription _inclusivement. La cocarde qui est à mon chapeau n’a jamais changé de couleur ». Et sa lettre à Casimir Périer du 19 mai est un modèle : « Je pense que votre Excellence peut maintenant être en parfaite sécurité sur le point important qui m’est confié (Il parle de la sécurité publique). Je me sens fort et je le suis en effet, puisqu’on croit généralement ici que je le suis. Je satisfais les gens du mouvement, parce que mon nom se trouve sur la liste de proscription des 38 (après les Cent jours) ; les patriotes sages voient en moi un des leurs ; les bonapartistes me tiennent compte d’une fidélité que j’ai gardée aussi longtemps qu’elle a été un devoir. Enfin la population générale d’une cité industrielle qui a essentiellement besoin d’ordre et de sécurité sait que je suis un homme de pouvoir et que j’ai appris à une grande école à le faire respecter. »
Reçue à coups de cailloux, de tuiles et de fusil, la colonne recule un instant, puis reprend sa marche, car Bouvier du Molart souhaite entrer en pourparlers avec les révoltés. Croit-il encore que sa fidélité de jadis à Napoléon lui servira de bouclier ?
 De fait, il ne se trompe qu’à moitié. A près avoir obtenu une trêve, accompagné de son secrétaire et du général Ordonneau, il rejoint la mairie de la Croix-Rousse du balcon de laquelle il commence à haranguer la foule. Mais les ouvriers ne répondent à ses exhortations que par les cris : « De l’ouvrage ou la mort ! Nous aimons mieux une balle que la faim ! » Cependant, tous respectent la trêve et, grâce aux dispositions conciliantes du préfet, un accord est sur le point d’être trouvé lorsqu’une fusillade éclate et le grondement du canon se fait entendre au loin. Roguet y est-il pour quelque chose ? Se croyant trahis, les ouvriers indignés empoignent en tout cas les trois représentants de l’autorité. Si Bouvier Du Molart lui-même échappe à une exécution sommaire, c’est à un des chefs de section des ouvriers en soie nommé Carrier qu’il le doit, ce dernier l’entraînant à l’Hôtel du Petit-Louvre, juste à côté, où il est gardé à vue. La tension est vive. Des ouvriers déposent quatre cadavres devant la façade de l’hôtel, en exigeant un cinquième pour les venger.
De fait, il ne se trompe qu’à moitié. A près avoir obtenu une trêve, accompagné de son secrétaire et du général Ordonneau, il rejoint la mairie de la Croix-Rousse du balcon de laquelle il commence à haranguer la foule. Mais les ouvriers ne répondent à ses exhortations que par les cris : « De l’ouvrage ou la mort ! Nous aimons mieux une balle que la faim ! » Cependant, tous respectent la trêve et, grâce aux dispositions conciliantes du préfet, un accord est sur le point d’être trouvé lorsqu’une fusillade éclate et le grondement du canon se fait entendre au loin. Roguet y est-il pour quelque chose ? Se croyant trahis, les ouvriers indignés empoignent en tout cas les trois représentants de l’autorité. Si Bouvier Du Molart lui-même échappe à une exécution sommaire, c’est à un des chefs de section des ouvriers en soie nommé Carrier qu’il le doit, ce dernier l’entraînant à l’Hôtel du Petit-Louvre, juste à côté, où il est gardé à vue. La tension est vive. Des ouvriers déposent quatre cadavres devant la façade de l’hôtel, en exigeant un cinquième pour les venger.
La capture du préfet constitue évidemment l’événement le plus important de cette matinée-là, puisqu’elle paralyse l’action des troupes. Dans la relation qu’il fera lui-même de tous ces événements en 1832 (et qui sera vendu 2 francs - 2 jours de travail d’un compagnon !), il confiera qu’on lui aurait alors demandé de signer des ordres pour récupérer 40 000 cartouches et 500 gargousses à boulet de six, ce qu’il aurait refusé. « Dans les 8 heures de captivité que j’ai passées au milieu des ouvriers de la Croix-Rousse, écrit-il, j’ai pu pour ainsi dire les compter. Ils n’étaient certainement pas plus de mille à douze cents. Ils n’avaient pas cent fusils.»
Les chefs d’atelier appartenant aux Volontaires du Rhône, et parmi eux Guillot et Lacombe, calment autant qu’ils le peuvent l’effervescence des compagnons, car ils redoutent une issue tragique pour tous. « Dans la nuit du lundi 21 novembre, écrit Guillot, vers 7 heures du soir, je pénétrai après bien des efforts vers l’hôtel qui servait de prison à M. le Préfet détenu par les ouvriers. Au moment où je l’abordai, notre courageux fonctionnaire haranguait le peuple et lui disait, ma foi, de bien belles choses, dont je n’ai pu retenir que les suivantes : « Braves ouvriers, je suis votre père, rendez-moi à la liberté et si le comte Roguet ne fait pas cesser le carnage, je marcherai à votre tête ». Entre 9 et 19 heures du soir, sur sa promesse d’obtenir du comte général Roguet la cessation des hostilités et des fabricants l’exécution du tarif, le préfet est reconduit en ville sous la protection des baïonnettes des « cadres d’officiers » des Volontaires du Rhône. Le général Ordonneau, lui, demeurera prisonnier jusqu’au lendemain, où il sera restitué en échange de la libération d’un ouvrier en soie emprisonné.
07:24 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : insurrections, révoltes, canuts, lyon, novembre1831, politique, culture | 
vendredi, 09 novembre 2007
Le novembre des canuts : Premiers coups de feu
Le 16 novembre, le représentant des chefs d'atelier Charnier écrit au préfet Bouvier Dumolard, afin de lui signaler quelques fautes d'impression sur les affiches du Tarif, toutes effectuées d'ailleurs au détriment des fabricants, et qui étaient sources de contestation entre ceux-ci et les chefs d'atelier.
Charnier croit-il encore au pouvoir ou à la parole du préfet ? Difficile à évaluer. Depuis l'hiver 1825, Pierre Charnier réfléchit aux "abus" dont souffre la Fabrique, et tout particulièrement ceux dont les chefs d'atelier en premier lieu, les compagnons en second, sont victimes. C'est lui qui est à l'origine de la première Association de Surveillance et Indication Mutuelle entre les membres de la corporation, ancêtre du Devoir Mutuel :
« Dans l'association, nous pourrons puiser toutes les connaissances de mécaniques et de droit industriel, toutes les consolations à nos maux. Nous apprendrons que l'homme pauvre n'est pas un pauvre homme, que cette dernière dénomination n'appartient qu'à l'homme dépourvu de probité. Axiome puissant pour nous procurer à résignation nécessaire à notre sort. Quand nous serons tous pénétrés de notre dignité d'hommes, les autres habitants de la cité dont, sans nous en douter, nous faisons depuis longtemps la gloire et la richesse, cesseront d'employer la mot canut dans un sens railleur ou injurieux. » Ainsi parlait Charnier.
Le préfet lui répond le 18 novembre que « les erreurs qui peuvent exister doivent être rectifiées d'un commun accord entre fabricants et ouvriers. On doit en agir à cet égard comme on l'a fait pour le tarif et l'autorité ne peut intervenir que pour interposer sa médiation, si elle est nécessaire. » Le 19 novembre, écrit Bouvier du Mollard dans ses Mémoires, « les 104 fabricants signataires du Mémoire adressé au ministère, encouragés par la connaissance qui leur fut imprudemment donnée de l'improbation du Tarif par le gouvernement de Casimir Périer, s'entendirent pour refuser tout travail aux ouvriers. »

Les ouvriers, quant à eux, quelles que soient par ailleurs leurs sympathies ou tendances politiques, refusent de travailler à un prix plus bas. La situation est inextricablement bloquée. Le même jour, à une séance du Conseil des Prudhommes, on lit une lettre de Bouvier Dumolard qui déclare que le tarif est seulement un engagement d'honneur et qu'il n'est nullement légalement obligatoire. Manière prudente de répercuter la position de l'autorité parisienne sans désavouer la sienne propre.
Dès lors, le Conseil cesse de condamner la non-observation des conventions du tarif. Les délégués des chefs d'atelier au Conseil des Prudhommes ne purent évidemment considérer cela que comme un évident "déni de justice" Selon Charnier, « cela a beaucoup contribué aux malheurs dont notre cité a été le théâtre ». De part et d'autre, l'irritation devient extrême face au camp opposé. Les représentants des compagnons reprennent leurs visites de chaque atelier, afin de vérifier qu'aucun métier ne fonctionne et que la solidarité s'organise. On dit même qu'ils ont commencé, depuis quelques jours, à collecter des fusils auprès des maîtres, et que parmi ces derniers, très peu leur en refusent.
Le lendemain, 17 novembre 1831, on affiche dans la rue Tolozan, à la Grande Côte et à la Croix-Rousse des placards manuscrits donnant rendez-vous à tous les ouvriers « pour dimanche et lundi prochain », c'est à dire pour les 20 et 21 novembre. Les avis du commissaire central Prat sont, à ce sujet, très alarmants :
« Tous les rapports que j'ai reçus aujourd'hui, soit de mes amis, soit de mes agents, soit de messieurs les commissaires de police, m'annoncent que lundi (21 novembre) les ouvriers en soie veulent se faire justice des fabricants qui ne veulent pas leur donner de l'ouvrage ou qui refusent de payer le tarif. Les uns disent qu'ils doivent se réunir au Grand Camp, les autres qu'ils descendront de leurs quartiers pour se porter en masse aux Capucins. »
De fait, ceux qu'on appelle les canuts avaient eu le temps de bien s’organiser. Quelques centaines de chefs d'atelier étaient déjà goupés dans le Mutuellisme, et presque tous dans le Mutuellisme élargi. Et leur exemple avait été suivi par les compagnons. Outre ces organisations économiques, une partie était regroupé en une association plus politique : Les Volontaires du Rhône. Beaucoup de chefs d'atelier faisaient aussi partie de la Garde Nationale. Un certain nombre possédaient des fusils. Pris en masse, ils n'avaient certes pas un sentiment d'agression; ils voulaient tout simplement cesser de travailler jusqu'à ce que les fabricants, fatigués de voir leurs commissions en retard, auraient enfin consenti à les rétribuer au prix du tarif. Mais la morgue de ces fabricants, l'inconséquence de l'autorité politique avaient heurté les esprits et froissé les sensibilités. C'était suffisant pour regrouper tous ceux qui, autour du métier à tisser et sur les mêmes paliers, dans les mêmes immeubles, les mêmes rues, le même quartier, avaient le sentiment de partager le même sort injuste.
08:10 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : politique, croix-rousse, canuts, société, culture, lyon, révolte | 
lundi, 05 novembre 2007
Le novembre des canuts : Premières dérobades
Depuis le début de l’automne 1831, la somme des impôts exigée à la classe ouvrière de Lyon s’étant trouvée triplée, voire pour certains cas quintuplée, les maires de Lyon et des communes environnantes avaient signalé au préfet en place, Bouvier du Molart le risque imminent de troubles à la tranquillité publique. A titre d'information, les salaires, pour les compagnons tisseurs, n’excédaient pas un franc par jour, quand le kilo de pain valait en moyenne 0,40 franc. Et de fait, dès le 8 octobre 1831, fut convoquée une première assemblée générale de chefs d’ateliers ; on y divisa en 40 circonscriptions la ville de Lyon et ses faubourgs, ce qui permit de répartir les 8000 chefs d’ateliers d’alors en sections de 200 chefs d’atelier. Leur revendication principale était de contraindre les fabricants à augmenter le prix de la façon.

Le 10 octobre une nouvelle assemblée exigea que fût créée une commission permanente de négociants et de chefs d’atelier. Deux jours plus tard, avec l’aide de l’adjoint au maire de Lyon Boisset, qui jugeait utile l’établissement d’un tarif au minimum pour le prix des façons, vingt deux commissaires furent désignés pour siéger dans la Commission du Tarif et établir ce tarif dans l’intérêt commun des deux parties, chefs d’atelier et négociants. Le 16 octobre, le préfet recevait une adresse de la part de cette Commission, laquelle était lue dans les assemblées générales de chefs d’atelier. Le 18 octobre, la Commission Centrale était reçue par Bouvier du Molart à la préfecture de Lyon, située encore place des Jacobins (voir gravure), tandis qu’un cortège de 150 compagnons défilait en chantant la Marseillaise dans les rues du plateau de la Croix-Rousse. Le 21 octobre, sous la présidence du préfet, en présence des maires de Lyon et faubourgs, se tint une première réunion qui promit de fixer le tarif avant le 1er novembre. Quatre jours plus tard, le 25 octobre 1831, tandis que la Commission rencontrait à nouveau le préfet pour signer le tarif qui venait d’être voté, un cortège de 6000 compagnons et apprentis s’avançait en silence vers la place des Jacobins, « sans armes ni bâtons ». Selon le journal le Précurseur : « c’était à la fois l’ordre et le désordre et, dans le désordre même, il y avait le calme et la régularité d’une organisation qu’on eût difficilement supposée dans une manifestation d’ouvriers. »
des Jacobins (voir gravure), tandis qu’un cortège de 150 compagnons défilait en chantant la Marseillaise dans les rues du plateau de la Croix-Rousse. Le 21 octobre, sous la présidence du préfet, en présence des maires de Lyon et faubourgs, se tint une première réunion qui promit de fixer le tarif avant le 1er novembre. Quatre jours plus tard, le 25 octobre 1831, tandis que la Commission rencontrait à nouveau le préfet pour signer le tarif qui venait d’être voté, un cortège de 6000 compagnons et apprentis s’avançait en silence vers la place des Jacobins, « sans armes ni bâtons ». Selon le journal le Précurseur : « c’était à la fois l’ordre et le désordre et, dans le désordre même, il y avait le calme et la régularité d’une organisation qu’on eût difficilement supposée dans une manifestation d’ouvriers. »
En cette journée du 25 octobre 1831 le préfet Bouvier Dumolard pouvait écrire au Président du Conseil : « J’ai joué dans cette grave circonstance le rôle de médiateur et de conciliateur. Ma voix a été entendue. Une augmentation considérable a été librement consentie. Je suis dix fois plus fort que je n’étais ce matin, et je vous réponds de la tranquillité publique ». La population de la Croix-Rousse,quant à elle, fit la fête dans les rues de la colline jusque tard dans la nuit. On pouvait penser que tout allait revenir en ordre, et que les jours à venir seraient des jours de bonheur.
Lorsque fut affiché le placard du Tarif, le 27 octobre, une grande effervescence gagna la population. On promettait son application pour le 2 novembre. Au même moment circulait un prospectus annonçant la création d’un journal par actions, « L’ écho de la fabrique, journal des chefs d’atelier ». Dans son premier numéro, daté du 30 octobre, L’Echo de la Fabrique livre un résumé des négociations en cours et annonce la création d’une « association générale et mutuelle de secours pour parer aux besoins de ceux qui manqueraient d’ouvrages par l’égoïste spéculation de certains chefs de fabrique, ou qui ne pourraient travailler en raison de maladies graves ou de malheurs imprévus ». Cependant, de la Croix Rousse aux Terreaux, des rassemblements d’ouvriers impatients de voir la tarif promulgué appliqué par les fabricants, se déroulaient, chaque jour plus nombreux.
Mais le tarif voté tardit à être appliqué, les fabricants ayant usé de toutes les arguties pour le repousser. Une réunion des Volontaires du Rhône eut lieu le 1er novembre, présidée par le chef d’atelier Lacombe. Suite aux nombreux refus, voire dans certains cas aux menaces que quelques fabricants avaient déjà concrètement opposés à plusieurs tisseurs, le 2 novembre, des rassemblements d’ouvriers se déroulèrent à nouveau à la Croix-Rousse. Depuis le 31 octobre, une cinquantaine de femmes, découpeuses de châles, s'étaient réunies place des Carmes dans l’intention, disent-elles, de briser une mécanique. Pendant ce temps-là, les négociants utilisaient leurs amis parisiens pour persuader le président du Conseil, Casimir Périer, de l’illégalité de ce nouveau tarif, dans lequel ils feignaient de ne rencontrer que leur future ruine. Le 3 novembre, la grogne monte encore d’un cran : compagnons et apprentis menacent désormais tous ceux qui travaillent en deçà des prix fixés par le tarif de déchirer les pièces sur leurs métiers. La tension est partout sensible.

Les délégués des chefs d’atelier commencent à perdre la direction du mouvement lorsque à leur tour, les compagnons décident de s’organiser en commissions. Le 4 novembre, Richan, maire de la Croix-Rousse, tente de raisonner les ouvriers. En vain. Le préfet Bouvier du Molart, de son côté, fait placarder un avis dans lequel il invite les « honnêtes gens à ne pas se mêler aux groupes afin de ne pas nuire à l’action répressive de la police » Au soir, un cortège se forme aux Terreaux. Des cris fusent : « A l’eau, la garde nationale ! Au Rhône, les artilleurs ! » Deux ouvriers en soie, un teinturier, un mousselinier (soit quatre ouvriers de la Fabrique ), deux pâtissiers, un boulanger, un tailleur, un voiturier et un ouvrier de la Manufacture des Tabacs, en tout dix personnes, sont arrêtées.
11:00 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, société, politique, canuts, révoltes, histoire, culture | 









