mercredi, 01 mars 2017
Carême
J’ai tant marché sur les plantes de mes pieds, tant saisi des paumes de mes mains : ce n’est pas au hasard que les bourreaux du Christ ont planté là les clous, dans l’intime creuset de ces points cardinaux ; les paumes et les plantes, à chaque extrémité de l’être, l’orientent vers les quatre coins du monde connu, du monde fini, contre lequel nous butons.
Percer le Christ en ces points, c’était donc percer le monde connu, le monde fini, pour que le Ciel s’ouvre. Mais cela, les bourreaux aveuglés de cruauté l’ignoraient : Lorsque des plantes de ses pieds et des paumes de ses mains a jailli le sang du Christ, ce sang qui coula ne fut pas signe de mort, mais signe de surabondance de vie. Surabondance pour les hommes de tous les temps, telle une issue vers l’Éternel, une trouée vers l’Infini, vers le Père.
En ce sens, le Carême engage tout le corps et ses limites. Mais il engage surtout le corps troué, supplicié du Christ et conduit donc le chrétien bien au-delà d’un simple jeun, d’un simple ramadan, d’un rite limité. La finalité du Carême est de rencontrer au bout de son propre chemin ce corps en Croix, incarnation parfaite de toute Charité, dont il devient au sens propre l’expérience surnaturelle.
La Résurrection des corps : J’ai tant marché sur les plantes non trouées de mes pieds, tant saisi des paumes non trouées de mes mains, que j’ai beaucoup voyagé dans ce monde fermé, beaucoup agi dans ce monde fini, beaucoup péché. Mais des plantes et des paumes du Christ coule véritablement le sang du pardon, le sang surabondant de la conversion du pécheur. Et de la cinquième plaie, tel un surplus de don, l’eau répandue de la sanctification pour laquelle incessamment chacun d’entre nous pouvons nous exhorter à combattre, nous devons prier.

Ci dessous un crucifix par Simone et Machilon, milieu du 13e siècle environ, palais Barberini, Rome.
23:11 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carême, christ, palais barberini, simone et machilon | 
mercredi, 22 février 2017
Giovanni da Rimini, 1305
L'oeuvre fut d'abord attribuée à Giotto lui-même, avant de l'être à L'oeuvre fut d'abord attribuée à Giotto lui-même, avant de l'être à Giovanni da Rimini. Elle date environ de 1305. Il s'agit d'un panneau isolé d'un diptyque, dont le pendant se trouve au château d'Alnwick, dans les collections du duc de Northumberland. Il représente des scènes de la vie du Christ : la crèche, la crucifixion, la mise au tombeau, la résurrection, l'ascension, la seconde parousie. Je suis resté longtemps devant, cet été, au palais Barberini où il est exposé. J'y retrouvai le fil, tout soudain devant moi illustré, d'une méditation qui avait commencé devant le saint Sacrement quelques mois plus tôt dans une église à Lyon, durant laquelle le Christ tentait de faire comprendre à mon esprit balourd qu'il est tout cela à la fois, "le berceau, la croix, le tombeau, le trône"... Et que fidèles ou non, résignés ou non, amoureux ou non, il nous faudrait -qui que nous fussions, quoi que nous fissions - emprunter un jour cette route passant par notre mort, route qui nous attire et nous effraie et nous aimante et nous répugne, qu'importe ! Et que le Christ étant ce Chemin, nous n'avions d'autre choix raisonné que de le suivre déjà, déjà, oui, dès maintenant.. Elle date environ de 1305. Il s'agit d'un panneau isolé d'un diptyque, dont le pendant se trouve au château d'Alnwick, dans les collections du duc de Northumberland. Il représente des scènes de la vie du Christ : la crèche, la crucifixion, la mise au tombeau, la résurrection, l'ascension, la seconde parousie. Je suis resté longtemps devant, cet été, au palais Barberini où il est exposé. J'y retrouvai le fil, tout soudain devant moi illustré, d'une méditation qui avait commencé devant le saint Sacrement quelques mois plus tôt dans une église à Lyon, durant laquelle le Christ tentait de faire comprendre à mon esprit balourd qu'il est tout cela à la fois, "le berceau, la croix, le tombeau, le trône"... Et que fidèles ou non, résignés ou non, amoureux ou non, il nous faudrait -qui que nous fussions, quoi que nous fissions - emprunter un jour cette route passant par notre mort, route qui nous attire et nous effraie et nous aimante et nous répugne, qu'importe ! Et que le Christ étant ce Chemin, nous n'avions d'autre choix raisonné que de le suivre déjà, déjà, oui, dès maintenant.

22:23 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : giovanni da rimini | 
samedi, 18 février 2017
La sagesse d'Oblomov
Ne rien modifier à l'ordre existant. En finir avec cette société de journalistes et de juges, de faux intellectuels et de marchands. La paresse d'Oblomov se confond avec sa sagesse, dans un même rêve dont la lecture discontinue peut s'étirer de l'enfance à la mort, sans que le lecteur ait besoin même en imagination de quitter son appartement.
« Les gens de l’Oblomovka n’avaient jamais entendu parler des hommes accablés de soucis écrasants, qui courent d‘un bout à l’autre de la terre ou consacrent leur vie à un travail de toutes les minutes », écrit Gontcharov (1). Son héros en robe de chambre se révèle à cet égard un parfait anti post-moderne qui fait du respect absolu de la tradition, de page en page, le lieu même d‘une mélancolique procrastination ; que ceux qui veulent changer le monde s’épuisent en vain à leurs chimères, l’oisif emprunte une autre voie, celle de la réaction bien comprise, comme on parle « d’intérêt bien compris » dans un univers qui ne sera jamais le sien. Ilia Ilitch Oblomov est-il un personnage puéril ? Inachevé ? Fou ? Il constitue une forme de réponse que l'on pourrait donner au monde puéril, inachevé et fou dans lequel le désordre des medias et l'assistance technologique permanente plonge l'esprit de nos contemporains.

Chez Oblomov, on peut considérer que la quête de l'être tient de la victoire comme de la défaite, d'un désir de plénitude comme d'un amourachement du vide. Là réside l'indiscernement à jamais irritant du personnage. Son caractère touchant, profondément touchant aussi, bien au-delà de tout ce qu'on a pu écrire sur son présumé spleen. Aujour'hui, il s'enorgueillirait de ne posséder ni smartphone ni page facebook, ni crédit à renégocier ni carte d'électeur, ni avis sur la marche du monde qui court à sa perte, ni valeur empruntée à des discours électoraux.
Lire ou relire Gontcharov, c'est explorer en silence ce peu de place que notre monde abominable laisse à l'individu, tenter de s'y lover une profonde fois en pariant que, malgré tout le poids de sa crapulerie et de sa bétise, il n'aura pas le dernier mot sur notre esprit.
08:04 Publié dans Des nouvelles et des romans, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : oblomov, gontcharov, littérature, saint petersbourg, russie | 
dimanche, 12 février 2017
Le sang coule à chaque messe
Le sang coule à chaque messe
La croix est éternelle. C’est le supplice par lequel le ciel fut rouvert et Satan vaincu. La croix est ceinte de nuée bleue, en un lieu aussi propice à tous les pécheurs qu’inaccessible aux légions de damnés. Le seul lieu au monde dont l’accès lui soit interdit, à lui, qui est prince partout ailleurs.
Le repentir. L’Agneau y est venu déposer le sceau par lequel sont épousés les Bien Aimés, et l’eau et le sang. Les Bien Aimés n’ont véritablement aucun autre lieu où se reposer, saufs, ailleurs qu’au pied de la Croix. Il faut aimer, près de la Croix, aimer toujours, aimer sans relâche.
La croix est connue de tous. Et depuis des siècles, nul ne peut ignorer la Croix.
L’Agneau a fait de la croix sa demeure. Et de sa propre chair, l’arbre de vie.
On ne sait comment se tenir devant la Croix lorsqu’intérieurement, on comprend ce qu’elle est. On ne sait comment être. Faut-il demeurer debout, s’agenouiller ? S’accroupir, se coucher ? Se répandre en larmes, demeurer muet de stupeur ? Nulle place pour la posture. La passion du Christ est vivante comme est vivant notre péché, et c’est par cela seul que dans la nuée bleue, la transsubstantiation de l’hostie est possible devant l’autel à chaque messe. Le sang coule à chaque messe.

22:46 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (0) | 
dimanche, 08 janvier 2017
Décadence, une réfutation d'Onfray
Dans le 2e volet de sa Brève Encyclopédie du monde, Michel Onfray considère la décadence de la civilisation judéo chrétienne comme un fait historique incontestable. Au départ de notre civilisation, souligne-t-il, « il y eut un guerrier accompagné d’un prêtre », mais aujourd’hui, « les guerriers sont sans prêtres » (et les prêtres sans guerriers, rajouterais-je). Constatant que, dans la confusion des valeurs qu’elle entretient, la république de France actuelle génère plus de vocations de djihadistes musulmans que de prêtres catholiques, je ne serais pas loin de partager son analyse. Je ne suis pas loin de penser comme lui non plus que « le catholicisme post-Vatican II a laïcisé la religion catholique », et que sous son influence «le sacré, la transcendance, le mystère ont souvent disparu au profit d’une morale de boy-scout qui tient lieu de règle du jeu contractuelle, un genre de contrat social catholique ». C’est d‘ailleurs la raison pour laquelle je me suis moi-même détourné de l’église contemporaine et de ses niaiseries simplificatrices pendant pas mal d’années. Mais lorsqu’il prédit la fin du christianisme pour autant, je demeure plus sceptique. Et je voudrais dire ici plusieurs erreurs de raisonnements assez importante qu’il commet.
La première, sans doute, est de penser les choses de la Providence à l’échelle de sa seule existence. La société, ainsi, se borne à ce que je vois, sais, constate d’elle. À sa décharge, tous ceux qui affichent profession de penser dans le monde contemporain agissent de même et bornent leur pensée à l’immanence. Il n’empêche que c’est là son premier aveuglement.
La seconde est de confondre le Christ avec, précisément, cette église de Vatican II contemporaine. Onfray, comme tous les athées, est victime de cette pensée historicisante qui, depuis Renan, n’est plus capable de penser le Christ autrement que dans une perspective historique. Pour eux, l’Église se serait développée comme une institution humaine, un état, de façon totalement organique et seulement moléculaire. Raisonnement de scientiste, qui ignore délibérément et en toute mauvaise foi un fait théologique : l’essor du christianisme n’a été rendu possible que par la volonté surnaturelle du Père et le sacrifice définitif du Fils. C’est ignorer l’extraordinaire (pour ne pas dire miraculeuse) puissance de régénérescence qu’ont de concert et l’amour du Christ et l’amour pour le Christ, et que seule la Résurrection peut expliquer. Certes, Onfray ne croit ni à la Résurrection, ni au Saint Esprit, ni à la transcendance : il balaie d’un revers de main tout cela, assurant qu’il est loin « le temps où la religion catholique rassemblait des fidèles qui croyaient dur comme fer à l’Immaculée Conception, à la transsubstantiation, à l’infaillibilité papale, au Paraclet de la Pentecôte, à l’Assomption de Marie, à la résurrection de la chair ». On a envie de lui rétorquer qu’assurer n’est pas prouver et qu’il ne connait guère ce qui se passe dans l’âme et le cœur de bien des fidèles. (Mais pour lui, toute théologie se bornant à de l’Histoire et à du récit, il paraît normal qu’il l’ignore). Et qu’il ne connaît pas davantage l’action des sacrements durant les siècles et encore aujourd’hui, de même que ce que le texte biblique lui-même enseigne, à savoir l’envoi du Paraclet.
La thèse du déclin professée par Onfray postule qu’il y eut un temps durant lequel le monde était vraiment chrétien et qu’aujourd’hui, il ne le serait plus. Son schéma, comme il l’avoue lui-même, est « vitaliste ». Il suppose qu’à la manière d’un volcan ou des plaques tectoniques qui disposent d’une vie propre, il y aurait une vie des civilisations. Chrétien ? Certes, les princes déclaraient l’être par leurs baptêmes. Mais le monde, lui, a-t-il jamais vécu en Christ ? Assurément non. Même aux heures de la chrétienté la plus triomphante, l’Ennemi était-là. Siméon qui reçut dans ses bras « la consolation d’Israël » le savait déjà, qui prédit à Marie que son enfant serait « un signe sur lequel on discutera »[1] ! Onfray discute encore. Il ne sera pas le dernier. Opposer à Augustin ou Thomas d’Aquin, comme il le fait, le De natura rerum de Lucrèce, ce n’est jamais qu’opposer une philosophie de la nature à une théologie de la foi, comme les païens le faisaient déjà du temps d‘Augustin ou de Thomas d‘Aquin ; le texte de Lucrèce n’est en rien, comme il l’avance, « une arme de destruction massive de la foi catholique » : pas plus qu’une philosophie de la nature n’est une arme de destruction d’une théologie de la foi, les choses ne se situant tout simplement pas sur le même plan ne peuvent aussi puérilement s’opposer.
Et je voudrais conclure sur la troisième erreur que fait Onfray : c’est de croire qu’il serait possible de lutter contre l’Islam et son faux prophète avec une philosophie, qu’elle soit héritée des stoïciens ou des épicuriens de l’Antiquité, des libéraux des Lumières ou des anarchistes du XIXe. Seule une bonne théologie peut lutter contre une mauvaise. Or il y a dans l’acte théologique du Christ qui s’est sacrifié pour les hommes de tous les temps, et pour toutes les nations, et pour toutes les générations, un Esprit dont la dimension surnaturelle et transcendante est totalement ignorée par le raisonnement schématique et donc spécieux d’Onfray, comme elle l’est d‘ailleurs par les musulmans qu’il prétend combattre et par leur Coran qui n’est qu’un amas de blasphèmes à l’égard des Trois Personnes de la Divinité. Or, tous les individus qui le veulent, quelle que soit leur origine, trouveront toujours dans l’adoration de la Croix de quoi revenir à la source même du christianisme. Car le Christ s’est sacrifié une bonne fois pour toutes. Là réside l’action de la transcendance, du Paraclet ou du Saint-Esprit, qui fait que le christianisme ne peut se penser seulement dans le champ clos de la linéarité des chiffres et des lettres, qu’il ne peut non plus, au sens où le philosophe de l’athéisme le prétend, connaître le déclin. La présence réelle du Christ, voilà ce qu’Onfray ne dit pas, parce que peut-être il ne la connait pas. Onfray a raison : Oui il se peut bien que la domination d‘un certain homme blanc, capitaliste et protestant, républicain et franc-maçon, occidental et matérialiste, doive un jour céder le pas à d‘autres formes de domination ; mais Onfray a tort : car à son successeur finira de toute façon par s’imposer, comme elle s’est imposée à l’homme blanc, la prééminence du sacrifice du Christ sur les sacrifices de vierges ou de simples moutons et la souveraineté de la charité sur toute forme de Loi. Car le Christ est mort et ressuscité pour une multitude d’hommes de tous les temps.

[1] Luc, 2, 34
16:44 Publié dans Des Auteurs, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : onfray, décadence, brève encyclopédie du monde, christ, présence réelle, lucrèce, de natura rerum, athéisme, anarchisme, lumières | 
mercredi, 28 décembre 2016
Je le hais comme vous haïssez Dieu
Nulle part, sans doute, Baudelaire n’est plus catholique.
Il faut imaginer une pièce sale, comme au temps de la prohibition américaine. Cet étranger, les mains liées derrière le dos, devant un flic en uniforme prêt à le gifler. « Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique » dit-il ; l’interrogatoire commence. « Ton père, ta mère, ton frère ta sœur ? ». À cette époque, on ne disait pas encore ton papa, ta maman, et toutes ces sucreries niaises et insipides. L’étranger n’a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Il le dit, sèchement. Quatre fois ni. Alors l’interrogateur continue : Il ne supporte pas l’énigme. Tes amis ? Le sens de cette parole, lui réplique l’étranger, lui est resté jusqu’à ce jour inconnu. Aujourd’hui, l’étranger ne pourrait entrer sur le sol des États Unis : il ignore facebook. Comme disent les jeunes avec mépris, c’est un sans amis. L’étranger ne dit plus ni, il dit in- un privatif. Alors, l’interrogateur se rabat sur la patrie. Quand on est orphelin, ignoré de tous, au moins a-t-on une patrie. L’interrogateur, c’est le sens commun, la vox populi, la doxa. « Ta patrie ? » Le ton peut sonner comme « Tes papiers ? », mais peut aussi être plus doux. On peut peut-être imaginer une parole de compatriote. Qu’importe. Cette fois-ci, l’étranger ne dit pas non, mais il ignore. « J’ignore, dit-il, sous quelle latitude elle est située ». L’énigme s’accentue. Il faudra que l’interrogateur lui propose la beauté pour qu’une fois, une fois, il ne dise pas Non. Mais voilà qu’il s’exprime au conditionnel. Celle-là, dit-il, je l’aimerais volontiers, à condition qu’elle, fût rajoute-t-il, déesse et immortelle. Ces deux mots, chez Baudelaire, ce n’est pas rien. L’étranger ne veut pas des filles des rues ni des œuvres d’art à trois sous. Déesse, dit-il. Et immortelle…
Et c’est alors que Baudelaire touche au génie. On peut n’aimer ni sa famille, ni ses amis, ni sa patrie, ni la beauté, soit. Mais l’or ? Hein, l’or ! L’interrogateur est certain de le toucher au cœur, cette fois-ci. L’or, c’est la passion commune, celle qui ne se refuse pas. Tout le monde, n’est-ce pas, veut son ticket pour l’Euromillions. Satan, en quelque sorte, est sûr de son coup. L’étranger devient alors extraordinairement christique : « je le hais, lâche-t-il, comme vous haïssez Dieu » On entend en creux, bien sûr, le célèbre « On ne peut adorer Dieu et l’argent » Ou bien la parabole du jeune homme riche, qui, pour aimer Dieu, ne parvient pas cependant à lâcher tout son or et suivre le Christ. La haine de l’étranger pour l’or est donc à la mesure de notre haine de Dieu. Comme nous haïssons Dieu, à ce degré-là de mépris, d’inconscience ou de malignité, l’étranger nous hait nous, c’est-à-dire notre monde, notre système de valeur, d’assurance, de morgue. L’or ! L’autre ne peut que se taire. Eh ! dit-il, « qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? » Il y a là comme un aveu qu’étant homme, on doit finalement quand même aimer, aimer quelque chose. Et c’est la seule fois que l’interrogateur tape juste : oui, l’étranger aime. Il aime quelque chose de passager, d’insaisissable, à sa mesure. Il bredouille : « les nuages, les merveilleux nuages » En eux seuls s’incarne le miracle de l’amour pour cet étranger paradoxal, loin des passions communes, au plus loin des hommes et comme s’il ne pouvait en être autrement.
Entendons-nous bien, cet étranger, ce n'est pas là une affaire de migrant ordinaire. Baudelaire tiers-mondiste, je ne crois pas ! À chaque fois que j’ai expliqué ce poème en classe, j’ai toujours interrogé les élèves sur le statut du dialogue, suggérant qu’au fond c’était sans doute un dialogue intérieur entre la pire part de nous-même, celle qui veut s’insérer, se socialiser, s’intégrer, comme nous disent les socialistes. Et l’autre qui résiste, ne veut pas, la dissidente qui guette l’au-delà, se sait de passage, mortelle, jamais citoyenne, rendant à César ce qui ma foi lui appartient, pas grand chose, prête à suivre le Christ, à pleuvoir, en quelque sorte. Je le hais, dit-il, et l'on se prend à penser que pour que l'étranger admette l'or, et toutes nos passions tièdes et communes, il suffirait que nous cessions de notre côté de haïr Dieu, puisque que tout est dans ce comme, et qu'il deviendrait alors possible d'aimer son prochain comme soi-même, ce soi-même fait de deux parts enfin réconciliées.
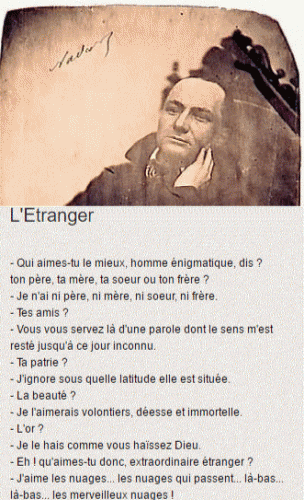
02:29 Publié dans Des poèmes, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (3) | 
samedi, 24 décembre 2016
Nativité véritable, surnaturelle et transgressive
Le Fils ne naît pas. Il traverse en quelques mois la chair de Marie, jusqu’à se faire homme : en se pliant aussi discrètement à un processus aussi parfaitement naturel, le Père manifeste une intelligence extraordinaire : à l’intérieur d‘une même chair, il révèle à qui veut engager sa foi la plénitude de son pouvoir surnaturel tout en prenant soin de le masquer au sceptique à qui il laisse la possibilité du doute.
C’est ainsi que Celui qui était au commencement et qui sera à la fin, l’Alpha et l’Omega, accomplit un miracle dans le respect minutieux de l’ordinaire. Peut-on, si l’on songe à la puissance divine, imaginer manifestation de sa réalité plus humble ? Plus délicate ?
Fils de la Vierge, issu du Saint-Esprit, l’Agneau ne peut qu’être un intrus parmi les hommes nés de la reproduction mimétique ; une menace dans le bel ordonnancement de leur édifice politique. Un original, au sens propre, qui ne peut trouver place dans les registres archivés du Sol Invictus. Aussi, l’empereur dont le pouvoir repose sur le doute ne peut que souhaiter sa prompte élimination.
Un recensement parfait de tout l’univers devrait débuter en vérité par le Père, le Fils, puis le Saint Esprit. Ensuite viendraient les prophètes, les saints et les martyrs et seulement après, on dénombrerait les hommes et les femmes. On saisit à quel point celui d’Auguste était incomplet et pourquoi ne pouvaient y figurer ni la personne du Christ ni celle de sa mère venue montée sur une ânesse de Nazareth à Bethléem pour le mettre au monde, ni celle de Joseph conduisant un bœuf pour ouvrir le chemin devant eux jusqu’à la grotte devant laquelle Constantin, quelque trois cent trente ans plus tard, adressa à Dieu l’offrande d’une basilique afin de rétablir un juste équilibre dans l’appréciation des hommes.

Depuis, à chaque Noël, des petites mains par milliards ont disposé autour de l’Enfant des santons de toutes les tailles et de toutes les couleurs. On comprend néanmoins pour quelle raison tant d’associations – laïques ou musulmanes – militent chaque année pour ne plus voir fleurir ces crèches dans nos espaces publics. La Nativité véritable, ils savent combien elle est surnaturelle et transgressive, et donc inacceptable à leurs yeux. Un seul enfant s’ouvrant intégralement au mystère de cette Nativité serait pour ces militants du dieu unitaire un enfant de trop. Pour eux tous, Dieu, s’il existe, « est unique et n’a jamais engendré »[1] Comment ne pas voir dans cette affirmation le point où, malgré leurs nombreuses divergences, juifs, musulmans, francs-maçons et athées parviennent à rencontrer chez le chrétien un ennemi enfin commun ? Pour tous ceux-là comme pour l’empereur Auguste, ce Jésus Christ de Bethléem reste de trop : il demeure un intrus qu’il faut exclure coûte que coûte de leurs systèmes de re-productions et de re-présentations jusque dans ses plus innocentes figurines pour que l’Europe parachève cette « apostasie silencieuse »[2] évoquée par le pape Jean Paul II.[3] Pour tous ceux-là, en tout cas, Christ demeure un empêcheur de croire ou de ne pas croire en rond, c’est-à-dire en tiède. C’est déjà pour tout ce beau monde un effort inouï que d‘imaginer Dieu infini, supposer que cet Infini ait pu s’incarner afin de se raconter dans une histoire purement humaine, en commençant par naître aussi humblement, cela chatouille et insupporte vraiment leur esprit : l’Infini, ils l’imaginent bien lointain, et d’une autre nature que leur viande, pour parler comme Céline[4]. Une telle naissance pour les plus tolérants d’entre eux constitue au mieux une belle histoire, au pire un véritable scandale.
Car nous ne sommes pas qu’un peu pris dans cette habitude de reproduction ou d’imitation que la Nativité vient gifler de plein fouet. Au contraire du Christ, nous y campons depuis notre propre naissance, pagures oublieux de leur enracinement dans leurs coquilles empruntées. En rappelant aux hommes de son temps que pour la plupart d’entre eux, tous les miracles étaient un scandale[5] Bossuet se souvenait que le Christ lui-même l’avait annoncé : « Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi »[6] Pour se placer devant la grotte de Bethléem et en contempler le déroutant mystère avec sa raison en toute sérénité et sans se dérober devant tous les écueils, il faut donc avoir mis à nu sa véritable soif, celle que tous les usages du monde s’ingénient à nous faire oublier ; notre soif de Dieu, c’est-à-dire de pur et souverain surnaturel.
[1] Coran, sourate 112, dite du dogme pur
[2] Jean Paul II, Angélus, Castel Gandolfo, 13 juillet 2003
[3] Le pape Jean Paul II se souvenait-il alors des propos plus anciens d’Emmanuel Mounier : « Il rôde parmi nous une forte odeur d'apostasie (Emmanuel Mounier « L'agonie du christianisme » Esprit, mai 1946)
[4] « On en devenait machine aussi soi-même à force et de toute sa viande » (Céline, Voyage au bout de la nuit)
[5] Bossuet, Sermon sur la Divinité
[6] Matthieu, 11 - 6
11:06 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : noël, nativité, christ, nazareth, bethléem | 
mardi, 01 novembre 2016
Tous les saints
L’une des raisons principales arguées par les gens qui ne croient pas en Dieu est celle-ci : le Mal. Si Dieu a créé le monde, entend-ton, pourquoi a-t-il créé le Mal ? Comment tolère-t-il la mort des innocents ? Dieu et la Shoah, entend-on ailleurs, ne peuvent exister dans le même monde. Je confesse avoir été sensible à ces arguments à une époque. Cela ne m’a pas fait douter de l’existence de Dieu, mais de sa nature telle que le judéo-christianisme me paraissait la poser à travers toute l’histoire sainte et profane. J’ai chopé à l’époque le mal Renan. Un tel doute m’a projeté pour de longues années dans une ronde assez infernale autour de cette question du mal, qui a duré pas mal de temps : cette ronde consiste à chercher un dieu dont la nature propre serait non pas à sa convenance, mais à la mienne ! Puisque le mal existe et qu’il est indéniable, cherchons un dieu qui ne serait pas omniscient ni omnipotent et qui serait donc a priori sans rapport avec lui. Bref, un dieu ont l’innocence présumée serait à l’image de l’innocence présumée de sa créature. L’athéisme dogmatique de l’homme machine à la française me paraissant contraire à ma conviction la plus profonde et l'Eglise me semblant se noyer en pleine déconfiture, je me tournais alors du côté de la sagesse orientale au sein de laquelle il est écrit que tout ce qui n’est pas divin relève en bonne part de l’illusion. Ce concept est fort pratique pour créer un dieu à sa convenance, puisque le curseur entre illusion et réalité, chacun peut au fond le positionner à l’endroit où son degré de compréhension le souhaite. Pour ma part, je rejetais le mal du côté de l’illusion, m’enlisant auprès d ‘autres dans une rêverie rousseauiste, mi christique, mi bouddhiste, à la recherche d’un syncrétisme qui fût à la fois humaniste et religieux, et qui échappât aux difficultés posées par l’Histoire, bref, qui fût en un mot à la portée de ma petite personne et de sa compréhension limitée des phénomènes. J’étais, ce faisant, à l’avant-garde de mon temps, de son humanisme droit-de-l’hommiste parfaitement décadent et de son libéralisme féru de new-age et de développement personnel. Dieu n’ayant pu créer le mal, me disais-je, l’emprise du mal sur le monde est forcément irréelle, il suffit donc d ‘ignorer cette emprise voire de relativiser son existence et, par la méditation et un mode de vie conforme à une certaine idée que je me faisais de la nature, je serai sanctifié en rejoignant ce dieu idéalisé en un lieu de la conscience où il doit résider, à l’écart du mensonge, bien protégé dans une zone de ma vérité.
Je me souviens même avoir dit et soutenu à l’époque que le Christ avait échoué en sa mission qui était de pacifier le monde, et que la meilleure preuve en était la Croix sur laquelle il était mort. Le Christ n’était plus qu’un homme qui avait échoué, et Dieu redevenait ce Dieu unitaire auquel rêvent les musulmans. Du pur Renan, ma foi. Le mal, je me noyais, infortuné, en plein dedans, et il ne tarda pas à se manifester rudement dans ma vie.
Tous les saints, en fait, ont accepté la réalité du mal. La conscience moderne, qui a inventé le mot « inhumain » pour caractériser le mal (comme si ce dernier n’était pas humain, avant tout humain) continue dans la voie de son rousseauisme étroit de croire en la bonté de l’homme démocratique et d’utiliser l’argument du Mal pour nier Dieu. Dieu a-t-il créé le mal ? Je ne me lancerai pas dans de telles arguties théologiques, en tout cas il est manifeste qu’Il le tolère dans l’histoire des hommes comme il a toléré mon erreur durant longtemps au sein de mon histoire individuelle. Tous les saints qui ont aimé Dieu plus que tout ont dû admettre cette vérité devant laquelle le monde post moderne regimbe : Dieu n’a pas créé le mal, mais il le tolère parce que le mal est le fruit de l’homme et que s’il tolère l’homme, il lui faut tolérer son péché. Ce qui ne signifie évidemment pas l’admettre. Tout mon mal fut, durant des années, de nier tout simplement mon péché en me proclamant innocent du mal des autres. Nous avons tous le moyen de trouver dans nos vies des excuses pour nous dédouaner du péché à la fois originel et collectif qui nous ronge. Selon un rapport établi par WWF et dévoilé le 27 octobre, par exemple, la sixième extinction de masse (dite de l’Holocène) a débuté sur terre et depuis les années 1970, les espèces pourraient avoir perdu 67% de leurs effectifs d'ici à 2020. Je peux toujours, étincelant yogi, m’assoupir en méditation sur mon tapis et me dédouaner de ce désastre (parmi d’autres) dont la reluisante espèce humaine est responsable. Vous, moi, nous tous. De brillants esprits (toujours les mêmes) nient l’âpre phénomène. Il se trouve que ce sont les animaux vivant en eau douce qui subissent le plus l'impact calamiteux de l'activité humaine. Or je me souviens pour ma part du sentiment très vif que j’ai eu vers l’âge de huit ans lorsque je découvris l’Azergues, rivière dans laquelle j’allais pêcher et me baigner chaque été et avec laquelle je vivais comme en osmose, draguée, polluée, ravagée, tuée en quelques saisons. L’enfant que j’étais songea alors que si les hommes étaient capables de faire subir cela à une rivière au nom de leurs prétendus intérêts, ils seraient capables de le faire subir à la totalité de la Terre : est-ce un hasard si, en parallèle, le nombre d’appareils électroménagers, d’ordinateurs, de portables, et de gadgets high-techs utilisé par des milliards d’innocents aussi urbanisés qu’autocentrés n’aura cessé de croitre ? Il semble ainsi que l’activité principale des hommes et des femmes de ma génération ait donc été de remplacer la vie animale par la vie technologique. Pas de quoi être fier, vraiment. La société du spectacle bat son plein, tandis qu’un être immense se trouve amputé de plus de la moitié de lui-même pour le confort de milliards de bipèdes ravis d ‘être soi. Le progrès, disent-ils. Le mal, pourrait-on leur répondre. Le péché, ne leur en déplaise.
Entendons-nous bien : je ne confonds pas cet Être immense qu’on pourrait appeler la nature ou la Création, ou encore l’écosystème, avec Dieu Lui-même. Je constate simplement que la charité du Père à notre égard ne tient guère à notre valeur, mais à la dimension du sacrifice du Fils. Et à la vertu du Saint Esprit. En ce sens, la justification de l’homme moderne qui ne comprend plus la notion de sacrifice, si abusé qu’il se trouve par celle d’échange entre égaux, devrait passer plus que jamais par la Trinité, comme tous les saints l’ont de siècle en siècle affirmé. Est-ce pour cette raison que tant de gens s’ingénient à faire de l’Islam qui nie cette dernière une alternative crédible au christianisme, après avoir de même tant porté aux pinacles les fausses religions du new-age, qui faisaient de même ? La Trinité, qui instaure ce rapport direct et aimant au Père a décidément beaucoup d’ennemis, qui tous se demandent pourquoi, si Dieu a créé le monde il créa aussi le Mal… Le Mal réside en fait dans la question, c’est même l’une des racines les plus prolifiques. Tous les saints ont lutté contre le Mal, et tous l’ont également subi, pour la plupart dans leur chair. Cela continue à présent, et cela semble inscrit, que cela nous plaise ou non, dans le projet historique de Dieu. Devant la persistance du Mal, garder une foi vive ne peut pas, ne doit pas être un acte raisonnable, même si bien des raisons pourraient rendre compte d’une telle nécessité pour nous tous. Il doit s’agir avant tout d’un acte surnaturel. Et donc d’un acte du Saint Esprit. Cela suffit-il à comprendre pourquoi le Mal existe ? Sans doute non. Mais au moins, faute d'avoir les moyens de le vaincre, de trouver ceux de le tenir à distance. Ce qui est déjà en vérité beaucoup.
15:43 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : toussaint, christianisme, mal | 
lundi, 22 août 2016
Dans un monde de moins en moins lyrique
Le monde s'éteint à chaque fois que meurt un artiste. Daniela Dessi a été emportée samedi soir par un cancer foudroyant. Que restera-t-il de nous tous, quand les derniers lyriques, qu'ils soient chanteurs ou poètes, prêtres ou mystiques, auront les uns après les autres cessé d'en exprimer l'âme ? Demeureront les cyniques et les comiques, les démagogues et les sportifs, les militants et les terroristes, les milliardaires et les migrants. Demeureront les statistiques et les grilles de lecture, les portiques de sécurité et les attentats, les campagnes électorales et les rassemblements pour la justice, les queues dans les magasins et les files d'attente devant les stades. Parce que tout est affaire de goût, que notre siècle a perdu le bon, et que le lyrisme pur ne sied pas aux cultures de masse. La joie sans réserve d'être en Dieu ne s'y éprouve pas davantage que le chagrin sans fond de l'avoir perdu, n'y demeure donc plus rien à dire et de fait plus rien à chanter. On ne pourra donc qu'écouter encore et encore ce qui fut :
00:39 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daniela dessi, soprano, art lyrique, cancer. | 









