vendredi, 28 janvier 2011
Sur la scène
J’ai trop souvent l’impression, lorsque je me rends au théâtre, que cet art a cessé d’être le grand rassembleur qu’il fut jadis, pour n’être plus, parmi d’autres, qu’un anodin représentant en images. Voilà pourquoi, contraint par l’époque, je peux passer de longs mois à ignorer son chemin qui me fut cher.
Et puis soudain, cinq, six spectacles, une sorte de boulimie presque involontaire, comme à la recherche d’ébranlements considérables dans la température des fondations éboulées.
Rejoindre le lieu d’où voir, et cet instinct égaré : « Le désespoir en dernier lieu de mon Idée qui s’accoude à quelque balcon lavé à la colle ou de carton-pâte », larmoyait Mallarmé (1) – et larmoyer est à entendre ici sous un jour positif –, tenter la clé du spectacle.
Longtemps, la culture des gens de théâtre – à cela la vive crainte que le bourgeois toujours leur porta – fut de ne rien conserver de lui-même : là, un soir efface l’autre, et chacun mérite la nouvelle et seule énigme d’une représentation ; on dit que c’est ainsi que le pape succède non pas à son prédécesseur, mais à Pierre lui-même. Comme si rien de trop ne comptait jamais, brûler les planches, flamber son cœur en guise de martyre, jouer fut longtemps le seul mystère du comédien.
Et dans un geste aussi aristocratique que catholique, centon échappé de la crèche, par le parvis de la cathédrale jusqu’au miroir de sa loge, l’homme de théâtre garda cela comme un honneur, à travers les siècles de possession. Telle fut sa coquetterie, qu’une maison jalouse dût ne durer, par nature qu’un instant.
Malgré l’aride travail qu’avait été l’édification de la précédente, assembler les poutres de la prochaine avec la ferveur d’un débutant, le compagnonnage d’un averti, le métier de l’artisan au déclin. Tant d’œuvres perdues, soit. Mais tant d’œuvres surgies de cette perte, consubstantielles. Tant d’autres, dans tous les sens du terme, passées. Tel, ce que la naissance doit à la mort.
Il est, de nos jours, question de captation de spectacles. Le metteur en scène, économe de son talent, devient réceptacle de son seul répertoire. Puisqu’il naquit de l’électricité, l’électricité le grille, en quelque sorte. Et, comme au cinéma, fige l’essor de sa parole. Moi, spectateur, il me faut alors redoubler de vigilance ; réserver mes applaudissements à quelques rares secondes : lorsque, quand même, loin de la performance, le souffle de l’acteur ranime mon instant.
(1) Mallarmé, Crayonné au théâtre
11:07 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : théâtre, littérature, société, mallarmé, spectacle vivant | 
mercredi, 08 décembre 2010
Kantor et l'abstraction
Drôle de hasard, alors que je vais passer pour la énième fois à des étudiants cet après-midi le film de Benis Bablet, « Le théâtre de Tadeusz Kantor », je découvre que ce dernier est mort il y a pile vingt ans, un 8 décembre 1990, durant les répétitions de Aujourd’hui c’est mon anniversaire.
Du dadaïsme, mais aussi de l’extrême précarité dans laquelle il a commencé, Kantor a pris ce goût pour l’objet pauvre, « incapable de servir, dit-il, bon à jeter aux ordures, débarrassé de sa fonction vitale, nu, désintéressé, artistique, appelant la pitié et l’émotion ».
Mais à présent, Kantor et son théâtre me semblent désormais si loin de nous : en parler devient difficile. Lui-même, lorsqu’il commente son œuvre est souvent répétitif ou confus.
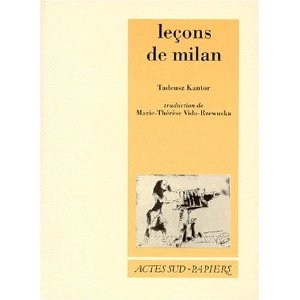
Pour retrouver ce théâtre, le plus difficile est de s’abstraire. S’abstraire de tout ce qui forme le monde aujourd’hui, et des débats dans lesquels nous nous empêtrons. S’abstraire aussi de la scène contemporaine, du spectaculaire et de la technologie qui y règnent. « La professionnalisation théâtrale de plus en plus marquée conduit à sa défaite », disait le maestro dans sa première leçon à Milan. (1)
C’est dans cette leçon qu’il insiste longuement sur cette notion d’abstraction. L’abstraction de Kantor n’est pas l’utopie de la forme pure, jadis prônée par le constructivisme. Elle en est même, dans son souci de révélation du concret le plus théâtral, le contraire absolu : s’il la définit d’abord comme le manque d’objet, l’absence de figure humaine, c’est pour justifier immédiatement la nécessité de leur retour : ainsi n’en finissent pas de revenir à nos mémoires les bancs de la Classe morte ou la roue de char du Retour d’Ulysse, porteurs non plus d’une fonction dans le monde réel mais d’une émotion sur la scène. En ce sens, Kantor a très vite cessé d’être plasticien pour devenir charnellement metteur en scène. « Je voudrais qu’ils regardent et qu’ils pleurent » répète-t-il souvent dans son entretien avec Denis Bablet. Ils, ce sont les spectateurs. Nous.
Quand ce n’est pas un objet, c’est un mouvement, un cercle, une ligne droite, ou la simple répétition d’un geste qui incarnent ce qu’il appelle l’abstraction.
Mais l’abstraction, là encore, n’est abstraite que pour mieux donner corps, voix, mouvement aux personnages. Elle demeure la condition d’existence de leur concret (non spectaculaire) sur la scène.
Il faut pour comprendre cela voir à nouveau et entendre encore cette parade de l’enfance morte dans l' Umarla klasa (la classe morte - suivre le lien sur Youtube). Ces vieillards pathétiques portant sur leurs épaules le poids de leur enfance martyrisée, de leurs illusions bradées, et revenant sur les bancs de l’école pour encore une fois ânonner une leçon qu'ils savent dérisoire, mais qui demeure leur dernier rempart contre la mort, sont restés gravés en moi comme un souvenir de théâtre impérissable.
Placer ainsi au centre de sa démarche l’abstraction, c’est aller évidemment à l’opposé du spectaculaire, lequel privilégie la vitesse, la variété, l’enchaînement. Rien de plus logique, dès lors, que la 12ème leçon de Milan, sous-titrée « avant la fin du XXème siècle » (et qui constitue le testament de Kantor peut-on dire) oppose à la démarche de l’abstraction autant celle de la consommation que celle de la communication.
Cet extrait de la dernière leçon de Milan, daté de 1986 :
« LA CONSOMMATION OMNIPOTENTE
Tout est devenu marchandise. La marchandise est devenue dieu sanguinaire. D'effrayantes quantités de nourriture qui nourriraient le monde entier; et la moitié de l'humanité meurt de faim; des montagnes de livres que nous n'arriverons jamais à lire; les hommes dévorent les hommes, leurs pensées, leurs droits, leurs coutumes, leur solitude et leur personnalité. Des marchés d'esclaves organisés à une formidable échelle. On vend des gens, on achète, on marchande, on corrompt. Création : ce mot cesse d'être un argument sans appel.
Et voici un autre visage de la FUREUR de notre fin de siècle : LA COMMUNICATION OMNIPOTENTE.
On manque de place pour les originaux qui marchent à pied (il paraît qu'un tel moyen de locomotion aide à penser). Des vagues et des fleuves de voiture se déversent dans les appartements. On manque d'air, d'eau, de forêts et de plantes. La quantité d'êtres vivants croît de façon effarante : des hommes .... Continuons : La COMMUNICATION qui s'accorde parfaitement avec les chemins de fer, les tramways, les autobus, a été jugée comme le concept le plus adéquat et le plus salutaire pour l'esprit humain et pour l'Art. Communication omnipotente ! son premier mot d'ordre : la VITESSE, s'est rapidement transformé en un cri de guerre sauvage de peuplades primitives. La devise est devenue ORDRE. Le monde entier, toute l'humanité, toute la pensée de l'homme, tout l'ART doivent exécuter docilement.
Tout devient obligatoirement uniformisé, égalisé et... SANS SIGNIFICATION. »
(1) Editées chez Actes Sud en mai 1990, les douze leçons de Milan, traduites par Marie-Thérèse Vido-Rzewuska ont été composées de juillet à novembre 1986. Tadeusz Kantor.
19:05 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : kantor, théâtre, umarla klasa, la classe morte, littérature | 
mercredi, 21 juillet 2010
La scène de la Croix-Rousse se vide
La Croix-Rousse vient de perdre deux figures majeures : Après Eric Meyer, le SDF de la grande place qui n’a pu (voulu ?) survivre au meurtre de son beau chien noir, Philippe Faure, le directeur du théâtre de la Croix-Rousse, qu’un cancer vient d’emporter. Eric Meyer, les gens du Plateau ne connaissaient peut-être pas son nom, mais tous connaissaient son visage. Tout comme tous connaissaient le visage de Philippe Faure. J’ai souvent croisé le regard de l’un et le regard de l’autre, lors de mes déambulations, sur le Plateau, le boulevard, le marché. Tous deux avaient le regard aussi triste. Je n’ai jamais vraiment parlé ni à l’un ni à l’autre. Je le regrette. Les échanges silencieux que j’ai pu avoir avec Eric Meyer paraissaient nous suffire. Quant à Philippe Faure, il n’a jamais daigné répondre à mes courriers concernant ma pièce, La Colline aux canuts. Aussi ai-je fini par la monter moi-même.
Dommage.
Quand un homme est mort, il n’est plus temps de polémiquer. Si je parle de ces deux hommes en même temps, c’est parce qu’il y avait de la rue, des errances, des volutes et des circonvolutions lisibles pareillement dans leurs yeux de chiens battus. Comme aux extrêmes l’un de l’autre - je veux dire de la reconnaissance sociale - et pourtant, si proches. Voilà même que je suis certain que leurs regards se sont évidemment croisés, sur cette place où Jacquard donne la patte aux pigeons. Oui. De la même manière que mon regard a croisé chacun des leurs, chacun a dû croiser le regard de l'autre. Forcément. La Croix-Rousse, comme on le dit souvent en prenant un ton hautement ridicule, la Croix-Rousse est un villaâââge... Ils se sont croisés devant ce bureau de tabac où l’un guettait la pièce, l’autre venait acheter son journal.
Dans le monde du Réel (celui où ni les pièces de théâtre, ni les pièces de monnaie ne tombent du ciel), ils étaient aussi emblématiques l'un que l'autre d’une forme de marginalité, de solitude. Et pourtant, tandis que l’un déjà s’enfonce dans l’oubli collectif, les hommages éphémères vont continuer quelques jours à pleuvoir sur l’autre :
Un homme de la parole vive, dit l’adjoint à la culture.
Un acteur hors-pair, un metteur en scène talentueux, dit le maire.
Un acteur passionné, un auteur inventif, un directeur engagé, dit le député.
Il était l’âme et le cœur du Théâtre de la Croix-Rousse, dit le président du conseil général…
Le plus grandiloquent est encore le président du conseil régional : "De l’homme qui proclamait fièrement, quelques semaines avant sa mort, que le destin du Théâtre de la Croix-Rousse est en marche : une Maison du peuple pour être utile , je me risquerais à dire, comme Camus à propos de Sisyphe, qu’il faut imaginer Philippe Faure heureux..."
Rebondissant sur ces propos de Jean-Jacques Queyranne, je me souviens à nouveau de cette tristesse dans leurs regards, et j’imagine l’un jouant l’autre, l’autre applaudissant l’un. Oui, non plus toujours assis par terre comme un clochard, mais dans un fauteuil de la Maison du Peuple, et je dis qu’il faut aussi imaginer Eric Meyer heureux, Eric Meyer heureux grâce à Philippe Faure.
Ce serait ça, l’art de la cité.
Ça, que le patron du théâtre de la Croix-Rousse tenait ferme, au cœur de son utopie.
Et pour conclure ce qui ne sont que paroles jetées, impressions fugaces tout autant que durables, car nous y passerons, nous le savons bien, tous et toutes à la suite d’Eric Meyer et de Philippe Faure, quelques paroles décisives de Beckett sur le sujet, homme de théâtre et d’écriture, et mendiant terrestre, s’il en fut :
« Oui, toute ma vie j’ai vécu dans la terreur des plaies infectées, moi qui ne m’infectais jamais, tellement j’étais acide. Ma vie, ma vie, tantôt j’en parle comme d’une chose finie, tantôt comme d’une plaisanterie qui dure encore, et j’ai tort, car elle est finie et elle dure à la fois mais par quel temps du verbe exprimer cela ? Horloge qu’ayant remontée l’horloger enterre, avant de mourir, et dont les rouages tordus parleront un jour de Dieu, aux vers. »
Samuel Beckett, Molloy,
Hommage à Eric Meyer & Philippe Faure qui ont tous deux comme autre point commun celui d’être mort prématurément : 42 et 58, ce qui fait à deux, pile, pas un an de plus qu'un siècle.

12:22 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : croix-rousse, eric meyer, philippe faure, théâtre, lyon, actualité | 
mercredi, 25 novembre 2009
Notre Terreur
Aïe ! Tel est le dernier mot du spectacle. Les temps de la postmodernité, ludiques et désabusés, paraissent soudainement soucieux de revenir à leur origine pour s’y mirer : Nous sommes donc le 10 Thermidor. Et un peu également aujourd’hui. Puisque cette terreur devant le mal inextinguible qui emporta les grandes utopies révolutionnaires, cette terreur est dite nôtre. Puisque les êtres que nous sommes, dépassés par les événements post-historiques que nous vivons seraient à l’image des êtres que furent les Révolutionnaires, dépassés, eux, par l’événement révolutionnaire qu’ils ont vécu.
Le collectif D’ores et déjà ouvre aux Célestins un cycle de plusieurs représentations (du 24 novembre au 4 décembre 2009). La compagnie érigée en collectif joue les héros de Thermidor érigés en comité de salut public. Mise en abyme assez réussie, il faut le dire. Car il y a du plaisir, de l’énergie, de la jeunesse et de l’intelligence sur scène. Qu’il y ait de la peinture, de la grenadine et une marionnette, cela n’était sans doute pas nécessaire. Heureusement, il y a du texte. Et des acteurs. De véritables morceaux de bravoure également. Durant la première partie du spectacle, on prend plaisir à être le témoin des nombreux affrontements verbaux des personnages, balancés sans cesse entre l'improvisation, le discours et le débat, et leurs joutes oratoires surdéterminés de citations littéraires - la plus inattendue demeurant la ballade de merci de Villon en presque final. Je reste plus dubitatif devant la cohérence du tout, et notamment devant cette deuxième partie qui se délite au fil d'une vision baroque et plus convenue des événements. Notre Terreur, au fond, ne parle quasiment que du vide de notre époque, qui depuis longtemps déjà prend l’Histoire pour un spectacle, le destin pour un jeu de rôles, la parole pour une mise en scène quelque peu hystérique de soi. La réussite du spectacle ne tient donc pas à son propos sur la période révolutionnaire, propos général assez confus, mais plutôt à celui qu’elle dévoile sur la terreur de l’époque actuelle : son enlisement dans l'échec politique, notamment.
Pour cette raison, et malgré ses flottements, ses longueurs, ses gratuités, le spectacle reste une belle tentative, et vaut quand même le déplacement.

Notre Terreur
Mise en scène de Sylvain Creuzevault
Avec Samuel Achache, Cyril Anrep, Benoit Carré, Antoine Cegarra, Eric Charon, Sylvain Creuzevault, Pierre Devérines, Vladislav Galard, Lionel Gonzalez, Arthur Igual Léo-Antonin Lutinier
Du 24 novembre au 4 décembre 2009
Célestins de Lyon
06:27 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : notre terreur, théâtre, sylvain creuzevault, d'ores et déjà | 
samedi, 21 novembre 2009
De Gré à Gré
La compagnie Le Chien Jaune présente dans le cadre du Novembre des Canuts une création de Valérie Zipper (écriture et mise en scène). Le contenu de la pièce est extrêmement riche puisqu’il s’agit de raconter au spectateur novice toute l’histoire du Conseil des Prudhommes, né à Lyon le 18 mars 1806 par la volonté de Napoléon, lequel prit bien soin – comme on nous le rappelle avec humour – de réserver un siège de plus aux marchands-fabricants (on dirait à présent les patrons) qu’aux chefs d’ateliers (l’équivalent des ouvriers). L’histoire du Conseil des prudhommes est riche mais complexe, intéressante mais austère et souvent douloureuse : la nécessité d’un tarif remettant en cause le vieux rapport de vente dit « de gré à gré » commença à se faire sentir dans la Fabrique lyonnaise dès le milieu du dix-huitième siècle; dans la foulée de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, les ouvriers tisseurs de Lyon commencèrent donc à réfléchir à une nouvelle façon de vivre et travailler dans la Fabrique : pour structurer le projet, les numéros passionnés et passionnants de l’Echo de la Fabrique, le journal des chefs d’ateliers de 1831 à 1835, que Ludovic Frobert et l’ENS ont heureusement mis en ligne, et auxquels l’écriture de la pièce reste fidèle en en citant de larges extraits. On voit bien l’écueil contre lequel le caractère didactique que ce spectacle revendique aurait pu l’emmener se fracasser, sans l’attention expérimentée de Valérie Zipper au rythme, à la mise en plateau et à la direction d’acteurs.
L’alternance des séquences, tout d’abord, grâce au jeu souvent distancié et souvent contrasté des comediens, qui tour à tour se font employés et employeurs, gens humbles et politiques roués, et donc juges et jugés. Ils nous entrainent l’espace d’un tableau tantôt dans une leçon, tantôt dans un sketch et tantôt dans un mini-drame. Avec une parfaite maitrise : la leçon n'est jamais ennuyeuse, le sketch jamais vulgaire, le drame jamais mélo.
La mise en plateau qui, dès la première image, utilise aussi bien la verticalité que la profondeur et ménage un jeu de théâtre dans le théâtre avec un va-et-vient entre de multiples époques (on se promène ainsi du dix-huitième au vingt-et-unième siècle sans vraiment voir le temps passer).
La direction d’acteurs, enfin, dont le résultat sonne juste. Le dialogue entre les époques ainsi que celui avec la salle sont portés par cinq comédiens qui ne se ménagent pas et déploient la bonne amplitude de registres, du sérieux au comique, au cocasse parfois. Et c’est ainsi que ce spectacle toujours sur le fil réussit son pari ; un pari moliéresque qui fut, en d’autres temps, celui de la fable et de la comédie : plaire et instruire
On souhaite donc à ce spectacle une vie après l’événementiel du novembre des canuts.
De Gré à Gré
Par la Cie du Chien Jaune
Ecriture et mise en scène : Valérie Zipper
Avec Alizée Bingöllü, Cyrille Cagnasso, Emilie Canonge, Denis Déon, Gilles Fisseau
Dernière représentation :
dimanche 22 novembre à 18 heures, salle Paul Garcin (Impasse Flesselles – Lyon 1er)
13:37 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : le chien jaune, de gré à gré, théâtre, valérie zipper, novembre des canuts, conseil des prudhommes | 
dimanche, 07 juin 2009
Oncle Vania aux Célestins
Vu hier soir Oncle Vania, aux Célestins de Lyon. Mise en scène de la maîtresse de maison, Claudia Stavisky.
Etrange, vraiment, cette impression en retrouvant le pavé mouillé et la brasserie Francotte (celle où Charles Dullin allait boire son café), quelques heures après avoir quitté la salle, de ne pas avoir vu une véritable représentation; mauvais signe : signe d'un théâtre instable, d'un théâtre fugace, spectacle de quelques instants, dont rien ne demeure dans la ville, dans l’âme, dans l’esprit. A peine quelque perspective dans le regard, quand la foule se répand sur la place en quittant le grand hall : un effet de mise en scène, vase de roses brusquement transpercé d’une balle. Le souvenir d'un axe par lequel les comédiens entrent côté cour et sortent par la salle. L'image d’une robe, d’une table sur laquelle tout le monde, à tour de rôle, vient s’asseoir ou se coucher pour débiter du texte. Le souvenir pénible de la toile peinte d’une maison au demeurant fort laide qu’on conserve sous les yeux durant trois des quatre actes. Le texte de Tchekhov, pourtant, est passé par là.
Au théâtre tout est une question d’échelle : aussi une hiérarchie entre les acteurs s’est rapidement installée. Autant le dire tout de suite, je n’aime pas ce que fait généralement Philippe Torreton. En toute honnêteté, il fut pourtant, et de très loin, le moins pire, le meilleur, même... Torreton qui jouait un Astov, certes un peu d’un bloc… mais au moins campait-il un personnage cohérent, capable de jouer avec le silence, capable de prendre son texte à bras le corps, capable enfin d’écouter et de s’adresser à un partenaire, bref de produire de l'illusion théâtrale. Bientôt, on finira par trouver que c’est un exploit, vous verrez ! Quelques très beaux moments, notamment dans l’acte III, en compagnie de Marie Bunel, qui jouait Elena. Une brève complicité dans le premier tableau, avec Maria Verdi (la nounou)… Et une sortie fort juste. Ce qui fait que contre toute attente, je me retrouve à dire bravo Torreton. Pour le reste…
Etrange, cette impression, que les autres comédiens qui s’envoyaient des répliques par-dessus la table ne comprenaient ce qu’ils disaient qu’au premier degré. Et encore ! Parfois ne comprenaient pas. Ou ne comprenaient chaque réplique que toujours et inconsidérément ramenée à eux-mêmes, à leur petite aptitude à respirer et à l’instant toujours linéaire de leur gesticulation. C’est tout. Comme si l’art était mort, et que ne subsistait qu’un boulot assez narcissique qu’on fait sans passion quand le soir arrive. Tchékhov exige de la nuance. Un peu comme la fadeur de Verlaine. Et beaucoup d'intelligence. Une nuance qui ne fût pas de la convention. Une intelligence qui ne fût pas du lieu commun. Là, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’y en eut pas. De nuances. De la convention, du lieu commun, on n’avait que l’embarras du choix.
Didier Bénureau en oncle Vania, c’est effrayant. Carrément. Et tandis qu’il se convulsionnait sur scène, l’ombre de Jean Pierre Marielle, au théâtre de l’Est parisien, dans la mise en scène de Christian Benedetti, qui date de 1986, me revenait mélancoliquement en mémoire. Un doux et lumineux souvenir refaisant surface, devant ce jeu ridicule, faux, boursouflé que propose Bénureau. Pas un seul moment juste. Mais qu’est-ce qui a pris à Staviski de le distribuer ainsi ? Et pourtant, Dieu sait si Vania est un beau rôle, Dieu sait ! On ne saura jamais ce que Bacri, l’acteur initialement prévu, en aurait fait… Ni à quoi tient que Bénureau soit si mauvais.
Quant à la comédienne interprétant Sonia, qui hurlait dans ce si beau morceau final « nous nous reposerons » assise sur une table... qu’en dire, qui ne soit pas cruel ? Rien, sans doute.
A quelle nécessité obéit donc, au final, cette mise en scène ?
La question demeure pendante.
Car ces comédiens/acteurs du vingt-et-unième siècle me paraissent plus éloignés de ce dix-neuvième siècle tchékhovien, que ceux du vingtième l’étaient, il y a trente ans, du Moyen-âge. Impression d’une incompréhension radicale entre un monde où le crépuscule était encore chrétien, et un autre où il n’est plus que technique. Où la province était encore un pays, l’ennui une émotion complexe, le rêve un refuge pour tout l’être, une rencontre un événement véritable. Où dire un texte était encore un vrai défi ; penser quelque chose un véritable goût; à présent… A présent, on ne comprend plus que la colère puisse se réfugier et presque prendre pour bouclier la pudeur, par exemple. On ne comprend plus que la passion puisse trouver son maître dans la charité. Demandez à une actrice de vous jouer ça. C’est bien pourtant cela, Sonia. A l’heure où triomphe le kit Charlotte Gainsbourg, vous ne trouverez plus aucune actrice foutue de jouer ça. Aucune. A qui la faute ? J’ai entendu une dame qui, en quittant les lieux, disait à son mari (j’ai supposé que c’était le mari): « C’est moderne, ça parle de déforestation des forêts ». Voilà ce qu’elle aura retenu du texte de Tchékhov qu’elle découvrait, visiblement. Elle a donc trouvé ça moderne. Un auteur écologique. « Qu’y faire ? Nous devons vivre ! », dirait Sonia. Devant ce truc, j’ai eu l’impression que tout le monde avait fait son boulot et qu’en n’applaudissant pas, j’étais au fond le seul à ne pas faire le mien. Mauvais garçon, une fois de plus.
Faut-il, alors, ne plus aller au théâtre ? J'ai l'impression finalement qu'il arrive au théâtre ce qui arrive à tout le reste, la politique, la littérature, l'enseignement ... Et pour quelle raison ai-je cru qu'il avait, lui, les moyens de passer à travers ? Je me souviens avec émotion de Giorgio Strehler, de Jean Claude Penchenat, de Patrice Chéreau, d'Antoine Vitez, de...
C'était un autre siècle.
A méditer. Dans le même ordre d’idée est-ce un hasard, qui a placé côte à côte, dans l’actualité du Grand Lyon ces deux nouvelles :
- Les droits TV accordés à l’OL s'élèvent à 43,5 millions d’euros. C’est un peu moins que Marseille (46,5) et un peu plus que Bordeaux (41,4). Joyeux transferts à tout le monde.
- Et le même jour, la Région vote un budget pour l’enseignement supérieur et la recherche : 39 millions.
Je ne ferme jamais les yeux sur ces rencontres inopinées d'informations, ces collages sans rigueur et pourtant très significatifs. A travers eux, bien souvent, se déchiffre l'air du temps d'une époque, se déclinent les priorités intellectuelles ou économiques d'une société. La société actuelle, qui a fait de l'ennui un vice, de la solitude un problème, de la sensation un impératif, est-elle encore une société à qui peut s'adresser, ne serait-ce que deux heures, l'oncle Vania ? Je rentre à pieds, du théâtre à la maison. Une violence latente flotte dans les rues, les places. Les gens qui crient se ressemblent. J'en doute.
10:41 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : oncle vania, torreton, claudia stavisky, didier bénureau, tchekhov, littérature, écologie | 
jeudi, 14 mai 2009
Roger Planchon
Belle mort, que celle de Roger Planchon, finalement. Une crise cardiaque foudroyante, pour en finir avec un monde en train de perdre la boule. Jadis, dans un autre siècle, c’est-à-dire dans les années cinquante, il y a eu une véritable «folie Planchon », dans un ancien atelier de serrurerie au 3bis rue des Marronniers, à Lyon, avec Jean Bouise et sa bande d’enragés. La folie s’est ensuite peu à peu institutionnalisée, labélisée. Mégalomanisée, disent les acides. Jusqu’à ce que le TNP devienne un lieu pour abonnés, au sens le plus trivial et le plus désolant du terme. Un lieu scolaire. L’aventure des CNP en toile de fond.
A Villeurbanne, Planchon, dont le nom-même désignait la vocation, était devenu une sorte de guru irascible ; mais au fond, comment pouvait-il en être autrement ? On peut reconnaître ce mérite à Roger Planchon, d’avoir maintenu vivante une tradition qui venait de loin, de Charles Dullin et de Jacques Copeau au moins autant que des plateaux de son Ardèche originelle la sciure du bistrot paternel. Et qui, après être passée par Jean Vilar et le théâtre étudiant des années soixante, s'était certes figé peu à peu entre ses mains vieillissantes : Mais n'est-ce pas aussi ce qui est arrivé au pays lui-même ?
Christian Schiaretti, plusieurs fois moliérisé il y a quelques semaines, a repris ce flambeau. Fidèle et sage continuateur de ce qu'on appela un jour la décentralisation populaire et critique. Le TNP est actuellement en travaux, « hors-les-murs » comme on dit. A sa réouverture, à l’heure de couper les rubans, l’une des salles qu'on aménage actuellement portera sans doute le nom de son ancien directeur. Une rue de Villeurbanne, non loin de là, également.
Ce qui est justice, car Planchon, qu’on n’aime ou pas, emporte avec lui un style et une époque. Une dimension également. C'est cela sans doute qu'on regrettera le plus.

09:11 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : théâtre, tnp, villeurbanne, roger planchon, répertoire, actualité, lyon | 
dimanche, 26 avril 2009
Littoral

Wajdi Mouawad sera l’artiste associé du Festival d’Avignon 2009, où il présentera quatre spectacles arrangés en « quatuor », le tout étant nommé « Le sang des promesses » : Littoral, Incendies, Forêts, puis Ciels. Les trois premiers volets existants seront repris en continu dans la Cour d'honneur (on parle déjà, à ce sujet, "de nuit-culte"); le dernier volet, Ciels, sera créé un peu plus tard au parc des expositions de Chateaublanc. «De 22h30 à 6h30 du matin, il faut, précise Vincent Baudriller (codirecteur du festival), remonter à l'intégrale du Soulier de satin de Claudel, il y a une quinzaine d'années, pour trouver un pari aussi fou. » Soit. Hortense Archambault (codirectrice du festival) annonce que « Wajdi », c’est « un certain retour au texte et à la narration, avec des réflexions complexes sur le monde actuel et ses violences ».
18:25 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littoral, avignon 2009, théâtre, lyon, célestins, wajdi mouawad, le sang des promesses | 
mardi, 21 avril 2009
Cérémonies sans fin
Dimanche soir aura lieu la énième cérémonie des Molières. Foutu calendrier, comme il passe ! On se demande ce qui pourrait ébranler quelque peu ce programme ironique dans lequel on nous suggère plus ou moins de faire tenir nos existences, et qui égrène ses soirées en paillettes d’années en années et d'écran en écran, comme si tout avait été déjà dit, écrit, joué, nominé. Comme si le théâtre était mort. C’est un vieil habitué des princesses et des princes, des révérences et des coupes de champagne rose, le vieux Frédéric Mitterand, qui tentera de conférer un peu de piquant à la soirée. Voilà qui promet. Trois écuries sont en lice pour le Molière du théâtre public : la Comédie Française, le TNP ou le TNS. Christian Schiaretti se taille d’ailleurs une part de lion : son Coriolan, plusieurs fois nominé, ne représente-t-il pas, au fond, ce que le théâtre subventionné peut produire de plus conventionnel -c'est-à-dire de ni pire ni meilleur, pour la bonne santé des abonnements et des soirs de galas ? des acteurs formés à s’envoyer la réplique (quelle qu’elle soit) sur un plateau vide et mouvementé, de façon claire et intelligible afin qu’on l’entende cette putain de réplique, même si on est mal placé, tout au fond. Pour le Molière de la mise en scène, Schiaretti se retrouve en compétition avec Braunschweig, Lidon, Lavigne, Nordey et Long. Le suspense est insoutenable. Ces paroles de Tadeusz Kantor, tristes, magnifiques et par lui prononcées au moment de la fondation du théâtre Cricot 2, en 1955, lequel d’entre nous aura donc la force d’aller les hurler sur la scène moisie du théâtre de Paris, dimanche soir à 20h30 ?
00:26 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : théâtre, tadeusz kantor, schiaretti | 









