mercredi, 29 juin 2011
Eclipse de lune à Lyon
par Drosochmou ( CHEUMOUPHILDROSO)
05:02 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : drosochmou, eclipse de lune, lyon | 
jeudi, 23 juin 2011
Couty : le poids du monde
L’association Jean Couty a mis au point un site qui permet de voyager agréablement parmi l’œuvre du peintre lyonnais, dont on fête le 20ème anniversaire de la mort. Sur la page d’accueil, un diaporama riche d'une vingtaine de tableaux. Sous l’onglet « œuvre raisonnée », de nombreuses reproductions avec les fameuses « vues de Lyon », ses églises, ses chantiers, ses usines (on sait que c’est Tony Garnier, le concepteur du Lyon industriel, qui a encouragé Couty à ses tout débuts), ses quais du Rhône comme de la Saône (le tableau illustrant le billet précédent était de lui, bien sûr), ses nombreux portraits (un seul auto-portait) et natures mortes…
De nombreuses photos et vidéos, par ailleurs, une biographie détaillée, des articles de presse et une sélection d’affiches. La visite complète, c'est par ICI
En illustration : Le poids du monde.

08:31 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jean couty, peinture, lyon | 
mercredi, 22 juin 2011
Les quais de Lyon
Sous la plume désuète d'une auteur oublié (1), je trouve ceci : « Les rives des fleuves, bordés de maisons de deux ou trois étages qui trempaient leurs fondations dans l’eau, et auxquelles s’accrochaient des auvents et des galeries en bois faisaient saillies sur le courant. De distance en distance s’échelonnaient des petits ports en forme d’anse, où l’on accédait soit par des marches, soit par le pente naturelle du sol. Dans les eaux basses, ces petits ports se tapissaient de verdure. Les enfants y venaient jouer. En tout temps y régnait une activité prodigieuse. »
L'oeil peine à présent à retrouver, dans l'alignement uniforme des quais tracés pour les automobiles en bordure de la Saône, traces de ces anciens et populeux débarcadères. Le port, comme l'église, signait alors la territorialité même de chaque quartier; chaque quartier, qui était une paroisse, était également un ténement et un paysage particulier : Ainay, Bourgneuf, Saint-Jean, Saint-Antoine, Pêcherie, Saint-Georges, Quarantaine...
A la fin du dix-huitième siècle et surtout durant le dix-neuvième, lorsque naquit l'idée d'aménager des quais, on les conçut d'abord comme des promenades : Le long du Rhône, du pont Morand à celui de la Guillotière, le quai dit des Brotteaux offrait à l'oeil une long sillon, face à cet autre dit de Bon-Rencontre, nom qui si poétiquement sollicite l'imaginaire. Ces premiers quais ne faisaient que reprendre le tracé d'anciens chemins de courtine, que le pas de générations de sentinelles avait tracés de veille en veille et de port en port parmi les hautes herbes, pour la sécurité des bons bourgeois endormis.
Les façades de deux hôpitaux (Hôtel-Dieu, Charité) et celles d'une prison (Perrache) formaient ainsi une seule perspective en bordure du Rhône. On y déambulait doucement et Louisa Siefert, poétesse parnassienne, sut dans ces alexandrins trouver des mots qui, comme des pas, laissent entendre le rythme de cette marche :
« Quand je vois ce long mur aux fenêtres grillées / Cet hôpital où sont tant d’âmes désolées / Puis ce long mur encore pleins de sombres hasards / L’hospice des enfants trouvés et des vieillards / Puis d’autres, puis enfin, sinistre, formidable, / La prison et plus loin le faubourg insondable, / Oh ! je l’avoue alors, ne pouvant rien sauver, / Comme le fleuve au bas, je voudrais tout laver ».
Avant que les bagnoles n’envahissent jusqu’à la nausée les abords des fleuves, les quais révélaient encore la densité des solitudes, au cœur même de la ville, suscitaient le recueillement des solitaires venus s'y égarer. Il n’est pas nécessaire d’être poète, peintre ou romancier pour ressentir tout ce que ces lieux ont à offrir de douceur, de rêve, ou de mélancolie. Je garde toujours au coeur l'onctuosité évaporée de ce que Jean Reverzy appelle le mal du soir :
« J’étais à Lyon sur les quais du Rhône et sous des platanes extrêmement parfumés. Le soleil se tenait entre d’extraordinaires images dont le relief et l’incandescence me stupéfiaient et à droite de la colline dont la seule image me rappelle l’odeur délicieuse des vieux bouquins de piété. Je me souviens que le Rhône découvrait de longs bancs de cailloux d’une blancheur absolue… Mais n’oubliez pas qu’à l’horizon fondait de l’or et de l’or… Dans la lumière inquiète et blanche du sunset, je vis s’éclairer des fenêtres ; ça et là tremblèrent de minuscules cristaux rouges. Un mystérieux esprit m’envahit, que j’appelle le Mal du Soir. »
Le temps d’une halte sur un quai la cité est saisie avec recul. Devenu lui-même flâneur, liquide, le regard en ne s’attachant à aucun détail, compose un paysage intérieur dont il s’émerveille naïvement : Comme l’espace aérien vu de Fourvière, l’espace de la Saône, vu du quai Jayr, agit, pour ce personnage de Georges Champeaux (2) tel un révélateur :
« Accoudé au parapet du quai, il ne se lassait pas de suivre du regard les travaux du bas-port et le mouvement de la batellerie. Et peu à peu s’établissait en lui la conviction qu’il avait sous les yeux un des plus beaux paysages de la terre. Tout en bas, le serpentement de la rive droite de la Saône , une route de campagne qui devient le quai d’un faubourg, comme succèdent aux pimpantes villas emmitouflées de Saint-Rambert le château d’eau, les grues et les cheminées de l’Industrie. Puis c’est le tassement autour de la Gare d’Eau des vastes entrepôts aux larges toits en pente douce, d’où surgissent, puissants et harmonieux, les trois blocs équarris des minoteries. Et, emplissant le paysage de sa présence, déployant à ses pieds le geste souple de son corps voluptueux, la Saône nonchalante qui paresse et se prélasse, cependant que, rangés le long des bas-ports, les noirs remorqueurs plats, les sapines béantes, les « plattes » pavoisées du linge mis à l’étendage, les péniches pansues ceinturées d’une bande claire, avec la futaie grêle de leurs mâts aux pointes blanches de minarets, parent ses profondeurs de leurs reflets. Longtemps le père Chatard avait méconnu la beauté d’un tel spectacle. Mais voici que du fer et de la pierre comme des feuillages et de l’eau, affluait une sympathie pénétrante. Et c’était l’âme même de ce paysage composite qui commençait à l’imprégner – une âme qui mêlait au sortilège originel de la nature la majesté poignante de l’effort humain »
Dans les fleuves se mirent la ville et toutes ses lumières. En n’exhibant que ses reflets, le fleuve, triomphalement, dénie la réalité de pierres et d’hommes, dont le rêve silencieux est captif. Dans ses Chemins de solitude, Gabriel Chevallier se souvient de tels instants d’oubli le long du quai de Tilsit :
« D’ailleurs, même aux instants où il ne se passait rien sur l’eau, il était doucement fascinant de regarder couler la rivière, qui reflétait des maisons vacillantes, des nuages furtifs, et des pans de ciel bleu. Une petite barque sollicitait la rêverie et laissait la pensée perdue, après que son sillage s’était effacé. Une voix soudaine m’appelait, qui me faisait tressaillir : « - Que fais-tu donc, qu’on ne t’entend pas ? - Je regarde la Saône … »
Si vive, parfois, si intensément vraie, l’impression annihile le regard qui se fond en elle. Démiurge à la réalité temporelle qui impose l’illusion de son reflet mortifère, le fleuve capte les existences : Dans Le Voyage du Père, (3) le personnage errant de lieux en lieux finit, malgré la robustesse de son esprit, par ressentir de si éminents vertiges sous la plume de Bernard Clavel :
« Il y avait ainsi beaucoup plus de lumière dans l’eau que sur le coteau d’en face où s’étageaient des maisons aux fenêtres éclairées. Plus les maisons étaient hautes et loin, plus leurs lumières se nimbaient d’un halo. Il n’y avait pas d’étoiles. La lueur qui montait de la ville semblait rencontrer comme un plafond cotonneux posé sur les toits les plus élevés. Quentin regardait tout cela sans rien voir vraiment. »
Enfin, les fleuves et les quais de Lyon ne seraient pas ce qu’ils sont sans leur cortège de noyés. Me Debeaudemont dans L’Arbre Sec de Joseph Jolinon, la petite Noëlle du Ciel de suie de Béraud, pour ne retenir qu’eux, finissent ainsi leur mélancolique existence dans les fleuves :
« Et puis, ce fut l’arrivée entre deux agents de l’affreux brancard bâché de cuir, d’où coulait, pas à pas, une inépuisable traînée d’eau limoneuse et glacée ».
Et pour finir, une toile et une photo. Je laisse à votre sagacité le soin d'en retrouver les auteurs ...
(1) Emmanuel Vingtrinier
(2) G. Champeaux, Le Roman d’un vieux Grôléen Lyon, Ed. de Guignol,1919
(3)Bernard Clavel, Le Voyage du père, Paris, Robert Laffont, 1965


09:05 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : lyon, actualité, société, écriture, littérature | 
lundi, 06 juin 2011
En Saint-Denis, Croix-Rousse
Du dehors, l’édifice paye franchement pas de mine. Le clocher qui ouvre sur la rue : Trois fenêtres, un bossage rustique et un petit dôme à lanterne supportant la croix. La façade : rien que beaucoup d’austérité, que perce un unique vitrail, étroit et rond. Il faut franchir le porche, et s’avancer de quelques pas pour rencontrer quelques primes sensations.

Vers 1910
Les Pères Augustins Réformés (qu’on nommait les petits Pères) qui posèrent là la première pierre de l’édifice en avril 1629 sont défuntés depuis lurette. On pénètre alors la pénombre de leur ancienne église conventuelle. Elle n’avait, comme le clocher, rien de remarquable : c’était une nef rectangulaire, couverte d’un simple lambris, et terminée par un modeste chœur. Deux chapelles latérales, l’une dédiée à la Confrérie de la Bonne Mort, l’autre à Notre Dame des Sept Douleurs lui furent adjointes. Au début, les Pères n’étaient guère plus qu’une douzaine en leurs cellules, au milieu des champs, des saules et des vergers, interdits d’aumône par le Consulat, et contraints de donner aux rares habitants du faubourg les sacrements de Baptême, Eucharistie et Pénitence en cas de nécessité.
Autour de leur enclos s’établirent peu à peu d’autres frustes fermes, puis de rustiques hôtelleries pour voyageurs de passage. En ce dix-septième siècle, les chemins alentours n’étaient pas pavés : il y avait celui qui menait vers Bourg (l’actuelle Grande Rue), celui qui partait pour Neuville et l’autre vers Montluel et la Bresse. D’une croix en pierre rose de Couzon, posée à la fin du quinzième siècle, tout le plateau et les coteaux alentours tenaient leur nom.
La Grande Révolution passant par là, l’église conventuelle échappa de peu à la vente des Biens Nationaux et les Augustins disparurent. Avec la fondation de la commune Cuire Croix-Rousse, elle devint paroissiale en 1791 et fut confiée à ancien Augustin du nom de Charles Plagniard, qui devint curé constitutionnel. La Terreur se propageant, la Croix-Rousse s’était proclamée « commune Chalier » et l’église, devenue « temple décadaire », puis « temple de la raison », connut le culte étrange de « l’Etre Suprême ». A son entour, le quartier changeait et se développait de plus en plus vit avec la venue des ouvriers tisseurs. Le 29 Thermidor an VIII (1- mai 1797), la Croix-Rousse devenait une commune autonome et l’église Saint-Denis la paroisse des canuts.
Dans sa pénombre, se découvre un cénotaphe contenant le cœur d’un ancien curé bien aimé de ses paroissiens, Jean Antoine Artru, défunté le 17 mai 1875. C’est l’un de ses prédécesseurs, Claude François Nicod, qui donna à l’église son volume contemporain. Il avait pris la paroisse en 1830, à l’âge de 42 ans, et mourut en 1853. Sur un portrait, on lui découvre un visage long et bon, à la Lamennais. Toute sa vie, il aima le baron de Richemont, alias le duc de Normandie, qui se prétendait Louis XVII, l’enfant du Temple, et avait pris durant leur révolte le parti des canuts (voir ICI son étrange histoire) contre la Garde nationale et les fabriciens. Pour lui, Nicod écrivit en 1850 un ouvrage, L’Avenir prochain de la France, que le Cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, condamna solennellement. C'est, croit-on, ce qui précipita sa fin.
Dès le début de son ministère, le curé Nicod fut soucieux d’obtenir du Conseil Municipal et du Conseil de la Fabrique des fonds pour agrandir l’étroite église des anciens Pères. En supprimant les anciennes chapelles et en aménageant de larges bas cotés, il fit d’abord doubler par l’architecte Antoine Marie Chenavard la nef, puis fit bâtir par Joseph Forest les trois hémicycles du chœur où il disposa les trois autels actuels. Grâce à une souscription, Nicod dota également l’église de ses orgues en 1838. En 1831, bien que légitimiste, cet étonnant curé donna officiellement la sépulture à deux canuts morts pendant les émeutes et cautionna en 1833 un service funèbre à la mémoire des insurgés tués sur les barricades.
C’est un autre curé, Zacharie Paret, qui paracheva son oeuvre en 1876, en confiant au peintre lyonnais Auguste Perrodin la réalisation des trois fresques des voûtes. La vieille église se transformait soudain en une vénérable micro basilique. Ce même Paret, en 1891, redonna vie au culte de Notre-Dame des Sept Douleurs en ouvrant une chapelle qui demeure toujours.
Vous voilà donc dans cette église aujourd’hui. Sur la cuve à cinq pans de la chaire en noyer massif qui sortit au dix-septième siècle des mains d’un sculpteur inconnu, vous reconnaissez des épisodes des Ecritures : La remise des Tables de la Loi sur le mont Sinaï, Jésus marchant sur les eaux, au puits de la Samaritaine, chassant les vendeurs du temple, Saint-Michel terrassant Lucifer. Un peu plus loin, vous voici face à la bannière de la Corporation des Tisseurs de Lyon. Puis à deux reliquaires ; le plus vieux, à deux étages, date probablement des vieux Pères fondateurs. Sur l’autre, est posée une tête de Saint-Denis. Derrière sa façade modeste, Saint-Denis recèle ainsi des trésors d’histoire et de mémoire, au même titre que les grandes églises du centre-ville bien plus visitées, Saint-Nizier, Saint-Bonaventure, Ainay ou la primatiale Saint-Jean. Elle reste le plus souvent ouverte et vaut le détour.
11:08 Publié dans Bouffez du Lyon, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : saint-denis, croix-rousse, nicod, religion, christianisme, lyon, augustins réformés, rue hénon | 
dimanche, 20 février 2011
Prise de tête à Lugdunum, 193
Le 20 février 197 la mort de Clodius Albinus solda la bataille entre deux empereurs sous les murs de Lugdunum : Septime Sévère, à qui cette bataille décisive livra définitivement l’empire, et Albin, pour qui Lugdunum avait pris fait et cause.
Septime Sévère de famille sénatoriale, avait été légat de la Lyonnaise en 186-188. Son fils Bassianus, futur Caracalla, était né dans la capitale des Gaules. Albinus, lui aussi de famille sénatoriale, avait été légat de Bretagne. Il s’était tout d’abord rallié à Sévère qui, pour le concilier, l’avait nommé général en chef et lui avait donné le titre de César en 194. A Rome, on frappa alors un denier à son effigie.
Mais en janvier 196, Albinus rompit avec Sévère et se fit proclamer Auguste avant de se fixer à Lyon où il établit son gouvernement. De là, il contrôlait les Gaules, l'Espagne et la Bretagne. La guerre était inévitable et Lugdunum, qui prit parti pour Albinus, fut incendiée.
On ne connait pas l’emplacement exact de la bataille (Tassin la demi-Lune ? Sainte-Foy les Lyon ? Saint-Didier au Mont d’or ? la Dombes ? Tournus ?). Les combats furent suivis de la mise à sac de la ville et de la mort d’Albin (exécution ou suicide ?)
Le texte suivant narre la « bataille de Lyon » et la fin d’Albin, les 19 et 20 février 193. Il est traduit de l’histoire romaine de Don Cassius, écrite quelques décennies après l’événement :

« La bataille entre Sévère et Albin devant Lyon se déroula de la façon suivante. Les deux camps confondus, il y avait cent cinquante mille soldats ; les deux chefs aussi étaient présents parce que, pour eux, il s’agissait ‘une question de vie ou de mort, alors que Sévère n’avait jamais assisté à aucune autre bataille.
Albin était supérieur par la naissance et par l’éducation. Mais son adversaire était supérieur dans l’art de la guerre et plus habile général (il était arrivé par chance à Albin, dans une bataille antérieure, de vaincre Lupus, un général de Sévère, et de massacrer un grand nombre de ses soldats). La présente bataille comporta de nombreux épisodes et revirements.
L’aile gauche d’Albin fut vaincue et s’enfuit vers son camp : les soldats de Sévère les poursuivirent les assaillirent, commencèrent à les tuer et à piller leurs tentes. Pendant ce temps, sur l’aile droite, les soldats d’Albin qui avaient disposé devant eux des fossés et des trous dissimulés superficiellement par de la terre s’avancèrent jusqu’à eux et lancèrent des javelots de loin ; ils ne s’avancèrent pas au-delà, mais comme s’ils avaient peur, ils firent demi-tour pour obliger leurs adversaires à les poursuivre. C’est précisément ce qui arriva.
Les Sévériens, stimulés par la rapidité de leur assaut et rendus présomptueux par la fuite soudaine de leur adversaire, s’élancèrent à leur poursuite comme si tout l’espace entre les deux armées était praticable. Mais arrivés aux fossés, ils subirent un terrible désastre. En effet, dès que la couche de terre qui recouvrait les fossés se fut effondrée, les soldats des premiers rangs y furent précipités, et ceux qui les suivaient, perdant l’équilibre, tombaient sur eux et les écrasaient. Le reste, effrayé, battait en retraite et en raison de la rapidité de leur volte face, ils bousculaient et renversaient l’arrière garde, et ainsi la poussèrent dans un profond ravin.
Il s’ensuivit de lourdes pertes, chez ces soldats et chez ceux qui étaient tombés dans le ravin, hommes et chevaux mêlés. Voyant cela, Sévère se porta à leur secours avec sa garde, mais loin de les aider, il s’en fallut de peu qu’il n’y laissât aussi sa garde, et lui-même courut un grand danger en perdant son cheval. Lorsqu’il vit que tous les siens étaient en déroute, il déchira son manteau, dégaina son épée et s’élança sur les fuyards dans l’espoir de les faire changer d’avis en leur faisant honte, ou de périr lui-même avec eux. Quelques-uns en le voyant ainsi s’arrêtèrent et firent demi-tour.
Par la même, ils se trouvèrent face à face avec ceux qui les suivaient, en frappèrent en grand nombre et mirent en déroute tous ceux qui les pourchassaient. La dessus la cavalerie, sous les ordres de Laetus (un général de Sévère) se jeta sur eux par le flanc et fit le reste. Car Laetus, tant que l’issue du combat était demeurée incertaine, s’était contenté de suivre du regard les événements avec l’espoir que les deux chefs périraient et que les soldats survivants des deux camps lui remettraient le pouvoir. Mais lorsqu’il se rendit compte que les troupes de Sévère allaient l’emporter, il prit part à l’action.
Ainsi vainquit Sévère. La puissance romaine éprouva un très grave échec puisque des deux côtés tomba un grand nombre de combattants. Nombreux parmi les vainqueurs furent eux qui pleurèrent l’événement. La plaine entière était recouverte par les cadavres d’hommes et de chevaux, les uns criblés de blessures et déchiquetés, les autres, bien que sans blessures, ensevelis sous les corps. Les armes étaient abandonnées ça et là, le sang répandu en telle abondance qu’il coulait dans les rivières. Albin, qui s’était réfugié dans une maison près du Rhône, lorsqu’il se vit assiégé, se suicida. A la vue du corps, Sèvère manifesta une grande joie par son regard et ses paroles, puis ordonna de jeter le corps dans le Rhône, sauf la tête qu’il fit envoyer à Rome au bout d’une pique.»
On trouve un dénouement différent chez Hérodien (Histoire des empereurs romains) qui, après un récit similaire de la bataille conclut par cette brève : « Les partisans de Sévère ravagèrent Lyon, qui était une cité grande et prospère, et la brulèrent. Ils firent prisonnier Albin le décapitèrent, apportèrent sa tète à Sévère, puis élevèrent deux grands trophées à la victoire, l’un à l’Est, l’autre au Nord.»
09:49 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (8) | 
mercredi, 16 février 2011
Eiffage ne convainc pas
Hier, mardi 15 février, le maire de Lyon présentait à nouveau aux Lyonnais le projet retenu pour le réaménagement de l’Hôtel-Dieu, en présence de Michel Chenevat le directeur régional pour la région Centre Est du « secteur Bâtiment et immobilier » du groupe Eiffage, de Didier Repellin, architecte en chef des monuments historiques, de Daniel Moinard, directeur général des Hospices civils de Lyon, de Nadine Gelas, vice-présidente du Grand-Lyon. La salle Justin Godart était à nouveau pleine, témoignage de l’intérêt que ce dossier exceptionnel a auprès le public. Une belle opération de communication, qui pourtant ne convainc pas. Le maire a commencé par exposer ses arguments politiques. Puis Michel Chenevat a brièvement détaillé à grands traits le projet de son groupe. Enfin Didier Repellin et Albert Constantin ont évoqué la nature de la restauration envisagée.
Intérieur du grand dôme -Photo : Cheumou Phildroso
Pour résumer la situation, le chantier serait à resituer dans la gestion globale des HCL, lesquels « ont beaucoup investi pour le développement d’hôpitaux modernes en périphérie de Lyon : un milliard d’euros d’investissement, vers le meilleur de la médecine » Le maire fait de la rénovation de l’hôpital Edouard Herriot une « vraie priorité ». Le financement de ces opérations passe nécessairement, explique-t-il, par des désaffectations : avant-hier l’Antiquaille, hier Debrousse, aujourd’hui l’Hôtel-Dieu. On comprend que pour la direction des HCL, ce qui compte est l’exploitation globale du parc hospitalier au sein duquel l’Hôtel-Dieu est un vieillard certes prestigieux, mais désormais inutile et couteux (sa rénovation est estimée à 150 millions d’euros), dont il faut autrement dit se débarrasser.
La ville de Lyon seule pourrait-elle reprendre à son compte un tel projet avec un plan de mandat budgétisé à 600 millions d’euros ? Le maire écarte d’un revers de manche une telle idée : « J’aime mieux réhabiliter La Duchère et Mermoz, et laisser Eiffage faire l’Hôtel-Dieu », dira-t-il. Derrière cet apparent intérêt pour le social se cache une étrange conception de la répartition territoriale de la ville. Le centre pour les riches, les ultra-riches, et les périphéries pour les modestes et les sans-le-sou. Est-ce le prix à payer pour devenir une « ville internationale » ? Pour Collomb, ça ne se discute même pas. Et plutôt que de prendre le temps d’établir un dossier à multiples partenaires, joignant musées, bibliothèques, théâtres, cinémas, commerces, restaurants, universités…, il préfère solliciter un groupe unique qui accorde sa priorité à l’industrie de l’hôtellerie de luxe.
C’est alors qu’intervient le groupe Intercontinental, partenaire d’Eiffage (qui s’installera aussi à Marseille grâce à la complicité de Jean Claude Gaudin). On prend grand soin alors de nous dire que cette industrie n’occupera que 30 % des lieux : le hall de l’hôtel sous le grand dôme qui demeurera ouvert au public, et la façade de Soufflot sur le bord du Rhône, qui abritera les duplex et les deux grandes suites : « Ce site dont on rêve tous », déclare ingénument Michel Chenevat, pour évoquer l’ensemble « dôme façade » ces fameux 30% qui seront dédiés à l’hôtellerie de luxe. En contrepartie, le groupe affirme rendre l’hôtel Dieu (le reste des bâtiments) aux Lyonnais, avec la réouverture de galeries, l’aménagement de cours intérieures, l’établissement d’un musée de la santé. Mais comment ne pas voir que ce qui est présenté comme « un parti-pris » n’est qu’un prétexte ? Dès 2014 certains commerces s’ouvriront et le tout devrait être livré en 2016.
C’est enfin au tour des architectes de prouver que la rénovation sera de qualité, et respectueuse du caractère historique du bâtiment. Didier Repellin et son adjoint expliquent que l’originalité du classement UNESCO de la ville au patrimoine de l’humanité s’est déroulée au motif non pas d’un patrimoine statique, mais dynamique… Dont acte ! Avec verve et lyrisme, ils nous font un cours sur l'histoire de l'Hôtel-Dieu. Pour finir, un bref film d’animation nous promène à travers la future rénovation et se clôt par ce slogan : « Lorsque l’Hôtel-Dieu s’anime, c’est tout Lyon qui rayonne »
Débute alors un débat avec la salle; un dialogue – évidemment de sourds, puisque toutes les décisions sont déjà prises.
Un étudiant fait remarquer que les figurants placés dans le film qu’on vient de voir, déambulant tous cravatés dans les cours intérieures ou sous le dôme de Soufflot, ne sont, à son sens, guère représentatifs du « peuple lyonnais », et qu’il craint somme toute une forme de « captation » des lieux au profit des plus riches. Gérard Collomb lui répond que s’il possède juste de quoi boire un café, il lui sera toujours plus agréable de boire son café dans un lieu joliment restauré, et parmi des gens cravatés, plutôt que dans les cafés de l’actuelle rue Bellecordière !
Cette question de « la captation des lieux » par les plus riches est bien au centre du débat qui se prolonge avec l’intervention de plusieurs représentants d’associations. L’Esprit Canut rappelle que si cette rénovation du bâtiment sert de prétexte au détournement du monument (car il s'agit de la mémoire des lieux), elle n’est tout simplement pas concevable. A quoi bon rénover un bâtiment si c’est pour tuer le monument ? La Renaissance du Vieux-Lyon s’inquiète des garanties qu’auront les associations de pouvoir être accueillies au PRES (pôle de recherche de l’enseignement supérieur) lorsque les signatures seront faites. Comment le maire garderait-il la main pour que le projet demeure lyonnais ? Un vieux monsieur accuse : « Il faudrait faire un geste pour ceux qui ne comprennent pas votre projet. Réserver une place pour une crèche et un établissement pour personnes âgées, c’est-à-dire pour les plus fragiles. Autrefois, les édiles lyonnais s’intéressaient à ce type de population ».
Collomb répond toujours de façon biaisée, en évoquant ce qu’il fait ailleurs, des logements sociaux, des rénovations de quartiers : comme si l’un devait forcément exclure l’autre. Comme s'il n'avait pas été possible, en prenant son temps, de ficeler un projet vraiment culturel dans ce site d'exception, au lieu de ce projet bling-bling, tape-à-l'oeil et clinquant.
Et l’on finit par penser qu’on est là au cœur de sa politique : la sectorisation du territoire au prétexte du social et le mépris de la culture patrimoniale au nom de l’affairisme contemporain ...
![]()
11:37 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : hôtel-dieu, lyon, eiffage, gérard collomb, didier repellin, michel chenevat | 
dimanche, 06 février 2011
Le dico de de nos pères
Essentiellement lié à une profession (les tisseurs) et à un lieu (Lyon, la Croix-Rousse), Le Littré de la Grand’Côte (de Clair Tisseur, alias Nizier du Puitspelu), se trouve encore chez les bons bouquinistes. Composé en 1894, il se présente comme un dictionnaire de termes ou d’expressions jugés par son auteur en voie de disparition, et qu’il recueille au gré de ses souvenirs, de ses promenades, de ses rencontres. Au fil des définitions, un véritable roman autobiographique,  celui de Puitspelu -alias Clair Tisseur (1827-1895)- se découvre, dont le lecteur peut, fragment par fragment, reconstituer la mosaïque. Quelques exemples : «Mon père avait une petite maison, en rue de l’hôpital » (art. aiguë) ; «Ma grand’, en passant un jour à Sainte-Foy devant la porte de sa chambre, aperçoit, en train de relever ses cheveux devant la glace, sa femme de chambre qui disait : je ne sons pas jolie, mais tout de même j’ons ce petit air ! » (article air) ; «Ma grand mère maternelle avait été l’amie de la dernière abbesse de la Déserte qui, après la Révolution, réduite à une grande gêne, lui vendit un très beau reliquaire du XVIIe siècle que nous possédons encore » (art. arquebuse) ; «Quand je revins de nourrice, j’avais une bonne grasse face large, mais sans flamme » (art. couyon) ; « Une des sœurs de mon grand-père, Barthélemy Puitspelu, passementier, se nommait Dodon » (art. dodon) ; « Quand j’étais gone, à Sainte-Foy, il me survint une enflure douloureuse à la partie inférieure du tibia » (art. fourche) ; « Il y a des mères qui forcent leurs enfants au travail. La mienne m’aimait tant que, si elle me voyait travailler avec un peu d’assiduité : Allons, me disait-elle, il ne faut pas tuer tout ce qui est gras. Va t’amuser ! » (art. tuer) «Lorsque j’étais aux Minimes, à la fin du déjeuner, l’élève chargé de la lecture pendant le repas lisait le martyrologe du jour » (art. col). « Mme Catiner, notre voisine, disait un jour à mon barjois… » (art crique) « Feu mon maître d’apprentissage avait pour maxime qu’il est plus facile de trouver un veau raisonnable qu’une femme raisonnable » (art. raisonnable)…
celui de Puitspelu -alias Clair Tisseur (1827-1895)- se découvre, dont le lecteur peut, fragment par fragment, reconstituer la mosaïque. Quelques exemples : «Mon père avait une petite maison, en rue de l’hôpital » (art. aiguë) ; «Ma grand’, en passant un jour à Sainte-Foy devant la porte de sa chambre, aperçoit, en train de relever ses cheveux devant la glace, sa femme de chambre qui disait : je ne sons pas jolie, mais tout de même j’ons ce petit air ! » (article air) ; «Ma grand mère maternelle avait été l’amie de la dernière abbesse de la Déserte qui, après la Révolution, réduite à une grande gêne, lui vendit un très beau reliquaire du XVIIe siècle que nous possédons encore » (art. arquebuse) ; «Quand je revins de nourrice, j’avais une bonne grasse face large, mais sans flamme » (art. couyon) ; « Une des sœurs de mon grand-père, Barthélemy Puitspelu, passementier, se nommait Dodon » (art. dodon) ; « Quand j’étais gone, à Sainte-Foy, il me survint une enflure douloureuse à la partie inférieure du tibia » (art. fourche) ; « Il y a des mères qui forcent leurs enfants au travail. La mienne m’aimait tant que, si elle me voyait travailler avec un peu d’assiduité : Allons, me disait-elle, il ne faut pas tuer tout ce qui est gras. Va t’amuser ! » (art. tuer) «Lorsque j’étais aux Minimes, à la fin du déjeuner, l’élève chargé de la lecture pendant le repas lisait le martyrologe du jour » (art. col). « Mme Catiner, notre voisine, disait un jour à mon barjois… » (art crique) « Feu mon maître d’apprentissage avait pour maxime qu’il est plus facile de trouver un veau raisonnable qu’une femme raisonnable » (art. raisonnable)…
La première fonction de ces remarques est de persuader le lecteur que le vocable lyonnais, qu’on dit alors en voie de disparition, était il y a encore peu, très vivant ; quand Littré va puiser ses références dans la Grande Littérature, Puistpelu n’a besoin que de se baisser au coin de sa cage d’escalier pour trouver les siennes. En introduisant son lecteur dans son intimité, sur le ton plaisant du commérage ou plus émouvant de la confidence, Puitspelu confère à ces remarques éparses une autre fonction : celle de le rendre sympathique, tel un grand oncle au ton patelin dont les bords du chapeau se recourbent sur des mèches blanches. Enfin, elles instaurent un système d’autoréférences entre le collectif et le particulier, le mythe personnel et le substrat communautaire : si le Littré de Puitspelu est le lexique de la Grand’côte, c’est donc que le parler de la grande Côte est aussi la langue de Puitspelu ; le roman d’une simple famille, en définitive, devient aussi celui de toute une corporation, de toute une ville, en réaction contre le pédantisme franco-parisien : « Sauf votre respect. C’est ainsi que disent quelques personnes qui tiennent à parler français. Nous autres, simples, disons toujours, à la lyonnaise, parlant par respect ». (art. saufre).
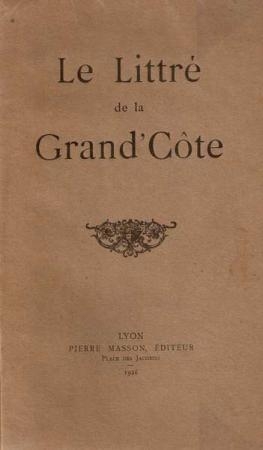 Ce roman familial fort discret s’élabore autour d’une nostalgie récurrente, qui, de même qu’elle affecte l’auteur, paraît au fil de la lecture affecter et la langue et le territoire dont, de façon métonymique, il se déclare le membre : un passéisme de bon aloi émane des définitions des termes populaires : « de mon temps à la Croix-Rousse… » (art. bardanière), « quel mot charmant, n’est-ce pas, quand nous étions petits gones ? » (art. badinage), « encore un métier de perdu, hélas ! » (art. arboriste), « jadis les fiacres de Vénissieux n’étaient autorisés à charger que du 1er novembre au 1er mai.» (art. allège), «on a démoli l’allée et la portion de maison placée au-dessus.» (art. allée des morts), «mot perdu à Lyon depuis qu’on se chauffe au charbon » (art.andier), « Mais hélas, aujourd’hui, tout a perdu sa vertu ! » (art. philtre), « Aujourd’hui, il n’y a plus que quelques rares Lyonnais qui aient gardé notre antique prononciation. » (art. prononciation)… Passéisme qui, outre ces quelques exemples, se diffuse un peu partout grâce à l’usage d’un imparfait narratif ostentatoire et proustien, affichant sur le mode du « il était une fois » l’arrière-plan regrettable dans lequel un certain progressisme, décidément détestable, paraît cantonner depuis peu la vraie vie. En voici quelques exemples : « De mon temps chaque bourgeoise secouait sa bardinière sur le carré. » (trad.: Chaque bourgeoise était propre, art. bardinière). « Chez mon oncle, on dînait et on soupait d’affilée, vu qu’on n’avait pas le temps de finir un repas avant de commencer l’autre. » (art. affilée). « Autrefois on donnait les innocents pour punition, non seulement aux enfants mais aux domestiques des deux sexes. C’était un souvenir des corrections de l’esclave. On ne voyait du reste pas à cette punition le caractère indécent et humiliant que nous lui attachons. » (art. Innocents – donner les innocents : donner le fouet). « Aujourd’hui, il n’y a que des ouvriers. Jadis, il y avait des artisans. Quand il fallait une certaine dose d’intelligence, de discernement, de goût pour l’exercice d’une profession, celle-ci était un art. » (art. airt). Tout le dictionnaire est ainsi structuré en sous-main par une première opposition aujourd’hui / autrefois. Opposition que redouble dans l’espace une seconde opposition, celle de la capitale de la province (Lyon) et celle du pays (Paris)
Ce roman familial fort discret s’élabore autour d’une nostalgie récurrente, qui, de même qu’elle affecte l’auteur, paraît au fil de la lecture affecter et la langue et le territoire dont, de façon métonymique, il se déclare le membre : un passéisme de bon aloi émane des définitions des termes populaires : « de mon temps à la Croix-Rousse… » (art. bardanière), « quel mot charmant, n’est-ce pas, quand nous étions petits gones ? » (art. badinage), « encore un métier de perdu, hélas ! » (art. arboriste), « jadis les fiacres de Vénissieux n’étaient autorisés à charger que du 1er novembre au 1er mai.» (art. allège), «on a démoli l’allée et la portion de maison placée au-dessus.» (art. allée des morts), «mot perdu à Lyon depuis qu’on se chauffe au charbon » (art.andier), « Mais hélas, aujourd’hui, tout a perdu sa vertu ! » (art. philtre), « Aujourd’hui, il n’y a plus que quelques rares Lyonnais qui aient gardé notre antique prononciation. » (art. prononciation)… Passéisme qui, outre ces quelques exemples, se diffuse un peu partout grâce à l’usage d’un imparfait narratif ostentatoire et proustien, affichant sur le mode du « il était une fois » l’arrière-plan regrettable dans lequel un certain progressisme, décidément détestable, paraît cantonner depuis peu la vraie vie. En voici quelques exemples : « De mon temps chaque bourgeoise secouait sa bardinière sur le carré. » (trad.: Chaque bourgeoise était propre, art. bardinière). « Chez mon oncle, on dînait et on soupait d’affilée, vu qu’on n’avait pas le temps de finir un repas avant de commencer l’autre. » (art. affilée). « Autrefois on donnait les innocents pour punition, non seulement aux enfants mais aux domestiques des deux sexes. C’était un souvenir des corrections de l’esclave. On ne voyait du reste pas à cette punition le caractère indécent et humiliant que nous lui attachons. » (art. Innocents – donner les innocents : donner le fouet). « Aujourd’hui, il n’y a que des ouvriers. Jadis, il y avait des artisans. Quand il fallait une certaine dose d’intelligence, de discernement, de goût pour l’exercice d’une profession, celle-ci était un art. » (art. airt). Tout le dictionnaire est ainsi structuré en sous-main par une première opposition aujourd’hui / autrefois. Opposition que redouble dans l’espace une seconde opposition, celle de la capitale de la province (Lyon) et celle du pays (Paris)
« A Lyon, nous employons toujours le premier, et à Paris, on emploie le second, parce qu’il appartient au style poétique. » (art. pot de chambre, par opposition à vase de nuit) : « C’est ce qu’à Paris ils appellent border un lit. » (article remployer) : « ils », par opposition au « nous , lyonnais », au « chez nous», ou au « au Gourguillon, nous disons couramment », assénés sans arrêt : « Voilà ce que vous entendrez chez nous ; les Parisiens disent… » (art. ancien) ; « je crois que le pôt, gigôt des Parisiens est une prononciation affectée, et que notre prononciation lyonnaise est la classique » (art. ot) ; «Gardons notre accent et ne soyons pas des perroquets. Est-il rien de plus ridicule qu’un provincial qui, revenant de Paris, essaie de prendre l’accent parisien et ne réussit qu’à faire lever les épaules à ceux qui écoutent son charabia » (art. avis). Si Puitspelu n’hésite pas à condamner le populaire parisien qui déforme les mots (art), il ne répète sans cesse que le populaire lyonnais ne les corrompt pas (art. finablement).
Ce provincialisme affiché serait anecdotique si, articulé à l’opposition jadis/aujourd’hui, et à la dissémination du roman personnel, il ne déclinait au nom d’une entière population les impressions d’un seul individu, « d’un petit gone », comme Clair Tisseur se nomme lui-même dans un autre de ses livres.
Ce tour de passe-passe, aux allures innocentes, permet ainsi, dans l’article canif, au modeste bourgeois qui a lu Homère de professer avec une hypocrite candeur que, pour qui ne connaît l’Odyssée, l’expression Charybde et Scylla demeure incompréhensible ; il suggère donc lui préférer le pittoresque tomber de canif en syllabe, expression qu’il recueille dans son bréviaire : manière peu délicate de dénoncer la culture érudite, au nom d’une pittoresque ignorance qui serait celle du ruisseau. Car on comprend à la lecture de nombreux articles que ce n’est pas de ce bon peuple de tisseurs que Puitspelu est en réalité épris, mais bien plutôt d’un moment heureux de sa propre vie, celui de son enfance. Si dans l’espace, le «parler» populaire des «vrais lyonnais» se voit assigné un territoire résolument restreint (la Grande Côte), il s’en voit assigné un autre dans le temps, l’enfance de son auteur, qui a littéralement « baigné » dedans : « A l’époque où le mot a été créé, on ne faisait ni ponts suspendus ni ponts en fer » (article pontiaude) ; autre exemple dans l’article « canetière » : « nouvelle machine avec laquelle je me suis laissé dire qu’on peut faire vingt ou trente canettes à la fois, tandis qu’avec le rouet, il fallait les faire une à une. Je ne désespère pas de voir un jour une invention pour faire vingt ou trente enfants à la fois ». D’où une posture à la fois neo-romantique et contre-révolutionnaire : « J’ai toujours pensé que le Peuple Souverain est le premier des barfouille-bachats » (autrement dit : imposture.) Mais ça, rajoute notre Littré du cru, « c’est défendu de le dire. Il faut se contenter de le penser ». Dans un recueil de réflexion privé, (Au hasard de la pensée, 1895), Clair Tisseur ne le pense-t-il pas en toutes lettres : « Ce qu’il faut à la multitude, c’est de la médiocrité de premier ordre »?
Le Littré de la Grand Côte se donne ainsi à lire comme un roman autobiographique joyeusement réactionnaire. En parfait décadent, Puitspelu érige en âge d’or l’Ancien Régime : « autrefois, mon père me racontait qu’au XVIIIe siècle… » (art. barouler). « Or sus, nos pères n’étaient pas moroses ou pédants comme nous. » (art. poil). Age d’or qui était celui du plaisir : « expression qui nous reporte aux temps antérieurs au Concordat où les fêtes étaient multipliées » (art. aimer) ; les révolutionnaires (les mathevons) se trouvent affublés d’un article défini générique qui les détermine en tant qu’espèce locale incongrue (les terroristes de Lyon) ; Clair Tisseur précise : « dans mon enfance, on ne les désignait que sous ce nom » (art.Mathevons) Le regret / respect de ce qui disparaît s’applique tout autant au bon peuple : ainsi, dans l’article canut, Puitspelu s’adresse solennellement au lecteur (« Lecteur, regarde avec respect ce canut ! ») pour lui signifier sa lente disparition (« Soixante mille métiers à mains lorsque j’étais borriau (apprenti), trois mille à l’heure où j’écris (1894). » Il glisse alors cette remarque : « Le nombre des ateliers privés va diminuant chaque jour au profit du métier mécanique. C’est à dire que la famille disparaît devant l’usine ».
Architecte, érudit, farceur, poète (à ses heures perdues, dirait Léon Bloy), Clair Tisseur (Puitspelu) mourut en 1895, à l'heure où triomphait la philologie; est-il saugrenu, pour conclure, d'affirmer qu'à l'orée du vingtième siècle, cet effort pour mêler l'objectivité du savant à la subjectivité de l'autobiographe, effort assez rare dans le genre du dictionnaire, est, comme l'aurait dit l'un de ses contemporains avec qui on l'aura rarement associé, « résolument moderne » ?
19:30 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : clair tisseur, accent lyonnais, littérature, lyon, littré de la grande cote | 
lundi, 03 janvier 2011
Maire de Lyon
Edouard Herriot, lorsque j’étais petit, c’était à la fois quelque chose et puis rien. Quelque chose : maire de Lyon durant cinquante deux ans ! Monolithique, dans sa génération, le bonhomme ! Rien : un homme du passé immédiat, mort alors que je n’avais que deux ans, et remplacé par un homme plus que médiocre qui abîma à jamais Lyon avec son bétonnisme aigu, le dénommé Pradel. Herriot déjà, ça n’était plus qu’une rue, la rue de l’Hôtel de Ville, débaptisée en rue Edouard Herriot. A present, lorsque je demande à des élèves s’ils savent qelque chose de ce type, ils me disent tous : rien. Rien... Le leçon de Sénèque : Comme les gloires passent, n'est-ce pas ? Pauvre Edouard...
Et puis une tombe grotesquement stalinienne, à l’entrée du cimetière de Loyasse. Grotesque, c'est même peu dire. C'est par là qu'à dix-sept ans, lorsque j'allais me saouler avec des potes en un lieu éloigné des familles, nous faisions le mur ... Il faut, se dit-on en voyant son gigantisme peu chrétien, savoir choisir son camp. Amusante, la gerbe de l'actuel maire de Lyon, à chaque Toussaint. Glissons.
Devant la nullité de son successeur, évidemment, cet Edouard ressemblait encore à quelque chose dans les années 60 : comment oublier pourtant qu’il avait signé l’arrêt de mort du dernier pont de pierre de la ville, un ouvrage de treize arches séculaire, le pont de la Guillotière, ainsi que celui de l’hôpital de la Charité et toutes ses cours intérieures, pour les remplacer par un hôtel des Postes, et un autre des Impots, comme pour rivaliser de laideur : Quelle ineptie ! Herriot malgré sa gloriole politique ne fut-il pas à ce titre guère plus qu’un moderniste opportuniste, sans grande vue ni grande culture, encensée par une bourgeoisie locale en mal de baron du cru ?
Albert Thibaudet, lorsqu’il évoque d’Herriot, en parle comme d’un girondin, mais c’est parce qu’il confond girondin et provincial. En réalité, nul ne fut plus centralisateur et jacobin que cet Herriot, dans sa manière autocratique de gérer sa capitale des Gaules comme si elle devait sans cesse rivaliser avec Paris. Il ne s’y trompe d’ailleurs pas, Thibaudet, qui écrit, dans la République de professeurs :
« Le maire de Lyon est le premier de Lyon – mais après le préfet, et son gouvernement facile, ressemble plus à celui d’un président de la République qu’à celui d’un chef de gouvernement. »
Ou encore :
« Paris est la capitale de la France, mais Lyon est la capitale de la province. Les politiques savent à quel point le Cartel des gauches de 1924 était une formation lyonnaise »
Herriot eut pour successeur un imbécile. Personne ne parla mieux de Louis Pradel que Pierre Mérindol. Je cite : « C’est un modeste expert en assurance automobile qui n’a jamais connu d’autres lauriers que ceux des concours de circonstances » Ou encore : « Le drame de Lyon – car il est bien vrai que la ville est défiguré – c’est que le maire ait été aussi mal entouré » (1)
L’inconsistance du successeur de Pradel, un Collomb, déjà (mais Francisque) n’est plus à souligner. Avec lui, le Grand Orient assoit un peu plus son autorité sur l’Hôtel de Ville, représenté par des guignols du nom de Soustelle, Ambre, Bullukian, Combes, Béraudier. Je cite toujours Mérindol, un homme fin et intelligent à la plume lucide : « La pauvreté de la solution Collomb – même si elle est une construction d’origine maçonnique –est le reflet de la pauvreté du personnel politique à Lyon. »
Sans doute est-ce à partir de Michel Noir et des années quatre-vingts qu’on commença a oublier Herriot et son autre temps. Le portrait qu’en dresse Pétrus Sambardier le rendrait presque sympathique :
« Généralement, le président, vers midi et demie, se rend à pied de l’Hôtel de Ville au cours d’Herbouville. Il remonte, pensif, à petits pas, l’allée de platanes du quai Saint-Clair. Les solliciteurs malins connaissent cette promenade et retardent souvent l’heure de déjeuner du président. M. Herriot est accueillant. Il s’assied volontiers sur un banc du quai pour écouter, sans impatience, le garçon « de platte » (2) racontant son dernier exploit de sauveteur ou la vieille femme exposant ses misères » (3)
Il y quand même, dans le ton du journaliste, un air d’hagiographie et l’on n’est pas loin du Joinville exaltant son saint Louis. En contrepoint, voici un portrait d’Henri Béraud, réalisé en novembre 1913, et publié dans le numéro 2 de la revue l’Ours :
« C’est en matière administrative surtout que le bon garçonnisme de M.Herriot lui crée des difficultés. On ne fait pas avec des sourires la besogne d’un comptable. Les poignées de mains et les gros compliments dont les plus acerbes prolos s’accommodent, font quelquefois la fortune politique d’un habile homme. Mais quand, par ces moyens, on est parvenu à ses fins, quand on a pris place au centre des affaires, il faut abandonner ces accessoires de parlottes électorales, comme les avocats laissent robes et toques au vestiaire du Palais. En affaires, il faut se montrer homme d’affaires. M. Herriot y parvient-il ? Non. (…) Les rapides succès de M. Herriot ont fait de lui un séducteur des foules… »

16:24 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : politique, lyon, littérature, edouard herriot, thibaudet, collomb, pétrus sambardier | 
vendredi, 24 décembre 2010
Le Noël du Satinaire
Je pinsavo mo cotaire
Quand la minay a souna
Com’in bravo satinaire
J’ayen fini ma jorna
Quand Michi, notron aprinti
Sauti n a bas de son meti,
Coran come un ecervela
Laissi son corse a marqua
La première strophe place le contexte chez les satinaires (fabricants de satin) entre un maître (Dufour) et son apprenti Michel : « Je pansais mes cautères quand minuit a sonné. Comme un honnête satinaire j’avais fini ma journée, quand Michel, notre apprenti sauta en-bas de son métier, courant comme un écervelé, laissa sa pièce en cours non marquée. »
Je li disi : « Nigodaimo
On et-ai don que te va ?
-Je vouai uvri la liquairna
Per vair ce qu’i dion là-bas.
Accotà si vo n’aite sor :
I dion que var lo Jagobin
Y’a un infan tot divin
A partir de la deuxième débute un dialogue oral par lequel le conteur réactualise l’Evangile. Nigodème (nigaud que j’aime) est une interpellation courante qu’on retrouve dans beaucoup de Noël. Le Noël fait naître l’enfant aux Jacobins qui est alors le plus important couvent de la ville et qui fut vendu comme bien national pendant la Révolution et démoli vers la fin de l’Empire (ce qui permet de dater le texte vers le milieu du XVIIIème) : « Je lui dis : « Nigodème, où est-ce donc que tu vas ? -Je vais ouvrir la lucarne pour voir ce qu’on dit là-bas. Ecoutez donc, maître Dufour, écoutez si vous n’êtes pas sourd ; on dirait que vers les Jacobins, il y a un enfant tout divin. »
Y dion que c’est lo Messie
Qu’est venu pair nos sauva,
Et que la Viarge Marie
Cette nuit l’a infanta ».
J’u craie prou, Dufor u dit,
Car i ne vodrai pa manti ;
Dufor est un home de bien
Ce qu’i dit, il u sa bien.
Pas de difficultés de compréhension dans cette strophe, sinon le cinquième vers, dans lequel le narrateur reprend la parole : « Je le crois bien, lui dit Dufour ». La strophe suivante donne la parole à ce dernier : « femme n’es-tu pas prête, le dernier coup va sonner. Mets par-dessus ta cornette ta coiffe de taffetas. Demande donc à la Fanchon où elle a mis mon manchon. Bernadine, qu’as-tu fait de la clé de mon buffet » :
Fuma, n’ai-ce tu pas preta,
Le dari co va souna
Betta dessu ta cornetta
Ta coiffi de taffeta ;
Demina vaire à la Finchon
Ont elle a beta mon minchon.
Bernadina, qu’a-tu fait
De la clia de mon bufait ?
Les termes techniques se multiplient dans la strophe suivante, alors que le canut s’endimanche à la mode du petit bourgeois de son temps : habit canelle, cravate de cambrésine, chemise à dentelle, souliers de maroquin, perruque à trois talons, joli chapeau brodé. Un pain blanc à l’anis, une queue de mouton et un morceau d’échine ( « o du china ») en guise de réveillon ( « noutron dina ») que la servante doit faire cuire à l’étouffée (« bete in etuffaie »)
Bailla mon habit canella
Ma cravata de cambrin
Et ma chemis’a dintella
Mo solas de maroquin.
Te prendra din celi carton
Ma perruqua a très talon ;
Et pui te me vargetera
Mon joli chapiau broda
Lioda, bete in etuffaie
Cela cova de muton ;
Faie in sorte qu’ale saie
Couita quand je revindron ;
Puis te betra l’o du china
Qui sera pair noutron dina
Te prendra cheu lo bolangi
Ain grou pin blan à l’ani.
Nous voici « sans transition » dans la strophe suivante à l'intérieur de l'église durant la messe : les antagonismes de classe resurgissent lorsque le satinaire désigne à sa femme (« vait-u din cela chapella ») leur crevé de marchand accompagné de son épouse qui fait la belle au milieu du banc . « Ne disons pas de mal du prochain, notre marchand est assez bon chien : du moins s’il nous paye mal, il ne nous laisse pas chômer » conclut le canut ironiquement.
Vai-tu din cela chapella
Noutron creva de marchan ?
Sa fuma fai bian la bella
U milieu de celi ban !
Ne dion gin de ma du proochin !
Noutron marchan est prou bon chn :
Du moin s’y nous paye ma
Y nos laisse pas choma.
Le Noël s’achève par une strophe où il est fait allusion à un empereur, ce qui laisse à penser qu’elle fut rajoutée durant le Consulat, supposition renforcée par les mentions aux guerres avec l’Espagne et l’Angleterre : La prière traditionnelle à Saint-Joseph, patron de la bonne mort, clôt le texte.
Sainte Maria, de grâce
Pri par nos le Saigneur
Qu’avan que ceti an passe
No ayon un bon Amperor.
Que los Espagnos, los Anglais,
Fassaissiont vitemin la paix.
Que Saint-Joseph, votre mari,
Nos aidasse a bien muri.
11:35 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : noël, lyon, patois, llittérature, canut | 










