jeudi, 31 octobre 2013
L'illustre français
J’ai relu aujourd’hui une trentaine de pages des Illustres Françaises de Robert Challe, dans l’édition nouvelle publiée en 1991 chez Droz par Deloffre et Cormier ; j’avais lu et annoté cette œuvre il y a longtemps, puis je l’avais totalement oubliée. Et au bout de quelques pages, sans doute à cause de l’enchantement que procure le rythme de ces phrases dont la syntaxe cherche à coller à chaque instant soit au sentiment, soit à l’action, il m’a semblé n’en avoir quitté que d’hier la lecture.
En revenant à moi après une petite heure passée dans ces pages, je me suis interrogé en silence sur la magie de cette langue française qui venait de m’unir aussi intimement à cet auteur dont rien d’autre ne reste sur Terre, que ses mots. Considérant l’état actuel du pays, la vacuité de la vie politique et éditoriale, la précarité de la pensée, la nullité des arts et des modes, la grossièreté et l’irréligiosité des hommes et des femmes, la fatuité de tout un chacun, je me suis demandé ce qu’un homme du XVIIème siècle comme lui trouverait à revenir parmi nous aujourd’hui : et je me suis dit qu’il ne trouverait sans doute rien, ni honneur ni prestige ni beauté.
Mais qu’au contraire ce que quelqu’un du XXIe siècle comme moi trouvait à revenir en sa langue demeure d’une saveur irremplaçable, inégalée. C’est le français à la fois populaire et savant, dont la syntaxe à peine détachée du tronc latin ramasse à pleine propositions les mots de la rue. Pas un seul terme technique ni administratif. Pas la moindre abstraction, du moins grossière et vaniteuse comme celles dont nous nous gargarisons à présent. Ce sentiment de légèreté n’est sensible qu’au fil de la lecture, grâce à l’oubli progressif de l’immondice linguistique dans lequel la contemporanéité plonge notre esprit.
Et en même temps qu’elle est oxygène par sa pureté, je me disais que cette langue perdue est aussi squelette par son maintien : le maintien, c'est-à-dire l’appui ferme et constant sur la consonne et la voyelle fermée, c’est évidemment ce qui manque le plus au français d’aujourd’hui, imprécis, pauvre et confus à force de s’être disloqué au contact de la presse, de l'audiovisuel et de la traduction. Les gens de cette époque, dont la raison était frottée dès leur plus jeune âge à la langue du droit comme à celle des Écritures, allaient sans grand mal d’un autre train, tout cela est certain.
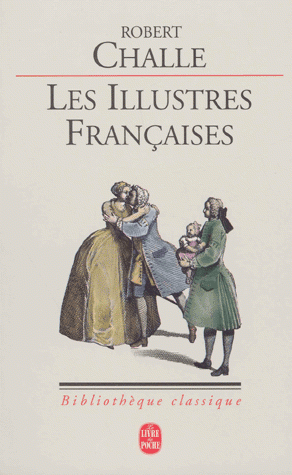
00:02 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : illustres françaises, robert challe, littérature, france, culture, romans | 
dimanche, 27 octobre 2013
Я ЕСТЬ -JE SUIS -
Je suis installe sur le plateau des Célestins l’histoire d’une ville, Komsomolsk-sur-Amour, dont la légende raconte qu’elle a été construite par une jeunesse communiste enthousiaste alors qu’elle est l’œuvre d’abord des déportés au goulag puis celle des prisonniers de la seconde guerre mondiale. Ce secret des origines, à force d’être tu, est tombé dans un oubli soigneusement entretenu par les officiels, mais tout aussi soigneusement conservé par la mémoire familiale de ses habitants. De cet oubli, Tatiana Frolova extirpe la parole de ses personnages qui développent les uns après les autres le fil de leur histoire, remontant au pire jusqu’aux grands-parents, au mieux jusqu’aux arrière grands-parents : après ou plus loin, on ne sait rien, on ne sait plus. C’est encore l’oubli.
Mais ce que l’on comprend très vite, c’est que le grand mystificateur qui a orchestré jadis cette rupture est le même que celui qui aujourd’hui alimente encore cet oubli : l’Etat. Pour faire face (ou front), à ce dernier, il n’est que l’être de chaque individu qui vient se dire tour à tour dans une nudité de parole quasi artisanale (documentaire), d’où ce titre, « Je suis ».
« L’histoire de la ville de Komsomolsk-sur-Amour, patrie du Teatr KnAM, est symptomatique de la façon dont la mémoire collective se cultive à partir d’une histoire passée sous silence, dont on ne donne qu’une image positive.» explique Tatiana Frolova. «Staline était un criminel mais sa tombe demeure dans la nécropole de la Place Rouge et, chaque année, les victimes du culte de la personnalité viennent honorer sa mémoire, accompagnés de très jeunes gens »
De Staline à Poutine, le fil conducteur est ainsi l’entretien politicien du mythe au cœur même de ce qui, par ailleurs, le dénonce : c’est la force inouïe de la propagande de parvenir à faire oublier ce paradoxe. Et c’est le pouvoir de l’image (la représentation) de rendre possible la propagande. C’est là que le propos du spectacle croise une réflexion qu’on pourrait dire universelle sur (bien au-delà du cas russe) ce media qui rend partout possible toute dictature, dès lors qu’il est mis au service de l’oubli : l’image elle-même.

La première image sur laquelle travaille Frolova est ce fameux quatrième mur placé, depuis Diderot, au cœur même de la représentation théâtrale. Elle l’investit durant toute la durée du spectacle en y projetant paroles, photos, dessins d’enfants, prières, manifestes, témoignages, ombres chinoises, et parfois même le reflet du public en train de le (se) regarder. Mais en même temps qu’elle l’utilise à la manière d’un écran de cinéma, elle en maintient aussi l’artifice puisqu’à travers lui on continue de voir les acteurs, tantôt occupés à jouer une scène, tantôt à manipuler ou dessiner sur une table de verre ce qui est projeté sur l’écran, dans un dispositif parfaitement brechtien de distanciation : le spectacle dénonce ainsi l’image en train de se faire. Après avoir ainsi occupé et maintenu simultanément le quatrième mur, Frolova le perce de façon fort efficace pour prendre à parti parfois le public, en questionnant frontalement : « qui répondra de tous ces crimes ? », ou, mieux encore, en affirmant que personne parmi ceux qui regardent le spectacle n’aurait eu la force de supporter la pression terrifiante du KGB.
De chaque côté de ce quatrième mur, Tatiana Frolova expose les images quasiment fixes de deux visages, à l’intérieur de deux écrans, qui soulignent la prééminence de la technologie moderne, principale vecteur d’images. Côté cour, celui d’un vieillard (Bernard Noël), côté jardin, celui d’un enfant. Façon de nous rappeler, la prééminence de l’outil de propagande dans la vie personnelle, voire intime, de chacun d’entre nous, de sa naissance à sa mort. Comme Kantor parlait « d’objet pauvre », on aurait envie devant ce que Forlova appelle un « théâtre documentaire » de parler alors d’image pauvre. Car ainsi exposées ces images finissent par acquérir un statut particulier dans la représentation : arrachées à la réalité non plus de la vie, mais du spectacle, elles témoignent, à leur façon, du mal qu'elles font.
Tout comme l’objet dans l’esthétique de Kantor, elles disent le rapport au monde, à la fois pauvre et dérisoire, de chaque personnage ; elle dénoncent aussi le véritable oppresseur, ce processus que Debord nomma la séparation, et qui est ici au cœur même de la mise en scène. Une étrange harmonie s’installe peu à peu entre les trois acteurs et les images d’eux-mêmes, comme si leur parole et leur effort de mémoire ne pouvaient s’extirper pleinement de l’oubli produit par leur représentation simultanée.
Ce questionnement sur l’image trouve par ailleurs sa forme au fur et à mesure qu’on avance dans le spectacle et que se crée sur scène un univers poétique spécifique : les bandes de gaze servant à effacer les traces de feutres rouges, assimilées à des pansements ensanglantés, par exemple. Ou bien les semelles-couche-culottes usitées, et les chapkas enturbannées, dans une leçon pleine d’humour pour survivre emmitouflé dans le grand froid.
Puis il devient pleinement critique, lorsque le spectacle suggère l’idée très significative qu’il y aurait un lien entre la maladie d’Alzheimer et la transformation du temps individuel autrefois vécu en histoire collective désormais établie en images. « Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation », disait Debord. Tatiana Forlova rajoute qu’Alzheimer, pourrait être le fruit de cette séparation. Et c’est alors que son spectacle trouve son véritable centre de gravité et sa pleine originalité,: « La première personne qui est venue voir Alzheimer lui a dit : je me suis perdue moi-même. », nous rappelle-t-elle. C’est pourquoi, dans la logique démente du système qui nous gouverne, soigner l’Alzheimer, ce ne peut être que le propager plus encore, jusqu’à une sorte de macabre solution finale, parodie de retour à la civilisation : dressage des vieux malades comme celui des enfants avec imposition d’une autorité, privation de la liberté, fixation d’habitudes, bref, perpétuation de la même dictature … A cet instant, le théâtre de Forlova marmonne, dans le sens noble du terme que le texte lui-même confère à ce mot, le théâtre de Kantor.
Une citation (lue par l’enfant) du livre de Bernard Noël, Le livre de l’oubli, clôt le spectacle : « Depuis l’invention des medias et leur emploi généralisé, il ne s’agit plus d’orienter l’espace mental, mais de l’occuper et de le vider de tout autre contenu que celui des spectacles qu’on y projette. Rien ne fut jamais aussi efficace pour soumettre les têtes que ce décervelage qui remplace pensée et imagination par le flux des images. L’oubli n’y peut rien, et il est temps de se demander s’il n’est plus lui-même devenu l’instrument de cette privation de sens »
Ce n’est pas le moindre mérite de cet insolite théâtre-documentaire de Tatiana Forlova (ni sa moindre prouesse) que de donner à cette privation de sens une signification à la fois philosophique et esthétique, tout en serrant au plus près l'expérience vécue et racontée des personnages que nous sommes.

Tatiana Frolova - photo Kirill Khanenkov
Я ЕСТЬ -JE SUIS - Cie : Teatr KnaM - Coproduction -Festival Sens Interdits - les Célestins, Théâtre de Lyon , Théâtre de Poche - Genève , Scène nationale André Malraux, Vandoeuvre-lès-Nancy Mise en scène de Tatiana Frolova, avec Elena Bessonova, Dmitry Bocharov, Vladimir Dmitriev, spectacle en russe surtitré Au théâtre des Célestins de Lyon, du 26 octobre au 30 octobre et du 5 au 9 novembre 2013
10:55 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Я ЕСТЬ, je suis, tatiana frolova, théâtre, lyon, célestins, teatr knam, komsomolsk-sur-amour, spectacle, oubli, bernard noël, propagande, staline, russie, poutine, goulag, kantor | 
jeudi, 24 octobre 2013
La grève des milliardaires et le courroux du philosophe
 Les footballeurs devraient s’entourer de quelques conseillers en communication. Déjà, parler de grève dans une profession dont le revenu moyen mensuel s’élève à 50 000 euros a quelque chose d’obscène. Cela fait penser à la sortie d’Evra, pourtant reconduit en sélection nationale par le comique Deschamps, traitant de clochards Courbis et autres consultants presse. Mais pousser le vice jusqu'à la faire pour de bon, je crois que c'est suicidaire.
Les footballeurs devraient s’entourer de quelques conseillers en communication. Déjà, parler de grève dans une profession dont le revenu moyen mensuel s’élève à 50 000 euros a quelque chose d’obscène. Cela fait penser à la sortie d’Evra, pourtant reconduit en sélection nationale par le comique Deschamps, traitant de clochards Courbis et autres consultants presse. Mais pousser le vice jusqu'à la faire pour de bon, je crois que c'est suicidaire.
J’étais, je m’en souviens, en Avignon en juillet 98. Nous jouions mon adaptation du Moine de Lewis et je planais bien dans ma bulle. Pour une affaire de comédienne ayant eu un nez cassé, nous avons eu vent de ce qui se passait aux urgences de l’hôpital cette nuit là de coupe du monde, et qui était proprement terrifiant. Le carnaval de la culture foot, c'est à dire du foot érigé en culture débutait dans ce malheureux pays, récupéré par un pouvoir politique qui avait à vendre du black blanc beur, pure ineptie en lieu et place du bleu blanc rouge. Je me souviens qu’à l’époque, j’avais trouvé le slogan inepte sans plus m’y arrêter. Subtil subterfuge par lequel la race prenait la place de la classe dans la mythologie politique post-moderne. Là-dessus la zone Europe avec ses états historiques privés de leur souveraineté monétaire. Là-dessus la crise orchestrée par le monde de la finance internationale, la mondialisation, les délocalisations Là-dessus les peurs galopantes et sans doute légitimes sur le sort de cette humanité à 7 milliards d’epsilons complètement dépendants en général et sur le sien en particulier.
Dans le Monde de ce soir,:Jean Birnbaum accuse Finkielkraut de lepénisme pour avoir écrit L’identité malheureuse. Je ne l’ai pas lu, je ne le lirai pas, mais je salue au passage le courage de Birnbaum ! quel vaillant acte de résistance vraiment, petit gars planqué au Monde des Livres ! On peut suivre encore aujourd'hui sur France 2 la video du passage de Finkielkraut chez Taddei dans Ce soir ou jamais . On a le droit d’être ou non d’accord avec lui, mais le traiter de lepéniste comme le fait le petit journaleux du Monde, c’est simplement dégueulasse. A moins que ce ne soit la mode, de se faire Finkielkraut entre la poire et le fromage. Finkielkraut a, comme Zemmour, la chance d'être juif, ce qui fait qu'on n'ira tout de même pas le traiter de fasciste parce qu'il tient le stand de la francité (quel mot!) dans la foire d'empoigne actuelle. Mais on sent que ça démange certains de ces plumeux,
J'avais rencontré Finkielkraut lors du conflit contre Allègre et son programme contre l'école - qui entre temps a été adopté et sur-adopté, même. Et il m'avait dit : ça va être très difficile de ne pas finir fou dans le monde qu'ils nous préparent. Nous avions parlé de l'école, de l'OCDE, des positions sur le sujet de Régis Debray, de Danièle Sallenave. J'ai une vraie sympathie pour cet homme-là qui croit encore à la complexité du monde et des idées. Une autre fois, je l'ai croisé dans le Luxembourg. Il marchait la tête en avant, les mains dans le dos, l'une tenant l'autre, comme si on l'attendait encore au Procope. Mais il s'est arrêté à la brasserie du Luxembourg, où il a pris le thé avec une vieille dame.
On peut juger les gens à l'emporte-pièce, certes. On peut coller aux idéologies et aux préjugés de son temps. Je préfère m'appuyer sur les hasards des rencontres et ce que j'apprends des faits. La vie, la vraie, son tissu qui donne sens et fait mémoire est là. Et pour passer du coq à l'âne, mais toujours dans la rubrique des faits, en feuilletant un prospectus pour des bouquets de chaines TV l'autre jour,je m'étonnais, moi théâtreux exalté de 1998 égaré avec ma troupe au milieu de klaxons hystériques, je déplorais même qu'il y ait des bouquets cinéma, des bouquets variétés, des bouquets sports, des bouquets cul, des bouquets séries tv, des bouquets nature et découverte, et même des bouquets histoire du monde ou musique classique, mais pas, mais rien, rien du tout sur la littérature ou le théâtre. Pourtant, et même en restant dans du mainstream pur jus, entre toutes les archives de l'INA, les retransmissions télé, les émissions pseudo littéraires à la Pivot et consorts, les documentaires et les archives de tous les théâtres, il y aurait de quoi faire au moins une seule chaîne. Mais rien, nada. Béraud, qui ne manquait pas d'humour, écrivit un jour que le meilleur moment du théatre, c'est quand on rentre à pied chez soi. Il a écrit un livre très drôle sur le sujet, dans lequel il consigne ses critiques théâtrales, et qu'il a appelé Retours à pieds. J'espère avoir le temps d'en parler ici un jour. Mais Dieu, que le temps passe vite.
En guise de consolation, j'ai trouvé ce portrait de Dullin en Avare que je trouve à la fois élégant et nostalgique. Les deux, dans le meilleur sens du terme. Je clonclus donc ce billet pas décousu du tout avec lui.
21:30 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : dullin, béraud, théâtre, jean birnbam, le monde, finkielkraut, ligue1, grève de footballeurs, zlatan, taddei | 
lundi, 21 octobre 2013
Les chiens de garde
Il faut les entendre achever leur carrière de chiens de garde du pouvoir socialiste, en tentant de meubler la vacuité hollandaise d’arguments oiseux d’un plateau télé à un autre, histoire de retravailler en ce moment d’abousement général « la fabrique de consentement » de l’opinion. Peine perdue, à mon sens. Faut dire que le pauvre type qui squatte l’Elysée ne leur facilite pas la tâche, entouré de courtisans qui le méprisent, sifflé publiquement par des militants socialistes marseillais comme il le fut au défilé du Quatorze Juillet,, à la recherche d’une synthèse entre des motions et des courants dont le contribuable canardé de tous côtés se fiche pas mal. Ne parlons pas des licenciés de l’industrie ou des suicidés de la paysannerie. Ni des millions de provinciaux de la manif pour tous qui voient le pingouin qui les méprisa si ouvertement faire la courbette si piteusement devant une poignée de lycéens.
Dix-huit mois que dure ce carnaval, prévisible ô combien !
Pas drôle, en réalité. Ca fait vivre des députés, des conseillers généraux, des ministres, des secrétaires de ceci, de cela, des chiens de garde, encore eux. Ils aboient à l’entrée du portail et vérifient la tenue de chaque prétendant à la Cour. Il y a encore des gens pour lire leurs torchons, dont les rédacteurs squattent toutes les écoles de journalisme. Il faut les voir sortir les dents pour dire que « il faudrait faire ça, bien sûr, mais ça, ce n’est possible que dans le cadre européen », ah, le cadre européen ! voilà leur vrai maître. L’affaire de leur piteuse génération. Hollande n’est au fond qu’un de leur collègue, un scribouillardeux du même âge qu’eux, sans talent. Ce qu’ils craignent tous, c’est que les peuples envoient trop de députés anti-européens au Parlement de « là-haut », comme ils disent. Après un référendum volé, une multitude de magouilles effectuées dans leur dos, les naufrages grec, espagnol, italien, et bientôt français, et malgré la fin de l'histoire programmée par leurs logiciels espionnés par la NSA, les peuples étant les peuples, ça risque de ne pas être triste. Mais déjà ils ont dû, tous les chiens de garde, se prévoir d'autres niches au soleil.


Claude Weill, Roland Cayrol, deux aboyeurs parmi d'autres
20:47 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (30) | Tags : opinion, chomsky, nsa, chiens de garde, roland cayrol, claude weill, france, europe | 
dimanche, 20 octobre 2013
Léonarda di capria
De quoi s’inquiète-t-on pour Léonarda ? L’Etat socialiste vient de lui faire un cadeau en or. Je suis sûr que deux ou trois éditeurs songent déjà au bouquin à la fois plein de sirop et d’indignation qu’elle devrait être capable, avec peut-être un léger coup de main je vous l’accorde, de tirer de ses aventures médiatico-politiciennes.
Parce que c’est plus une enfant, Léonarda. Vous l’avez entendu comme moi lancer « Point barre » à ce couillon de Hollande ? Grâce au pingouin et à sa bande d’incapables, elle a touché le gros lot, Léonarda. Plus besoin de se taper un bac-pro ou un BTS laborieux dans les classes surchargées de la défunte République, tout ça pour finir derrière la caisse d’un Leader Price ou en emploi-jeune dans un collège pourri de Peillon : le plateau de Ruquier l’attend déjà avec le récit de ses exploits, ainsi qu"un public de manifestants boutonneux, dont elle deviendra sans grande difficulté la Madonna kosovare si elle est bien coachée. Toute cette jeunesse militante sera tout prêt à acheter ses livres et ses albums à venir. Et ses nombreux frères et sœurs comme jadis ceux de Mireille Mathieu n'auront pas de souci à se faire pour leur survie C’est ce qui s’appelle de l’intégration à l'Europe libérale et citoyenne, non ?
Vous trouvez mes propos cyniques ? Mais le cynisme rugit dans cette société du spectacle qu'il gangrène. Devant sa duplicité sans bornes, toute décence parait pour jamais abolie.

10:59 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : leonarda, politique, show-business, ruquier, spectacle | 
samedi, 19 octobre 2013
Poïpoïgrotte et autres arts montables
Les Grecs ne connaissaient que deux procédés de reproduction mécanisée de l’œuvre d’art : le moulage et la frappe. Les bronzes, les terracottes et les médailles étaient les seules œuvres d’art qu’ils pussent produire en série. Tout le reste restait unique et techniquement irreproductible. Aussi ces œuvres devaient-elles être faites pour l’éternité. Les Grecs se voyaient contraints, de par la situation même de leur technique, de créer un art de valeurs éternelles. C’est à cette circonstance qu’est due leur position exclusive dans l’histoire de l’art, qui devait servir aux générations suivantes de point de repère. Nul doute que la nôtre ne soit aux antipodes des Grecs.
Jamais auparavant les œuvres d’art ne furent à un tel degré mécaniquement reproductibles. Le film offre l’exemple d’une forme d’art dont le caractère est pour la première fois intégralement déterminé par sa reproductibilité. Il serait oiseux de comparer les particularités de cette forme à celles de l’art grec. Sur un point cependant, cette comparaison est instructive. Par le film est devenue décisive une qualité que les Grecs n’eussent sans doute admise qu’en dernier lieu ou comme la plus négligeable de l’art : la perfectibilité de l’œuvre d’art. Un film achevé n’est rien moins qu’une création d’un seul jet ; il se compose d’une succession d’images parmi lesquelles le monteur fait son choix - images qui de la première à la dernière prise de vue avaient été à volonté retouchables. Pour monter son Opinion publique, film de 3 000 mètres, Chaplin en tourne 125 000. Le film est donc l’œuvre d’art la plus perfectible, et cette perfectibilité procède directement de son renoncement radical à toute valeur d’éternité. Ce qui ressort de la contre-épreuve : les Grecs, dont l’art était astreint à la production de valeurs éternelles, avaient placé au sommet de la hiérarchie des arts la forme d’art la moins susceptible de perfectibilité, la sculpture, dont les productions sont littéralement tout d’une pièce. La décadence de la sculpture à l’époque des œuvres d’art montables apparaît comme inévitable.
Walter Benjamin, L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique,1935

Poïpoïgrotte, à Grigny
20:22 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grigny, poïpoïgrotte, art contempôrain, lyon, walter benjamin | 
mercredi, 16 octobre 2013
Langage, qui le possède
Es-tu bien sûr que ta gorge s’emplit de tes propres mots
Quand vous dévalâtes le chemin vers l’eau sans taches
Et que tu lui déclaras ta flamme ?
« Je ne veux pas de mots inventés par quelqu’un d’autre », disait Hugo Ball
Orgueil, déraison, sagesse ?
Peut-être eut il mieux valu, tel l’évêque magique de Zurich,
Lui dire ; jolifanto bambla o falli bamblagrosβiga m’pfa habla horem
Qui sait ? Le quiproquo eût peut-être été moindre
En biaisant l’arbitraire du signe aussi fauvement..
Mais tu lui dis je t’aime, simplement je t’aime
Comme tu avais vu faire, entendu dire, senti en toi
Le mot et tant pis si, en s'imprégnant du temps,
Il déroula sous tes pas le tapis de la mort,
Langage, qui le possède ?
22:34 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : hugo ball, dada, littérature, poésie | 
mardi, 15 octobre 2013
Tristes urgences
Des centaines de malades attendant parfois jusqu'à 24 heures pour disposer d'un lit en service d'urgences, des médecins transformés en hôteliers et perdant leur temps à téléphoner aux quatre coins des villes pour placer leurs malades : Tandis que le racket banco-fiscal se poursuit à chaque étage de l’impôt, tandis que les Hotel Dieu, fermés l'un après l'autre, se métamorphosent en hôtels de luxe pour noceurs milliardaires, tandis que Marc Zuckenberg achète tout un quartier pour être en paix chez lui (lire ICI), l'hôpital français se délite dans l’indifférence, si j'ose ce jeu de mots douteux. Et la priorité de l'Etat semble ailleurs. On se demande où.

13:18 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : hôpital, urgences, france, politique | 
lundi, 14 octobre 2013
La République comme sujet et comme représentation
Dans la société séparée du Spectacle, telle que l’a théorisée Debord, il n’y a pas ce qui est advenu et ce qui va advenir, mais une constante interaction langagière entre les deux qui permet de maintenir les spectateurs en haleine en énonçant sans cesse les mêmes slogans pour mystifier le Réel et surtout les abuser, eux. Changer et Sauver, pour faire court, sont les deux procès événementiels sans cesse invoqués par les officines de propagande, à quoi il faudrait rajouter leurs doublets sémantiques reformer et refondre. Mais rien n’est jamais advenu et rien n’adviendra jamais d’autre, que des informations éparses reliant entre eux des gens à l’imaginaire de plus en plus pauvre, de plus en plus séparés et d’eux-mêmes et les uns des autres au fur et à mesure que la société s’européise et se mondailise, et que les profiteurs du Spectacle établissent leurs dynasties
Dans la réalité réellement vécue, pour parler comme Debord, dans et derrière l’écran de fumée du Spectacle, des gens, qui sont nous, cependant, passent. Les enfants affamés de Bangui prennent l’écran des enfants affamés du Biafra ; les naufragés de Lampedusa celui des boat people vietnamiens, et Nicolas Bedos le siège de Guy, et Alice Munro le prix de Camus. Ce qui est vrai des acteurs volontaires ou non des images que nous voyons l’est aussi des spectateurs qui les regardent. Nous passons.
Les sexagénaires d’aujourd’hui s’installent ainsi dans les murs de ceux qui avaient soixante ans il y a dix ans, il y a vingt ans, il y a trente ans et cinquante ans. Les sexagénaires d’aujourd’hui ont pris la place des sexagénaires du temps qu’ils avaient dix ans. Pour les rassurer, on leur laisse croire que le rôle a un peu changé, que Catherine Deneuve est plus jeune à soixante dix ans que ne l’était Marlène Dietrich au même âge. L’une a pris l’affiche de l’autre et rien d’autre n’adviendra de plus, sinon que l’une est morte et l’autre va mourir. Et pendant ce temps le jeune homme d’aujourd’hui a pris la place du jeune homme d’hier. Il prendra la place des sexagénaires qui s’en iront et s’en ira à son tour.
Depuis quand dure cette histoire sans fin ? Quand finira-t-elle ? La perspicacité de Debord rejoint la sagesse de Chateaubriand voyant embarquer à Cherbourg son vieux roi qui partait pour l’exil :
« Maintenant, qu'était devenu Charles X ? Il cheminait vers son exil, accompagné de ses gardes du corps, surveillé par ses trois commissaires traversant la France sans exciter même la curiosité des paysans qui labouraient leurs sillons sur le bord du grand chemin. Dans deux ou trois petites villes, des mouvements hostiles se manifestèrent ; dans quelques autres, des bourgeois et des femmes donnèrent des signes de pitié. Il faut se souvenir que Bonaparte ne fit pas plus de bruit en se rendant de Fontainebleau à Toulon, que la France ne s'émut pas davantage, et que le gagneur de tant de batailles faillit d'être massacré à Orgon. Dans ce pays fatigué, les plus grands événements ne sont plus que des drames joués pour notre divertissement : ils occupent le spectateur tant que la toile est levée, et, lorsque le rideau tombe, ils ne laissent qu'un vain souvenir. »
cliquez sur l'image pour l'agrandir
Lorsque Debord conçut Le prolétariat comme sujet et comme représentation, il ne fit jamais que reprendre ce que Chateaubriand avait fait de la monarchie elle-même, comme sujet et comme représentation, dans ces pages remarquables de ses Mémoires :
« Parfois Charles X et sa famille s'arrêtaient dans de méchantes stations de rouliers pour prendre un repas sur le bout d'une table sale où des charretiers avaient dîné avant lui. Henri V et sa soeur s'amusaient dans la cour avec les poulets et les pigeons de l'auberge. Je l'avais dit : la monarchie s'en allait, et l'on se mettait à la fenêtre pour la voir passer.
Le ciel en ce moment se plut à insulter le parti vainqueur et le parti vaincu. Tandis que l'on soutenait que la France entière avait été indignée des ordonnances, il arriva au roi Philippe des adresses de la province, envoyées au roi Charles X pour féliciter celui-ci sur les mesures salutaires qu’il avait prises et qui sauvaient la monarchie .
Dans cette insouciance du pays pour Charles X, il y a autre chose que de la lassitude : il y faut reconnaître le progrès de l'idée démocratique et de l'assimilation des rangs. A une époque antérieure, la chute d'un roi de France eût été un événement énorme ; le temps a descendu le monarque de la hauteur où il était placé, il l'a rapproché de nous, il a diminué l'espace qui le séparait des classes populaires. Si l'on était peu surpris de rencontrer le fils de saint Louis sur le grand chemin comme tout le monde, ce n'était point par un esprit de haine ou de système, c'était tout simplement par ce sentiment du niveau social, qui a pénétré les esprits et qui agit sur les masses sans qu'elles s'en doutent. »
La morale de l'histoire est qu'un régime est mort dès lors qu'il existe à la fois comme sujet et comme représentation. Bien triste. Heureusement, tant qu'un homme peut exister comme sujet différent de sa représentation, il est encore vivant. Nous savons donc ce qui nous reste à faire, quoi qu'il advienne.
05:52 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : chateaubriand, guy debord, monarchie, république, prolétariat, spectacle, france, politique, littérature, théâtre, lampedusa, alice munro, europe | 










