jeudi, 11 mars 2010
Le parti des abstentionnistes
C’est ce que les partis ont trouvé de plus filou pour enrôler les abstentionnistes dans leur univers frelaté : cette expression ridicule, fausse et tordue : le parti des abstentionnistes. Je ne sais quel communicant véreux en profondeur a créé l’expression : un de gauche, un de droite ? un petit copain du centre ? Je ne me souviens pas, non plus, depuis quand on la répand à profusion dans les medias pour forcer la main de l’électeur. Voter étant, de ce point de vue, la seule attitude normale, civique, responsable, celui qui ne l’adopte pas n’est donc récupérable qu’au prix de cette contorsion sémantique absurde : lui aussi serait membre d’un parti, lui aussi aurait une opinion enrolable, il serait membre du parti des abstentionnistes. Les fumiers !
 Cela s'inscrit dans le paradigme d’une idéologie puante (comme beaucoup d’autres, venue des USA), le comportementalisme. De la même façon que vous seriez fumeur ou non fumeur, vous vous retrouvez ainsi votant ou non-votant ; ces gens-là, souvent adeptes de l’hygiénisme physique et moral au moins autant que de l’hygiénisme politique, vous expliqueront toujours que vous êtes réductible à ce que vous faites, comme le petit bourgeois est réductible à ce qu’il possède, l'animal à ce qu'il chasse. Pour ma part, j’ai tour à tour fumé et non fumé au moins autant que j’ai voté et non voté, bu et non bu, sans me définir pour autant comme un fumeur ou un non fumeur, un votant ou un abstentionniste, un gars sobre ou un alcoolique.
Cela s'inscrit dans le paradigme d’une idéologie puante (comme beaucoup d’autres, venue des USA), le comportementalisme. De la même façon que vous seriez fumeur ou non fumeur, vous vous retrouvez ainsi votant ou non-votant ; ces gens-là, souvent adeptes de l’hygiénisme physique et moral au moins autant que de l’hygiénisme politique, vous expliqueront toujours que vous êtes réductible à ce que vous faites, comme le petit bourgeois est réductible à ce qu’il possède, l'animal à ce qu'il chasse. Pour ma part, j’ai tour à tour fumé et non fumé au moins autant que j’ai voté et non voté, bu et non bu, sans me définir pour autant comme un fumeur ou un non fumeur, un votant ou un abstentionniste, un gars sobre ou un alcoolique.
Abstenir : du latin abtinere, tenir éloigné. S’abstenir : se tenir éloigné…
Une attitude unanimement réprouvée, tant le vote est devenu, jusque dans les aspects les plus futiles de la société du spectacle, à la fois un jeu et une mise en scène de soi ; il n’est qu’à compter le nombre de fois où l’on sollicite, ici et là, de jeux stupides en sondages inutiles, votre implication, participation, point de vue, solidarité – appelons ça comme on veut – à l’édifice prétendument commun…
Je n’irai pas voter dimanche parce qu’au final les deux partis qui se retrouvent au second tour mènent sur le fond la même politique depuis des décennies. Ces deux partis n'ont-ils pas tous deux été créés, d'ailleurs, pour être, à toutes les strates de la participation citoyenne, de gigantesques et efficaces usines électorales ? Et qu’au premier tour les listes prétendument dissidentes, d’un bord comme de l’autre, ne font, in fine, que servir la soupe aux deux autres. Servir le nombre. On se compte.
Je n’irai pas voter parce que je n’ai aucun intérêt à voir au pouvoir untel plutôt qu’untel.
Aucun intérêt particulier non plus à faire partie du nombre. Je n’irai pas voter parce que je ne suis membre d’aucun parti, et surtout pas de celui des abstentionnistes.
Ne pas donner sa voix, pour sauver sa parole.
07:06 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (46) | Tags : régionales, politique, société, ps, ump, regionales | 
mercredi, 10 mars 2010
Pour saluer Paul Virilio
« La nature de l’échange change, aussi bien dans sa dimension interpersonnelle que dans celles des moyens de diffusion de masse. L’informatique (au sens de stockage instantané des divers types d’informations) a fondamentalement modifié la signification de l’information. Aucune, désormais, ne peut être neutre ou sans valeur dans une époque systémique où le fragment prend son sens de l’ensemble. Puisque la nouvelle la plus banale est indispensable à la perfection structurale du système, il faudra désormais exploiter la banalité comme on exploitait l’originalité, l’exceptionnel, le bizarre… Nous serons donc inévitablement épiés, testés, écoutés, soupesés, reniflés, sondés… et ce sera moins notre personnalité qui intéressera l’interlocuteur que le détail sans importance que nous lui apporterons, fragment qui en prenant place dans l’ensemble systémique, le complètera comme un puzzle, un puzzle jamais terminé d’ailleurs. Un peu comme ce collectionneur qui possède toutes les pièces d’une collection à l’exception d’une seule, et ressent ce manque comme une imperfection, l’Etat recherchera auprès de nous avec une fébrilité toujours plus grande la pièce manquante que nous pourrions lui refuser, sans même le savoir le plus souvent. Voilà la dernière conversation, la vérité n’est plus qu’un piège. Comme l’excès modifie le sens des actions, celui de l’Etat moderne pervertit la vérité des rapports sociaux. L’excès est désormais dans les gestes les plus ordinaires, dans la quotidienneté le plus simple, il nous faut maintenant nous méfier de ce qui n’était rien. En période d’outrance, d’excès généralisé et totalisé, il n’y a plus de vices ou de vertus, tout est foncièrement vicié, la disparition même de la guerre comme de la paix au profit de la crise est bien significative, ici, d’un bouleversement dans le statut social. »
Paul Virilio. La délation de masse, U.G.E. 10/18 cause commune, n° 1, 1975, p 38-40
Ces lignes furent écrites en 1975... Il y a quelque chose de la lucidité de cet homme avec quoi je me sens en réelle empathie. Autre chose devant lequel j'éprouve une certaine réserve. Comme si cet optimisme qu'il évoque à la fin de cette video ne me paraissait que rhétorique. Mais qu'importe. Pour saluer Paul Virilio, 9 minutes et quelques d’intelligence avec lui, évoquant « l’université du désastre » :
Interview de Paul Virilio
envoyé par obole_le_nain_malin. Enregistrement de janvier 2009
20:06 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : paul virilio, l'université du désastre, société, philosophie | 
mardi, 23 février 2010
Les transformations de l'homme
La première vertu de ce livre au sujet austère, c’est son aspect narratif. « Son œuvre entière est traversée par une immense sollicitude envers les réalités vivantes. » disait Jacques Dufresne de Lewis Mumford (1895-1990). Avec justesse. Et raison : Mumford est un conteur né et cela transparait dans ses livres qui pourtant ne sont pas des récits. Je viens d’achever « Les transformations de l’homme » (lequel date de 1956), dans une nouvelle traduction de Bernard Pécheur, que l’excellente maison l’Encyclopédie des Nuisances a éditée en 2008.
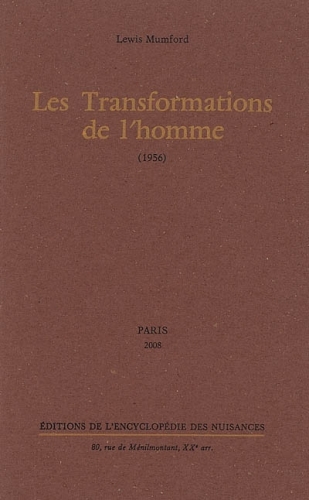 Le titre The transformations of man, donne déjà le ton. Lewis Mumford, contrairement aux progressistes béats applaudissant à tout rompre toute innovation technologique rompt avec ce terme imbécile d’évolution, qui postule implicitement l’idée d’une transformation forcément positive. Car s’il est vrai qu’il est des transformations aux effets positifs, il en est de nombreuses aux effets négatifs : Mumford est l’un des pionniers de la critique moderne du machinisme industrielle et de la société technique, et pour sûr des gens comme Marcuse ou Ellul l’ont lu avec attention.
Le titre The transformations of man, donne déjà le ton. Lewis Mumford, contrairement aux progressistes béats applaudissant à tout rompre toute innovation technologique rompt avec ce terme imbécile d’évolution, qui postule implicitement l’idée d’une transformation forcément positive. Car s’il est vrai qu’il est des transformations aux effets positifs, il en est de nombreuses aux effets négatifs : Mumford est l’un des pionniers de la critique moderne du machinisme industrielle et de la société technique, et pour sûr des gens comme Marcuse ou Ellul l’ont lu avec attention.
Tout exposé d’ensemble du développement humain court bien sûr le risque de l’extrapolation ou celui de la généralité. L’axe que suit Mumford est cependant rigoureusement posé : au vu de la gouvernance technique du monde, gouvernance assurée de plus en plus par des machines, quelles illusions peut encore se faire le bipède humain sur le sort de sa propre liberté sans être ridicule ?
Dans le développement du monde, Lewis distingue plusieurs périodes. Au vrai, il les « raconte » (j’en reviens à l’art du récit, comme chez la Fontaine) :
Celle de « l’homme archaïque », en compagnie duquel nous restons quelques dizaines de pages. C’est l’occasion d’évoquer aussi bien des cueillettes de Neandertal que les Travaux et les Jours d’Hésiode, occasion de rappeler aussi quelles traces, du bon sauvage rousseauiste au sapiens middle class parti ramasser des champignons en famille, ce lointain souvenir nous a laissé. Avec la naissance des premières civilisations survient la première transformation de l’homme, dont l’effet principal (s’il fallait n’en retenir qu’un seul) par rapport au sujet qui nous intéresse fut la création de « l’homme partiel ».[1] Invention de l’écriture, naissance du politique, apologie et systématisation de l’art de la guerre, règne de l’utilitarisme, chef ou pharaon déifiés, développement du « panem et circenses » et des nombreux anesthésiques dont l’alcool ou la prostitution :
« Au fond, les bienfaits de la civilisation ont été pour une large part acquis et préservés – et là est la contradiction suprême – par l’usage de la contrainte et l’embrigadement méthodique, soutenus par un déchainement de violence. En ce sens, la civilisation n’est qu’un long affront à la dignité humaine ».
Mais la civilisation pousse aussi celui qu’elle met en esclavage au dépassement de soi, elle devient un leurre ou un mal nécessaire à une transformation par lequel l’homme grégaire trouve sécurité et protection et surtout parvient à une émancipation et à une domination collective sans précédent. Nous revisitons rapidement, avec Mumford, les grandes épopées, celle de Gilgamesh, le Mahâbhârata, l’Iliade. Pour à nouveau aboutir à ce cul de sac antique, celui où se trouvait Saint-Augustin lorsqu’il commença La Cité de Dieu.
Avec les religions, les philosophies et les maîtres de la pensée axiale, nous entrons dans un nouveau processus qui tente d’humaniser cet homme civilisé sans cesse menacé d’être reconduit à sa barbarie initiale. Débute alors la première phase des temps modernes, celle qui, contestant les apports purement techniques de la civilisation, fonde, de la Chine à l’Europe en passant par le Proche Orient, ce qu’on pourrait en un mot appeler l’Humanisme du vieux monde. « La civilisation, écrit Mumford, cesse d’être un but pour devenir un moyen ». L’écrivain recense tous les apports des religions axiales (qu’on peut assimiler aux religions monothéistes), la principale étant l’invention de la liberté individuelle qui, jusqu’alors, était le privilège du seul souverain. Il n’oublie pas les inconvénients, le principal étant de n’avoir su éradiquer la guerre et d’avoir échoué à créer un réel universalisme.
Nous arrivons peu à peu à l’homme moderne, soumis à des forces de plus en plus hasardeuses et contraignantes. Nous sommes en 1956 : « Jamais auparavant l’homme n’a été aussi affranchi des contraintes imposées par la nature, mais jamais non plus il n’a été davantage victime des sa propre incapacité à développer dans leurs plénitudes ses traits spécifiquement humain ». Et Mumford étudie la manière dont les mécanismes du pouvoir et de l’ordre, censés libérer l’homme moderne, ont contribué finalement, avec une efficacité redoutable à créer de la désorganisation et de la violence, tant dans la société que dans le cœur des hommes. C’est un homme de soixante et un an qui compose le livre, et qui vient de vivre – et c’est au fond toute l’histoire de sa génération – deux guerres mondiales. Les enjeux de la culture mondiale et les perspectives qu’elle ouvre à ce qu’il appelle l’homme post-historique sont-elles réjouissantes ?
Ce livre, écrit à peu près au moment où je naissais, ne donne, à dire vrai, qu’à moitié envie de naître. Mumford conclut par une réflexion cependant positive, concernant la génération à venir (il se trouve que, c’est la nôtre, au sens large, celle des vivants actuels) : « la génération à venir dispose encore d’une autre possibilité de choix, la plus ancienne pour l’homme : celle de cultiver consciemment les arts qui humanisent l’homme ».
Je n’étais pas loin de penser comme lui à dix-huit ans, lorsque je pris fort naïvement mon sac à dos, en partance pour le monde. J’avais déjà vu les rivières de mon enfance, là où nous péchions goujons et brochets à cœur joie, comme des Neandertal, polluées une à une, j’avais constaté l’inévitable assujettissement de chacun à l’impuissance politique que masque en réalité le grand progrès démocratique auquel avait cru l’homme moderne. Avais-je sincèrement, comme lui, la possibilité de croire « aux arts qui humanisent l’homme » ?
Hmmmm...
Ce billet commence à être bien long.
La suite au prochain numéro.
15:18 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : lewis mumford, littérature, société, politique | 
samedi, 20 février 2010
Générations ?
Le concept – (ou la notion) de génération, tel qu’à partir des « années soixante » les sociologues les plus dévoués à la société du spectacle l’ont institué, m’a toujours mis fort mal à l’aise. Peut-être parce que j’ai passé mon enfance dans une solitude relative, parmi des gens de tous âges, des parents d’avant-guerre, si on peut parler ainsi, et des grands-parents de la Belle Epoque. Et que tout empli de cette solitude qui ne me pesait pas, bien au contraire, j’ai très tôt lu. Je me suis baladé ainsi en esprit parmi des gens de toutes les générations. Sur les pas de certains auteurs, j’ai pu même remonter très loin dans le temps, je l’avoue. Fictivement, me dira-t-on. Et alors ?
J’ai donc très tôt appris à respecter les disparus. Plus même, à ressentir pour eux une sorte de sympathie en regardant les pages, les toiles et les pierres qu’ils avaient laissées. La cohorte des baby-boomers, qui me précédait de peu, la génération Salut des Copains, lorsque mes yeux se sont ouverts sur quelques-uns de ses spécimens, mes yeux ont eu plutôt envie de se refermer qu’autre chose, je dois bien l’avouer. Depuis quelques années, je vois partir à la retraite les gens de cette « génération ». La cohorte tumultueuse laisse peu à peu le champ libre. Sylvie Vartan, et Françoise Hardy sont nées en 1944, Sheila en 1945. Elles étaient, ces trois là, leurs « vedettes » et je ne sais combien d’actuels sexagénaires ont épinglé sur le mur de leurs chambres « d’ados » leurs jolis minois, qui alors n’étaient, ni l’un ni l’autre, refaits. Pour ma part, dès que j’ai eu l’âge d’aller dans des « concerts », j’ai préféré aller écouter ceux de Barbara. Née, elle, en 1930, la génération précédente, la même que Brigitte Bardot (née en 1934) qui accepte superbement aujourd’hui de faire, comme on dit pudiquement, « son âge »… Grâce lui soit pour cela rendue.
Les baby-boomers vont-ils nous manquer ? J’avoue leur avoir toujours préféré soit des gens de mon âge, soit des gens beaucoup plus vieux dont la plupart sont morts à présent, soit des gens bien plus jeunes qu’eux. Les affinités électives plutôt que les regroupements générationnels, donc. J’ai bien eu quelques bons camarades parmi eux. C’est ce nombre, cette culture de masse et cette société de consommation absolue, que les meilleurs d’entre eux ont violemment critiqués, mais qu’ils auront collectivement laissé passer durant les deux septennats d’un président roublard, qui pose problème, si l’on peut dire. Et je m’aperçois en écrivant ceci, que ceux-là de leur génération que j’ai aimés étaient tous des solitaires, très mal à l’aise parmi eux. Comme je le suis, moi. Décidément.
23:14 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (26) | Tags : société, brigitte bardot, sylvie vartan | 
mardi, 16 février 2010
Gueule Noire
Boulets de charbon : Je me souviens que l’expression m’a toujours fasciné lorsqu’enfant, je voyais débarquer cet homme sombre qui, dans un déluge de poussière et un vacarme épouvantable, renversait les uns après les autres ses sacs en toile de jute dans le charbonnier jusqu’à l’emplir totalement de leurs pierres noires et polies. Gueule noire était, certes, le bougnat. Mais une gueule noire de l’aval. En amont, il en était une autre, souterraine, plus affreuse encore selon la légende. Un piocheur de l’abime, disait-on, et pour cette vraie gueule noire, le bourgeois Zola avait été jusqu’à écrire un roman, le roman, disait-on, de la guerre sociale.
Boulets de charbon : je n’avais entendu parler que de ceux des forçats, ceux-là, qui venaient du Nord, étaient pour moi parfaitement étrangers. Plus même. Avec leurs pioches, ils descendaient non seulement dans le fond des sols, mais aussi dans le fond des siècles pour en extraire leur diamant noir.

Gueule noire : voici donc le tirage de ce billet, le seul billet authentiquement du Nord que, dans une France occupée par la botte nazie, on commence à imprimer le 11 septembre 1941. Le peintre Lucien Jonas, qui avait longtemps vécu parmi les mineurs de Lens et les soldats de la guerre de 14-18 rendait hommage à l’un des leurs. La teinte générale du billet est bleu ardoise. Comme le berger des Pyrénées tenait ferme son bâton, celui-ci ne lâche pas le manche de son piolet, de ces mêmes mains noueuses qui ne lâcheront pas non plus le morceau : ils sont, dit le dessin, du même peuple. Oserait-on dire, encore, de celui de Michelet ? Le bonhomme, son casque et son piolet, valaient alors 10 francs.

Au verso, cette jeune paysanne de Lorraine. Elle brandit, elle, son piochon, tandis qu’un enfant blond tente de délacer son corsage. Toujours ce sol qu’il faut gratter, cette terre, pour extraire de son ventre un quelconque avenir. Mais là, le ton est plus vert. Dira-t-on plus féminin ? Comme lui son casque, elle son fichu. Le filigrane rappelle la célèbre tête sculptée du musée d’Orléans.
Le billet du Mineur a circulé jusqu’en juin 1949. Il fallut attendre Voltaire et les nouveaux francs dévalués pour retrouver cette valeur faciale, en 1963, et en nouveaux francs. Le mineur n’avait plus que quelques décennies à vivre pour être à son tour, après le tisseur et comme le paysan, peu à peu démonétisé. En septembre 2009, la commission régionale du Patrimoine et des Sites classait ses fosses, au titre de monument historique.
Reste ce billet, comme ses deux contemporains, le cinq francs Berger et le vingt francs Pécheur, et après le cent francs forgeron de Luc Olivier Merson, le cinq francs Docker et le vingt francs Faucheur de 1914, l’un des rares à vraiment célébrer, si cela peut avoir du sens sur du papier monnaie de la Banque de France, le monde du travail à travers la figure du travailleur.
18:34 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : billets français, lucien jonas, littérature, germinal, société | 
samedi, 13 février 2010
La Logique, royalement
Un drôle de hasard m’avait conduit chez ce bouquiniste ; je cherchais un ouvrage d’Adorno, et je tombe sur La logique de Port Royal. Et ce fut un raccourci saisissant : de la culture de masse et de sa critique, si l’on peut dire, à la culture du solitaire et de sa raison. Et je vis en un éclair la façon dont nous étions passés d’une société où la culture permettait avant tout aux individus de cultiver leur solitude – dans le silence de leurs lectures ou dans celui de leur écriture (ah, la haute image de Racine coiffant tous ces rayonnages, tandis que d’un pas feutré sur le parquet grinçant, d’autres clients vaquaient autour de moi !) - à un monde où la culture, sous la garde de ses sbires diplômés - ne sert plus qu’à socialiser des individus, lesquels n’ont plus (semble-t-il) le moindre goût pour la solitude.
Et je demeurais accroupi, à feuilleter cette édition ancienne de la Logique de ces Messieurs, comme il se disait à l’époque, à badiner avec moi-même devant la construction juste ou fausse de leurs syllogismes d’un autre siècle. J’en oubliai Adorno –ma foi, tant pis ! Le brave et bon Adorno, qui condamna l’Aufklärung pour avoir cru en la valeur émancipatrice de la Raison, sans avoir saisi quel instrument de domination redoutable cette dernière était par ailleurs, dès lors qu'il s'agissait d'asservir, d'aliéner (d'acculturer, somme toute) les populations.
Dehors, le soir tombait. Une odeur de barbe à papa, aussi séduisante par sa vivacité que répugnante par son uniformité, me tarauda sans ménagement la narine. Impossible de le dire (ni comment, ni pourquoi) : en contemplant les vitrines, les passants, leurs habits, leurs regards, il me sembla (une fois de plus) que nous étions jusqu’à la mort victimes de cette culture de la résignation à laquelle je ne peux me résoudre, bien que je sois immergé dedans, et nourri d’elle. Je pressai le pas pour rentrer chez moi.
Rien de tel, alors, que d’exercer son esprit à un vieux syllogisme de nos parfaits logiciens pour s’en extraire, ou s’en donner l’effet, quelques instants.
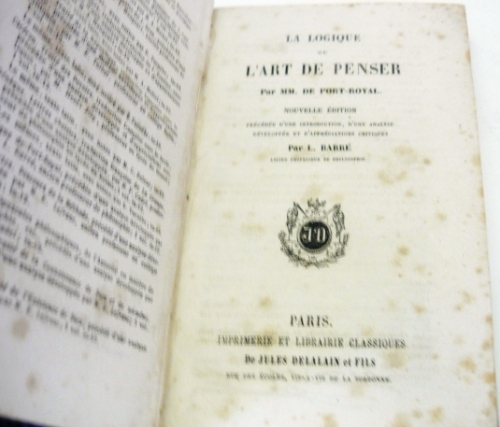
18:55 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : adorno, logique de port-royal, littérature, société | 
vendredi, 12 février 2010
La haine de la littérature
« La haine de la littérature est la chose la mieux partagée au monde » (Flaubert)
Cette phrase est d’une lucidité fascinante, terrible, presque d'acier. S’y lit d’abord une exigence absolue, celle qui anima le styliste hors pair que fut l’écrivain Flaubert dans l’arrachement douloureux et besogneux de son écriture devenue, à force de pratique, force consciente d’elle-même. Et c’est vrai que la haine de l’exigence (je ne parle même plus de l’exigence littéraire) dans une société qui a fait de l’égalitarisme condescendant et démagogique son credo de base et sa seule façon d’éviter la guerre civile, est une des choses le plus communément admise. Jamais la haine de l’exigence ne fut chose aussi partagée que dans la société du tout se vaut mise en place depuis quelques quarante ou cinquante ans.
Ainsi, éditeurs, professeurs de français, animateurs d’ateliers d’écritures, ministres de l’éducation nationale, animateurs de centre social, libraires, académiciens, publicistes, auteurs de bande dessinées, footballeurs, cadres supérieurs, techniciens en informatique ou en sciences de l’éducation, pharmaciens, présidents de la République, critiques littéraires, psychiatres, linguistes, sociologues, journalistes, épiciers, chanteurs de variétés et parents d’élèves - et surtout écrivains ou écrivaines- sont-ils tous, à des degrés divers et pour des raisons diverses, ennemis de l’excellence, et particulièrement de l’excellence littéraire. Parce qu'ils sont amis, et amis souvent fort intimes, de l'imposture littéraire.
Il n’y a que le solitaire, qui se recrute occasionnellement chez l’une ou l’autre des espèces citées plus haut, il ne reste que le solitaire ou la solitaire pour être capable de ne pas rejoindre la cohorte de ceux qu’anime cette haine, parce qu'au sens propre, la littérature l'a aidé d'abord à survivre, et puis peut-être à vivre. Un solitaire aimant des Lettres, vous en trouverez également chez un éditeur, bien sûr, un professeur de français, un animateur d’atelier d’écriture, un ministre d’éducation nationale … Eventuellement (mais de moins en moins) chez un auteur ou une auteure de renom.(1) N’importe lequel d’entre nous peut le devenir, ce solitaire-là avant de retourner à ses occupations mondaines. Occupations mondaines qui feront de lui à nouveau, et peut-être surtout s’il travaille dans le secteur littéraire, le pire ennemi de la littérature. C'est qu'il faut bien, comme le disait le bon Zola, gagner sa vie.
Se lit donc dans la phrase de Flaubert, outre cette lucidité terrible, une conscience à la fois grandiose et désabusée du cœur humain.
Et c'est pourquoi me semble-t-il, cette phrase demeure quelles que soient nos indignations respectives et nos « efforts » pour « lutter contre » la réalité qu’elle pointe du doigt tragiquement vraie. Je vais proférer un lieu commun : L’homme a besoin de reconnaissance. Or, pour aimer la littérature, il a besoin d’être reconnaissant à son égard. Combien d’entre nous le sommes-nous réellement ?
20:40 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : flaubert, littératre, actualité, société, édition | 
lundi, 08 février 2010
Tout bas
J’ai retrouvé dans ma bibliothèque un exemplaire de la Poétique d’Aristote. J’ai pu constater l’autre mois en allant à Paris que la librairie où je l’avais acheté n’existe plus. Le livre est, lui, toujours-là, encore que quelque peu oublié, sur mes rayons : « Collection Poétique », aux éditions du Seuil, 1980. Des lignes, auxquelles je ne faisais pas attention à l’époque se découvrent. A la page 9, par exemple :
« La publication de ce livre a été facilitée par des aides financières de l’Ecole Normale supérieure et de la Compagnie IBM France. Que MM Jean Bousquet et Michel Hervé, directeurs de l’ENS, et M René Moreau, directeur du développement scientifique à la Compagnie IBM, soient ici remerciés de leur généreux appui. »
 Ce n'est qu'alors que je m'aperçois que l’édition est bilingue, ce dont je ne me souvenais pas du tout. Cela fait longtemps que mon regard ne s’était pas posé sur des paragraphes en grec ancien. Je ne saurais dire pourquoi, à cette heure, c’est si reposant. En couverture, le détail d’un bas relief de la cathédrale de Chartres, représentant Aristote. La préface est de Todorov et la traduction de Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot. Le texte et sa traduction occupent très exactement 107 pages (de la page 32 à la page 139). S’y rajoutent 270 pages de notes et une soixantaine d’autres, d’index et de bibliographie.
Ce n'est qu'alors que je m'aperçois que l’édition est bilingue, ce dont je ne me souvenais pas du tout. Cela fait longtemps que mon regard ne s’était pas posé sur des paragraphes en grec ancien. Je ne saurais dire pourquoi, à cette heure, c’est si reposant. En couverture, le détail d’un bas relief de la cathédrale de Chartres, représentant Aristote. La préface est de Todorov et la traduction de Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot. Le texte et sa traduction occupent très exactement 107 pages (de la page 32 à la page 139). S’y rajoutent 270 pages de notes et une soixantaine d’autres, d’index et de bibliographie.
Ce livre, avant de vous le décrire, je l’ai feuilleté en rêvant. Et puis je me suis demandé – juste à titre de curiosité – combien il coûtait à l’époque. J’aurais voulu comparer avec ce qu’il coûterait à présent. Mes yeux se sont machinalement dirigés au bas du quatrième de couverture, là où il se trouve d’habitude. Surpris, je n’ai rien vu.
Et puis je me suis rendu compte à quel point j’avais oublié l’état dans lequel se trouvait le monde dans lequel j’avais grandi. Forcément. Ni l'évolution qu'il a subi. C’est arrivé peu à peu, tout bas. C’était avant la loi sur le prix unique du livre. Bel apologue, finalement, dont je laisse à chacun tirer la morale.
06:31 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : aristote, littérature, la poétique, société, politique | 
vendredi, 05 février 2010
Scandaleux,sordide,fascisant...
Scandaleux, sordide, fascisant…
Que n’ai-je entendu sur le débat suscité par Besson à propos de l’identité nationale. Tandis que Besson et son inquiétant rictus politicien sortait du bois, Peillon instrumentalisait le non-débat pour placer ses billes dans son parti décomposé.
Et puis, comme on le fit de l’épidémie de la grippe A, on déclara le débat terminé.
Jusqu’à ce que ce que, pour faire parler de soi, à droite comme à gauche, ces deux partis interchangeables que sont le PS et l’UMP trouvent autre chose.
Scandaleux, sordide, fascisant : ce débat est surtout inutile, imbécile et sans issue. Il me rappelle ces espèces de questions bidonnées que posait Delarue dans son talk-show : comment vit-on avec un paraplégique ? Y-a-t-il une vie après un troisième divorce ?
Qu’est-ce qu’être français ?
Etre français, c’est avoir épousé, comme un italien, un russe, un marocain, ou un esquimau, les contours d’un certain particularisme au sein de la grande famille universelle. Mais j’emploie des mots que l’idéologie dominante, à l’élaboration de laquelle PS et UMP auront bien contribué de pair (1), n’aime pas : l’idéologie dominante préfère mondialisé à universel, et communautariste à particulier. Demander aux français résidents en France de se poser la question de leur identité, cela revient à les considérer comme une communauté parmi d’autres. Or nous ne sommes pas une communauté parmi une autre. Car le communautarisme est une imposture autant idéologique qu’historique, nous le savons tous. J’en veux pour preuve cette réflexion identitaire que je viens de conduire à travers nombreux textes sur le fait d’être lyonnais : réfléchir au particularisme sans déboucher sur l’universel, c’est se perdre dans le communautarisme, comme le lit d’un torrent qui prendrait la mauvaise pente et n’arriverait plus ensuite à trouver la route de la mer.
Le marché mondialisé a besoin de penser le monde sans histoire et sans transcendance : c'est-à-dire sans particularisme et sans universel. Le monde a besoin d’un seul marché et le marché a besoin qu’il n’y ait face à lui qu’un monde fait d’individus et de communautés qui auraient besoin exclusivement de lui pour trouver (et se payer) de pauvres repères afin de survivre dans une idéologie et une histoire faites de bric et de broc. S’interroger sur une quelconque identité dans un tel contexte, cela revient à renoncer (ou faire mine de) à la sienne. Seul celui qui est perdu se demande qui il est. Et ce qui était vrai, jadis, sur un plan uniquement ontologique, l’est devenu, aussi dans ce monde post-moderne et foireux, sur le plan identitaire. Dans un tel contexte, et au vu des échéances électorales qui se préparent, nous n’avons pas fini d’entendre un peu partout des âneries en cascades. Je viens par exemple d'apprendre hier soir qu'on pouvait, au XXIème siècle, porter le voile pour les beaux yeux de Mahomet et militer dans un parti d'obédience marxiste. Visiblement, il n'y a pas que la religion qui est l'opium des peuples... Vive les facteurs !
Comme demeure d'actualité, dès lors, cette remarque de Léon Boitel dans ce passage où il justifie l'existence de la revue qu'il vient de créer en 1835 :
« Au milieu des graves préoccupations qui dominent notre société, au milieu de tant de partis qui la déchirent, de tant de corruption et de scepticisme qui l’envahissent, au moment enfin où, à voir les transes convulsives qu’elle éprouve, on devine l’enfantement de nouvelles idées et l’agonie d’idées anciennes ; nous dirons qu’avec les révolutions matérielles il nous faut les révolutions intellectuelles ; qu’aux hommes ballottés par la politique décevante et irritante, il faut souvent une page où reposer l’esprit. »
(1) L’encartage politicien mis à part, rien ne ressemble plus à Nicolas Sarkozy que Dominique Strauss-Kahn. Les sondages qui discrètement nous rappellent l'existence d'une opposition entre eux deux en témoignent. Rien, hélas, ne ressemble non plus tant à Martine Aubry (M.A) que Michèle Alliot Marie (MAM).
23:52 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : politique, ps, france, régionales, actualité, société, identité nationale | 









