vendredi, 09 mai 2008
La vérité sort toujours du cul des corneilles
« Paris. Mon premier voyage en métro. Travail gigantesque, j’y consens, et même non dénué d’une certaine beauté souterraine ; mais bruit infernal, danger certain, mort probable – et quelle mort ! – toutes les fois qu’on descend dans ces catacombes. Impression de la fin des sources, de la fin des bois frissonnants, des aubes et des crépuscules. Dans les prairies du Paradis. De la fin de l’âme humaine »
Paroles de Léon Bloy (Quatre ans de captivité, 15 mars 1904). Pour faire le lien avec la note qui précède. Autre chose vue dans ce lieu de vérité, ma foi, il y a déjà un bon moment : Tous les occupants d’une rame plongés dans la lecture du même Métro. Métro Pravda : même combat. Il y a cependant des choses vues plus jolies, plus réjouissantes. Le cul dactylographique d’une corneille fort lève-tôt, en train de déterrer des vers, sur la pelouse. Et malgré les lambeaux de l’intense pollution matinale sur la ville, je ne sais quelle ardeur à s’emparer de chaque journée, qui monte de la terre, dont l’oiseau se saisit, à chaque trémoussement.
21:44 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, littérature, bloy | 
samedi, 29 mars 2008
Des bêtes et des objets.
Dans les cliniques vétérinaires, on trouve la même population que dans les pharmacies, sauf que là, au lieu de se réciter leurs propres bobos, les mémères à chats new-age se récitent ceux de leurs animaux favoris. Les assistants en blouses blanches ont besoin de redoubler de patience à l'écoute de tout ce qui se raconte là. Tenir une banque de clinique vétérinaire, apparemment, c'est un peu comme tenir un comptoir, ça revient à assumer un boulot de psy. Débat animé dans l'espèce de salle d'attente de trois mètres carrés sur le confort des litières, par exemple, ou sur le rapport qualité-prix : Car les marques et leur empire ont ici aussi gravé leur empreinte. Derrière la banque, une enfilade de sachets et de boites colorées de toutes dimensions bordent de chaque côté le couloir qui conduit au cabinet du docteur. "Perlinette, donc, c'est vraiment très bien. Les grains sont gros, on n'en trouve pas partout autour (nb : des grains hors de la caisse). Et il ( c'est le chat) aime ça !" Ensuite, la conversation tourne sur les rondeurs des petits chéris : "C'est qu'il fait huit kilos, à présent... C'est vraiment un très beau chat !" Ici, la moyenne d'âge des maîtresses dépasse largement la cinquantaine, car le sexe dominant est nettement féminin. Je ne peux pas m'empêcher de penser à des petites filles mal grandies, qui jouent encore à la marchande avec leurs animaux. Tout à l'heure, elles joueront à la poupée.
Sous la haute verrière de la salle des ventes, plusieurs maisonnées défilent chaque semaine, bribe par bribe, brin par brin, au fil des successions. Autre lieu, autre moeurs : la salle des ventes est emplie d'une population presque exclusivement masculine. Les pros ne sont jamais assis : c'est presque un signe distinctif; la mobilité, dans le métier, c'est une vertu cardinale. Debout en fond de salles ou sur les côtés, ils vont, le portable à la main, ils viennent, échangent des poignées de mains, des clins d'oeil entre eux. Et quand une affaire les intéresse, ils s'approchent de la banque du commissaire-priseur d'un pas leste, tâtent ou lorgnent de plus près l'objet, font ou non un signe de la main avant de retourner à leurs conciliabules. Sur les chaises, ceux qu'on appelle les particuliers : ni brocs ni antiquaires, souvent retraités, quelques badauds, une poignée d'amateurs specialisés qui dans les faïences, qui dans l'argent, qui dans l'étain... Arrondir ses fins de mois. Auprès du pape des lieux, chacun a son petit négoce intérieur, sa conversation particulière, son rapport intime. Avec le commissaire-priseur, c'est un peu comme avec l'instit'. D'ailleurs on lui donne du Maître. La aussi, chacun a l'air de grand enfant. Du spécialiste averti au poulet qui vient se faire plumer, chacun a au fond de lui cette passion secrète pour l'objet. Une tisannière accidentée début XIXème part à cinq euros, un porte flacon en chagrin rouge du XVIIIème à 130, une tête de Saint-Denis du XVIème à 240... Cela monte et redescend selon un rythme très étudié, qui laisse à chacun le temps de souffler. De temps en temps, le patron des lieux annonce la pièce rare. Ses adjoints décrochent les téléhones. Dans un moment d'éblouissement, l'enchère grimpe, 3000, 7000, 150.000. Les Gueux du Marche aux Puces et d'ailleurs se donnent l'illusion d'être bardés de pognon. Un collectionneur étranger à emporté la mise. Tout retourne dans l'ordre. Un lot d'assiettes dépareillées...
14:33 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : société, chats, chiens, vétérinaires | 
samedi, 22 mars 2008
Bergère, ô tour Eiffel
"Le billet de 200 francs à l’effigie de Gustave Eiffel (1832-1923) rend hommage au génie créatif et au talent de cet ingénieur à travers son chef-d’oeuvre le plus connu, la Tour Eiffel, construite pour l’Exposition universelle de 1889. La Tour Eiffel illustre à merveille la révolution que constitua  l’introduction du fer dans l’art de la construction et symbolise l’esprit d’invention et de découverte de la fin du XIXe siècle." C'est ainsi que la BdF présente au public l'émission, fin octobre 1996, de son nouveau billet de 200 francs. Il fait partie de la dernière gamme du Franc, gamme hyper sécurisée ( filigrane, strap, motifs à couleurs variables, encre incolore brillante, transvision, microlettres, numérotation magnétique, code infrarouge...) où l'on rencontre également le Saint Exupéry, le Cézanne et le Curie. Ces billets de la dernière série, qui ressemblent à des coffre-forts, sont de véritables allégories de la société qu'on met alors en place, monde de codes, d'alarmes et de surveillance-vidéo : Sont-ils encore des francs ( rappelons que franc signifie libre ) ou déjà des euros ? Ce que le prospectus de la Banque de France omet de dire, c'est qu'Eiffel et sa Tour ont remplacé in extremis un autre projet consacré aux frères Lumière et au cinéma, projet brusquement abandonné en raison d'une polémique quant à l'attitude des deux frères durant le gouvernement de Vichy.
l’introduction du fer dans l’art de la construction et symbolise l’esprit d’invention et de découverte de la fin du XIXe siècle." C'est ainsi que la BdF présente au public l'émission, fin octobre 1996, de son nouveau billet de 200 francs. Il fait partie de la dernière gamme du Franc, gamme hyper sécurisée ( filigrane, strap, motifs à couleurs variables, encre incolore brillante, transvision, microlettres, numérotation magnétique, code infrarouge...) où l'on rencontre également le Saint Exupéry, le Cézanne et le Curie. Ces billets de la dernière série, qui ressemblent à des coffre-forts, sont de véritables allégories de la société qu'on met alors en place, monde de codes, d'alarmes et de surveillance-vidéo : Sont-ils encore des francs ( rappelons que franc signifie libre ) ou déjà des euros ? Ce que le prospectus de la Banque de France omet de dire, c'est qu'Eiffel et sa Tour ont remplacé in extremis un autre projet consacré aux frères Lumière et au cinéma, projet brusquement abandonné en raison d'une polémique quant à l'attitude des deux frères durant le gouvernement de Vichy.
Au recto, le portrait de Gustave Eiffel se détache devant la silhouette du viaduc de Garabit, construit entre 1880 et 1884 dans le Massif central. Eiffel a la barbe bien coupée et la mêche dynamique des sages élèves de la Modernité. Il regarde vers la gauche ( vers le passé, dit-on). De part et d’autre de l’arche métallique du viaduc, des lignes courbes violettes, bleues, rouges et jaunes — inspirées d’une étude aérodynamique du patron — forment des cercles concentriques et symbolisent le mouvement. À l’arrière plan du portrait, on distingue le détail d’une charpente évoquant la Tour Eiffel, dont la structure métallique seule pèse 7 300 tonnes (avec les équipements, le poids total de la Tour s’élève à plus de 10 000 tonnes). Au verso, une vue de la Tour Eiffel et du Champ de Mars lors de l’Exposition universelle de 1889. Au loin, le dôme du Palais des Beaux-Arts ainsi que la verrière de la Galerie des Machines, construite à l’occasion de la même exposition et démolie au début du XXe siècle. En haut, à gauche du filigrane, une partie de la structure métallique de la Tour Eiffel est reproduite de manière symbolique ; lors de la construction de l’ouvrage, 2 500 000 rivets ont été utilisés pour assembler les quelques 18 000 pièces composant l’édifice. "Nul monument, depuis les cathédrales et peut-être depuis les pyramides, n'a remué comme la tour Eiffel la sensibilité esthétique de l'humanité, écrit Rémy de Gourmont en 1901 dans Le Chemin de Velours. Devant tant de ferraille en hauteur, la bêtise elle-même est devenue lyrique, la sottise a médité, l'étourderie a rêvé; il tombait de là comme un orage d'émotions. On chercha à le détourner, il était trop tard, le succès était venu.", Léon Bloy consacre un article entier (qu'on peut
on distingue le détail d’une charpente évoquant la Tour Eiffel, dont la structure métallique seule pèse 7 300 tonnes (avec les équipements, le poids total de la Tour s’élève à plus de 10 000 tonnes). Au verso, une vue de la Tour Eiffel et du Champ de Mars lors de l’Exposition universelle de 1889. Au loin, le dôme du Palais des Beaux-Arts ainsi que la verrière de la Galerie des Machines, construite à l’occasion de la même exposition et démolie au début du XXe siècle. En haut, à gauche du filigrane, une partie de la structure métallique de la Tour Eiffel est reproduite de manière symbolique ; lors de la construction de l’ouvrage, 2 500 000 rivets ont été utilisés pour assembler les quelques 18 000 pièces composant l’édifice. "Nul monument, depuis les cathédrales et peut-être depuis les pyramides, n'a remué comme la tour Eiffel la sensibilité esthétique de l'humanité, écrit Rémy de Gourmont en 1901 dans Le Chemin de Velours. Devant tant de ferraille en hauteur, la bêtise elle-même est devenue lyrique, la sottise a médité, l'étourderie a rêvé; il tombait de là comme un orage d'émotions. On chercha à le détourner, il était trop tard, le succès était venu.", Léon Bloy consacre un article entier (qu'on peut  trouver dans Belluaires et Porchers) à la promenade qu'il effectua dans les entrailles de cette nouvelle dame de fer, alors qu'elle n'était pas même achevée. Pages sublimes d'ironie, dans lequel il se réjouit du fait que les ferrailleurs, dont les poutrelles métalliques sont désormais capables de rivaliser avec la pierre des bâtisseurs de cathédrales, devront se montrer à la hauteur de leur moderne ministère. " Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacés, contre l'érection, en plein cœur de notre capitale, de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel, que la malignité publique, souvent empreinte de bon sens et d'esprit de justice, a déjà baptisée du nom de Tour de Babel..." : Tout le monde connait la pétition des artistes contre l'érection de la Tour, qui parut dans le Temps du 14 février 1887, parmi lesquels on retrouve François Coppée, Alexandre Dumas fils, Gérôme, Charles Gounod, Leconte de Lisle, Guy de Maupassant... Pour clore cet article, il resterait à se demander si le nombre de Japonais qui ont effectivement photographié cette foutue tour de Gustave est bien, comme l'affirma un jour Serge Gainsbourg ivre à Michel Debré enrhumé, supérieur de trente fois la population autrichienne d'avant-guerre au nombre de libéllules vivant au Vénézuela. Mais une telle vérification, votre serviteur ne se sent pas capable de l'établir avec exactitude. Il suffit de croire, avec l'éditeur du Guide du Routard et celui des oeuvres d'Amélie Nothomb, que ce chiffre est élevé. Très élevé. Autant que le nombre de Monégasques qui photographièrent le viaduc de Garabit ? A l'âge du numérique, nul ne le saurait dire. Et c'est ainsi qu'Eiffel est grand.
trouver dans Belluaires et Porchers) à la promenade qu'il effectua dans les entrailles de cette nouvelle dame de fer, alors qu'elle n'était pas même achevée. Pages sublimes d'ironie, dans lequel il se réjouit du fait que les ferrailleurs, dont les poutrelles métalliques sont désormais capables de rivaliser avec la pierre des bâtisseurs de cathédrales, devront se montrer à la hauteur de leur moderne ministère. " Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacés, contre l'érection, en plein cœur de notre capitale, de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel, que la malignité publique, souvent empreinte de bon sens et d'esprit de justice, a déjà baptisée du nom de Tour de Babel..." : Tout le monde connait la pétition des artistes contre l'érection de la Tour, qui parut dans le Temps du 14 février 1887, parmi lesquels on retrouve François Coppée, Alexandre Dumas fils, Gérôme, Charles Gounod, Leconte de Lisle, Guy de Maupassant... Pour clore cet article, il resterait à se demander si le nombre de Japonais qui ont effectivement photographié cette foutue tour de Gustave est bien, comme l'affirma un jour Serge Gainsbourg ivre à Michel Debré enrhumé, supérieur de trente fois la population autrichienne d'avant-guerre au nombre de libéllules vivant au Vénézuela. Mais une telle vérification, votre serviteur ne se sent pas capable de l'établir avec exactitude. Il suffit de croire, avec l'éditeur du Guide du Routard et celui des oeuvres d'Amélie Nothomb, que ce chiffre est élevé. Très élevé. Autant que le nombre de Monégasques qui photographièrent le viaduc de Garabit ? A l'âge du numérique, nul ne le saurait dire. Et c'est ainsi qu'Eiffel est grand.
08:23 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, eiffel, billets français, belle époque, société, culture | 
mardi, 18 mars 2008
Je me prive de rien
Pourquoi me priverais-je ? Mes ancêtres, serfs, esclaves ou gladiateurs, ont été ou se sont tellement privés de tout, jadis. De tout ! Avec les moyens technologiques dont nous disposons dans notre société, je peux assouvir avec un seul ticket en main mes frustrations et celles qu'ils m'ont léguées, concrétiser mes fantasmes ainsi que les leurs. Ah, le marketing ! Par exemple, si je suis une black, je peux me teindre en Marylin pour aller draguer, et si je suis blond, me relooker façon pote avec des tresses africaines sympas sympas. Et tutti quanti. Ce n'est pas un style que j'adopte, c'est leurs voeux que je comble, si si ! Et je me sens bien comme ça. Ni mon esprit que je gave, mais le leur. Devant un tel déluge de merveilles, la notion même de privation m'est insupportable ! Quand je pense que mon grand frère n'avait même pas de portable ! Mon père même pas de GPV ! Et mon grand-père même pas de télé... La famille Même pas, pour tout dire. Je rachète. Je rachète à tour de bras, moi qui suis enfin libre et cultivé. Dites vous bien que mon arrière grand-mère n'a jamais connu la pilule ! Et mon arrière grand-père, qui ne savait pas skier, jamais vu la mer ! Mais comment faisaient-ils ? Pauvres gens ! Comment faisaient-ils ? Il parait qu'ils se lavaient à l'eau presque froide dans des baquets ! Qu'ils péchaient le poisson dans les rivières ! Et qu'au lieu de télécharger de la musique, ils chantaient ! Quelle horreur ! Moi, c'est un tout autre genre. Moi, je me prive de rien.
"Nous oublions toujours, quand nous comparons le passé au présent, de considérer à quel point le présent est débiteur du passé. En naissant, ou quelques années plus tard, nous nous trouvons les maîtres d'un mécanisme immense et compliqué qui nous parait, ou peu s'en faut, faire partie de la nature. Les villes sont à ce point de vue de mauvaises écoles philosophiques. Quand on a vécu en des campagnes où on manque de presque tout, on se fait déjà une meilleure idée du passé. On apprécie mieux la solidité des fondations établies par les générations anciennes. Les mille petites commodités, les petits luxes modernes nous cachent l'essentiel de la civilisation. En avoir été privé, c'est souvent en apprécier l'inutilité. Mais il y a une partie stable, très ancienne, dont l'homme ne pourrait être dépouillé sans cesser d'être l'homme. Or cette partie ancienne, si on y réfléchit, on trouvera qu'elle n'est pas seulement la plus utile, mais qu'elle est aussi la plus belle. "
1 Rémy de Gourmont, "Une loi de constance intellectuelle" - La Culture des Idées.
09:38 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, gourmont, société, culture | 
samedi, 15 mars 2008
Le petit misérable
C'était le temps des numéros de téléphone à quatre chiffres : Balzac 02-04 / Danton 67-78 / Odéon 87-19 ...
Au verso, le front haut ceint de la couronne blanche, le regard droit, la barbe enneigée de Père éternel, l'homme de la Place Royale (actuellement place des Vosges ) et des promenades nocturnes et consignées dans les Choses Vues. Deux jours après son élection à l'Académie Française ( Toto académicien ! s'était écriée Juliette...) au fauteuil de Népomucène Lemercier, le 9 janvier 1841...

IL relate en parlant de soi à la troisième personne (comme plus tard le fera A.D.) la querelle, dont IL est le témoin, entre un jeune bourgeois et une non moins jeune prostituée. Débarquent alors un essaim de sergents de ville : « Ils empoignèrent la fille et ne touchèrent pas à l'homme : - Tu en as pour six mois ». Le récit se poursuit : IL ( V.H., pas A.D.) vit la pauvre femme se traîner de désespoir par terre, s'arracher les cheveux; la compassion le gagna, IL se mit à réfléchir. Et voilà V.H, magnanimement travaillé par la Conscience, en train de signer une déposition contredisant les dires des vils sergents de ville. A ce prix-là (un autographe d'une telle patte, bigre!), la fille est relâchée, bien sûr.
IL, l'Académicien, devient à peu de frais le shérif de la Conscience Pure, le Robin des bois de la Veuve et de l'Orphelin, le douanier intransigeant de la Bonté morale en passe de devenir républicaine. Bref, une légende. « Ces malheureuses femmes ne sont pas seulement étonnées et reconnaissantes quand on est compatissant envers elles, elles ne le sont pas moins quand on est juste. » Le maître-mot hugolien est lâché. Ah, Victor ! On le retrouvera, ce même mot, vingt-et-un ans plus tard dans le premier livre des Misérables lors de la scène entre Fantine, M. Madeleine et Javert : « Allons marche ! Tu as tes six mois. Le Père éternel en personne n'y pourrait rien » : Même au cours de ses passages les plus pathétiques, Barbe Blanche savait manier l'humour.

Au recto, l'homme du Panthéon. Trajectoire normal : l’académicien est entre temps devenu la légende républicaine. Poète millionnaire dans un cercueil de pauvre. « J'étais élevé, témoigne Léon Daudet dans Fantômes et Vivants, dans la vénération de Hugo. Mes grands parents maternels, tous deux poètes, tous deux romantiques, tous deux républicains, savaient par coeur Les Châtiments, La Légende des Siècles, Les Misérables... »
Léon Daudet retrace sa première rencontre avec "l'oracle trapu aux yeux bleus, à la barbe blanche" que le billet de la BdF à présent reproduit devant le Panthéon : "Il articule distinctement ces mots : La terre m'appelle, qui ne pouvaient avoir qu'une grande portée, un sens mystérieux..." Dans ses Souvenirs sans fin, André Salmon brosse le tableau du même fétichisme ridicule autour du vieil Hugo en racontant comment Pierre Quillard ne quitta "le très riche et très encombré appartement de la rue d'Eylau" qu'après avoir recueilli avec des ciseaux "une touffe des poils du chat du maître". L'entrée du cadavre de ce dernier au Panthéon fut le prétexte à des fêtes mémorables, ponctuées par une marche de Chopin et un hymne de Saint-Saëns, jusqu'à cette crypte froide où, narre Daudet, "la torche symbolique qui sort de la tombe de Rousseau a l'air d'une macabre plaisanterie, comme si l'auteur des Confessions ne parvenait pas à donner du feu à l'auteur des Misérables."
Dès son émission en 1954, le billet à l'effigie d'Hugo (qui remplaça le projet initial d'un Louis XIV, jugé trop équivoque pour une république) fut surnommé le petit misérable. Tristounet, jugea le populo, peut-être parce qu’on ne pouvait pas se payer grand-chose avec. . Tristounet ! Plutôt que cet académicien austère et soucieux dans son complet bleu, prenant la pose au-devant de bâ.timents officiels à la silhouette aussi empesée que les alexandrins de La Fin de Satan, le populo aurait probablement préféré un Victor beaucoup plus jeune, plus chevelu et plus fougueux, un véritable Toto, quoi, à la façon du temps des batailles romantiques, un mage véritable comme l'aurait prononcé en chaire le professeur Paul Bénichou ! C'est, au passage, l'occasion de rendre hommage à Jacques Seebacher pour qui « l'image de l'écho trop sonore du moulin à antithèses, du mélimélo dramaturge démagogue, du satyre torrentiel, du politique ridicule, bref, de l'exagéré en tous sens » n'a jamais correspondu à la réalité.
Au vrai, n'était-ce pas, au temps des numéros de téléphone à quatre chiffres, le billet de Monsieur Pinay, celui de Mendes France et d'Edgar Faure ? Entre une nouvelle Citroën, un steak frite et un match de catch, on regrette que le sémillant sémiologue du Quartier Latin n'ait pas, tel quel, consacré à ce billet d'instituteurs l'une de ses Mythologies. Le billet de cinq cents ! Celui dont, chaque hiver, on se mit à remplir les boites en fer des croisades de l'Abbé Pierre ! Et ne devint-il pas, en changeant de valeur, celui de De Gaulle et de ses Nouveaux Francs ? Pinay, De Gaulle, des politiques moins rigolos que le petit Nicolas, certes, et qui n'étaient pas connus pour leur fantaisie... Le populo n'appréciait guère le petit misérable : et pourtant, devenu billet de 5 NF, il ne fut retiré qu'en 1965 du commerce des Français. Il traîna donc quinze années dans leurs poches et dans leurs portefeuilles.
Le plus modeste des billets, le plus quotidien, pour ne pas dire, puisque le Peuple porte en lui la Sagesse de Dieu, le plus misérable...
08:10 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : hugo, billets français, société, seebacher, littérature | 
mercredi, 05 mars 2008
Météo
 Par la fenêtre, temps clair. Ciel bleu. Très bleu. Où se lantibardanent quelques nuages dodus, rares. Extrêmement lumineux. Il est 14 heures 20. Ce matin même, vers 6h 30, temps couvert. Un peu venteux. Amoncelés sur la ville qu'on domine du haut des collines, aplatissant tout son éclairage, un plateau crèmeux de nuages. Frisquet glacial en prime. Hier soir, vers 22 heures, neige. Neige mouillée, certes. Ne tient pas, certes. Neige quand même. Par la fenêtre, branches d'arbres en bourgeons. Bourgeons naissants. C'est le printemps. Et puis flocons virevoltants dans la nuit. Il neige. Non, il pleut. A présent, soleil. Température qui suit. Comme livrée dans le même colis. Tout comme les sondages, température en yoyo. Tout comme le prix des choses. Dans les autobus : "On ne sait plus comment s'habiller". Eh non ! Le temps, c'est comme les prix. Ca vient, ça va. On peut plus guère compter dessus. A quel moment la vie est-elle, comme cela, devenue la vie chère ? Passage à l'euro, c'est sûr. Billets très laids, d'ailleurs. Billets d'ailleurs, très moches. Plus un humain dessus. Fini, l'humain. Quel est donc le prix qui a fait déborder le vase ? Foutu prix. Foutu vase. Celui des yahourts ? Celui des pâtes ? Quel seuil ? Du petit noir sur le zinc ? De l'essence ? De la redevance ? Du m2 en centre ville ? A la vitesse où l'euro coule, le temps varie. Nous aussi. Sommes, que nous sommes. Guère plus que ça, avec tous nos codes. Fillon au plus haut : 66 %! Comment est-ce possible ? Fillon ! Comment est-ce pensable ? Municipales : sait-on pour qui voter ? Je songe à Winnie, enlisée en son tertre. Visionné plusieurs fois la cassette, avec Madeleine Renaud. "Le vieux style...", dirait-elle. Irremplaçable. Irremplacée. Une articulation impeccable. Merveille d'actrice. Chaque syllabe, immobile. Immobile et interprêtée. Sa solitude, en ce tertre. Lumière, disait Samuel. Chaleur et lumière, vives, sur Winnie. Puis écarquillerait d'abord les lèvres. Ensuite les yeux. Est-ce que ça s'écarquille les lèvres, Samuel ? Ou bien les yeux ? N'en sait rien! N'en sais bien rien, non plus. Dirions plus rien, à la fin. Mais quel beau jour! Quel beau jour, quand même...! Mardi. Hier, mardi ! Mardi de mars! Et à présent, Mercure. Mercredi de Mercure : Encore un de plus. Et quel beau jour ! Quel beau jour ç'aura, été, Willie, encore un. N'est-ce pas ?
Par la fenêtre, temps clair. Ciel bleu. Très bleu. Où se lantibardanent quelques nuages dodus, rares. Extrêmement lumineux. Il est 14 heures 20. Ce matin même, vers 6h 30, temps couvert. Un peu venteux. Amoncelés sur la ville qu'on domine du haut des collines, aplatissant tout son éclairage, un plateau crèmeux de nuages. Frisquet glacial en prime. Hier soir, vers 22 heures, neige. Neige mouillée, certes. Ne tient pas, certes. Neige quand même. Par la fenêtre, branches d'arbres en bourgeons. Bourgeons naissants. C'est le printemps. Et puis flocons virevoltants dans la nuit. Il neige. Non, il pleut. A présent, soleil. Température qui suit. Comme livrée dans le même colis. Tout comme les sondages, température en yoyo. Tout comme le prix des choses. Dans les autobus : "On ne sait plus comment s'habiller". Eh non ! Le temps, c'est comme les prix. Ca vient, ça va. On peut plus guère compter dessus. A quel moment la vie est-elle, comme cela, devenue la vie chère ? Passage à l'euro, c'est sûr. Billets très laids, d'ailleurs. Billets d'ailleurs, très moches. Plus un humain dessus. Fini, l'humain. Quel est donc le prix qui a fait déborder le vase ? Foutu prix. Foutu vase. Celui des yahourts ? Celui des pâtes ? Quel seuil ? Du petit noir sur le zinc ? De l'essence ? De la redevance ? Du m2 en centre ville ? A la vitesse où l'euro coule, le temps varie. Nous aussi. Sommes, que nous sommes. Guère plus que ça, avec tous nos codes. Fillon au plus haut : 66 %! Comment est-ce possible ? Fillon ! Comment est-ce pensable ? Municipales : sait-on pour qui voter ? Je songe à Winnie, enlisée en son tertre. Visionné plusieurs fois la cassette, avec Madeleine Renaud. "Le vieux style...", dirait-elle. Irremplaçable. Irremplacée. Une articulation impeccable. Merveille d'actrice. Chaque syllabe, immobile. Immobile et interprêtée. Sa solitude, en ce tertre. Lumière, disait Samuel. Chaleur et lumière, vives, sur Winnie. Puis écarquillerait d'abord les lèvres. Ensuite les yeux. Est-ce que ça s'écarquille les lèvres, Samuel ? Ou bien les yeux ? N'en sait rien! N'en sais bien rien, non plus. Dirions plus rien, à la fin. Mais quel beau jour! Quel beau jour, quand même...! Mardi. Hier, mardi ! Mardi de mars! Et à présent, Mercure. Mercredi de Mercure : Encore un de plus. Et quel beau jour ! Quel beau jour ç'aura, été, Willie, encore un. N'est-ce pas ?
14:58 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : météorologie, vie chère, société, actualité, littérature, beckett | 
mercredi, 27 février 2008
Notre société
C'est la nôtre! Et elle est rien qu'à nous. A nous ! Notre société, c'est la plus belle des sociétés, comme notre maman est la plus belle des mamans. Là ! Notre société : lieu commun qui atteint le bel âge depuis peu. Au XVIIème siècle, La Bruyère parlait dans ses Caractères du « dédain de la société » ou « du plaisir de la société » dans un chapitre entièrement consacré au sujet (« De la société et de la conversation ») Et sous la plume de son rêveur de père, Alceste ne songeait qu'à fuir « la société des hommes », c'est-à-dire leur commerce, leur compagnie, leur conversation, en effet.
Société : nom commun, normalement déterminé par un article défini. On trouve dans Le lys dans la vallée de Balzac les bienveillantes recommandations d'Henriette de Morsauf à Felix de Vendenesse : « Acceptez la société comme elle est, et ne commettez point de fautes dans la vie » . A la fin des Illusions Perdues, ceux de Vautrin à Lucien de Rubempré : « Le grand point est de s'égaler à toute la société. » Et lorsque le même Vautrin, déguisé en abbé espagnol, emploie un déterminant possessif (votre société), c'est pour évoquer péjorativement auprès du jeune imbécile qu'il a sous les yeux cette société dans laquelle il n'est plus qu'un forçat évadé.
De La Bruyère à Balzac, le sens du mot s'est donc infléchi (on passe de compagnie des hommes à corps social). Mais cela serait pareillement une faute de français (et une faute de goût) de s'attribuer à soi-même la société en la disant « nôtre ». L'emploi du possessif ne se justifie que dans le cas où on veut opposer la société contemporaine aux sociétés précédentes (notre société par rapport à celle des Anciens) ou bien la société française aux sociétés étrangères, les bas-fonds aux beaux salons. « Ce que les artistes appellent intelligence semble prétention à la société élégante » ecrit encore Proust au début du vingtième.
Une société commerciale peut en revanche devenir mienne de façon métonymique, pour peu que j'aille y user le fond de mes culottes un nombre d'heures conséquent chaque jour. Ma société, ma boite... Notre société, notre entreprise : nous touchons à la racine du lieu commun, à l'instant pivot. A ce moment satanique (vers le milieu des années 80 ) où il est apparu, lorsque la publicité est devenue « une culture », et « la société » « notre société ». Que n'a-t-on pas écrit à propos de cette libéralisation de l'espace public, de cette lente dilution des frontières entre le public et le privé, du rachat progressif du premier par le second, de l'envahissement de la sphère social par le moi prédateur... La res publica, la chose commune, celle qui justement, n'appartenant à personne, ni aux « nouveaux arrivants » ni à ceux qui sont sur le départ, est disponible à tous, devient comme un produit, une marchandise ou un divertissement, quelque chose de nôtre.
Notre société ! Insignifiante et sordide faute de grammaire qui, l'air de rien, transforme le citoyen averti en consommateur abruti. Alors que l'intégration est un échec patent, un simple déterminant pour en donner l'illusion et discréditer toute critique, toute opposition : Car de même que tu n'as pas intérêt à toucher à ma mère, tu ne touches pas à ma société...
15:57 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, société, balzac, la bruyère, proust | 
mardi, 05 février 2008
La disparition
Que dire de ces livres plats, sans relief, sans profondeur, dont la société du spectacle nous inonde ? Quel intérêt y avait-il, déjà, à lire un ouvrage consacré à la pauvre existence de Rachida Dati ? A celle, non moins exaltante, de Cécilia Sarkozy ? Et quel nouvel intérêt y aurait-il à se pencher sur l'un de ceux qui racontent la vie de Carla Bruni ?
Je remarque au passage que le e muet, qui laisse de façon si douce en suspens à l'oreille une consonne, ou bien qui lui permet de s'essoufler lentement dans un bruissement vaporeux, le e muet est bizarrement (ou tragiquement) absent du nom des femmes du président. Le n om et le prénom de chacune de ces dames qui ne donnent pas dans la nuance, au contraire, ne possèdent qu'une voyelle claironnante et sonnant sec en finale. Comme, entre parenthèses, celui de leur mentor Nicolas Sarkozy qui ignore aussi abruptement qu'un claquement de porte la tendre suggestion et la fine délicatesse du e muet si caractéristique de la langue de Bossuet (qu'il écorche d'ailleurs tant qu'il le peut). De la plus fermée (A, noir) à la plus ouverte (I rouge, disait Arthur.), les voyelles des femmes du président et du président lui-même sont donc sans mystère, sans ambiguïté, sans profondeur. Starlettes, tout au plus. De là à dire que celles et celui qui les portent sont, de même ....
om et le prénom de chacune de ces dames qui ne donnent pas dans la nuance, au contraire, ne possèdent qu'une voyelle claironnante et sonnant sec en finale. Comme, entre parenthèses, celui de leur mentor Nicolas Sarkozy qui ignore aussi abruptement qu'un claquement de porte la tendre suggestion et la fine délicatesse du e muet si caractéristique de la langue de Bossuet (qu'il écorche d'ailleurs tant qu'il le peut). De la plus fermée (A, noir) à la plus ouverte (I rouge, disait Arthur.), les voyelles des femmes du président et du président lui-même sont donc sans mystère, sans ambiguïté, sans profondeur. Starlettes, tout au plus. De là à dire que celles et celui qui les portent sont, de même ....
Cette disparition ferait en tout cas une bonne intrigue pour un Pérec post-moderne qui aurait du temps à perdre à broder sur la vie de tous ces êtres insipides dont le destin n'est que de passer de rayons en rayons, tout en empochant un maximum de blé. Signes éphémères, pauvres livres de vent... "L'Art s'intéresse à l'objet pauvre, disait Tadeusz Kantor, pour le faire passer de la poubelle à l'Eternité." Belle formule inspirée du dadaïsme et du ready-made, façon Duchamp. Et pour de vrai, ni le banc de la Classe Morte, ni la roue du char du Retour d'Ulysse, ni le pistolet de Marcel Duchamp ne sont entièrement passés à la poubelle. Qui aurait, pourtant, la folie de vouloir sauver de la consommation frénétique dont ils sont les repoussants emblèmes tous ces haïs, icones si vertigineusement et si tragiquement vides et indignes du moindre e muet ?
17:30 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : politique, littérature, société, voyelles | 
lundi, 04 février 2008
Un monde en toc
Assiégé par des rebelles, un palais présidentiel tremble. Dans un autre, un avocat véreux épouse une courtisane liposucée. Seul sur un banc, un homme lit la philosophie d'un Grec ancien, qu'on vient de lui fourguer avec le journal du soir. Au magasin bio du coin, une cliente antipathique se fait tirer son sac par un malfrat malin. Le lendemain, un club breton de CFA 2 sort d'une compétition footballistique pourrie un club pro. Quelques jours auparavant, le conseil d'administration d'une banque avait reconduit son PDG qui venait pourtant de laisser partir en fumée rien moins que 7 milliards d'euros. Ce qu'on retient des primaires aux Etats-unis, c'est que pour être noir, il faut quand même être né d'une mère blanche afin de partir à l'assaut de la Maison du même adjectif. Tout ça ne nous dit pas l'heure, assurément. Mais quand même.
On ne peut imaginer à ce jour le nombre de mères de famille âgées de la cinquantaine qui rêvent de voir leur progéniture, mâle ou femelle, s'imposer enfin à un jeu de téléréalité. Compensation narcissique ? Economique ? 78 millions d'euros, c'est le budget d'un film érigé à la gloire de la connerie française et diffusé dans le monde entier. Un traité rejeté par référendum est ratifié en catimini par des députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles. Tous plus ou moins maqués dans une loge ou dans une autre. Cela ne sera que le énième calamiteux traité de Versailles. Celui-ci, nous dit-on, n'est qu'un mini. Comme les fourmis. Pendant ce temps, des millions de consommateurs de démocratie participative s'activent à préparer les élections municipales à venir, comme si ça devait changer quelque chose à leur morne existence. Dame, vous disent-ils, un maire, c'est un élu de proximité avec lequel on peut causer. Soit.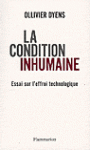 Mais tout ça ne nous dit toujours pas l'heure.
Mais tout ça ne nous dit toujours pas l'heure.
A quoi bon, me direz-vous l'heure, l'heure ? « Nous disparaissons ». Tels sont les premiers mots d'un essai qui vient de paraître chez Flammarion (voir ci-contre). Analyse brillante, par son auteur canadien Ollivier DYENS, de la relation qui s'est tissée entre chacun d'entre nous et ceux que Georges Bernanos appelait déjà, en 1944, "les robots". Analyse brillante mais in fine décevante car finalement impuissante. Cet auteur, comme beaucoup de verbeux officiels, ne sort du rang que pour mieux aller y occuper une place un peu plus en tête au box-office des centres de distribution d'objets culturels. Le tout guidé par "l'effroi technologique" qui n'a pas l'air de le terroriser tant que ça, ni intellectuellement, ni moralement, ni spirituellement : car s'il n'y a rien à faire, véritablement, qu'être cette "machine qui palpite", alors pourquoi avoir écrit ce livre ? Et où sont passés les polémistes d'antan ? Techniciens, le seraient-ils devenus jusqu'aux confins de leurs lacunes? A ce rythme-là, le monde en toc ira, par nos soins, proliférant, en effet... Et qu'importe l'adjectif qu'un petit malin ira plaquer sur le mot condition. Cette prolifération, quand chacun d'entre nous et tout ce que nous consommons en fait partie, n'est plus même une condition. A quel point Beckett avait, non pas vu ( Qui voit ? Où sont les voyants, où sont les visionnaires ? ), mais subi - et décrit - juste ! Sous le ciel gris d'un monde en toc, pour se faire un chapeau de paille, toute l'actualité du monde, et tous les essais qu'on peut écrire à son sujet, ne suffit plus.
14:06 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : société, actualité, culture, politique, critique, littérature, beckett | 









