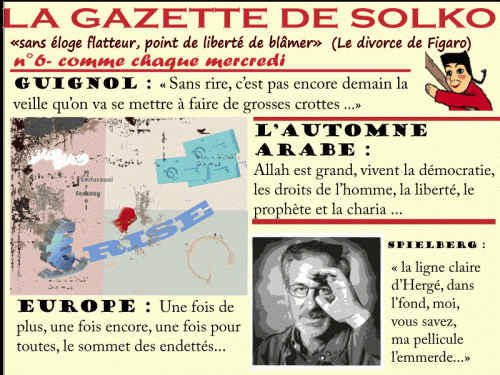mardi, 15 novembre 2011
L'écharpe de K
Les ronds se tirent vite. Tout ça n’est pas nouveau, non. Mais depuis peu, ça s’est corsée, la vitesse à laquelle l’argent coule. De plus en plus leste, virevoltante et fatale, la monnaie : tirer sur chaque dépense jusqu’à la fin du mois, c’est devenu une façon d’être seul au monde. On y arrive en tirant par ci, par là, les bouquins, les plaquettes de beurre, les chaussettes. Geste furtif, et hop. Le franc est en train de vivre ses dernières années. Une clique d’économistes parie sur l’euro à venir. Comme ça, tout ça, paraît abstrait, lointain. Situation précaire, certes, que la sienne : tester la méthode torcheculative de Rabelais sur des infirmes moteurs et cérébraux dans une banlieue parisienne dont on vient juste de changer le nom, tu vois, de Les Gonesses à en France, comme si pour améliorer le sort des pauvres il suffisait de changer de nom… Et puis les occuper comme tu peux, les infirmes, ça s’appelle éducateur, il fait le job, comme on dit à présent des footballeurs, alors qu’il n’a même pas le diplôme en poches : avec la rigueur, mot depuis peu entré en fonction, on regarde plus trop nulle part qui fait quoi.
La seule conclusion qu’il en a tirée, c’est qu’au moins pour surnager, s’il doit vivre encore longtemps, durer, et sait-on jamais une vie, parfois ça dure, il faudrait reprendre des études, ces sacrées études qui lui ont toujours tant coûté, comme si tenir en place à écouter des faux savants, non vraiment.
Parce que de véritables études pour lui jusqu’alors, ça restait quand même l'école de la rue, celle de la route, de la scène, et puis les petits jobs par ci, par là, d’usines en administrations, d’hôpitaux en commerces, le boulot, la démerde et la débine à chaque fois remise au lendemain. La scène et le carnet de notes, et toujours tout recommencer. Engagé dans rien, endetté de rien. Survivre en temps de crise. Tenir bon. Rien devoir à personne.
Je raconte donc l’histoire d’un étudiant tardif et fauché. Tu imagineras que la scène se passe au printemps 1986. Cet éternel instable trime donc dans un foyer pour handicapés à Tremblay trois journées de treize heures, avant l’ère de la sinistre Aubry, ça faisait 39, la semaine pour tout dire. Depuis peu, la situation dans le pays s’est durcie. Elle en finira plus de se durcir, au fur et à mesure qu’on ouvrirait les frontières et ferait monnaie commune et qu’on l’aurait dans le cul, la situation. Le bel enfumage. Plus la même insouciance, non : Ni dans la capitale ni ailleurs. A moins que ce soit lui, depuis qu’il a vraiment réalisé dans sa chair de mortel qu’il est tout seul au monde, que c’est leur lot à tous, que se croire en famille c’est quand même un sacré luxe, et que trois rides lui barrent le front, à moins que ce soit lui qui finalement se soit rendu, ait accepté que ça irait peut-être mieux en retroussant les manches et en roulant une bonne fois pour toutes pour sa bosse par les sentiers de l'insertion.
Il a suivi ce jour-là la rue des Ecoles jusqu’à son extrémité, son bout. Il a passé la fière Sorbonne toute de pierres vêtue, le cœur-Villon pincé, il a filé devant le Collège de France dans le jardin duquel rêve, oui c’est le mot vraiment, rêve Montaigne, et comme on n’a pas voulu de son dossier à la Sorbonne –déjà trop vieux – il a poussé jusqu’aux tours si laides en face du Nemrod, ce campus hâtivement bâti. Il a d’abord bu un café, puis deux pour se remonter le moral, ah que n’a-t-il étudié du temps de sa jeunesse folle ? Dans la rumeur des conversations, le cliquetis de cuillers à café dans les tasses vertes que sur leurs plateaux ronds des garçons en pantalons noirs, tabliers blancs, trimballent comme s'il était en train de s'égarer dans une page de Sartre. Un rendez vous avec le Président de Paris VII, rien que ça, à quoi ça ressemble, un président de Paris VII songe-t-il en laissant traîner son regard sur ces tours salies dans la brume qui ressemblent à un coin de banlieue planté par mégarde à deux pas de Notre-Dame.
Finalement ça a marché. Il a fait valoir la compagnie théâtrale créée jadis, l’ouverture rectorale accordée à cette époque, un bouquin édité en 81, plusieurs articles sur une ou deux pièces, tout ça, il n’en revient pas, le président de Paris VII lui a dit : « vous n’allez pas perdre un an pour rien, ça peut faire une équivalence professionnelle tout ce que vous me racontez là, vous n’avez plus de temps à perdre… » Une équivalence professionnelle ? Alors qu’il n’a pas suivi un seul cours, le voilà déjà en deuxième année, le voilà les deux jours de la semaine qui lui restent après les trois perdus chez les handicapés, à suivre un cours sur La Religieuse, un autre sur La Peau de Chagrin, et le plaisir de retrouver ce latin qu’il n’a jamais vraiment égaré depuis son cher et vieux lycée de province, le Pollio de Virgile et le Pro Archia de Cicéron. En septembre, les bombes ont pété rue de Rennes, à la Fnac où il va chercher les bouquins qui lui manquent. Comme c’est curieux, ça. Il lit la Poétique d’Aristote tandis que des passants innocents, non loin, payent la facture d’Eurodif, et Chirac, le soir, avec du sang sur les mains qu’on ne voit pas, mais tous ces rictus qu’on voit : « mes chers compatriotes », on dirait un Homais désappointé. A cette époque, il lit tout le temps, comme on respire. Quand il marche dans Paris, c’est la force des auteurs qui le portent, exactement ça, et lui montrent les magasins d’aujourd’hui, le délabrement dans lequel les êtres sont. Ce qui fait que ce qu’il dit quand il ouvre la bouche n’est pas toujours clair, branché au bon endroit. Qu’importe, se dit-il. Autour de lui, ça ne compte plus. Aucun ne l’aidera à survivre, à trouver salaire et pitance, rien d’autre que lire. Pas de temps à perdre. Plus de temps. Un prof, un jour, en lui rendant une copie lui dit : « vous, il faut passer l’agrégation, et vite… » Comme si tout à coup, au son de cette voix, il rentrait à la maison... Comme si passer l’agrégation n’était au fond qu'une formalité ressurgie du néant.
Le voilà donc dans cet amphi où résonne un cours de licence. Enfin, un cours… On vient de la Sorbonne, on vient de l’ENS, on vient de Censier, de partout pour écouter la star. La star de Jussieu. Même à Paris, flotte quelque chose d’atrocement provincial, se dit-il. Il s’est inscrit à son cours parce qu’il n’a pas de temps à perdre. Les stars l’emmerdent, l’ont toujours emmerdé, celle-ci comme d’autres, on dirait une madame de Bargeton égarée là devant ces Rubempré niais à mourir, mais il paraît que K…, contre un exposé bien ficelé, refile facilement l’unité de valeur. Et ça, il en a besoin. Comme il a besoin de monnaie. La sémiologie et lui, jusqu’alors, les théories du signe… De la Bible jusqu’à James Joyce, rien que ça, a-t-elle annoncé avant de distribuer à tous les auditeurs une liste d’exposés, comme si elle marchait sur la lune.
K… est une fort jolie eurasienne, jadis trotskiste et parvenue avec la grâce d’une papesse de la gauche mitterrandienne dans ce qu’il est convenu de nommer la force de l’âge. Lui, il a tiré au sort « la théorie du signe dans la Logique de Port-Royal ». Diable ! Arnauld, Nicole, et cette affaire de raison janséniste, le jugement. Voilà de quoi l’occuper quand il garderait cette semaine les fauteuils au foyer. Jongler avec les syllogismes. Les mater. Ah, les mots considérés « comme des objets de pensée » et ceux qui ne font que renvoyer « à la forme et à la manière de nos pensées ». Ceux qui et ceux qui ne font que. Tout est là. S’il y a une théorie plausible là-dedans, nous partirons d’une prémisse remarquable, c’est qu’elle ignore l’arbitraire. Au sortir du métro, déjà des bradeurs d’écharpes étalées à même le sol. Il ya toujours eu des vendeurs à la sauvette, des vendeurs de tout, et puis des musiciens. La débrouille. Ces écharpes écossaises, à 20 francs l’une, il en portait d’ailleurs une en ce mois de février – ça devait être 1988 – qui commençait à s'effiler, nouée autour du cou, grise, blanche et noire, et qui gardait son odeur rance et tenace à lui, son propre parfum comme en conserve, qu’il humait dans la journée, comme on hume une superstition. Comme deux chiens affamés, Mitterrand et Chirac allaient se jeter à la gueule l’un de l’autre la libération des otages, toujours cette sale histoire de l’uranium et des millions d’Eurodif, « les yeux dans les yeux je le conteste », on s’en souvient, Dieu-Grenouille serait réélu, et Libération, le journal que lisait K… et dans lequel elle-même et les gus de sa bande écrivaient parfois des articles d’indignés titrerait bravo l’artiste, et le pays berné. La décomposition de l’artiste, comme celle du pays, galopante
Un jour, son tour vint d’aller mendier son 18/20 devant la bruissante assemblée. Pendant que les strapontins claquaient, miroir de poche en main, Julia se refaisait une beauté habile. Car elle commence à avoir l’Eurasie fatiguée, ça se comprend. Derrière elle, le tableau est empli d’équations et sur le bureau est posé le chiffon pour effacer les traces de ceux qui nous ont précédés. C’est ça, la connaissance, un long chemin. Il avance la main pour s’en saisir, de ce chiffon empli de poussière blanche, et au tout dernier moment s’aperçoit qu’en réalité, ce chiffon est une écharpe, une vraie, comme celle qu’il porte à son cou. Une de ces écharpes que les pauvres vendent au noir à des pauvres dans le métro, vingt balles, oui, on disait alors vingt balles, vendre comme on jouerait de la guitare et la porter de longs jours jusqu’à ce qu’elle sente l’odeur, ton odeur. Il hésite.
K… fait une moue et pose sur sa main à lui qu’il vient d’immobiliser devant cette foutue écharpe ? ce maudit chiffon ? il ne sait plus qu’en penser. Elle pose son regard aux longs cils et c’est vrai qu’il est beau et profond, ce regard qu’elle laisse glisser le long de son avant-bras à lui, son bras, sa bouche, ses yeux maintenant, elle le fixe quelques secondes tandis qu’il rosit, pris en flagrant délit de pauvreté. Et elle, l’universitaire qui théorisa si joliment les lois les plus retorses du langage et de la Révolution, d’une voix sèche, sucrée, tombant comme un couperet lâche : « Vous ne pensez tout de même pas que cette écharpe est à moi ? »
Je dédie cette fable à toutes celles et tous ceux qui galèrent pour mener à terme quelques études leur permettant (peut-être) de survivre dans la Jungle.

06:06 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, jussieu, julia kristeva, la logique de port royal, théories du signe, sémiologie, précarité, mitterrand, chirac, politique, société | 
lundi, 14 novembre 2011
Le leurre Hollande
Le François made in Corréze n’est pas encore élu qu’il est déjà critiqué par son aile gauche, comme s’il était aux affaires depuis dix ans : « capitaine de pédalo dans la tourmente », pourquoi diable la formule de Mélanchon fait-elle si joliment mouche ? Voilà une question que les soutiens du candidat devraient se poser avec plus de sérieux qu'ils ne le font. J’entends ces gens qui se rêvent déjà ministres utiliser de plateaux télé en plateaux télé la même méthode Coué en martelant que « les Français ne supportent plus Sarkozy », que « les Français en ont marre de la droite », etc, etc. C’est certes vrai des 2 à 3 millions de militants et sympathisants de la primaire socialiste qui se sont déplacés et y sont allés de leur écu. Cela dit, comme ne s’est pas privé de leur faire remarquer Copé, 3 millions, ça ne fait pas une majorité : la preuve ? C’est encore moins que le score de Jean Marie Le Pen au premier tour de 2007 ( 3 millions 834 530, soit 10,44 % très exactement). Moi, ce n'est pas de Sarkozy que j'ai marre, mais de quelque chose de beaucoup plus vaste, une sorte de tartufferie politicienne qui dure depuis longtemps, et dans laquelle les socialistes autant que les sarkozistes sont inclus. D'ailleurs, tous ces barons locaux ne sont-ils pas déjà aux affaires dans les régions, dilapidant tout autant que ceux de droite au gouvernement, l'argent et le patrimoine public de la même façon ?
Voilà pourquoi, que ce soit Sarkozy ou Hollande, je n’en ai pas grand-chose à faire. Je sais déjà que le changement en France n’arrangera que les élus ou les militants d’un bord ou de l’autre qui ont des dents à planter dans le gâteau. Comme le remplacement par Monti de Berlusconi, celui de Papandréou par Papadémos (quel nom, le père du peuple, ça fait un peu froid dans le dos…) celui de Sarkozy par Hollande ne serait qu’un leurre de fort courte durée, un leurre jeté dans les eaux troubles pour créer, faute de rêve, du répit. On le voit déjà, le pli au front, errer parmi les tombes de 14/18 pour se trouver une stature, quelle inspiration !
Giscard d’Estaing et sa loi de 1973 ont permis à Mitterrand de financer sa « politique sociale » au point de devenir ce Dieu-grenouille ridicule qu’on a connu, qui fut le premier, il faut le rappeler, à précariser la jeunesse avec les TUC de 1983 (le socialisme militant eut la vie brève). Puis cette même loi permit à deux présidents de droite de maintenir à grands frais un geste de hauteur – faute de grandeur (car ceux qui taclent constamment Sarkozy ont oublié que ce dernier n’est que le fils conjoncturel de Chirac en matière de grossièretés et de revirements de veste) – geste de hauteur de plus en plus grotesque, tout en arrosant les plus riches. Chacun des trois derniers présidents a donc laissé creuser le déficit à des fins électoralistes, selon le vieil adage de Louis XV, je crois, « après moi le déluge ». Mitterrand est mort, Chirac à moitié gâteux, Sarkozy presque carbonisé : que peut-on attendre de l'énarque Hollande en train d'ouvrir les narines et d'humer l'air, lui qui n’a jamais dirigé que le PS et ce dans son époque la plus corrompue (et on peut à nouveau savourer là la bonne blague de son copain Mélanchon) quel renouveau, quelle vertu, quelle discipline ? Comme Sarkozy, Hollande ne serait jamais qu’un leurre, qui peut en douter ? d’ailleurs ce vieux roué de Mitterrand le savait fort bien, qui traita un jour Chirac de « faux-dur entouré de vrai professionnel ». Et qui, songeant à l’héritage de souveraineté qu’il laissait à celui qu’il ne considéra jamais autrement que comme son premier ministre, déclara un jour dans l'un de ces sourires mortifères dont il avait le secret qu’il serait, lui, le dernier président français. Après avoir vendu le pays à Maastricht, en faisant basculer de ce côté catastrophique le vote des Français, il savait ce dont il parlait. Toujours en parlant de Chirac, Hollande balança : «Si ce type entre à l’Elysée, n’importe qui peut y entrer…. » On ne saurait mieux dire…
En attendant, le choix que les urnes laissent en 2012 aux classes moyennes est celui de la rigueur imposée (UMP) ou de la rigueur consentie (PS). Entre la peste et le choléra, je ne choisirai pas. Le système a toujours fait passer qui il voulait, on sait bien que Sarkozy & Hollande sont ses deux candidats et que l’un comme l’autre ferait son affaire. Durant les dernières décennies, le peuple, comme ils disent tout le temps (et qu’est-ce que ça a le don de m’énerver), a foutu deux fois le bordel dans leurs belles prévisions : Le Pen au deuxième tour en 2002 et le Non à la Constitution en 2005. Contempteur blasé de ce vieux rite démocratique fatigué et désormais placé sous la Haute surveillance des marchés, j’attends de voir, un peu comme on attend sans l'attendre le dénouement d’une série à laquelle on s’est laissé prendre, autant par lassitude ou désœuvrement, quel leurre sera à l'arrivée en 2012.

20:40 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : politique, françois hollande, france, europe, actualité | 
vendredi, 11 novembre 2011
Etat des lieux
18:58 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : politique, société, tom et jerry | 
mercredi, 09 novembre 2011
La gazette de Solko n°8
05:59 | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : grèce, papandréou, papademos, berlusconi, assemblée nationale, iran, politique, solko, actualités | 
mercredi, 02 novembre 2011
La gazette de Solko n°7
00:07 | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : solko, politique, g20, cannes | 
mercredi, 26 octobre 2011
La gazette de Solko n°6
00:05 | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : solko, europe, politique, actualité | 
mardi, 25 octobre 2011
L'été 73
Cet été-là, le Qatar était tout juste indépendant
On dînait en Grèce pour 3 francs
Sur des terrasses ensoleillées
Personne n’y songeait tant depuis le franc Poincaré
« L’Allemagne paiera » disaient-ils
Le monde, ses nouvelles, ses bars, ses villes,
Avec du papier que décorait le visage de leurs grands hommes
Les francs se croyaient parés, fournis, et comme
La Fleur aux dents chantait
Joe Dassin qui louchait …
Mon premier job rue Bellecordière
Où les rotatives tournèrent
Pour quelques mois encore
Mon père et ma mère vivaient encore
La nuit dans un bar de cette rue
En lisant des auteurs de leur cru
La chaîne régionale émettait à peine
Du papier, nos poches à tous en étaient pleines
Je guettais l’avenir crissant sur ce papier
La tête emplie d’histoires à raconter
Partir, c’était la sainte Parole de ces temps-là même si
Tout n’était pas si
Entre Cendrars et Nizan
Tranché dans l’esprit des jeunes gens
Partir, loin du pays de nos ainés
Loin aussi du mensonge de mai
Avions-nous senti déjà impavides
A quel point nos poches finiraient vides
Et combien nous ne ferions
D’image en image que tourner en rond
Quand du mensonge de mai sortirait président
La rondeur grise de Mitterrand
Regarde, chanterait naïvement Barbara, puis Le Luron, morose,
L’emmerdant, c’est la rose
Mais nous n’en étions encore qu’à Pompidou
La crise, mais de quoi parliez-vous
Et même durant les années Giscard
La crise, auriez-vous fait un micro-trottoir
C’est pas pour nous auraient chanté en chœur
Des millions de téléspectateurs
Le premier juillet de cette année banale
Rockeller et Brzezinki fondaient la Trilatérale…

papier peint années 70
A suivre
21:20 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : politique, littérature, crise | 
mercredi, 19 octobre 2011
La gazette de Solko n°5
06:18 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : politique, actualité, solko | 
lundi, 17 octobre 2011
La farce tranquille

Après une parodie de scrutin et une mise en scène médiatique des plus réussies (on aura même eu droit au plan téle suivant la voiture du candidat aux fenêtres fumées, dans la roue de sa Peugeot en direction de l'Elysée la rue de Solférino ), la société du spectacle a élu son nouvel histrion.
Sentiment désagréable de facticité, que tout ceci n'est que postures, imposture, construction d'images, distributions de rôles et ressassement de mots. Une farce tranquille et mystificatrice, qui recommence. A la fin de la pièce, Hollande faisant applaudir les candidats malheureux, comme après une représentation. Scénographie d'énarques bien huilée, bien rodée, maçonnée en loges. Dans tout ça, comme d'hab', un grand absent dont on parle sans cesse, pourtant : le peuple.

05:54 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (22) | Tags : politique, hollande, parti socialiste |