mardi, 21 décembre 2010
Defense et illustration des oisivetés hivernales
Oisif proviendrait en ligne courbe du latin otium. Courbe, parce que comme beaucoup de mots de formation populaire, il fit un détour par la langue vulgate, ce latin machouillé médiéval, d’où en 1350 jaillit ouesif, lequel donna d’abord oiseux, puis, par changement de suffixe savant, oisif. Quand je lis chez Robert les définitions des deux mots, je me demande quelle connotation tinte le mieux à mon oreille :
Oiseux : « Qui ne sert à rien, ne mène à rien »
Oisif : « Qui est dépourvu d’occupation, n’exerce pas de profession ».
Le mieux n’est-il pas de ne mener à rien ?
De oisif est dérivé oisiveté, qui est l’état qu’on imagine d’une personne oisive (pas nécessairement oiseuse) C’est un mot qui ne s’emploie, semble-t-il, qu’au singulier (on dit crânement que l’oisiveté serait la mère de tous les vices). Le terme s'utilise également au pluriel, pour qualifier un genre littéraire des plus agréables à pratiquer, les Oisivétés.
Les Oisivetés sont des textes qui se reconnaissent au fait d'être nés sous la plume d’un oisif. Peut-être même d’un oiseux, puisque les textes, songes, récits en question ne mènent pas nécessairement à grand chose. Sénèque, en conseillant à Lucilius de ne mener d’otium que studieux, n’était guère éloigné de l’Oisiveté entendue comme telle. Montaigne non plus, qui dès le huitième de ses essais, évoqua des « terres oisives » et, causant de son esprit, déclara qu’il ne pouvait lui faire de plus grande faveur « que de le laisser en pleine oisiveté, s’entretenir soi-même, et s’arrêter et rasseoir en soi » L’oisiveté favorise le bon comme le mauvais imaginaire, et si le mauvais est le prix à payer pour le bon, il ne faut point être avare de ses vices, contrairement à ce que prétend le proverbe.
Les Oisivetés ne sont guère éloignées non plus des Loisirs, autre genre littéraire oublié du siècle ignare où nous sommes. Le Loisir pourrait après tout être l’œuvre de l’oisif, même si les étymologistes nous soufflent à l’oreille qu’il n’en est rien.
Comme les Divertissements, les Loisirs sont davantage tournés vers l’extérieur. Dans cette forme de littérature assez libertine, le bourgeois narre des épisodes galants qui l'arriment davantage du réel, et deviennent donc assez rapidement ennuyeux, comme avec les Promenades ou les Souvenirs. Les Loisirs sont partie prenante du printemps, me semble-t-il. Les Promenades de l’été, les Souvenirs de l’automne. Tandis que les Oisivetés, comme les Divagations, dépendent foncièrement de l’hiver. Tous deux sont ensemble comme l'ongle à la main. C’est en ce sens qu’elles coiffent de haut tous les autres genres susnommés. Et qu’en ce 21 décembre, elles sont, plus que jamais, de saison.
14:33 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, hiver, oisivetés, essais, promenades, souvenirs | 
dimanche, 19 décembre 2010
Arbres en hiver
Le bois sec et tortueux des hauts platanes, lorsque le vent les berce, s’entrechoque. L’hiver, il faut à cacher la corneille, ni n’abrite ses amours. Il pointe de longs bras vides de gueux vers le ciel, comme en direction de vitrines aux marchandises colorées.
Des rumeurs d’osier heurté ponctuent doucement leur aussi haut que frêle et lent et nu balancement rayant le ciel.
Ils font mine, au matin, de boire le soleil. La lueur vient-elle sur le creux mordoré de leurs ocelles se poser, le zigzag de leurs mille fronts demeure, face aux saisons, de glace. Comme s’il fallait dormir encore un peu, au fond de soi, et pas ailleurs, puiser sa permanence.
Jean Couty : paysage d'hiver
09:38 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jean couty, littérature, poésie | 
jeudi, 16 décembre 2010
Reçu à l'Elysée
André Salmon évoque brièvement dans ses Mémoires une soirée où il fut reçu à l’Elysée par Alexandre Millerand. Un huissier assez vieux pour avoir assisté aux derniers instants d’Edgar Faure articula son nom, dit-il, d’une belle voix de chantre laïque, comme si cette annonce devait faire plaisir à tout le monde. La première dame de la République et son homme accueillaient leurs hôtes au seuil du premier salon. Mon salut, écrit Salmon, à la dame. On s’y croirait. Ma main dans celle que me tendait le président aussi lugubrement cordial, ne m’ayant jamais vu, que s’il me connaissait depuis toujours. Il se peut même qu’Alexandre Millerand, précise Salmon, n’écoutant rien, n’ait même pas entendu le nom articulé par le doyen des huissiers.
Suit un portrait en plan américain du président français d’alors : « Massif, cordial jusqu’à faire douter de la cordialité en soi, le plastron gondolé barré du Grand cordon de la Légion d’Honneur (n’est-ce pas Giscard qui a remisé le truc aux oubliettes pour la photo officielle ), celui qui me touchait la main ainsi qu’on dit au-dessous de la Loire, imposait à mon esprit l’image de l’Homme du Discours de Saint-Mandé. Bientôt, l’extrême gauche renverserait comme un simple Mac-Mahon, éjecterait, balancerait Alexandre Millerand devenu l’incarnation de l’esprit réactionnaire. Renvoyé de l’Elysée à son cabinet d’avocat, il n’y retrouverait jamais son ancienne opulente clientèle de grand civiliste. Alexandre Millerand, conclut Salmon dans ses Souvenirs sans fin – page 820 – en serait réduit à plaider en justice de Paix. »

ALEXANDRE MILLERAND (né le 10/02/1859 à PARIS, décédé le 07/04/1943 à VERSAILLES). Il fut président de la République du 23/09/1920 au 11/06/1924
17:54 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, elysée, société, littérature, andré salmon, alexandre millerand | 
mercredi, 15 décembre 2010
A la chausse-pommes
Elle, de ce ton imperturbable, celui des métronomes :
- Qu’est-ce que j’vous sers ?
Lui, d’un ton plus personnel – normal, il n’est là que client - et fatigué :
- Ce chausson aux pommes…
Il n’ira pas lui avouer que ce chausson-là, aux pommes, oui, contient dans le raffinement de ses bouffissures mordorées toute la poésie embuée du mi-décembre reflété sur les vitres, poésie qu'on chantait sur le chemin de l’école, en casquettes et galons dorées, autrefois…
Il n’ira pas...
De la pointe de la langue, comme sur une palette, il recherche quand même le goût de la compote cuite au bain marie, et celui, roux, de quelques éclats de peau rêche attestant de la vitalité en amont d’un fruit jadis accroché à une branche véritable mais là sans doute aussi viennent se glisser au palais quelques texturants, émulsifiants, gélifants, appêtants…
Jadis les boulangères, comme leurs chaussons, avaient des humeurs. Mais leur ton, c'est indéniable, comme l’arôme de leurs chaussons, est devenu univoque.
Nous-mêmes prenons la couleur de ces chaussons.
D’où, c’est le revers de la médaille industrielle, une insidieuse et mélancolique frustration, significativement nichée au lieu-même du péché de gourmandise : Satan lui-même, ironique et falsifié…

05:26 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, chaussons aux pommes | 
lundi, 13 décembre 2010
Qu'as-tu fait de ta jeunesse ?
« Un jour nous vîmes s’asseoir à notre table un garçon fin et maladif, d’une pâleur nacrée. Une barbe légère encadrait son visage, où l’on ne voyait que deux grands yeux, d’une tendresse féminine et d’une rare beauté. Pouvions-nous penser que ces yeux deviendraient ceux d’un coureur de routes et qu’ils se fermeraient aux lueurs d’un drame terrible ? Il nous monte des larmes en pensant au destin de celui qui, vers Pâques, en 1903, vint à nous, le rire aux lèvres et les mains tendues. C’était le plus pur d’entre nous. Sa vie nous fut un charme et sa mort un exemple. Il avait dix-huit ans et s’appelait Albert Londres.
Albert incarnait alors avec une miraculeuse exactitude l’idéal des dernières grisettes. Il eut ce privilège entre tous envié d’être à chaque pas de sa route exactement l’homme attendu. A l’âge des premières amours, comme à tous les âges de sa brève existence, il n’eut qu’à se laisser vivre pour triompher.
Je voudrais le peindre tel qu’il fût. Mais que puis-je ? Ombre chère, comment te retrouver ? Quarante ans ont fui depuis ce matin rêveur où tu nous offris tes premiers vers, une mince brochure au titre anxieux et tendre. Un soleil jaune dorait les toits sous un ciel de coton mouillé. La rumeur étouffée de la ville accompagnait ta voix claire, et ta grâce animait le fier délabrement de notre mansarde.
Dès cette époque, il savait se passer de tout, et, pour commencer, du nécessaire. Jamais, à aucun moment, il n’eut rien d’un bourgeois. De toutes les faiblesses humaines, celles qui lui furent toujours étrangères, c’étaient assurément le goût des aises et la vanité. Plus tar, au temps même où, par état, il dut fréquenter les milliardaires et hanter les palaces, un meublé de troisième ordre suffisait à son confort. Il se passait des petites commodités comme il se moquait des honneurs. Son mépris du décorum s’étendait aux décorations. Jamais, de personne, il n’accepta aucun ruban. Il avait des politiciens de toute nuance le mépris le plus complet. Les gens en place lui faisaient l’effet de chevaux de fiacre. Mors d’ordre et mots creux le dégoutaient également. Patriote à l’extrême, il n’était nullement cocardier. Il ne suivait en aucune façon les musiques militaires. Il ne croyait à aucune louange, à aucune consécration. Lui, si courtois, si curieux, se gardait de lire ce qu’on écrivait sur ses œuvres. Les querelles d’écrivains lui faisaient hausser les épaules. Il ignorait jusqu’à l’existence des snobs. Quant à l’argent, lorsqu’il en eut, ce fut pour le laisser couler entre ses doigts, comme de l’eau. »

Ce portrait d’Albert Londres se trouve au cœur du dispositif de Qu’as-tu fait de ta jeunesse ?, deuxième tome des souvenirs de Henri Béraud.
05:40 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : albert londres, henri béraud, littérature, qu'ast-u fait de ta jeunesse, lyon | 
vendredi, 10 décembre 2010
A me regarder, ils s'habitueront
La campagne médiatique pour l'élection présidentielle a donc commencé. Tandis que DSK joue le dieu absent, Sarkozy le dieu occupé ailleurs, Ségolène Royal et Martine Aubry ont enfourché leur vélo de campagne pour sillonner la banlieue. Marine le Pen a les yeux déjà posés sur les aiguilles du chrono et accuse Michel Drucker, le (vieux) gendre des familles, de faire de l'ostracisme à son encontre. Le palpitant feuilleton pour la désignation du prochain sous-préfet de l’Elysée a commencé.
« A me regarder, ils s'habitueront », a lancé Ségolène durant son pas de danse à Cergy, reprenant à son compte le troisième aphorisme de Rougeur des Matinaux de René Char :
« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder, ils s’habitueront ».
Le « ils » se trouve en italiques dans la version du poète.
Je ne sais ce que le poète aurait pensé de cette métamorphose en slogan de son aphorisme.
La resucée qu’en fait Ségolène est assez équivoque. S’agit-il d’assimiler sa promotion personnelle à un combat politique comparable à celui du maquis en pleine Résistance ? S’agit-il d’une auto-exhortation ironique ? S’agit-il d’un jeu de salon, du genre Précieuses Ridicules (Oyez gens de banlieue comme je suis cultivée...) ?
Cette intrusion du discours poétique assujetti à un discours auto-promotionnel (on ne peut même pas dire un discours politique au stade où nous en sommes de non-programme) met mal à l’aise. Elle avoue sans complexe à quel niveau de narcissisme se pose le débat, et à quel point l'électeur, simple sujet de ce ils, n'est désormais plus qu'un spectateur qu'on méprise.
Arrête ton Char, Ségolène, c'est affligeant.
12:07 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : rené char, littérature, politique, ps, ségolène royal, cergy | 
mercredi, 08 décembre 2010
Kantor et l'abstraction
Drôle de hasard, alors que je vais passer pour la énième fois à des étudiants cet après-midi le film de Benis Bablet, « Le théâtre de Tadeusz Kantor », je découvre que ce dernier est mort il y a pile vingt ans, un 8 décembre 1990, durant les répétitions de Aujourd’hui c’est mon anniversaire.
Du dadaïsme, mais aussi de l’extrême précarité dans laquelle il a commencé, Kantor a pris ce goût pour l’objet pauvre, « incapable de servir, dit-il, bon à jeter aux ordures, débarrassé de sa fonction vitale, nu, désintéressé, artistique, appelant la pitié et l’émotion ».
Mais à présent, Kantor et son théâtre me semblent désormais si loin de nous : en parler devient difficile. Lui-même, lorsqu’il commente son œuvre est souvent répétitif ou confus.
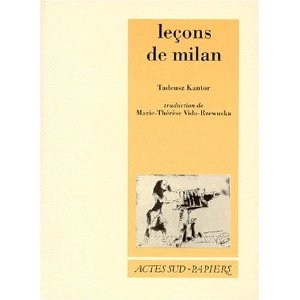
Pour retrouver ce théâtre, le plus difficile est de s’abstraire. S’abstraire de tout ce qui forme le monde aujourd’hui, et des débats dans lesquels nous nous empêtrons. S’abstraire aussi de la scène contemporaine, du spectaculaire et de la technologie qui y règnent. « La professionnalisation théâtrale de plus en plus marquée conduit à sa défaite », disait le maestro dans sa première leçon à Milan. (1)
C’est dans cette leçon qu’il insiste longuement sur cette notion d’abstraction. L’abstraction de Kantor n’est pas l’utopie de la forme pure, jadis prônée par le constructivisme. Elle en est même, dans son souci de révélation du concret le plus théâtral, le contraire absolu : s’il la définit d’abord comme le manque d’objet, l’absence de figure humaine, c’est pour justifier immédiatement la nécessité de leur retour : ainsi n’en finissent pas de revenir à nos mémoires les bancs de la Classe morte ou la roue de char du Retour d’Ulysse, porteurs non plus d’une fonction dans le monde réel mais d’une émotion sur la scène. En ce sens, Kantor a très vite cessé d’être plasticien pour devenir charnellement metteur en scène. « Je voudrais qu’ils regardent et qu’ils pleurent » répète-t-il souvent dans son entretien avec Denis Bablet. Ils, ce sont les spectateurs. Nous.
Quand ce n’est pas un objet, c’est un mouvement, un cercle, une ligne droite, ou la simple répétition d’un geste qui incarnent ce qu’il appelle l’abstraction.
Mais l’abstraction, là encore, n’est abstraite que pour mieux donner corps, voix, mouvement aux personnages. Elle demeure la condition d’existence de leur concret (non spectaculaire) sur la scène.
Il faut pour comprendre cela voir à nouveau et entendre encore cette parade de l’enfance morte dans l' Umarla klasa (la classe morte - suivre le lien sur Youtube). Ces vieillards pathétiques portant sur leurs épaules le poids de leur enfance martyrisée, de leurs illusions bradées, et revenant sur les bancs de l’école pour encore une fois ânonner une leçon qu'ils savent dérisoire, mais qui demeure leur dernier rempart contre la mort, sont restés gravés en moi comme un souvenir de théâtre impérissable.
Placer ainsi au centre de sa démarche l’abstraction, c’est aller évidemment à l’opposé du spectaculaire, lequel privilégie la vitesse, la variété, l’enchaînement. Rien de plus logique, dès lors, que la 12ème leçon de Milan, sous-titrée « avant la fin du XXème siècle » (et qui constitue le testament de Kantor peut-on dire) oppose à la démarche de l’abstraction autant celle de la consommation que celle de la communication.
Cet extrait de la dernière leçon de Milan, daté de 1986 :
« LA CONSOMMATION OMNIPOTENTE
Tout est devenu marchandise. La marchandise est devenue dieu sanguinaire. D'effrayantes quantités de nourriture qui nourriraient le monde entier; et la moitié de l'humanité meurt de faim; des montagnes de livres que nous n'arriverons jamais à lire; les hommes dévorent les hommes, leurs pensées, leurs droits, leurs coutumes, leur solitude et leur personnalité. Des marchés d'esclaves organisés à une formidable échelle. On vend des gens, on achète, on marchande, on corrompt. Création : ce mot cesse d'être un argument sans appel.
Et voici un autre visage de la FUREUR de notre fin de siècle : LA COMMUNICATION OMNIPOTENTE.
On manque de place pour les originaux qui marchent à pied (il paraît qu'un tel moyen de locomotion aide à penser). Des vagues et des fleuves de voiture se déversent dans les appartements. On manque d'air, d'eau, de forêts et de plantes. La quantité d'êtres vivants croît de façon effarante : des hommes .... Continuons : La COMMUNICATION qui s'accorde parfaitement avec les chemins de fer, les tramways, les autobus, a été jugée comme le concept le plus adéquat et le plus salutaire pour l'esprit humain et pour l'Art. Communication omnipotente ! son premier mot d'ordre : la VITESSE, s'est rapidement transformé en un cri de guerre sauvage de peuplades primitives. La devise est devenue ORDRE. Le monde entier, toute l'humanité, toute la pensée de l'homme, tout l'ART doivent exécuter docilement.
Tout devient obligatoirement uniformisé, égalisé et... SANS SIGNIFICATION. »
(1) Editées chez Actes Sud en mai 1990, les douze leçons de Milan, traduites par Marie-Thérèse Vido-Rzewuska ont été composées de juillet à novembre 1986. Tadeusz Kantor.
19:05 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : kantor, théâtre, umarla klasa, la classe morte, littérature | 
samedi, 04 décembre 2010
La nounou d'Helena
« Nous réussîmes à trouver une femme très gentille pour garder notre fille et entretenir l’appartement. Dans un régime comme celui sous lequel nous vivions, avoir chez nous une femme qui nous aidait à élever notre fille et à faire le ménage était une chose non seulement rare, mais périlleuse, voire illicite. D’ailleurs, son statut manquait même de dénomination. D’aucuns l’appelaient la « nounou », mais d’une voix timorée, comme si cela ajoutait encore au danger, car cela faisait partie des anciennes pratiques, autrement dit de celles par quoi on exploitait la force de travail d’êtres humains.
Déjà la recherche de cette nounou avait été toute une histoire. Par bouche-à-oreille, comme dans les réseaux clandestins, on pouvait finir par en dégotter une à condition de ne pas le crier sur les toits. Le Comité de quartier veillait, les Anciens Combattants veillaient, les militants du Front démocratique veillaient. Ils montaient la garde avec zèle, comme ils le faisaient aussi contre ceux qui installaient en cachette des antennes sur leur balcon pour tenter de capter les chaînes de télévisions italiennes. Ces femmes de ménage, seules y avaient droit les familles de dirigeants. Dès que ces familles constataient que quelqu’un d’autre disposait de ce qu’elles pensaient être les seules en droit de posséder, leur amour-propre maladif crevait les yeux »*
Helena Kadaré, Le temps qui manque, Mémoires, Fayard
* La situation rapportée se situe bien sûr en Albanie, vers l’année 1965. La photo ci-dessous est d'Elliott Erwitt

16:17 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : elliott erwitt, helena kadaré, littérature, photographie | 
vendredi, 03 décembre 2010
La "gallaire" Houellebecq
Florent Gallaire, le blogueur juriste qui avait mis à la disposition des internautes une version numérique de La Carte et le territoire de Houellebecq l’a finalement retirée, suite aux injonctions de Flammarion, tout en maintenant pourtant la "pertinence" de son analyse juridique sur la première page de son blog. Pour lui, le fait que Houellebecq ait inclus dans son texte plusieurs articles de wikipédia transformait ipso facto le texte entier (428 pages) en œuvre libre, par conséquent téléchargeable à volonté.
Le roman aurait été téléchargé plusieurs milliers de fois.
A y regarder de près, ces quelques milliers d’exemplaires qui se baladent dans la nature virtuelle auront surtout constitué un double instrument de promotion :
-pendant une dizaine de jours, on aura ça et là continué à parler du Goncourt 2010.
-ceux qui l’ont téléchargé l’auraient-ils acheté ?
Il me semble que Florent Gallaire, qui vient d’accéder à une éphémère notoriété grâce à sa confusion (sans doute volontaire) entre « libre de droits » et « licence libre » pourrait être un personnage de cette comédie décomposée, de ce monde où on survit par à-coups médiatiques, et qui constitue le monde romanesque de Houellebecq.
Je ne suis ni houellebecquophile ni houellebecquophobe. Il est cependant clair que Houellebecq avait les moyens de masquer ses quelques emprunts en soignant les raccords narratifs avec le reste du texte. Pourquoi a-t-il pris grand soin, au contraire, de les rendre visibles en créant même un effet de rupture de ton assez saisissant ?
A la première lecture du texte, il m’a semblé évident que Houellebecq se situait davantage dans une volonté de collage et de parodie que dans un souci de plagiat : ces interventions, qui miment assez lourdement (1) les interventions d’auteurs des vieux narrateurs omniscients du temps des Goncourt, n’amènent rien au roman, sinon un effet comique et un certain discours en creux sur la culture en toc d’aujourd’hui, lequel rejoint d’ailleurs le propos global de l’œuvre entière du romancier. Comme Houellebecq lui-même s’invite dans son roman en tant que personnage, il y fait entrer Frédéric Nihous et quelques autres notices de wikipédia. Manière d'évoquer la pauvreté et la tristesse du réel dans lequel évolue Jed Martin et ses comparses.
Florent Gallaire, ainsi qu’Eric Cantonna et ses déclarations aussi fracassantes que vaines sur la révolution du 7 décembre, pourraient tout aussi bien devenir les particules élémentaires d’un prochain roman. On voit bien, in fine, qu'ils ne valent guère mieux que ça. Personnages de leur temps, emblématiques de son dérisoire.
Une question, cependant, demeure pendante :
Ce roman, quel romancier aura à coeur de se donner encore la peine de l’écrire ?
(1) Voir le billet consacré au roman ICI

12:38 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : florent gallaire, michel houellebecq, prix goncourt, littérature, société, wikipédia | 









