mardi, 18 janvier 2011
Man with beer
Que faire de la réalité d’un désespoir ?
De la présence de Mélancolie ?
Tenter de la travestir au risque du surfait ?
Il ne le faut, non.
L’accepter plutôt comme la trace d’une conscience
Telle, sais-tu, celle du renard sur la neige :
Une conscience – ta conscience, malheureux,
Oui, l’accepter, ce désespoir,
En conscience, en effet.
Alors redevient plausible l’évidence de la joie
Car le récipient dans l'épreuve
Est demeuré intact

Photo : Man with Beer, 1899
00:00 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : politique, solitude, villes, poésie | 
lundi, 17 janvier 2011
Quoi qu'il en soit
Quoi qu’il en soit, on en revient toujours à sa misère,
Celle dont les reflets dans la ville vous alpaguent,
Et dont l’époque est emplie comme une outre,
Et dont il faudra un jour ou l’autre
Mourir.

00:28 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : politique, actualité, solitude | 
samedi, 15 janvier 2011
L'étudiant au salon
Je ne veux pas faire d’analogies déplacées, mais enfin, la halle Tony Garnier fut à Lyon, durant plusieurs décennies, un abattoir, pour ne pas dire l’abattoir municipal. Veaux, vaches, cochons y rendirent donc en masses beuglantes ce qu’ils avaient d’âme, avant d’aller remplir en tranches et morceaux les assiettes des bonnes et braves gens d’entre Saône et Rhône.
C’est entre ces murs que depuis hier et jusqu’à demain se tient le salon de l’étudiant.
Passage obligé d’un parcours qu’on nomme désormais pré-professionnalisant ; dans les travées étroites entre les multiples stands, de longs convois de marcheurs : on cause masseterre, bétéhesse et class’prepas, en familles ou en couples.
Ce n’est là, me direz-vous, qu’une parenthèse de temps sérieux, pris en sandwiches entre des spectacles du plus haut intérêt (des animations waltdisneyesques, un tour de chant nohâesque, une soirée avec Michel Sardou, voyez, que du divertissement mainstram très basic, suffit de consulter le programme, quoi) .
Mais là, en attendant, c’est du sérieux, l’avenir des petits, quoi !
On compulse avec fébrilité ou détachement les brochures emplies de sigles et de photos, on interroge, on a – et c’est un peu normal dans toutes ces traverses – du mal à trouver le chemin de l’avenir. Tel métier : combien ça gagne ? L’avenir ? A quoi ça ressemble ? Et puis, combien sommes-nous sur le coup ?
Une certaine morosité s’installe.
Trouver sa place, y accorder son goût, ni simple ni facile, dirait-on. C’est alors qu’on s’aperçoit que pour les parents les plus modestes, la novlangue technicienne des sciences de l’orientation, c’est de l’étrusque, pour ne pas dire du basque paléolithique. Voilà que cela saute aux yeux, combien tout est démontable dans cet univers en kit, et que même les plus sages, les plus sérieux, les mieux avertis d’entre nous, ne faisons qu’y passer, passablement désorientés à l’endroit où ça compte, celui du cœur.
Au cœur de l’après-midi, justement, je me suis pris à rêver à ce que Justin Godart écrivit en 1899 dans sa thèse sur l’Ouvrier en Soie : Justin Godart expliquait qu’un apprenti-tisseur passait au minimum cinq ans en apprentissage chez un maître, avant de subir l’examen dit « du chef d’œuvre », puis de devenir compagnon pour au minimum rester deux ans chez un nouveau maître, chez lequel il devait dormir chaque soir, gage de son sérieux. Au sortir de cette « formation», il n’était encore qu’un ouvrier, et pas un « Bac + 7 ».
« Pendant les années de l’apprentissage, écrit Godart, « l’homme se développe, à qui bientôt on pourra en toute sécurité (le point est d’importance) décerner ses lettres de maîtrise. » La maîtrise arrivait enfin, et avec elle « l’inscription faite sur les registres de la Communauté, aux armes de la ville » Alors seulement l’ouvrier en soye pouvait s’installer à son compte, et revendiquer le titre de ce métier.
Combien (s’ils revenaient), ces gens-là - qui tissèrent entre autres les splendides teintures de Versailles et des robes d’évêques par centaines - s’étonneraient de voir ces bacheliers à la fois si vaniteux et si désemparés, errant d’un stand à l’autre, à la recherche de quoi – finit-on par se demander, la barre au front dans ce brouhaha en fin d’après-midi.
On se dit finalement que tout comme mères, pères, grand-mères, femmes, amoureux et autres ont leur fête et leur journée, il convient que comme l’automobile, l’agriculture, le livre, le mariage ou le chien, l’étudiant aussi ait son salon.
Et que cela, seul, est ce qui compte.

19:57 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : salon de l'étudiant, lyon, orientation, politique | 
jeudi, 13 janvier 2011
Père peinard
Tout à l’heure, un homme traînait à grand peine un géant aux arêtes nues, qu’il a balancé par-dessus la barrière. Le géant a rebondi sur le matelas de ses collègues déjà abandonnés dans cette sorte de décharge improvisée depuis quelques jours sur la place, avant de s’immobiliser dans une posture grotesque, le tronc renversé vers le ciel. En divers points de la ville, s’entassent ainsi ce qui reste des sapins.
Le soir, des camions municipaux viennent ramasser leurs cadavres. Une odeur vive de résine s’échappe des bois secs, lorsque des dents de fer les broient. Quelques secondes de vacarme, puis plus rien. On a le sentiment que tout, ainsi, du monde qui rutile, sera peu à peu ingéré, absorbé. Orifice final, terme de tout événement. Décharge finale.
Deux employés balaient en sifflotant sur l’asphalte des débris de rameaux verts, épars, Quand le trottoir est nickel, ils sautent sur le marchepied du camion, leurs instruments en mains. Le camion benne s’ébroue, avant de disparaître au virage dans la relative obscurité de la ville, les feux arrière clignotant comme des clémentines
J’en connais un qui, quelque part, sourit à vives dents, allume enfin sa clope. Pour quelques mois, et pour de bon, père enfin peinard.

06:08 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : société, noël, sapins, actualité, consommation | 
mardi, 11 janvier 2011
L'argot qui se perd
« Pour être un homme du Milieu, il faut huit choses : avoir fait du ballon, être bousillé, savoir valser à l’envers, être nasi, ne pas se dégonfler, avoir une femme sur le tapin, savoir jouer à la belotte et jaspiner le jars. »
Edmond Locard, Confidences, Ed, Joannes Desvigne, 1951

Laboratoire de police de Lyon, atelier photographique, tatoué, papier au gélatino-bromure d’argent, v. 1930, fonds Edmond Locard, coll. ENSP, Saint-Cyr-au-Mont-d’or.
08:31 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : argot, edmond locard, langue française | 
dimanche, 09 janvier 2011
René Leynaud, poète
« Vivant je ne le suis sinon qu’en vos poitrines
Réside encor la voix que la mort me ravit,
Et redire mon nom me fait l’ombre divine
Du soleil de mes jours venir à mon envi
Et moi venir à moi, et ma chair transparaître
Mieux acquise aux voix que mon chant ne sut l’être »
 Les poésies de René Leynaud ont plusieurs été fois exhumées. Une première fois par Francis Ponge qui, triant dans les papiers que la veuve du résistant fusillé à trente quatre ans lui donna, supervisa la publication du premier recueil posthume en 1947. Une seconde fois par Paul Gravillon, journaliste au Progrès qui fut à l’origine de la réédition par les éditions Comp’act et le Goethe Institut de ce même recueil, en 1994.
Les poésies de René Leynaud ont plusieurs été fois exhumées. Une première fois par Francis Ponge qui, triant dans les papiers que la veuve du résistant fusillé à trente quatre ans lui donna, supervisa la publication du premier recueil posthume en 1947. Une seconde fois par Paul Gravillon, journaliste au Progrès qui fut à l’origine de la réédition par les éditions Comp’act et le Goethe Institut de ce même recueil, en 1994.
« Je l’ai connu par hasard dans une anthologie de Seghers. », raconte ce dernier. « J’étais fait-diversiers de nuit au Progrès». Découvrant qu’il avait été journaliste au Progrès, Gravillon écrivit à Gallimard et reçut le recueil. Il découvrit alors une amitié entre un écrivain qu’il admirait (Albert Camus) et un jeune poète qu’il ne connaissait pas. « Modeste et mystérieux », dit Gravillon, fort justement de Leynaud, en parlant de l’intérêt humain qu’il ressentit à lire ses textes.
Dans ses poèmes, Leynaud, le martyr de Villeneuve dans l'Ain, évoque si souvent la mort que sa femme parla à leur sujet un jour de « textes prémonitoires ». Les trois derniers paragraphes d’un long poème en prose, Etre, sont, de ce point de vue, magnifiques :
«Soudain, et sans que je le voulusse, je me trouvai debout contre la vitre. Je regardai au-delà de mon visage dressé dans un reflet.
En bas le kiosque, les arbres, ce qui m’apparut de la place, les trottoirs, les quais, tout était renversé dans une lumière bouleversante de déluge. Le paysage entier, ciel livré à la terre, s’ordonnait suivant une certaine détresse, un désespoir sans cause d’exister.
Et je compris soudain dans une soudaine lenteur, que cette détresse c’était celle-là même que je n’avais pas reconnue en moi, noyée sans visage, lorsque je marchais en quête de ton absence. Et je fermai les yeux pour mieux te nier, toi, sans nom, sans voix, sans regard, toi, contre tous les désirs de mon être, que je retrouvais dans cette maison illuminée de bitume et d’eau, et tapie sournoisement au creux de cette chambre où j’étais seul, enfermé dans ma déchirante volonté d’exister enfin hors de tout. »
Magnifique est également, dans ce recul où nous sommes par rapport à l’événement de la Résistance, cette longue préface de Camus à son ami. Cet extrait, parmi d’autres, dans lequel il narre leur conversation au 6 de la rue qui porte aujourd’hui son nom, au bas des pentes, dans la chambre de bonne où il l’hébergeait lors de ses visites à Lyon : « J’aimais le voir rire. Il le faisait rarement, si j’y réfléchis, mais alors de tout son cœur et jeté sur sa chaise avec abandon. L’instant d’après, il était debout, dans une position où je le revois souvent, les pieds un peu écartés, roulant ses manches très au-dessus des biceps et relevant ses bras solides pour essayer de discipliner ses cheveux toujours en désordre. Nous parlions de boxe, de bains de mer et de camping. Il aimait la vie physique, l’effort, la terre fraternelle, et tout cela silencieusement, à la façon même dont il mangeait, avec un bel appétit taciturne. Quand minuit approchait, il vidait sa pipe, disposait de nouvelles cigarettes dont il me priait d’user pendant la nuit, et, la veste sous le bras, partait d’un pas vigoureux. Je l’entendais encore dans l’escalier et je regardais autour de moi ce qui lui appartenait. »
A Camus, René Leynaud écrivit : « Je me suis souvent demandé si je ne m’exerçais pas à la poésie pour me démontrer à moi-même que je n’étais pas poète, ou encore pour tuer en moi le prestige des mots, qui est grand. Déjouer, tromper les mots qui nous séparent de nous-mêmes et de Dieu. Car il est vrai peut-être que les mots nous cachent davantage les choses invisibles qu’ils ne nous révèlent les visibles. J’ai parfois le dégoût de la poésie, ma passion profonde. C’est dans ces moments-là que je me sens le plus près d’autre chose. »
Et Camus de rajouter : « Aujourd’hui, délivré de toute passion, délivré de la poésie, Leynaud n’appartient qu’à cette autre chose. Il savait, en m’en parlant, que cette autre chose n’avait pas de sens pour moi et que le seul endroit où je pouvais le rejoindre était sa certitude. Mais il aimait ma différence comme j’aimais la sienne. Et quelle que soit la vérité de cet appel qu’il ressentait, le déchirement où il était, et qu’il me disait si simplement, suffit à lui donner tort quand il doutait d’être poète ».
21:51 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : rené leynaud, poésie, albert camus, littérature, paul gravillon, lyon | 
samedi, 08 janvier 2011
Verlaine et la beauté du quelconque

C’est aujourd’hui l’anniversaire de la mort de Verlaine qui, le 8 janvier 1896 à dix-neuf heures, mourut d’une congestion pulmonaire au 16 rue Saint-Victor à Paris, à l’âge de 52 ans. Rendre l’âme le mois de Janus dut ne pas être trop incongru pour l’auteur des Poèmes Saturniens : on sait que les deux dieux s’entendaient en effet comme culs et chemises au temps de l’âge d’or. Je vous souhaite donc de passer un samedi verlainien en diable, à goûter la double nature du monde et la fadeur du langage, dans ce « quiétisme du sentir » si propre à Janus, le dieu aux deux visages, et à Verlaine lui-même, le pauvre Lelian, dont Jean Pierre Richard (1) écrivit un jour que la poésie trouvait sa source dans un dédoublement assumé de la perception : « Car tout comme Rimbaud, Verlaine pouvait écrire que « Je est un autre » ; mais alors que Rimbaud, une fois cet autre découvert, se livre entièrement et frénétiquement à lui, Verlaine ne peut abolir en lui la voix ancienne, et il se condamne donc à demeurer à la fois JE et Autre. Il sent sur le mode de l’anonyme, mais il se sent sentir sur le mode du particulier. Et c’est dans cet intervalle que se situe sa poésie. Elle dit l’étonnement et la couleur d’un être à demi aliéné transporté dans un paysage dont il ne peut que découvrir le sens, et dans lequel il lui est cependant interdit de tout à fait se perdre. »
Quel amoureux, en effet, sinon l’amoureux verlainien, reste à même de dire : « J’aime vos beaux yeux quelconques », transformant la platitude du cliché (« t’as d’beaux yeux, tu sais ») en un des plus beaux compliments qui soit « tes yeux qui pour tous sont quelconques sont pour moi les plus beaux »), et sans oublier ni la Laure de Pétrarque, ni la Cassandre de Ronsard, avec l’espièglerie d’un Murger, empiète déjà le territoire à venir d’un Marcel Carné ?
(1) Jean-Pierre Richard « Fadeur de Verlaine », Poésie et Profondeur, Seuil, 1955
Lire aussi : Tant de beau monde pour un poivrot.
10:34 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : littérature, poésie, verlaine, jean-pierre richard | 
vendredi, 07 janvier 2011
Mortes saisons du langage
Heureux de me retrouver, clavier en main sur un site que j'affectionne particulièrement, à l'occasion de ces vases communicants. Pendant que je vous parle, là, sur Solko, de langage et de son saccage chaque jour répugnant, l'ami Roland a pris les clefs de l'Exil et s'est installé chez moi. Manière pour nous deux de concrétiser publiquement une complicité que nous avons depuis bientôt deux ans sur cette inextricable tissage de textes que constituent les blogs.
Amicalement
Bertrand
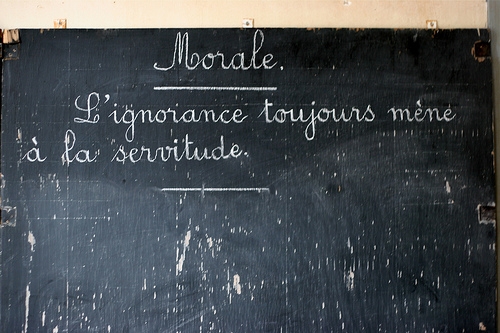
Pauvre langage ! Langage de pauvres !
Vous le savez aussi bien que moi, mais j’ai quand même toujours envie de le dire…Plus rien ne signifie rien….Je lis, par exemple - car on pourrait multiplier les exemples à l’envi - : « Le moral des ménages est en baisse » ou, a contrario, « le moral des ménages est au beau fixe ».
Le moral réduit à son expression la plus triviale : le taux de consommation.
Le cœur de la vie-même chiffré, pesé, évalué, soupesé, vendu, mesuré, établi, estimé, jaugé, aliéné, négocié, soldé, liquidé, rétrocédé, monnayé, calculé, compté, combiné, agencé, réfléchi, troqué à l’aune de la masse de cochonneries entassée dans la chaumière du citoyen.
Langage mort, reflet d’une réalité morte.
J’avais, pour de Non de Non, écrit cette chanson que j’avais affublée d’une musique : Sim, La, Ré, La, Sim, Fa dièse mineur etc.…Le projet était de l’enregistrer et de la mettre en ouverture de blog.
Ça ne s’est pas fait…Il m’arrive de la chanter en solo. C’est toujours un peu naïf, une chanson. Et comme Roland était un co-auteur de Non de Non, l’occasion des vases communiquants s’offre à moi de la lui offrir :
Ils ont envahi nos pays
Et ravagé nos territoires,
Sans une salve, sans un fusil,
A la seule force de leurs miroirs.
Ils ont déformé tous nos mots,
Ils ont pillé notre langage
En l’enfouissant sur leurs images,
Nous ont murés dans leur ghetto.
Couper la langue des insoumis,
C’est plus propre que d’leur couper l’cou,
Et c’est surtout mieux garanti
Pour les voir vivre tous à genoux.
Quoi que tu dises, que tu écrives,
Ta rime ira à leur moulin,
Ta poésie à la dérive
De toi ils feront une putain !
Nous sommes condamnés au silence
A moins de leur faire allégeance.
Y’a plus qu’à mettre dans la balance,
Tout l’désespoir de la violence
Et fi de toute hésitation,
Atermoiements et réflexions,
Nous ne reprendrons la parole,
Qu’aux accents de la Carmagnole.
06:22 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : bertrand redonnet, poésie, littérature, l'exil de mots, chanson | 
jeudi, 06 janvier 2011
Kontrepwazon : à la gloire d'un blog défunt
ELOGE DU GRAND STATISTIQUEUR
JE SUIS LE GRAND STATISTIQUEUR.
Je vais prononcer mon propre éloge, parce qu’on n’est jamais si bien servi que par soi-même, d’une part, et d’autre part, parce que les Français passent leur temps à dénigrer l’INSEE (vous savez, l'Institut National de la Statistique).
Alors, en vérité, je vous le dis : la statistique est un presse-citron.
Je te définis la statistique en deux mots : le pouvoir a besoin de moi pour connaître la réalité sociale, qui est inconnaissable, à cause du nombre et de la complexité des phénomènes à prendre en compte, ça vibrionne en permanence, vous allez dans toutes les directions, toujours en mouvement. Vous êtes trop nombreux, aussi, faudrait voir à vous arrêter de copuler, de procréer. Vu la quantité de chair humaine ainsi produite, le chef a forcément besoin d’en savoir un peu plus. La statistique (certains diront « sociologie quantitative »), pour cela, construit un modèle mathématique. Les Anglais ne parlaient pas de « statistiques », mais de « political arithmetic », avant d’adopter le vocable. C’est assez dire que la statistique n’a de valeur que pour celui qui gouverne. D’ailleurs, le mot vient du latin moderne « statisticus » (1672), « relatif à l’Etat ».
Autrement dit, appliquée à la société, la statistique a pour seul but de REDUIRE, d’où le presse-citron.
Pour moi, le grand statistiqueur, dans mon univers, toi, INDIVIDU, tu n’as aucune valeur, tu n’existes même pas, perdu dans tous mes nombres. La profondeur et la richesse de ta personnalité, l’étendue et la précision de ton savoir, la vivacité et l’ampleur de ton intelligence, tes petits bonheurs et tes grandes souffrances, je m’en tamponne le coquillard. Tu ne m’intéresses que comme une SOMME DE DONNEES. Moi, le grand statistiqueur, je me contente de définir des critères, puis de rassembler les données.
Par exemple, en 1999, en France métropolitaine, je peux te dire qu’il y avait 28.419.419 hommes et 30.101.269 femmes. Ne me parle pas de l’anatomie du sexe, et ne me parle pas de l’amour : ce n’est qu’un critère, je te dis, rien de plus.
JE SUIS LE GRAND STATISTIQUEUR : TOUT CE QUI EST HUMAIN M’EST ETRANGER.
L’homme ne m’intéresse que découpé en tranches et en morceaux, des tranches et des morceaux de plus en plus petits, de plus en plus fins, par exemple : « Votre dernier achat d’une paire de chaussures ? Vous grattez-vous le nez au feu rouge ? Faites-vous confiance à Nicolas Sarkozy ? ».
Et des critères, je t’en fabrique quand tu veux : l’Europe veut fixer des normes pour la fabrication des préservatifs masculins ? C’est moi qui lui fournis les informations : taille moyenne du pénis en érection en Europe : 14 cm. L’industrie du vêtement s’aperçoit que les dimensions des êtres qu’elle habille ont changé ? C’est moi qui actualise ses données. Combien de yaourts chocolat, nature ou fruits rouges faut-il mettre dans les linéaires de l’hypermarché ? C’est encore moi qui réponds.
JE SUIS LE GRAND STATISTIQUEUR : JE SUIS PARTOUT, JE SUIS INDISPENSABLE.
Sinon, tu imagines le gaspillage. Je suis là pour optimiser les performances, les rendements, la rentabilité. Je suis la machine à mesurer les hommes, pour améliorer le fonctionnement de la grande machine sociale.
Je suis l’outil obligatoire de tous ceux qui dirigent, de tous ceux qui décident et de tous ceux qui gèrent : les patrons, les chefs, les administrateurs, les bureaucrates. La statistique est le Saint Graal du gestionnaire, comme le sondage est le Saint Graal de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal. C’est d’ailleurs à peu près la même chose, non ? Le dirigeant politique aujourd’hui n’est qu’un directeur d’hypermarché (mais il est un peu tôt pour en parler). Je me rappelle Lionel Jospin, ministre de l’Education en je ne sais plus quelle année, qui parlait de son « stock de profs », et ça, depuis que l’économique a triomphé du politique.
Je m’occupe de la hauteur des chaises (45 cm), des tables (75cm), des marches d’escalier (18 cm). En vérité, c’est moi qui conditionne le concret de ton existence quotidienne. Le moindre objet que tu utilises est passé par ma fabrique de données. Pourquoi Monsieur Renault fabrique-t-il beaucoup de voitures pour quatre personnes ? Pourquoi 9 m2 pour une chambre ? Pourquoi ? Pourquoi ? Moi, moi, moi, toujours moi. Je définis, j’encadre, j’oriente. Dans le fond, c’est moi, LA STATISTIQUE, qui architecture ton espace et qui modèle ton temps, bref :
JE SUIS LE GRAND STATISTIQUEUR : C’EST MOI QUI DIMENSIONNE TON EXISTENCE.
Et tu sais comment je fais ? Je vous prends chacun un par un, oh pas tous, on n’en finirait pas, mais j’ai inventé le fabuleux ECHANTILLON REPRESENTATIF, la source inépuisable à laquelle je me désaltère. Et puis j’extrapole, je généralise, j’uniformise. Et cela, à travers une autre fabuleuse invention : LA MOYENNE. Tu as compris comment et pourquoi tu cesses d’exister, individu ? Parce que pour moi, tu n’es qu’un écart par rapport à la moyenne. Pourquoi crois-tu qu’on a pu parler de « Francémoyen », il y a maintenant des lustres ? C’est grâce à l’avènement du règne tout puissant de LA MOYENNE.
Il me suffit alors de dérouler toute la gamme de mes produits : la consommation moyenne (café, cannabis, épinards en boîte, séances de cinéma, etc.), l’âge moyen (apprendre à marcher, premier rapport sexuel, réussite au bac, mariage, longévité, etc.), la distance moyenne (suivant la région, la profession, la période, etc.), la fréquence moyenne des prénoms, etc. De ma moulinette à nombres et à catégories (ce sont les petits morceaux d’humains que j’ai savamment découpés), j’extrais ainsi des milliers de moyennes possibles, qui finissent par dessiner, fais bien attention à ce point : qui finissent par dessiner tous les aspects possibles de l’existence humaine. Toutes les variétés et variations de l’individu ont fini par entrer dans les cases que j’ai élaborées. Tu te rends compte de ce que ça veut dire ? Toi, petit grain individuel de sable, avec tes arrêts et tes trajectoires, TU ES DEVENU ENTIEREMENT PREVISIBLE.
C’EST MOI, LE GRAND STATISTIQUEUR, QUI T’EXPLIQUE TON EXISTENCE.
Oui : à force de te disséquer, toi l’individu, et de confectionner des petites boîtes où j’enferme ta vie sous forme de données chiffrées, à force d’énumérer tes caractéristiques, en partant des plus générales et en allant jusqu’aux plus individuelles, j’ai tout su de toi, tu es devenu totalement transparent. Et toi, à force d’être imprégné de l’idée de moyenne, tu t’es dis : il ne faut pas être trop au-dessus ou trop au-dessous. Tu ne supportes pas l’écart, tu veux être comme les autres, tu as peur d’être différent. On appelle ça d’un mot banal et dévitalisé : le conformisme. C’est très intéressant de voir comment ça se passe : LA MOYENNE finit par devenir LA NORME. D'un moyen de connaître la population, je suis devenu un moyen de la gouverner, et cela sans qu'elle s'en doute. Image de la réalité, je suis devenu la réalité elle-même, que nul ne songerait à ne pas considéreer comme telle. Je suis devenu un objet de croyance, et d'autant plus puissant que la "réalité" me valide, que je ne parle que de "faits". Je suis à présent, LA RELIGION DU FAIT.
Ton psychisme, tes gestes, tes actes, tes façons de voir sont imprégnés de cette norme, et sans t’en rendre compte, progressivement, tu te mets à ne plus exister par toi-même, mais à OBEIR. Le moule de la moyenne s’en est pris à ton cerveau, à ta mémoire, à tes projets. La façon dont tu voyais les choses est réécrite : tu diras, de quelqu’un qui vient de mourir à 65 ans : « Tiens, c’est plutôt jeune ». Réfléchis à cette énormité, et dis-toi qu’elle prend sa source dans la moyenne, devenue norme, parce que je l’ai fait et voulu ainsi. C’est une forme de SOUMISSION, c’est une forme de disparition.
JE SUIS LE GRAND STATISTIQUEUR : JE FAIS DISPARAÎTRE L’INDIVIDU.
Oui, tu es mort, et tu n'as rien senti.
JE SUIS LE GRAND STATISTIQUEUR : JE CREE LE MONDE A VENIR.
Alleluïa !
(Et la foule, percluse de ferveur extatique : « Gloire à toi, Grand Statistiqueur ! – Oui, bon : allez, couché ! A la niche, la foule ! ».)
_____________________________________
Ce texte a été écrit en novembre 2007 par Frédéric Chambe, et publié par ses soins sur son blog Kontrepwazon, aujourd'hui défunt, que je vous conseille d'aller visiter en cliquant sur ce LIEN.
PS : Si le blog est défunt, l'auteur va bien, je le précise.
05:37 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : statistique, littérature, politique, kontrepwazon | 









