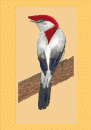mardi, 04 novembre 2008
L'abbaye, le jardin, l'amphithéâtre
Le 8 juin 1785, le représentant du peuple Dupuis décide la formation à Lyon d'un Jardin des Plantes dans l'ancienne abbaye des Dames Bénédictines de la Déserte, située sur les pentes de la Croix-Rousse. En 1805, le tout jeune jardin est baptisé « Jardin de l'Impératrice », en hommage à Joséphine de Beauharnais qui fait don de plusieurs plantes exotiques qu'elle avait acclimatées dans son château de la Malmaison, parmi lesquelles une somptueuse collection de roses. A partir de 1831, Charles Seringe, directeur du Jardin, décide d'orienter ce dernier vers la réalisation des objectifs scientifiques de son temps : il constitue un herbier de plus de 17 000 plantes, une collection de bois utile à l'ébénisterie, rassemble une imposante collection de céréales utiles aux agriculteurs, met en place le premier étiquetage systématique et instaure un cours gratuit pour les étudiants des Beaux-arts à l'intérieur du Palais Saint-Pierre. Ravagé par un ouragan en 1853, le Jardin des plantes ferme alors ses portes. Quatre années plus tard, en 1857, profitant de l'inauguration aux Brotteaux du Parc de la Tête d'Or, Seringe transporte dans le tout nouveau jardin botanique toutes ses fragiles et précieuses collections. A partir de ces années là, le jardin des Plantes continue son développement dans ce Parc tout nouveau, fierté du préfet Vaisse, qui accueillera l'Exposition Universelle de 1876, tandis que l'ancien redevient un paisible jardin de quartier, un lieu oublié et sans histoire comme il en existe des centaines dans cette ville.
A cette époque, on savait bien qu'il y avait eu un amphithéâtre à Lyon, mais son emplacement, depuis le XVIème siècle, demeurait une énigme, l'énigme centrale de toute l'archéologie lyonnaise Le lieu était d'autant plus légendaire qu'en son enceinte avaient été martyrisés les premiers chrétiens de la communauté gallo-romaine, dont Blandine, Alexandre et Pothin. D'abord localisé à Ainay, puis à Saint-Jean, enfin à Fourvière, il fut enfin situé avec certitude grâce à la découverte de sa dédicace, sous le vieux Jardin des Plantes, devenu entre temps un jardin banal que se partageaient depuis un siècle pigeons, enfants, amoureux et nourrices. Des blocs de calcaire du midi donnant la nature du monument (un amphithéâtre), le nom des deux personnages (Rufus père et fils) ayant financé une partie de sa construction, furent exhumés et le mystère de l'emplacement de l'Amphithéâtre des Trois Gaules se trouva enfin résolu.

Le touriste peut éprouver une déception légitime devant ce maigre réduit de terre rouge finalement exhumé, les quelques débris de gradins offerts à sa vue. C'est tout ce qui reste de la magnificence de l'Amphithéâtre des Trois Gaule qui dominait majestueusement Lugdunum sur la colline de Condate. Rien de plus lyonnais, finalement que ce bâtiment dilapidé dont les siècles et leur nécessité ont dispersé les pierres, et que l’imaginaire seul peut relever à sa guise : utilisé comme carrière afin de construire les murs de bords de Saône et bâtir les premières sanctuaires chrétiens, comme beaucoup d’autres au cours de l’histoire tumultueuse de cette ville, comme l’autel de Rome et d’Auguste, comme les églises Saint-Etienne et Sainte Croix, comme l’hôpital de la Charité, il s’est tout simplement « évaporé ». Ce n'est pas le moindre charme de l'histoire cette ville fascinante, qu'un amphithéâtre se mue en abbaye, laquelle cède la place à un Jardin des Plantes, lequel accouche finalement du simple souvenir de l'amphithéâtre des commencements.
00:15 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : lyon, joséphine de beauharnais, jardin des plantes, amphithéâtre, abbaye de la déserte, urbanisme | 
lundi, 03 novembre 2008
20 francs & les faux-monnayeurs
Le cartouche de ce billet, dessiné par Chazal, avait d'abord servi pour une coupure de 25 francs, dont l'impression ne dura que quelques mois, du 16 aout au 5 décembre 1870. A l'occasion de sa sortie, la Banque de France inaugura son imprimerie de Clermont Ferrand, où la moitié du stock postérieur vit le jour. On trouve au recto une allégorie très classique de l'industrie.
Muse adulée d'un dix-neuvième siècle septuagénaire, elle trône, assise au centre un cadre de feuillages. Ronde de visage, lar ge de hanches, dans le genre de Lisa Macquart, la charcutière du Ventre de Paris dont la chair se confond avec l'étal. Comme tous les billets dits bleus de ces temps-là, cette coupure fait la fête à l'article 139 du code pénal, qu'elle reproduit quatre fois (deux fois par face) dans des cercles bleu foncé : Depuis le 12 août 1870, on punit des travaux forcés à perpétuité tous ceux qui se risqueraient à contrefaire, falsifier ou introduire à l'intérieur du territoire français de faux-billets. Ce billet de vingt francs, bicolore sur fond pâle, reste d'une imitation facile pour bon nombre de professionnels le 25 septembre 1873, le nombre de contrefaçons atteint 48, 21 faussaires sont condamnés par les tribunaux. Trois ans plus tard, un rapport de la Banque de France signale que 15.769 billets de 20 francs faux sont en circulation. La plupart proviennent d'ateliers installés en Espagne, à Pampelune et Barcelone (1). Il fallut donc, pour déjouer de nouvelles contrefaçons, changer de billet, et améliorer ce qu'on appellerait à présent « le design »
ge de hanches, dans le genre de Lisa Macquart, la charcutière du Ventre de Paris dont la chair se confond avec l'étal. Comme tous les billets dits bleus de ces temps-là, cette coupure fait la fête à l'article 139 du code pénal, qu'elle reproduit quatre fois (deux fois par face) dans des cercles bleu foncé : Depuis le 12 août 1870, on punit des travaux forcés à perpétuité tous ceux qui se risqueraient à contrefaire, falsifier ou introduire à l'intérieur du territoire français de faux-billets. Ce billet de vingt francs, bicolore sur fond pâle, reste d'une imitation facile pour bon nombre de professionnels le 25 septembre 1873, le nombre de contrefaçons atteint 48, 21 faussaires sont condamnés par les tribunaux. Trois ans plus tard, un rapport de la Banque de France signale que 15.769 billets de 20 francs faux sont en circulation. La plupart proviennent d'ateliers installés en Espagne, à Pampelune et Barcelone (1). Il fallut donc, pour déjouer de nouvelles contrefaçons, changer de billet, et améliorer ce qu'on appellerait à présent « le design »

Sur papier filigrané en provenance d'Angleterre le recto représente, dans un encadrement bleu cobalt et un fond bistre, Mercure et Cérès assis chacun en un coin, le regard détourné l'un de l'autre, comme s'ils venaient de se disputer. Le dieu des voleurs et la déesse de la moisson sont les deux allégories préférées de la Banque de France : un aveu ? Comme on peut le voir ci-dessus, leur posture est moins figée que celle de l'allégorie de l'Industrie du billet précédent. La somme de vingt francs (il n'existe pas encore de billet de 10 et la seule coupure inférieure est le billet de 5) s'y trouve reproduite 3 fois en gros caractères. Une série de médaillons représentant des visages ornent le fond bistre, de façon à compliquer la tache des falsificateurs. 10 050 000 billets sont imprimés en 1874 et 1875. En 1904, l'impression est reprise avec 724 autres alphabets de 25 000 unités. Ce billet, qui fut retiré au début de la Première Guerre Mondiale pour laisser la place au 20 francs Bayard a marqué la transition entre les billets monochromes et ceux polychromes de la fin du XIX° siècle.
Lui en poche, vous pouviez inviter dix personnes à déguster des bouquets de crevettes fraîches à la terrasse du fameux restaurant Marquery sur le boulevard Bonne Nouvelle. Dans ce même lieu très couru à la Belle Epoque, il fallait en aligner deux pour les régaler de dix portions de homard à l'Américaine. Dans un caboulot plus populaire, il donnait droit à dix repas complet. Le tarif des fiacres pris en gare étant, à l'époque, de 2 francs par heure, il permettait donc 10 heures de promenade dans Paris. Au théâtre Antoine (prix des places 5 francs), on pouvait à quatre se payer une représentation pur jus naturaliste. Avec la chance, peut-être, de rencontrer le maître. C'était aussi, en gros, le prix d'un livre broché. Un numéro de l'Assiette au beurre coûtait alors 50 centimes. Avec le vingt francs de l'époque, on pouvait donc s'offrir une jolie collection. Encore fallait-il avoir le temps de lire... (2)
(1) Henri Guitard, Vos billets de banque, Ed. France Empire
(2) Source : Le Crapouillot n° 29, spécial Belle Epoque.
10:06 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : billets français, littérature, crapouillot, belle époque | 
dimanche, 02 novembre 2008
Jour des morts
19:36 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : bloy, littérature, poèmes, toussaint, mort | 
samedi, 01 novembre 2008
Le besoin d'absolu
Je m'étonne de trouver sous la plume de Victor Serge, de la même façon que sous celle de Léon Bloy, le mot absolu, récurrent, vindicatif, si j'ose dire d'un emploi absolu. Je suis frappé de retrouver dans les Mémoires d'un révolutionnaire, ce même thème du Besoin d'Absolu dont Bloy se fit le pèlerin. Cette ressemblance entre ces deux hommes, le vieux de la montagne et le jeune révolutionnaire contemporains et par ailleurs si opposés, si différents d'âge comme de convictions, ne devrait pas m'étonner. Elle m'étonne pourtant.
Elle me touche encore. Elle me plait ; l'un a jeté toutes ses forces dans la communion quotidienne et la dévotion à Notre Dame de la Salette, l'autre dans le militantisme et l'action révolutionnaire.
Tous deux dépeignent le monde des hommes comme un cloaque, un sordide cachot, et la vie dans la société régie par les lois de l'argent comme une sorte d'agonie perpétuelle, qui rend l'homme indigne de lui-même et de ses proches. Et dans l'intime conviction de tous deux, dans la courbe de leur écriture aussi, l'on sent poindre cette même ferveur, ce même enthousiasme - ces mots, d'ailleurs, reviennent souvent sous leur plume respective - pour ce qu'ils appellent l'Absolu, à la fois introuvable, infréquentable, mais désirable, aimable au point d'y sacrifier l'attente et l'espoir de toute autre chose et de tout être, toute autre rencontre.
Victor Serge : « Jeunesse présomptueuse, dit-on. Plutôt affamée d'absolu. La combine est toujours et partout, car on ne s'évade pas d'une société, et nous sommes au temps de l'argent. (...) Où aller, que devenir avec ce besoin d'absolu, ce désir de combattre, cette sourde volonté de s'évader malgré tout de la ville et de la vie sans évasion possible » (Mémoires d'un révolutionnaire, Bouquins, 510).
Léon Bloy : « Malgré tout, je ne peux quitter cette pensée, cette certitude ancienne que je dois avoir ma revanche en ce monde et que mon drame, jusqu'ici plein de ténèbres et de sanglots, doit se dénouer avec splendeur. Depuis plus de vingt ans, je compte les jours, en nombre inconnu, qui me séparent du grand jour où une puissance que j'ignore me sera donnée. Dans ma veille ou dans mon sommeil, j'entends l'appel des lieux profonds. »
(Quatre ans de captivité à Cochons-sur Marne, 10 Juillet 1902, Bouquins, p 421)
Aujourd'hui qui s'achève presque, TOUSSAINT, jour de tous les saints, il me plait de les réunir tous deux dans ce billet, l'athée, le croyant, tous deux écrivains et amants de l'Absolu. Et, pour le clore, cette phrase de Bloy (26 juin 1902 - Bouquins, p 419 ):
« Horreur de vivre à une époque si maudite, si renégate, qu'il est impossible de trouver un saint. Je ne dis pas un saint homme, mais un saint, guérissant les malades et ressuscitant les morts, à qui on puisse dire : Qu'est-ce que Dieu veut de moi et que faut-il que je fasse ? »
23:22 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (26) | Tags : léon bloy, victor serge, recherche de l'absolu | 
Monde sans évasion possible
« Dès avant même de sortir de l'enfance, il me semble que j'eus, très net, le sentiment qui devait me dominer pendant toute la première partie de ma vie : celui de vivre dans un monde sans évasion possible, où il ne restait qu'à se battre pour une évasion impossible. J'éprouvais une aversion mêlée de colère et d'indignation pour les hommes que je voyais s'y installer confortablement. Comment pouvaient-ils ignorer leur captivité ? Comment pouvaient-ils ignorer leur iniquité ? »

Victor Serge
Mémoires d'un révolutionnaire ( 1905 - 1941)
On peut trouver les Œuvres de Victor Serge chez Robert Laffont (collection Bouquins) dans une édition préfacée par Jil Silberstein et annotée par Jean Rière. Toute la complexité de la situation en Russie, avant, pendant et surtout après 1917 y est exprimée en des termes justes. Les Mémoires d'un Révolutionnaire, notamment, (le texte le plus autobiographique de Victor Serge), expliquent de façon assez douloureuse mais avec grande clarté qu'une génération entière de russes n'eut le choix qu'entre la Terreur Blanche et la Terreur Rouge, et que la première eût été pire pour le plus grand nombre que la seconde qui le fut également. Toute la vie de Serge est traversée par la ferveur révolutionnaire qui hante cette Révolution dès son origine, et par tous les paradoxes qui en découlent. Il meurt dans un taxi, le 17 novembre 1947. En 1954, écrit son biographe, « faute de concession perpétuelle, il est transféré dans une fosse commune. »
Lui dont le nom était devenu célèbre dans le monde entier, il rejoint ainsi la foule d'anonymes que ses pages ont fait vivre, et que traverse une question récurrente - la question bourgeoise par excellence : « Pourquoi écrire un nom ? »
10:49 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : victor serge, littérature |