lundi, 20 octobre 2008
Par un panier de François Vernay

14:21 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : peinture, art, françois vernay, poésie, poème | 
Par un chemin de Ravier

06:11 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : ravier, peinture, poésie, poème, art, morestel, dessin | 
dimanche, 19 octobre 2008
Médecin des pauvres.

Le personnage narrateur de deux excellents romans lyonnais, peut-être les deux meilleurs qui soient, est un médecin, et un médecin des pauvres. Qu'en faut-il en penser ? Est-ce un hasard ?
Ciel de Suie, le troisième volet de la série de La Conquête du Pain d'Henri Béraud parait aux Editions de France, en 1933. Le Passage de Jean Reverzy est publié chez Julliard, en 1954. Béraud n'a alors plus que quatre ans à vivre, puisqu'il s'est éteint à Saint-Clément les Baleines, le 24 octobre 1958. Et Reverzy plus que cinq, qui est mort brutalement le 9 juillet 1959.
Entre les deux, une indéniable unité de ton dans la mélodie.
Béraud, tout d'abord, puis Reverzy :
« Mon métier n'est pas d'écrire. Je suis médecin à la Croix-Rousse, médecin des canuts, une espèce de rebouteux en jaquette et chapeau melon. Mes clients sont mes amis. Ils m'appellent tantôt le Docteur comme s'ils n'en connaissaient point d'autre, et tantôt le Militant, à cause de mes opinions qui sont les leurs. Souvent, le soir, avant d'aller en vieux garçon que je suis vider un carafon de marc aux cafés de Bellecour, je m'attarde à trinquer avec eux. Ailleurs, on m'a fait la réputation d'un cynique, et même d'un méchant homme. Mes canuts trouvent que je suis trop franc :
- On vous l'a bien fait payer, disent-ils. Quand je ne suis pas là, ils ajoutent.
- S'il avait su se taire, il ne passerait pas sa vie à soigner les pauvres !... Les braves gens ! Ils connaissent, eux, le goût amer de la vérité. Je ne me plains pas. En agissant comme je l'ai fait, je savais que j'allais perdre. Qu'importent la quiétude et la douceur de la vie, s'il faut les payer du mépris de soi-même ? »
« J'étais un petit docteur attaché à une banlieue triste. Je savais un peu de médecine : la digitale ranime les cœurs, la morphine endort les douleurs, la pénicilline modère les fièvres. Quand je devinais un cancer, un peu attristé, je disais : vous entrerez à l'hôpital. (...) Fixé dans ma ville, j'étais devenu le médecin d'un quartier malheureux; j'avais accepté ce destin et un horizon de hautes maisons misérables. Des infiniment pauvres, des intouchables puis des ouvriers des employés chétifs avaient frappé à ma porte : tout le jour ils venaient s'étendre sur mon divan brûlé par leurs fièvres, verni par la sueur de leurs angoisses. Le soir, un cartable sous le bras comme les policiers, j'escaladais les exténuants escaliers de la misère : ces spirales semblent mener au ciel et finissent au corridor noir de l'enfer prolétarien. Je pensais que ces gens m'aimaient et comme quelque chose persistait en moi de cette bonté naïve de l'enfance, cela m'avait longtemps suffi. »
Ciel de Suie et Le Passage ont bien d'autres parentés :
- Le décor de la ville de Lyon, d'abord, de la ville de Lyon telle qu'elle était dans la première moitié du vingtième siècle. - La tristesse et la douceur des destins qu'ils narrent l'un et l'autre, ensuite :
Palabaud, l'interminable agonisant dont l'agonie finale éclaire la métaphore du titre, Patrice et Noëlle, les amants inavouables dont le sacrifice final entre soudain en résonance avec la suie d'un ciel ô combien béraldien. Une pudeur dans la narration, enfin, pudeur qui fait évidemment de Reverzy un des fils secrets d'Henri Béraud. Mais enfin, laquelle de ces filiations aurait pu être significative, si cette première - le narrateur-médecin des pauvres, avec toute la symbolique dont elle est chargée pour le lecteur - n'avait été d'abord rendue à ce point explicite.
Illustration "Médecin et son patient", tirage photo de Beato FELICE, 2ème moitié XIXème siècle.
09:46 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : béraud, reverzy, littérature, lyon, romans, ciel de suie, place des angoisses | 
samedi, 18 octobre 2008
Louis Guilloux et la chronique
Bien que Le Pain des rêves se présente à nous comme un récit d’apparence autobiographique, tous ses personnages appartiennent à ce que Louis Guilloux appelle sa Chronique, et qui prendra jour en 1949 dans Le Jeu de Patience. Une chronique est « un recueil de faits historiques, rapportés dans l’ordre de leur succession » (Petit Robert). Le genre connaît ses heures de gloire durant le haut Moyen Age avec Froissart et Joinville, qui fixent dans leurs chroniques (Vie de Saint Louis) les exploits de leurs Rois, ceci afin de laisser trace de leurs passages dans l’histoire des hommes.
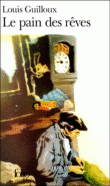 Dans Le Pain des Rêves, cependant il ne se passe rien. Rien de dramatique, rien qui soit digne d’être conté : un vieil homme coud. Il coud toute la journée, toute la semaine, tout le mois et toute l’année. Son petit-fils le regarde. Il regarde l’homme qui coud, « cette gravité plus pathétique que celle du penseur » et il rêve que son grand père est un roi. Ou plutôt, non, je corrige : « Ce n’était pas un roi, mais le Roi. Le roi lui-même enfermé depuis des années dans un cachot, autrefois une écurie, et qu’on venait de délivrer» Nous sommes à Saint-Brieuc, à la charnière entre le dix-neuvième et le vingtième siècle. Avec les démolitions des vieilles maisons du XVème siècle transformées en taudis, « l’esprit d’une nouvelle époque soufflait son chemin dans les ruines » L’enfant découvre l’école, les fêtes religieuses et militaires qui scandent l’année, le théâtre l’injustice sociale : il découvre ce qu’il appelle « la diabolique fantaisie du monde ». Sorte de petit chose l’enfant ne comprend pas pourquoi sa mère et son grand père sont si pauvres, pourquoi son frère est infirme, pourquoi, aux yeux de toute la ville, il fait partie des voyous de la rue du Tonneau. Puis le grand père meurt. Survient une étrange cousine, la cousine Zabelle, qui va s’occuper désormais de lui. Entre en scène un premier amour. Bientôt, l’enfant va entrer, lui, au lycée.
Dans Le Pain des Rêves, cependant il ne se passe rien. Rien de dramatique, rien qui soit digne d’être conté : un vieil homme coud. Il coud toute la journée, toute la semaine, tout le mois et toute l’année. Son petit-fils le regarde. Il regarde l’homme qui coud, « cette gravité plus pathétique que celle du penseur » et il rêve que son grand père est un roi. Ou plutôt, non, je corrige : « Ce n’était pas un roi, mais le Roi. Le roi lui-même enfermé depuis des années dans un cachot, autrefois une écurie, et qu’on venait de délivrer» Nous sommes à Saint-Brieuc, à la charnière entre le dix-neuvième et le vingtième siècle. Avec les démolitions des vieilles maisons du XVème siècle transformées en taudis, « l’esprit d’une nouvelle époque soufflait son chemin dans les ruines » L’enfant découvre l’école, les fêtes religieuses et militaires qui scandent l’année, le théâtre l’injustice sociale : il découvre ce qu’il appelle « la diabolique fantaisie du monde ». Sorte de petit chose l’enfant ne comprend pas pourquoi sa mère et son grand père sont si pauvres, pourquoi son frère est infirme, pourquoi, aux yeux de toute la ville, il fait partie des voyous de la rue du Tonneau. Puis le grand père meurt. Survient une étrange cousine, la cousine Zabelle, qui va s’occuper désormais de lui. Entre en scène un premier amour. Bientôt, l’enfant va entrer, lui, au lycée.
Toute l’intrigue du Pain des Rêves tourne autour de cette question que l’enfant qui grandit se pose malgré lui : pourquoi sommes-nous si pauvres ? Le récit explore ainsi toute l'ambiguïté offerte par le titre : Parle-t-on du pain dont on rêve ou du rêve dont on se nourrit ? du pain fait rêve ou du rêve fait pain ? La déchristianisation en cours du pays transforme le statut même du pauvre, le regard dont on l'enrobe comme celui qu'il pose sur lui-même et ses semblables.
Cela, Charles Péguy et Léon Bloy l'ont également noté. Rien de plus éloquent, à cet égard, que cette remarque de Bloy : "Le comble de la misère humaine, c'est la haine du pauvre par les pauvres." L'apprentissage de l'enfant-narrateur, dans cette France de 1905, consistera donc à placer tous ses efforts pour ne pas laisser cette misère morale le contaminer. "Je doute qu'aucun amour vaille celui des pauvres, écrit Guilloux. Le nôtre était un amour religieux. Nous savions que cet amour-là n'était possible qu'à l'intérieur d'une certaine catégorie, qu'il n'était propre qu'à de certains êtres, vivant dans des conditions définies : les nôtres. (...) Oui, nous savions, et peut-être même était-ce ce que nous savions le mieux, que cet amour tirait sa plus grande force du fait qu'ailleurs, nous n'étions pas aimés."
(Le Pain des rêves, première partie)
Si l’on peut parler, à propos du Pain des Rêves de chronique, c’est en référence à ce souci constant de Guilloux, à la fois de parler vrai et d’offrir à ses personnages l’abri de sa mémoire. Comme beaucoup d’écrivains de sa génération Louis Guilloux a conscience d’appartenir à un monde dont on a dit beaucoup de mensonges et qui est voué à la dissolution : le monde du petit peuple, celui dont il est issu. L’homme du peuple : le romantisme lyrique et le naturalisme scientiste qui, tour à tour, en ont fait un motif littéraire, un thème bourgeois, l’ont soit mythifié, soit caricaturé, soit transfiguré. Hugo, ce n’est « qu’un grand et beau mensonge » nous dit Louis Guilloux. Or, ce mensonge demande une réparation. Ecrit en pleine période d’Occupation allemande, Le Pain des Rêves, récit d’enfance, galerie de portraits, début de la longue chronique qui occupera toute la suite de l’œuvre, jusqu’à L’Herbe d’Oubli, aura été cette nécessaire réparation.
11:46 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : louis guilloux, le pain des rêves, saint-brieuc | 
vendredi, 17 octobre 2008
La France se cultive à l'école
Dans de nombreux établis semant scolaires de France, la France et les petits français se cultivent. Et donc, des sorties citoyennes sont organisées par des preux fesseurs d'instruction citoyenne et civique qui, fèzant passer la jeunesse d'un huis-clos entre des murs à un 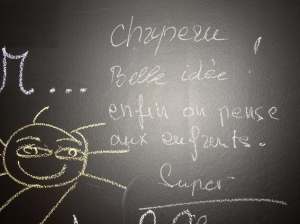 autre, vont faire zyeuter la dernière Palme d'Or de Cancanne, et que mêmeu y'a des zéducateurs syndiqués et zélés qui n'hésitent pas à organiser des soirées spéciales avec z'élus municipaux et peutits fours afin d'y débattre et causer ensemble de la belle culture qu'on y fait tous ensemble tous ensemble dans la res publica bien sympa qu'on est devenu entre nous tous ensemble tous ensemble et entre les murs et qu'il y a plein de morpions qui vont désormais apprendre la belle littérature en lisant les conneries du professeur bégue au dos... Je propose donc à tous les visiteurs de Solko un petit tour par Théatrum Mundi où Pascal Adam, le vaillant, héberge un entretien exclusif entre Alain Potent et François Bigoudi...
autre, vont faire zyeuter la dernière Palme d'Or de Cancanne, et que mêmeu y'a des zéducateurs syndiqués et zélés qui n'hésitent pas à organiser des soirées spéciales avec z'élus municipaux et peutits fours afin d'y débattre et causer ensemble de la belle culture qu'on y fait tous ensemble tous ensemble dans la res publica bien sympa qu'on est devenu entre nous tous ensemble tous ensemble et entre les murs et qu'il y a plein de morpions qui vont désormais apprendre la belle littérature en lisant les conneries du professeur bégue au dos... Je propose donc à tous les visiteurs de Solko un petit tour par Théatrum Mundi où Pascal Adam, le vaillant, héberge un entretien exclusif entre Alain Potent et François Bigoudi...
22:27 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : theatrum mundi, bégaudeau | 
A ma guise
Agone vient de publier les quatre-vingts chroniques écrites par George Orwell de décembre 1943 à février 1945, puis de novembre 1946 à avril 1947, pour le journal Tribune. La traduction est de Frédéric Cotton et de Bernard Hoepffner, l'édition est enrichie d'une préface de Jean Jacques Rosat, d'une postface de Paul Anderson, d'un glossaire et d'un index afin de se repérer dans le contexte de ces années-là. Le livre s'appelle A ma guise, titre de la chronique.
Orwell y discute des sujets les plus variés, en associant généralement par trois un thème de société, un thème littéraire, un thème politique : un couplet de God save the King, le maquillage féminin, le déclin de la nouvelle, les métaphores mortes et les injures mal traduites, la littérature sur commande, le nationalisme écossais, les vertus et les limites de la nationalisation, qu'est-ce que le fascisme ?... En parcourant ces chroniques, on se trouve projeté dans les coulisses de 1984,  dans la conscience d'un homme qu'inquiètent l'avènement de la bureaucratie, le pouvoir grandissant de la radio, la dissolution de l'esprit critique dans les démocraties.
dans la conscience d'un homme qu'inquiètent l'avènement de la bureaucratie, le pouvoir grandissant de la radio, la dissolution de l'esprit critique dans les démocraties.
« Lorsqu'on examine ce qui s'est passé depuis 1930, il n'est pas facile de croire à la survie de la civilisation » (La une des quotidien et l'irrationalité du monde")
« Ce que révèlent les annonces matrimoniales, c'est la terrible solitude des habitants des grandes villes » ("Les annonces matrimoniales")
« Quand on voit ce qu'il est advenu des arts dans les pays totalitaires, et quand on voit la même chose arriver ici, de manière un peu plus voilée, par l'intermédiaire du ministère de l'Information, de la BBC, des studios de cinéma - des organismes qui non seulement achètent de jeunes auteurs prometteurs, les châtrent et les mettent au travail comme des mules, mais réussissent en outre à enlever tout caractère individuel à la création littéraire en la transformant en un processus de travail à la chaine, la perspective n'est pas encourageante. »
(L'Artiste dans la société bureaucratique moderne")
J'ai pioché au hasard, et en feuilletant rapidement ce petit livre qu'on vient de m'offrir, ces quelques citations.
17:56 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : george orwell, a ma guise | 
jeudi, 16 octobre 2008
Louis Guilloux : Le sang noir
La vé rité de cette vie, ce n'est pas qu'on meurt. C'est qu'on meurt volé.
rité de cette vie, ce n'est pas qu'on meurt. C'est qu'on meurt volé.
Lorsque parait le Sang noir, dans la deuxième quinzaine d'octobre 1935, on ne voit tout d'abord que ce bandeau, qui résume la portée critique du roman. Les mots vie et vérité sont imprimés en grosses lettres; meurt en plus grosses encore, et volé en énormes. Louis Guilloux vient d'avoir 35 ans. « Tout grand roman suppose une idée du monde », a-t-il noté- dans son journal quelques mois plus tôt. Mourir volé : Le héros de son livre (Merlin, comme l’Enchanteur) devra incarner à lui seul cette tragédie là. Guilloux choisit l’année 1917, année des mutineries des poilus et de la révolution russe, pour situer l’action de son roman. C’est pour lui une évidence, 1917 étant à ses yeux l’année où tout bascule, où l’on passe du dix-neuvième au vingtième siècle. Merlin, qui dans son esprit prend déjà les contours de George Palante, devra mourir à l’aube de ce changement de siècle. Merlin, pâle fantôme alcoolisé de Kant dont il cite la Critique de la Raison Pure, ce qui, dans la bouche des élèves, deviendra facilement : « Cripure de la raison tique ». A ce personnage, il assigne une compagne, Maïa (l’illusion en russe et en hindi).
La ville où se déroule l’intrigue, bien qu’elle ne soit jamais nommée, sera Saint-Brieuc, la ville natale où il a grandi et fréquenté Palante ainsi que le lycée.
Ville dans laquelle il met en scène ce que les poilus ont appelé l'Arrière, cette humanité larvaire fait d’un monde de notables et de femmes de notables, toutes et tous uniquement préoccupés de survivre, et sacrifiant pour cela, goutte à goutte, le sang de leurs enfants afin de continuer leur comédie provinciale, aussi insignifiante que désenchantée; fade puissance de cet Arrière qui vient à bout des idées généreuses, de l'idéalisme, de l'humanisme, bref, de toutes les valeurs sur lesquelles il prétend reposer, toutes les valeurs qu'il prétend défendre et transmettre. Cripure, ravagé par l'alcool et la routine sera l'étrange bouc-émissaire de tous ces cloportes, rejoignant par son suicide les innombrables sacrifiés du front.
Pour composer son roman, Guilloux avoue avoir suivi les conseils de Malraux :
« Ecrivez ce que vous voyez, la scène telle qu’elle se présente. Ensuite vous monterez ça comme un film. Il y aura forcément des ponts qui vous donneront des vues nouvelles ».
Sur son carnet, il a noté aussi cette phrase de Marcel Proust :
«Ce que nous n’avons pas eu à déchiffrer, à éclaircir par notre effort personnel, ce qui était clair avant nous n’est pas à nous. Ne vient de nous-mêmes que ce que nous tirons de l’obscurité qui est en nous, et que ne connaissent pas les autres. »
Des personnages naissent en contre-points : Un ennemi de Cripure, qui sera Nabucet, Babinot, qui jouera le rôle de l’idiot, Moka qui sera le doux.
L’idée d’un lieu unique et celle d’une seule journée, la dernière de Cripure, s’imposent.
Eté 35 : Louis Guilloux peut enfin noter dans son journal : « Hier, 5 août, j’ai achevé mon roman ». En septembre, il est à Paris pour en corriger les épreuves. Il donne quelques indications sur la signification du titre choisi : « Le sang de ceux qui n’ont plus que l’apparence de la vie »
« Cripure et les hommes qui participent de son univers condamné sont des personnages en contradiction avec eux-mêmes et avec la vie. Un monde finit, qui les écrase, mais qu’ils n’ont pas la force de rejeter. Les uns consentants, les autres révoltés, tous dupes, ces hommes et ces femmes désorientés s’efforcent de chercher en eux-mêmes une justification à leur existence gâchée. Il faut passer outre, ou périr. Cripure, le plus lucide d’entre eux, le plus douloureux aussi, ne pourra faire autre chose que de contempler son destin tragique et de s’y soumettre. Il disparaîtra, répandra sur lui-même volontairement son sang noir. Un autre homme, plus ordinaire et plus vrai, ira chercher les moyens d’un ordre nouveau, et contre les anciens malheurs qu’il oubliera, il s’efforcera de travailler à ouvrir une porte sur la vie.»
Le roman sort dans la deuxième quinzaine d’octobre, et a immédiatement un grand retentissement. Romain Rolland écrit à Guilloux :
« Votre livre est extraordinaire. Il me faut remonter aux romans russes de ma jeunesse pour retrouver un roman qui m’ait fait une impression aussi inattendue et aussi forte ». Il pense, bien sûr à Dostoïevski.
Avec son Sang Noir, Guilloux rate de peu le Goncourt, décerné à Sang et Lumière de Joseph Peyré, l'auteur de l'écurie Grasset. Roland Dorgelès a voté pour Guilloux et sera avec Gide, son plus ardent auxiliaire ; Gide, qui trouve la formule : « Il y a dans Le Sang noir, non pas à tel ou tel endroit précis du livre, mais épars et constant, de quoi me ravir tout particulièrement : un certain sens de la vie, comique en tant que spectacle, tragique en tant que réalité (…) ce qui me plait dans Le Sang Noir, c’est qu’il offre de quoi perdre pied »
De quoi perdre pied : C'est bien le moins qu'on puisse dire tant on se demande à la relecture de ce roman fascinant ce qui est le plus effroyable dans l'espèce humaine : la dimension de son cycnisme ou celle de sa naïveté.
Description d'une place, un jour de 1917
« Lucien parcourait la place, flânait d'un étal à l'autre, fasciné par tous ces jeunes gens qu'il regardait comme s'il eût cherché parmi eux tous quelqu'un de connu. C'était, pour la plupart, de petits paysans venus le matin à pied par la route, en bandes, conduits par un violoneux. Ceux de la ville ne restaient guère sur la place. La morue, le pain noir et la piquette, ils n'en mangeaient pas. Ils étaient dans les cafés où déjà rentrés chez eux porter à leurs parents la nouvelle : bons pour le service armée ou ajournés. On ne réformait pas. De petits malingres portaient à leur chapeau le signe de la mort prochaine. Comme ils avaient l'air peu guerrier, cependant, peu faits pour la mort. Comme ils paraissaient peu se douter de la mort ! Presque tous les visages de ces jeunes gens, même les plus virils, exprimaient une confiance, une crédulité d'enfant, une ignorance pathétique du mensonge. Il ne leur venait pas à l'esprit qu'on pût les trahir. Ils étaient tout prêts à mettre la main dans la main de qui les emmenait, pourvu que le conte promis fût beau et noble... »

08:54 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : le sang noir, cirpure, marcel maréchal, merlin, c'est qu'on meurt volé, octobre 1935 | 
mercredi, 15 octobre 2008
Louis Guilloux : La Confrontation
La parution de La Confrontation, en 1968, ne précède que de quatre mois les événements de mai. Un des personnages, le maçon Philippe, ne les annonce-t-il d’ailleurs pas lorsqu’il s’écrie : «Après six mois de grève générale, il faudra bien réviser le problème une fois pour toutes. » Mais les événements ne dureront qu’un mois, et c’est dans un silence consterné que Louis Guilloux voit, à la télévision, son vieil ami Malraux descendre les Champs Elysée à la tête du cortège des « réactionnaires », la main dans celle de Michel Debré. Il garde alors le silence, comme, au retour du voyage de 36 en URSS, et au contraire d’un autre ami, André Gide, il s’était tu. Il sait depuis longtemps qu’il n’est ni un homme du spectacle, ni un homme de l’instantané : « J’ai laissé le journal », se contente de déclarer le narrateur de La Confrontation devant les événements contemporains : guerre du Vietnam, incidents raciaux aux Etats-Unis, dictature militaire en Grèce. « Quel beau siècle que le nôtre ! », se contente-t-il de remarquer. Ce récit bref sonne-t-il, dans l’œuvre ardemment militante, l’heure du retrait ? « Si un homme de vingt-cinq ans a quelque chose à dire aux autres, ce n’est probablement pas ce qu’il dira à trente-cinq et, à plus forte raison, ce que dira un homme de quarante ou cinquante ans » (1) , note-t-il dans les brouillons de L’herbe d’oubli. Or il a alors soixante neuf ans.
Depuis 1962, il a en tête l’idée de raconter l’histoire d’un « détective recherchant quelqu’un qui est l’homme même qui s’est adressé à lui ». Ainsi écrit-il alors, « celui-ci connaîtra indirectement son passé et ce qu’il a été dit de lui ». La confrontation initiale est donc, dans l’esprit de l’auteur, celle d’un homme avec son image publique. L’intrigue du roman met en effet en scène un ancien journaliste, sollicité par un certain Germain Forestier à enquêter sur un certain Gérard Ollivier. Le premier ayant perdu le second de vue, il désire, avant de lui léguer une somme importante, savoir s’il en est digne. Le récit se présente comme le rapport oral que le journaliste narrateur chargé de l’enquête (je) livre à son terme à son commanditaire, durant une nuit entière, dans la petite chambre de bonne qu’il habite en plein quartier latin, et qui du coup s’adresse directement au lecteur (vous). Ce dernier s’aperçoit très rapidement que cette voix narrative n’est qu’un habile truchement qui ne masque qu’à peine la personne de l’auteur lui-même ; toujours dans L’herbe d’oubli, ce dernier note :
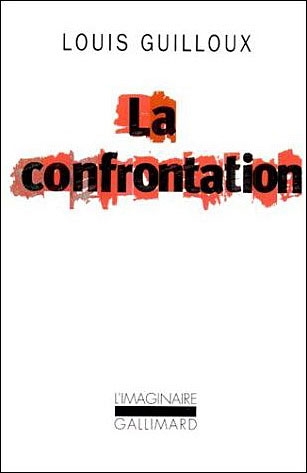 « La distance entre le personnage et la personne paraît énorme. Mais ne peut-on tout bonnement décider que cette distance-là peut aisément se réduire jusqu’à disparaître dans une fusion complète, que bon nombre de romans ne sont guère autre chose que des Mémoires déguisés, que nombre de « mémoires » constituent une matière romanesque à l’état but, enfin que si l’on n’éprouve pas l’envie de se mettre un masque, on peut tout aussi bien, en s’épargnant le mal d’inventer, raconter ce qu’on a vu et su (…), à condition qu’on ait le courage de dire partout la vérité, même et surtout quand l’amour propre voudrait qu’on l’habille ? Il faut que les choses vous soient devenues comme indifférentes dans la distance qui vous en sépare, qu’elles cous apparaissent à vous-même comme étant arrivées à un autre, et que, en tout cas, il ne s’agisse jamais de se vanter. » (2)
« La distance entre le personnage et la personne paraît énorme. Mais ne peut-on tout bonnement décider que cette distance-là peut aisément se réduire jusqu’à disparaître dans une fusion complète, que bon nombre de romans ne sont guère autre chose que des Mémoires déguisés, que nombre de « mémoires » constituent une matière romanesque à l’état but, enfin que si l’on n’éprouve pas l’envie de se mettre un masque, on peut tout aussi bien, en s’épargnant le mal d’inventer, raconter ce qu’on a vu et su (…), à condition qu’on ait le courage de dire partout la vérité, même et surtout quand l’amour propre voudrait qu’on l’habille ? Il faut que les choses vous soient devenues comme indifférentes dans la distance qui vous en sépare, qu’elles cous apparaissent à vous-même comme étant arrivées à un autre, et que, en tout cas, il ne s’agisse jamais de se vanter. » (2)
Dans son roman, la question de la vérité n’est pas posé en terme de « Mémoires », mais en terme de « biographie » : Très vite, en effet, l’apparente intrigue policière tourne court pour se déliter dans le décor anodin d’une petite ville de province, Laval, et ses nombreux bars. Rien ne se passe et, « de la rue Sainte Catherine au boulevard Thiers », déclare le narrateur, « je tenais les deux bouts de la chaîne ». Comment le lecteur s’intéresserait-il plus longtemps à une enquête que dédaigne aussi ouvertement celui-là même qui la conduit ? Le banal, le fortuit, l’anecdotique occupent ironiquement le devant de la scène, réservé en principe dans ce genre de récit à l’action, au drame, au suspens : « plus aucune envie de me mettre à l’ouvrage, je vous assure ». La plaisanterie du voisin écossais du narrateur à propos du biographe enterré à côté de l’auteur éclaire la démarche poétique que prend le récit lorsque l’imagination « qui s’est mise en branle » le transforme en hasardeuse introspection intérieure : pour le journaliste enquêteur, il ne s’agit pas, en effet « de reconstituer un fait, les circonstances d’un délit, voire d’un crime (…) mais de reconstruire… une âme, en somme d’établir… une biographie ». Le narrateur, biographe d’un personnage imaginaire, rencontre alors un ami de celui sur lequel il enquête, « petit pédant » qui lui a dédié une pièce, « Le Monument ». Le héros fantomatique, véritable Arlésienne de ce roman, en est-il digne ? Telle est la confrontante question qui se pose bel et bien à Guilloux lui-même depuis que, l’année précédente, il a reçu le prix national des Arts et des lettres pour l’ensemble de son œuvre, telle est la question centrale de l’enquête menée entre fiction et réalité : peut-on, lorsqu’on est né pauvre, devenir riche et demeurer digne (revers de la question est-on digne de devenir riche ?) Faut-il accepter l’argent (Philippe, le maçon, affirme que non), la gloire, la consécration quand « le bordel est partout » ? « Il m’a semblé tout à coup que je devenais le jouet d’un immense canular » déclare J/L Boutier au fur et à mesure que se déroule son enquête désinvolte. Ou bien : « Vous n’allez pas me dire que je suis vieux jeu ». Ou encore « Quel abîme entre le Je et le Il. Peut-il être comblé ? » La question du personnage comme la figure même de l’auteur sont alors au cœur des préoccupations littéraires des jeunes romanciers, tous marqués par « l’ère du soupçon » ; et devant ces partisans de la modernité, le vieux rusé de Saint-Brieuc sait qu’il fait figure de vieux romancier, sympathique mais décalé. Un changement de ton ? Certes, la critique de l’époque a failli s’y tromper, tant la fusion progressive des trois personnages en un seul (celui de l’auteur) est un brouillage énonciatif propre à la littérature des années soixante. Mais la mise en abyme, la « confrontation » dans l’écriture même du roman entre deux procédés, celui de l’écrivain « du temps passé étudiant le milieu dans lequel il va camper son personnage » et celui qui consiste à tromper le lecteur par de nouvelles techniques narratives n’est-il pas plutôt, pour reprendre un mot du texte un « canular », un pastiche avant l’heure d’une « modernité » dont le pessimisme doux de l’auteur se raille : « Je me suis mis au nouveau roman pour ne pas me rouiller tout à fait », soupire le narrateur avant de revenir à l’essentiel, car pour lui, la question demeure évidemment sociale : « qui manque de pain ne rêve plus d’autre chose, et quelle est la première des choses ? Le pain ou le rêve ? ». Le lecteur du Pain des rêves, du Jeu de patience, du Sang noir et des Batailles perdues reconnaît là une voix qui ne se reconnaît que par ce qu’elle dit, et qui n’a d’autre souci que de répondre à la nécessité historique de son temps, même s’il doit contredire d’apparentes nécessités littéraires : A l’heure où la littérature se sépare de l’Histoire, épargnons-nous le mal d’inventer :
« Il faut faire avec ce qu’on a, écrit dans La ville cet auteur discret, qu’à l’heure de la mondialisation en cours il est plus que jamais nécessaire de redécouvrir, « non se venger mais venger les siens et pourtant n’offenser personne inconsidérément, dire la vérité quoiqu’il en puisse coûter à soi et aux autres, payer ses dettes, instruire les petits enfants en racontant comme au coin du feu à la vieille mode et sans trop se demander si on ne va pas radoter, si on n’a pas déjà raconté ailleurs ce qu’on s’apprête à raconter aujourd’hui ».
Telle pourrait être le sens de cette dignité qui fait tout l’enjeu de l’enquête. Il faut en définitive écouter ces petites vieilles, pauvres voisines du narrateur et de l’auteur lui-même, dont les pas ponctuent le roman et en forment la magistrale conclusion : « n’entends-tu pas comme des bruits de chaînes qu’on secoue ? » Cette œuvre dont on pouvait croire qu’elle sonnât le glas de l’écriture militante nous semble en définitive, parce qu’elle marque en la pastichant l’insignifiance de toute autre tentative aux yeux de l’auteur, constituer de par son titre même, La confrontation, une ultime œuvre de résistance.
07:54 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : louis guilloux, littérature, culture, la confrontation, saint-brieuc | 
mardi, 14 octobre 2008
Louis Guilloux, L'esprit de fable

« J'ai toujours regretté de n'être plus un paroissien de la cathédrale comme je le devins, huit jour après ma naissance, puisque c'est là que je fus baptisé le 22 janvier 1899 », écrit Louis Guilloux au soir de sa vie, dans la nouvelle La Ville, un texte magnifique qu'on peut trouver dans Vingt ans ma belle âge (Gallimard, Paris 1988).
Il n'est pas anodin, cet autre titre choisi pour l'une des ultimes confidences: L'herbe d'oubli. Louis Guilloux n'y parle que de sa ville natale, Saint-Brieuc, du temps que la fausse lumière de l'électricité n'avait pas encore envahi toute la baie. Il évoque les processions religieuses, les légendes qui dorment :
« C'est en l'année 469 qu'un vieux moine venu d'Irlande et du pays de Galles avec quatre-vingts compagnons débarqua sur nos bords. Le vieux moine et ses compagnons n'étaient ni plus ni moins que des réfugiés fuyant leur île envahie par l'ennemi. En débarquant, ils ne trouvèrent que la forêt et les loups, un méchant baron dans son château de bois qui d'abord voulut les tuer tous, mais qui fut touché par la grâce, s’étant mis à prier. Avec ses compagnons, le vieux moine s'arrêta près d'une fontaine. Ils bâtirent là un oratoire. C'est alors que s'alluma la première lampe, que tinta la première cloche et que retentit le premier coup de hache des défricheurs. On dit aussi que le vieux moine et ses compagnons apportèrent avec eux l'esprit de fable... »
L'esprit de fable... Je retrouve, en lisant ces lignes, quelque accent du Renan des Souvenirs d'enfance et de Jeunesse, je perçois, derrière la stature un peu sec de Renan, l'ombre plus humide de celle de Chateaubriand : Combourg, Tréguier, Saint-Brieuc... Guilloux se veut tisseur de continuité, raccommodeur de déchirures, il se veut, se voit, se vit et se sait planté dans cette terre-là, faite de la tradition du vent, du langage et du sel. Au fond de la cathédrale de Saint-Brieuc, dans un coin de la chapelle Sainte-Anne, une pierre gravée rappelle qu'en effet, Saint-Brieuc (Brigomalos, du celte bri , dignité et mael, prince) ne s'est pas ému devant les loups :
"Un peu plus tard, Brieuc revenait d’une dépendance éloignée de son monastère. Assis dans son chariot, il chantait des psaumes ; les moines marchaient devant lui, entonnant les antiennes. Le soir tombait. Tout à coup, les moines se turent, puis se dispersèrent en fuyant avec épouvante ; à leur place le vénérable abbé vit se dresser, se former en cercle autour de lui une bande de loups menaçants, prêts à se ruer sur les bœufs attelés au charriot. Le saint, impassible leva la main ; les loups tombèrent et se prosternèrent devant lui comme pour demander grâce. Mais quand les moines, remis de leur panique voulurent pour rejoindre leur maître franchir la ligne formée par les fauves, ceux-ci leur refusèrent le passage et les tinrent en respect. Au matin, passèrent une troupe d’émigrants. Leur chef Conan s’arrêta afin d’admirer le prodige et, y voyant un signe du ciel réclama pour lui et ses hommes le baptême. Brieuc ordonna aux loups de s’éloigner et prescrivit à ses catéchumènes un jeûne de sept jours, pendant lesquels il les instruisit. Le huitième il les baptisa."

Saint-Brieuc, évêque et dompteur, Louis Guilloux, dansant avec les loups : sous les poutres de la cathédrale, les dalles sont humides, autant que l'air est marin. Les lourds piliers de pierres veillent sur l'esprit de fable qui hante une pénombre chargée de Magnificat et de Je vous salue Marie. Dans la cathédrale Saint-Etienne furent célébrés et le baptême et la messe d'enterrement de Louis Guilloux. La bâtisse grise et trapue aura été paradoxalement son Panthéon à lui, lui qui s'est souvent plaint d'avoir été oublié de Dieu. Elle n'est peut-être pas la plus belle église de Bretagne. Elle est, assurément, la plus enchantée.
09:24 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : louis guilloux, littérature, culture, actualité, l'herbe d'oubli, saint-brieuc | 









