vendredi, 27 février 2009
Plan Sentimental de Paris
Années vingt... La guerre, ses souvenirs font mine de s'estomper de la mémoire des Français. Font mine. Après la Belle Epoque, donc, les Années Folles... Les fractures générationnelles n'ont jamais été si vives, dans ce vieux pays. Les idéologies ressurgissent, les financiers sortent de l'ombre. Paris, certes, Paris... Paris sera toujours Paris, ses boulevards, ses enseignes lumineuses, ses théâtres... version bien frenchie de the show must go on... Alors, soit ! Pigalle et ses bars... Montmartre et sa colline. Le caf-conc'. Le Moulin Rouge... ! «Paris ! Paris, proclame Béraud dans le Plan sentimental de la ville de Paris, on ne le voit et on ne l'aime bien qu'à travers une triste vitre ! ».
Quel lecteur, aujourd'hui, s'intéresserait à ce vieux livre oublié, le premier de la collection « Les Images du temps », publié en 1927 chez un éditeur disparu, du nom de Lapina ? L'édition de tête comporte une centaine d'unités. Suivent mille exemplaires, sur Vergé de Rives pur chiffon, pas un de plus, chacun dans son étui en carton vert marbré de jaune. La couverture du livre, d'un vert plus pâle, est marbrée de rouge. Titre et marques de l'éditeur sont imprimés en rouge ; Sur la page de garde, un portrait de l'auteur exécuté en pointe sèche par un certain L. Madrassi, puis en double page, un fac similé d'un fragment manuscrit signé Henri Béraud. Le Plan Sentimental de Paris est dédié à Marise Dalbret, sa secrétaire, sa maîtresse, sa compagne d'alors.
Le texte se donne à lire comme un jeu, un pari : Prenant pour référence le temps où Jules Laforgue - encore le dix-neuvième, le monde d'hier - s'exclamait : « Je viens de gagner une gageure. En plein Paris, j'ai passé trois journées sans adresser la parole à mes semblables, sans ouvrir la bouche, seul. Essayez. Vous m'en direz des nouvelles. », le narrateur fait mine de relever le défi : Huit nuits, huit nocturnes parisiens, huit errances ambiguës à la manière des Promenades d'un Nerval désinvolte, dans ce Paris des années folles. Huit promenades tout emplies de ce que Béraud appelle, avec une ironie désabusée, un romantisme rhumatismal.
« Les théâtres, les music-halls, les phonos, les cinémas et les bars populaires se jettent à la face, comme des provocations, les feux de leurs enseignes. C'est, chaque soir, une fête violente et gaillarde comme un carrousel forain. Or cette liesse, je l'ai dédaignée pour entrer sous un porche plein d'ombre, où l'on voyait une à une s'engager des personnes à la contenance grave et méditative. »
C'est le porche du concert Touche, où des instrumentalistes à la vieille mode jouent les compositeurs des siècles précédents : « Ils jouent. Les sonorités frappent les murs comme les parois d'un tombeau. Les auditeurs écoutent pieusement. En passant au contrôle, n'ont-ils pas acheté du rêve ? N'ont-ils pas acquitté le péage de l'oubli ? » La musique suscite en cascade des images intérieures : « Wagner et Berlioz lâchent à pleines brides leurs coursiers. Schumann passe avec une langueur apprêtée sur sa barque de deuil. Franck apparaît dans un clair-obscur flamand, les mains sur le clavier, les yeux fouillant le clair-obscur violet ; et c'est Mozart, souriant à son destin mélancolique ; et c'est le vieux Moussorgsky, enluminé et dévotieux, errant sous la neige devant les portes de Kiew ; et c'est Schubert, dans le petit cabaret viennois, fumant sa pipe, tenant un bouquet de fleurs maladives ; et c'est Duparc, égaré devant un miroir où son passé merveilleux l'entoure comme un fantôme ; et c'est Debussy, le front dans sa main fine, et murmurant l'immortel poème de Mallarmé»
Mais sitôt dans la rue, le beau drame intérieur s'évanouit devant un autre spectacle : Un film qu'on tourne, un peu plus tard, place Pigalle. Se déroule là comme un surplus inutile et accablant de bruits, de lueurs, une surenchère de mouvements, détachés de tout sentiment profondément ressenti, tel celui que la musique, par exemple, vient de procurer : La lumière électrique, assimilée à la foudre meurtrière, crée une sorte de cercle magique et brûlant où s'agitent des acteurs, assimilés à des ombres illusoires et morbides et d'où les vivants, simples spectateurs endeuillés, réduits en cendres, sont exclus :
« La foule en cercle noir, entourait un espace d'où, vers le ciel et les toits, montait une lueur de foudre. C'était, tout ensemble, aveuglant et lugubre. Tout ce qui ne vivait pas dans la blanche fournaise semblait pétri de suie. Les badauds avaient quelque chose de spectral. D'un porte voix jaillissaient sans relâche les ordres d'un metteur en scène. Alors surgissaient au milieu de l'espace enchanté, des simulacres de noctambules, tous en grand arroi de noces, avec des visages si fardés qu'ils semblent momifiés. Et l'on croyait suivre, en pleine rue, sous les quolibets de Montmartre, un blafard épisode de Pirandello. Quand j'eus assez longtemps joué mon rôle dans ce décor de folie, je partis le long des trottoirs. Au-dessus de ma tête, je voyais le ciel où passaient quelques nuages d'un impassible bleu »
17:37 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : henri béraud, littérature, plan sentimental de paris, musique, concert touche | 
mercredi, 25 février 2009
Un révolté raffiné
Le jeune lion dort avec ses dents : Cela nous ramène à l'année 1974. Dans l'une des Radioscopies de Jacques Chancel, Michel Lancelot (1938-1984) était venu présenter un nouveau livre. Ce titre, disait-il alors, il l'avait tiré d'un proverbe d'une tribu bantou. Il l'avait choisi parce que ce sommeil du jeune lion évoquait, pour lui, «une menace positive ou négative ». Non, ce n'était pas forcément lui, « le jeune lion », répondait-il à Chancel. Mais c'était une partie de la jeunesse, disait-il, de la jeunesse de l'époque, celle qui en avait marre « des falsifications culturelles et des salades éhontées ». Le propos du livre, toujours d'après son auteur, c'était la tension, la guerre même, que se livrent la culture et la contre culture. « A trente-six ans, lui demandait alors Chancel, avec sa gueule de faux ingénu, «êtes-vous sorti de votre jeunesse ? » Lancelot éludait : « C'est chez eux que se produisent les créations les plus constructives » C'est pour eux qu'il avait écrit ce livre, parce que les jeunes étaient placés devant les génies et les faussaires de la contre culture. Et qu'il fallait faire le tri. « La véritable culture, c'est le pragmatisme de l'intelligence, qui peut prendre les choses, les exploiter, les dominer et les rejeter. »
Depuis 1974, la controverse est terminée parce que, comme toujours, c'est les faussaires qui ont gagné, et les génies qui se sont tus. Un exemple : Cohn-Bendit est député européen, Debord est mort. Vous n'aurez aucun mal à en trouver d'autres. Depuis 1974, les frontières entre mode, publicité, couture, cuisine, football, talk-shaw et culture sont tombées. Œuvre d'un certain Jack Lang, fossoyeur ministériel de la contre culture. Œuvre relayé par un certain Pivot, aujourd'hui académicien. Ainsi, dans le galimatias de ce qui définit ce qu'est la culture, à présent, on range tout ce qui a un peu de notoriété, et qui parait capable de fidéliser un public. Depuis Tonton qui fait déjà partie de l'ancienne France, (celle où l'on confondait les divinités et les grenouilles) les insoumis et les notables ont impunément partout partouzé ensemble. Témoin la vente Bergé, mécène de Ségolène, et le prix atteint par la Belle Haleine de Marchel Duchamp. Les insoumis et les notables, guidés par Julia Kristeva et Philippe Sollers, ont fait la révolution culturelle dans les Garden party de l'Elysée que chaque Quatorze Juillet a fait, que le président fut de droite ou de gauche. Michel Lancelot n'aura jamais assisté à ça. Il est, dira-t-on, "mort à temps". Et nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de sa disparition. La politique (Nicolas) et la culture (Carla) ont passé leur nuit de noces « à la Lanterne », résidence des premiers ministres à Versailles. A Versailles ! Les aristocrates, sait-on s'ils auront été pendus ? Ils auront été, en tous cas, bien b..... Depuis, Julien Clerc et sa voix de chèvre bêlante, a repris du service dans les box office. Michel Lancelot n'aura jamais vu cela. Julien Clerc remplaçant Line Renaud dans les cortèges officiels des chanteurs de la République ayant leurs entrées l'Elysée. Julien Clerc sera-t-il un jour ministre de la culture ? La chèvre de monsieur Lang, un beau conte à dormir debout, pour le coup...
Michel Lancelot est mort un 25 février, le 25 février 1984, précisément (l'année fatidique d'après Orwell) ! Dans ces années encore cruciales, Lancelot fut l'un des derniers agitateurs à tenter de démêler le vrai du faux et le faux du toc dans le bazar culturel de l'époque; où en est la jeunesse d'aujourd'hui, livrée aux mains seules des faussaires des désirs d'avenir et des ensemble tout est possible ? Pendant plusieurs années, la jeunesse de France écoutait Campus en douce, l'émission qu'anima Michel Lancelot de 20h 30 à 22h30 sur Europe1, de 1968 à 1972. Une telle émission serait aujourd'hui, sur une chaîne comme Europe1, carrément impensable. La roue a tourné, et c'est Drucker qui a placé sa nièce à la télé. C'est Drucker qui reçoit Besancenot à Vivement Dimanche, une belle affiche de plus après Rama Yade. J'écoutais Campus. Je me souviens d'un concert de Barbara, enregistré en direct le 28 novembre 1969 à l'Alhambra de Bordeaux. Je me souviens d'un long entretien avec Brassens, lorsque sortit en 1972 « Le roi des cons ». Je me souviens d'une prise de bec avec Ferré, sur l'argent du show-business gagné sur le dos de l'anarchie. Ferré se défendant : « il vaut mieux vendre de l'anarchie que de vendre de la merde comme j'en écoutais l'autre soir à la télévision, c'est plus noble ». Lancelot, ne disant rien. J'ai retrouvé les paroles d'une chanson que le vieux Léo fit au jeune Michel, peu après sa mort :
Ce qu'il ne faut pas dire en fait toi tu le dis Michel
Ce qu'il ne faut pas faire en fait toi tu le fais Michel
Chaque soir à Campus
Avec dans l'œil et dans l'oreille
Les chants perdus du bout d'la terre
Et de Nanterre
Rappelle-toi là-bas chez les hippies
J'y étais moi aussi
Comme ceux de Nanterre et de Campus
Michel
Ce qu'il ne faut pas dire en fait toi tu l'as dit Michel
Ce qu'il ne faut pas faire en fait toi tu l'as fait Michel
Chaque soir à Campus
Après ce mec tout noir
Avec dans l'œil les chants perdus du bout d'la terre
Et du boulevard Saint-Michel Michel
Rappelle-toi là-bas chez les hippies
Nous y étions nous aussi
Comme ceux de Nanterre et de Campus
Michel
Michel Lancelot avait dans les veines du sang irlandais. « Quand on parle de sang irlandais, disait-il, on oublie de raconter le massacre des Irlandais par les Britanniques. » Et du sang autrichien : « Dans l'univers germanique, les Autrichiens, c'est le raffinement face à l'oppression ! » Michel Lancelot était au final français. Et donc, concluait Chancel « un révolté raffiné. » Michel Lancelot est mort il y a pile vingt-cinq ans. Le temps de faire ce qu'on appelle à présent un jeune. Une citation de Bernanos, à l'intention de ce jeune : « Quand la jeunesse se refroidit, le monde entier claque des dents. » Et une question, legs d'outre-tombe de ce bel esprit hélas oublié : Dans le pays de France, dort-il toujours avec ses dents, le jeune lion ?
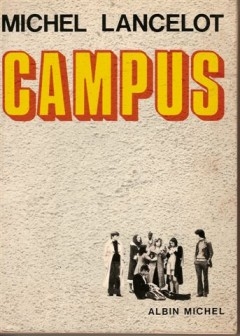
00:06 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : campus, michel lancelot, culture, contre-culture, littérature, europe1 | 
mardi, 24 février 2009
tetjfggea'trgheqwsraézehné'r
Web
Essayez avec cette orthographe : jfg'trghewsraézehné'r
Aucune page ne contient tous ces termes de recherche.
Les termes de recherche spécifiés - tetjfggea'trgheqwsraézehné'r - ne correspondent à aucun document.
Suggestions :
- Vérifiez l'orthographe des termes de recherche.
- Essayez d'autres mots.
- Utilisez des mots plus généraux.
Accueil Google - Programmes de publicité - Solutions d'entreprise - Confidentialité - À propos de Google
C'est pas dément, un truc pareil ?
21:27 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : google, moteur de recherche, tetjfggea'trgheqwsraézehné'r, absurdité | 
La machine à perdre
35,9 millions d'euros pour les Coucous de Matisse. Joli coup de marteau, ça. 29,1 millions pour une sculpture du roumain Constantin Brancusi, Mme L.R, pas mal non plus. Le commissaire est ravi. Bergé aussi. 8,9 un flacon de parfum dans sa boite de Duchamp (Belle Haleine) : voilà du ready-made qui vieillit bien. Dans son jus, comme on dit.
Les instruments de musique sur un guéridon, eux, sont restés en rade. Entre 25 et 30 millions d'euros, personne n'en a voulu. Dingue ça. Son Pablo sur les bras, Pierre s'est déclaré ravi, On l'espère pour lui. Cela lui fera un souvenir d'Yves, hein. Dingue, comme c'est beau, l'amour entre vieux tourtereaux, j'en ai la larme au coin de l'œil. Pas vous, bande d'insensibles ?
Quand même, laisser un Picasso sur le bord de l'enchère ! Mais où les gens ont-ils la tête ? Y'a pire. On ne vous dit pas tout. A 3,50 euros, la Ségolène aussi est restée au vestiaire. Personne n'en a voulu. Pas même les garçons de salle ! Et moi je commence à flipper. Sans doute vont-ils tenter de la refourguer aujourd'hui, en lot, avec une autre saloperie. Mais bon, en temps de crise, une machine à perdre, qui en veut ?
Et au final, si elle ne trouve pas preneur aujourd'hui, à votre avis qui va en hériter ? Hein qui ? Non, pas le peuple de France, quand même pas ! Pas ça ? Pas une deuxième fois ? Vous savez bien qu'il a bon dos, le peuple de France ! Une Ségolène au premier tour, c'est la meilleure façon de se fader un Nicolas au second, ça a marché une fois, pourquoi pas deux ? On aime bien l'histoire qui se répète, ici. Deux mandats du Tonton, deux du Jacquot, deux du Nicolas, vous allez voir. La vente bling-bling, dans un pays bling-bling, avec une candidate bling bling pour une histoire bling bling d'un mandat bling bling. C'est beau comme une chanson de Carla, tout ça. Et comme on dit ici, entre Rhône et Saône, au moment de recevoir « le grand Barça », le Trophée des trophées, on n'est pas près de le gagner ! C'est que la machine à perdre, sympa, on a fini par la trouver sympa dans le beau pays de France: on la lâchera pas comme ça, hélas !
07:40 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : vente pierre bergé, matisse, ségolène | 
lundi, 23 février 2009
Vente Bergé Saint-Laurent
Lot spécial hors catalogue : Une machine royale à foutre en l'air la gauche. Mise à prix 3 euros. Tout doit partir.
Cela intéresse quelqu'un ? Un effort, allez : Une machine à perdre en parfait état d'marche, vous n'allez pas me la laisser sur les bras. Elle a servi qu'une fois. La p-tite dame au troisième rang ? Le monsieur à ma droite ? 3 euros cinquante si vous voulez...

19:27 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : politique, ps, ségolène royal, vente bergé saint-laurent | 
dimanche, 22 février 2009
Chez tante Zize
On remettait hier, à l'Institut Lumière à Lyon, le 5ème prix Jacques Deray. Jacques Deray (1929-2003), c'est Le Gigolo (1960), La Piscine (1969), Borsalino (1970), Flic Story (1975), Trois hommes à abattre (1980), c'est à dire du bon polar populaire. Le prix qui porte son nom récompense donc le meilleur polar de l'année. Après 36 quai des orfèvres d'Olivier Marchal (2004), De battre mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard (2005), Ne le dis à personne de Guillaume Canet (2006) et Le deuxième souffle d'Alain Corneau (2007), Pascal Thomas fut hier soir le lauréat de la cinquième édition. Pour ma part, je ne vais presque jamais au cinéma. Un ami m'avait traîné l'an dernier à l'UGC Odéon à l'occasion d'un passage à Paris, j'avais vu un navet sur Amin Dada dont je me suiis remémoré quelques images, quelques effets faciles, dans le métro en allant à l'Institut Lumière hier soir. Auparavant, je crois que je n'avais pas mis les pieds dans une salle obscure depuis 1998. Et donc, "Le Crime est notre affaire" fut le second film que j'aurais vu en salle du siècle présent. Je tiens là peut-être un record.
C'est vrai que l'Institut Lumière, rue du Premier Film à Monplaisir, est un lieu émouvant. Pour beaucoup de raisons. Cette place toujours vide et assez triste, où trône l'horrible monument élevé à la mémoire des frères Lumière, signe l'arrivée dans les lieux. La villa familiale d'un cossu assez dix-neuvième et très mastoc, villa d'industriels - je n'aime pas trop -. C'est à partir de la rue du Premier Film qu'on peut rêver un peu; je revois la sortie des Usines, l'homme en vélo, le chien qui aboie - et je ne peux qu'avoir la page de Béraud en tête, cet atelier - l'une de mes grandes tantes, enterrée à présent dans le cimetière de Francheville-le-Haut, a passé sa vie dans cette usine - Lorsqu'elle venait deux ou trois fois par an nous rendre visite, avec toujours les mêmes sortes de gateaux, je lui trouvais un air moustachu, sous une toque beigeâtre. Je me suis souvenu aussi d'une voix nasale assez désagréable, et j'ai imaginé sa vie dans cette rue d'un faubourg à l'époque, cette tante qu'on surnommait "la tante Zize", ouvrière conditionneuse de plaques photographiques, une vie assez triste, avec un fils handicapé à cause d'une tuberculose d'enfance mal soignée, mort lui aussi. Trace d'une famille qui a toujours été assez lointaine, et à présent disparue. Pour moi, l'Institut Lumière, c'est chez Tante Zize.
Chez tante Zize, hier soir, Bertrand Tavernier a donc remis à Pascal Thomas son trophée après la projection du film. Une fantaisie policière, à vrai dire, plus qu'un polar, avec Dussolier et Catherine Frot, laquelle tient le film sur les épaules. Quand je lisais des polars, je préférais Simenon à Agatha Christie. C'est Pierre Bayard, récemment, qui m'a un peu ouvert les yeux sur le coté comique, voire même farfelu et pas du tout rigoureux - au contraire de la légende - des romans de Christie. La limite n'y est, en effet, jamais net entre délire et théorie, chez Poirot comme chez les autres enquêteurs. Dans "Qui a tué Roger Ackroyd", il s'amuse a ré-écrire Le Meurtre de Roger Ackroyd et en conduisant une autre enquête, il trouve un autre coupable. Il s'amuse. Pascal Thomas, lui aussi, s'amuse. Il met en avant le coté ludique des enquêteurs dans cette histoire qui joue sur les clichés. De magnifiques décors, au passage. Une narration pépère, reposante. Dire que je me suis amusé serait beaucoup dire. Mais je ne me suis pas ennuyé. Le public non plus. Que des grisonnants, chez tante Zize. Tavernier, que je n'avais pas vu depuis longtemps, et Pascal Thomas, c'est blancs cheveux et cheveux blancs. Tous ces vieux gamins se la jouent un peu relâché, avec une cour de trentenaires qui les appelle par leur prénom. Au moment des discours de circonstances, ils ont du mal à ne pas devenir agaçants, les deux vieux. Leur public ressemble au public des premières. Je me demande quel regard la tante Zize poserait là-dessus, elle. En recevant son prix, Pascal Thomas, qui a suspendu deux fois sa carrière de cinéaste pour celle de collectionneur, s'est arrangé pour placer le nom de Saint-Laurent, - me souviens plus comment. Neuf ans collectionneur : un parfait notable, cet amuseur. A-t-il réservé son billet pour la vente de demain au Grand Palais? Qui sait. Quelle distance, dans le vieil atelier des Lumière, de cette gent prétendument culturelle jusqu'à ma tante Zize et ses gâteaux, sa toque, son respect des convenances, ses principes (elle avait le tutoiement moins facile que nos éminences cinématographiques...) ! En sortant, j'ai pensé à son petit pas trottinant il y a des ans sur ce même trottoir, je l'ai vu passer et repasser par cette rue du Premier Film, avec toutes ses copines-ouvrières, que je n'ai jamais ni vues, ni connues. Elle portait toujours des chaussures à talons plats, marrons, assez vilaines. Sur le mur de l'Institut, même Woody Allen a sa plaque ! Pas la tante Zize. C'est dire !
Ma tante Zize n'a jamais amusé personne.
Pas même moi.
Du coup je lui dédie ce billet. A elle, comme à tous les inconnus illustres de la rue du Premier Film.

11:17 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : jacques deray, pierre bayard, cinéma, pascal thomas, polar, institut lumière, le crime est notre affaire | 
samedi, 21 février 2009
Le Mont-Blanc, faute de mieux
Si j'étais à Paris aujourd'hui, je serais allé à l'exposition du Grand-Palais, prélude à la vente de la collection Saint-Laurent qui débute le 23 (voir calendrier ci-dessous). Sûr. Il parait que Pékin rouspète à propos de deux figures (une tête de rat et une tête de lapin) qui auraient été volées durant les guerres de l'opium. Les Chinois exigent une restitution. Un référé devant le tribunal de grand instance de Paris pour bloquer la vente ... Pierre Bergé, qui est un vieux filou, sait ce qu'il fait en rendant l'affaire publique : Les deux têtes dépasseront sans doute les meilleures estimations ; cela dit, la tête de rat et celle de lapin ne m'intéresseraient guère (je suis obligé de parler au conditionnel puisque je ne suis pas à Paris et je n'ai pas la bourse qu'avait Yves Saint-Laurent pour s'offrir toutes ces friandises culturelles.) Donc aujourd'hui ou demain, je serais allé à l'expo, et à partir de lundi j'aurais assisté à la vente. J'aime l'ambiance unique des salles des ventes, qu'elles soient remplies de brocs en jeans sales et pulls à mailles tirées ou de collectionneurs en cravates et index discrets. Je crois l'avoir déjà dit, je radote, c'est un peu normal par les temps qui ne courent plus, on finit par se répéter. J'aurais assisté à la vente, donc, guettant les premières enchères, jouant de, avec prudence, mais histoire de, quand même : le mouvement furtif de la pointe du pied, le plissement du front ou le hochement du chef, l'index qui pianote sur le genou et soudain... Car il y a de beaux spécimens dont les acquéreurs sont déjà connus. Mettre son petit grain de sel dans le bel agencement... Je ne cracherais pas sur un Degas ou un Ingres, tiens, pour décorer mon petit bureau d'où je vois, pour me consoler, les lointains reliefs du Mont-Blanc, faute de mieux.
Exposition ouverte au public - accès libre
21 et 22 février, de 9h à minuit
23 février, de 9h à 13h
Ventes aux enchères
23 février, 19h : art impressionniste et moderne
24 février, 14h : tableaux anciens, dessins anciens, tableaux 19e siècle
15h : orfèvrerie, miniatures
18h : arts décoratifs du 20e siècle, art tribal
25 février, 13h : sculptures
19h : art d'Asie, objets d'art, céramiques, mobilier, art islamique, archéologie

01:44 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : vente saint-laurent, pierre bergé | 
vendredi, 20 février 2009
Ecrivains aphones
Qu'est-ce qu'un écrivain aphone ? Un écrivain sans voix. Qu'est-ce qu'un écrivain sans voix : un écrivain qui ne sait parler que de soi. Soi. Soi, à tout bout d'pages, entraînant chacun de ses lecteurs dans l'illusion et la banalité que représente la pseudo-connaissance de soi par ce type d''écriture. Entraînant son lecteur dans sa vision lilliputienne des choses. Qu'est-ce qu'une vision lilliputienne des choses ? Une vision lilliputienne des choses est une vision dépressive du monde. Une vision vue de soi. La vision dépressive de l'écrivain aphone. Un écrivain a tout à fait le droit d'être névrosé (dixit l'illustre Barthes). Mais pas celui d'être dépressif. Car alors il perd sa voix. Je constate qu'un des traits communs de tous les écrivains aphones que les cinquante dernières années ont produits est d'être dépressif. Ou de faire comme. Des exemples ? On en trouve à la pelle. Je me contenterai de deux icones : Côté mâle, regardez Charles Juliet. Côté femelle, tournez les yeux vers Annie Ernaux. Aussi aphones l'un que l'autre. Aussi centrés sur eux. Vision du monde au ras de sa propre existence. Leur seul individu. Le mien. Nos miasmes. Aucun style. Le monde, avec cela, comme évacué. Absent.
Dans un chapitre de La culture du narcissisme, l'essayiste américain Christopher Lasch a fort bien analysé la manière dont ces écrivains aphones sont les chevaliers servants de l'ordre narcissique qui s'impose à nous tous. Il est l'un des premiers à avoir mis en lumière la différence entre l'introspection à laquelle une véritable autobiographie convie son lecteur, et la platitude désespérante de ce discours truqué qui est celui du faiseur d'autofiction. Pour finir, ce paragraphe essentiel de Christopher Lasch sur le sujet,
« Les confessions entreprises dans cette atmosphère d'irresponsabilité dégénèrent en anticonfessions. Ces expositions de la vie intérieure en deviennent, sans le vouloir, la parodie. Ce genre littéraire qui semble mettre en valeur l'intériorité nous prouve au contraire que la vie intérieure est précisément ce qu'on ne peut plus prendre au sérieux. L'écrivain d'antan mettait à nu ses luttes intérieures, car il était persuadé qu'elles représentaient un microcosme du monde. Les confessions de l'artiste contemporain n'ont de remarquable que leur écrasante banalité. Le voyage intérieur ne révèle que le vide. L'écrivain ne voit plus la vie reflétée dans son esprit mais, au contraire, le monde, même vide, comme son propre miroir. Lorsqu'il rend compte de ses expériences "intérieures", ce n'est pas pour nous donner un tableau objectif d'un fragment représentatif de la réalité, mais pour séduire afin qu'on s'intéresse à lui, afin qu'on l'acclame, qu'on sympathise, et qu'ainsi l'on conforte son identité chancelante ».
Christopher Lasch, La Culture du Narcissisme (Climats)
Voilà. C'est, brièvement, ce que j'appelle être aphone. Avoir une voix, et ne révéler que le vide. Mais la notion demande à être retravaillée en temps et heures. Elle le sera assurément.
20:25 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (27) | Tags : autofiction, christopher lasch, la culture du narcissisme, écrivains aphones | 
jeudi, 19 février 2009
Le monde change
"Le monde change." J'entends souvent débiter ce genre d'âneries par des gens qui souvent ont un portable à la main, des écouteurs à l'oreille. et une épingle de travers dans l'arcade sourcilière. Le monde ne change pas. Non. Ce sont les générations qui le peuplent, qui changent. Qui passent la main. Qui se refilent, comme on dit, le témoin. Quand j'étais gosse, dans les années cinquante/soixante, j'ai vu partir aux caveaux de familles et aux fosses communes la dernière génération née dans le XIXéme siècle, celle, très pragmatique, dont les membres avaient commencé leur vie d'adulte durant la première guerre mondiale, dans une France encore en grande partie agricole, et dont les derniers rares centenaires viennent de quitter les vivants que nous sommes encore. Puis s'en est allée des affaires celle de leurs enfants, une génération ancrée dans le matérialisme, et qui a voulu et bâti la société de consommation dans laquelle nous sommes tous nés, quel que soit à présent notre âge. Celle du premier baby boom, qui n'aura en guise d'expériences historiques, vécu que le crédit , le spectacle et la consommation, quitte à son tour le monde du travail. Et je dois bien reconnaître que ce ne sont pas les mêmes vieux que ceux qui étaient vieux quand j'avais vingt ans, que je rencontre sur les marchés et dans les pharmacies. Souvent, je pense à ces vieux que je croisais, qui ne sont plus. D'autres vieux les ont remplacés. Qui leur ressemblent sans être comme eux. Autre langage. Autres préoccupations. Autre sagesse. Et ce qui est vrai des vieux est vrai de chaque tranche d'âge. Le quadragénaire d'aujourd'hui n'est plus le même que celui d'il y a cinquante ans. Même chose du moutard de six-sept ans. Et il faut être sacrément imbu de sa personne et de cette stupide société pour y voir un progrès. C'est moi qui vous le dis. Ou une regression, d'ailleurs. Quand serons-nous capables de voir les faits sans ce maudit esprit d'analogie, de comparaison, qui fausse tout jugement ? Oui, les générations passent à la queue leu leu et diffèrent, dans un monde qui, lui, imperturbable, suit sa loi. Ce sont les conditions d'existence, et les mentalités dans ce monde stable, qui, elles, varient. Pour changer les conditions d'existence et les mentalités, comptez trois ou quatre générations. La génération aux affaires actuellement, celle des Nicolas et des Ségolène, sa niaiserie, son incroyable aveuglement historique, son égoïsme aussi béat que spectaculaire et frileux, est sortie tout droit des dessins animés de Walt Dysney, des boums du samedi soir dans les garages, du premier homme sur la lune et des belles illusions que lui avait léguées la précédente. Et quand on regarde les trentenaires, les "enfants de la téle" comme dit le cynique Arthur, cela ne s'arraange pas. Vous me direz, bien sûr, et vous aurez raison, que j'oublie un peu vite la valeur des individus en parlant ainsi. Soit. La vie intérieure, la vie spirituelle, la vie intellectuelle de chacun. Soit. Mais ce n'est pas cela qui détermine les grands phénomènes mondiaux. Hélas. Ni Jaurès, ni Romain Rolland, ni Proust, je prends au hasard trois noms d'hommes fort différents, n'ont empêché Quatorze Dix-huit, comme ni Rabelais, ni Erasme, ni Marguerite de Navarre n'ont su éviter les guerres de religion, et ni Chateaubriand, ni Danton, ni Madame Roland, la Terreur. Le monde ne change pas. C'est bien cela, le problème.
10:56 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : générations, consommation, culture, renouvellement, le monde change | 









