mardi, 02 juin 2009
Ecrivains de la fabrique
J’ai découvert un peu par hasard, il y a une vingtaine d’années de cela qu’il avait existé à Lyon un ensemble de romans structurés autour de la fabrique de la soie, des années 1870 à 1930. Quand je dis par hasard, c’est en réalité en fouinant chez des bouquinistes. Et petit à petit, les écrivains lyonnais ont trouvé place en mes rayons. La plupart ne sont que pittoresques. Certains sont vraiment attachants. Quelques-uns furent des maîtres dans leur domaine. Je songe à Henri Béraud, bien sûr, mais aussi à Gabriel Chevallier, à Nizier du Puitpelu.
Bernard Poche, qui avait déjà publié Lyon tel qu’il s’écrit (Presses universitaires de Lyon – 1990) propose chez Permezel (un éditeur courageux que je salue au passage) un « Dictionnaire bio-bibliographique des écrivains lyonnais – 1880-1940) : l’universitaire y a recensé plus de trois cents noms d’écrivains ayant, de 1880 à 1940 entretenus avec Lyon « un rapport significatif ». Parmi eux, ceux que j’appelle les écrivains de la fabrique, qui composèrent un jour un roman de mœurs, de sentiments ou de caractère ayant pour siège une maison de soierie, et participèrent ainsi à un témoignage entre réalisme littéraire et journalisme sociologique sur le Lyon de la Belle Epoque. Poche a retrouvé aussi la trace de nombreux poètes ou nouvellistes, conteurs et chroniqueurs. L’ouvrage a le mérite de rappeler la ferme volonté de décentralisation intellectuelle qui, jusqu’à 1940, a présidé dans l’esprit de plusieurs générations d’écrivains lyonnais. Le seul reproche qu’on lui pourrait faire, c’est que la recherche bibliographique a souvent pris le pas sur celle, biographique : sans doute parce que la première est plus simple à réaliser que la seconde, le monde et son labyrinthe étant plus vaste et hasardeux qu’une bibliothèque et ses rayons. Et que nombreux sont, parmi ces auteurs, ceux qui disparurent ou sombrèrent dans l’anonymat.
Je recopie une notice qui a tout particulièrement attiré mon attention, parce qu’elle est particulièrement emblématique, peut-être, et que j’ignorais tout de cet écrivain :
« BARDOT Henri (Lyon …- ….)
La totale ignorance dans laquelle on est de la vie d’Henri Bardot est d’autant plus surprenante que L’Autre Rive publié en 1917 mais qui reflète une certaine ambiance du Lyon des dernières années de l’avant-guerre, est peut-être l’expression la plus achevée du roman lyonnais de cette période et figure très honorablement à côté des œuvres antérieures d’Esquirol, d’Hennezel et de Rogniat. Les quelques échos que l’on recueille à son sujet laissent entendre qu’après la guerre il avait sombré dans la bohême et l’alcoolisme : l’amère misogynie de l’essai qu’il publie en 1920 se rattache aisément au pessimisme de son roman. Ses projets ultérieurs ( "pour paraître prochainement ») n’ont évidemment pas abouti. Aucune trace ne semble, apparemment, demeurer de ce naufrage.
L’Autre rive, P.Jouve, 1917 ; L’art de mal vivre et de bien mourir, ou maximes sans prétention suivies de quelques histoires également profitables, par Henri BARDOT, lyonnais, ill. Combet-Descombes, Ed de la Revue Fédéraliste, Trévoux, imp. Jeannin, 1920 »
Et je cite quelques patronymes (ou pseudonymes) de ces illustres oubliés, outre les maîtres que furent Clair Tisseur, Vingtrinier, Béraud ou Chevallier :
Alexandre Arnoux, Louis Aurenche, Emile Baumann (admirateur et ami de Léon Bloy, auteur de très beaux Mémoires), André Billy, Auguste Bleton (pour plaire à Marcel Rivière), Magali Cabanes (auteure d'un joli Masque de Lyon), Georges Champeaux (dont j'ai déjà beaucoup parlé pour le roman d'un vieux groléen), David Cigalier, Henry Clos-Jouve, Max André Dazergues (un pur Delly de Lyon !!!) , Jean Dufourt ( et son Calixte), Charles Fenestrier (co-singataire, avec Béraud, des Marrons de Lyon), Albert Giuliani, Marcel Grancher (qui mit en selle Frédéric Dard et son San Antonio et écrivit avec La Soierie se meurt un bouleversant témoignage de la faillite de Lyon en 1930), Henri d’Hennezel, Charles Joannin (pour Périssoud, militant lyonnais), Joseph Jolinon (voir mes billets sur trois de ses romans dans la rubrique : la bibliothèque est en feu), monseigneur Lavarenne (spécaliste de Guignol), Claude Le Marguet (pour Myrelingues la Brumeuse), Edmond Locard, Amédée Matagrin, Louis Pize (poète injustement oublié), Xavier Privas (prince des chansonniers), Léon Riotor (Léon de Lyon), Pierre Scize, Louisa Sieffert (une poétesse elle aussi injustement oubliée), Joséphin Soulary, Tancrède de Visan (Sous le signe du Lion) …
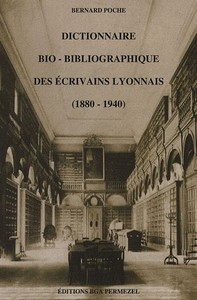
20:42 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : bernard poche, permezel, littérature, romans, lyon, écrivains lyonnais | 
lundi, 25 mai 2009
Zozo, chômeur éperdu
Bertand Redonnet ne manque pas de malice. Zozo, son personnage, est un «vrai visionnaire », nous voici prévenus dès les premières lignes : ce qu’il voit arriver, c’est un monde où chacun sera assigné à sa place par une administration de mieux en mieux organisée ; un monde sans rivière à vairons ni battue aux sangliers ; un monde pour transformer les braconniers de son espèce en une autre espèce d’hommes, une espèce nouvelle de chômeurs -parce que chômeur, ça sonne mieux que sans profession ; un monde qui se met en place vers la fin des années cinquante, au prix de la fin d’un autre, le sien : voilà ce que  Zozo, de loin, a vu venir. Chômeur ! Tel est le mot central du titre, et l’on ne comprendra que dans les dernières pages, sur un coup de fourche à fumier aussi imprévu qu’inévitable, pourquoi éperdu.
Zozo, de loin, a vu venir. Chômeur ! Tel est le mot central du titre, et l’on ne comprendra que dans les dernières pages, sur un coup de fourche à fumier aussi imprévu qu’inévitable, pourquoi éperdu.
« Il était le principal personnage de ce drame, après le pendu bien sûr, quoique… » : Bertrand Redonnet signe là une fable, nous dit le quatrième de couverture « sans morale apparente ». Quoique… Les quatre dernières lignes en livrent une, aussi ironique qu’explicite… Que je ne dévoilerai pas, pas davantage que je ne dévoilerai la trajectoire de Zozo, d’arabesque en arabesque, toute tracée.
Pour inscrire sa fable dans l’histoire en marche, Redonnet évoque de ci de là quelques événements : météorologique, comme le mois de février cinquante-six, « alors que le gel mordait la pierre et la terre et que la neige durcie comme une croûte engloutissait le monde depuis des semaines » ; historique, comme le dix-neuf mars 1962, jour des accords d’Evian, ou décembre 1918, année de la de la naissance de son héros peu après l’armistice. Au cours de la narration, quelques dates (62, 64) plantées dans le texte comme des bornes, jalonnent la résistance de Zozo aux assauts des bureaucrates.
Pourtant, bien qu’il ait « la manie des dates et des symboles », le calendrier de Zozo s’écoule en marge du temps des hommes, « selon un ordre bien défini qui, s’il n’était pas réfléchi, n’en était pas moins réglé sur le grand mouvement des choses, en fonction des saisons, les saisons elles-mêmes vécues par rapport aux mois et les mois articulés sur les lunes ». L’histoire de Zozo se déroule dans un pays fait de pommiers de plein-vent, d’allées de noyers et de taillis bourrus, un pays de légende, signe l’éditeur… on a plutôt envie de dire de mémoire, puisque c’était le pays de Genevoix, le même que celui de Giono, que celui de Guilloux. Assurément, Redonnet est de cette écurie-là .
00:05 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : zozo chômeur éperdu, bertrand redonnet, le temps qu'il fait, romans | 
vendredi, 16 janvier 2009
Dans la hauteur obscure des biblothèques

Quelles sont les dernières mains à s'être posées sur ces reliures ? Les derniers regards à s'être attardés sur ces pages ? Ces volumes dominent un monde qui les ignore, croupissant dans l'ombre éperdument fascinante d'un savoir toujours recommencé. Doivent-ils au hasard alphabétique du nom de leurs auteurs d'être perchés si haut ? Ou plutôt au désamour d'un public, de moins en moins féru d'érudition ?Ces sommets obscurs et silencieux des salles de lecture du dix-neuvème siècle sont véritablement des lieux à part. Neiges éternelles du savoir oublié, fossiles secrets et tétus, juste avant le plafond... L'ouvrage ancien, là-haut siégeant, tire-t-il cependant un peu d'honneur du fait que l'atteindre serait devenu méritoire ? Ou bien sent-il poindre en lui l'amertume de l'exil et de l'abandon définitif, depuis combien de temps délaissé en de telles cimes, tel un billet à la valeur démonétisée ?
L'échelle est un peu comme une baguette de sourcier. Quelles mains agrippent ses barreaux, et tatônnent dans le vide ? Quel regard un peu myope cherche l'appui sur un rayon pour l'y poser ? Quels pas craquent au sol ciré ? Odeur grinçante de ce parquet : A la recherche de quoi, déjà, cette échelle qui hésite ? Où donc, surtout ? De quel titre, jadis rangé ? Dans le labyrinthe des alphabets et des cotes, l'échelle, baguette de sourcier, oh véritablement ! Car tout là-haut, le cimetière des livres est devenu le cimetière des savoirs. Paradis, enfer ou purgatoire, qui sait ? Mais pour quel retour ? "La Bibliothèque est illimitée et périodique. S’il y avait un voyageur éternel pour la traverser dans un sens quelconque, les siècles finiraient par lui apprendre que les mêmes volumes se répètent toujours dans le même désordre – qui, répété, deviendrait un ordre : l'Ordre. Ma solitude se console à cet élégant espoir" (Borges)
09:09 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, écriture, romans, borges, bibliothèque | 
mercredi, 07 janvier 2009
Le père Rival
A Lyon les bouquinistes, paradis des chineurs, refuge des épuisés, se sont installés depuis quelques décennies sur le quai de la Pêcherie, face au quai de Bondy le long duquel siège chaque dimanche matin le marché de la création. Les bouquinistes lyonnais ont en cela imité leurs confrères parisiens des bords de Seine. En rendant hommage à un citoyen de la Belle Epoque, bouquiniste de son état et, sans aucun doute, oublié de tout le monde, je voudrais leur rendre hommage à tous.. Je suis pour ce faire le témoignage d’Henri Béraud dans sa Gerbe d’Or, qui nous apprend qu'en ce temps jadis, c'étaient les quais du Rhône qui, à Lyon, étaient comparables à ceux de la Seine, c'était le long du Rhône que chineurs et bibliophiles trouvaient leur bonheur :
« Du pont de la Guillotière au nouveau quartier Grolée, le rez-de-chaussée de l’Hôtel-Dieu n’était qu’un bric-à-brac. On n’y voyait que bouquinistes, marchands d’estampes, tapissiers, empailleurs d’oiseaux. Le père Rival, qui était un peu tout cela, avait son échoppe au milieu de la façade, sous le dôme de Soufflot, à droite du grand portail. Quelle échoppe, quel éventaire ! Tout ce qu’on pouvait pendre ou accrocher était accroché ou pendu là, aux murs gris du vénérable édifice, jusqu’aux voûtes de la soupentes, où dormait le père Rival. Lui-même se présentait sous un aspect des plus fantasque, le chef couvert d’un bonnet carré, à tour de velours et fond d’indienne, la barbe fauchée à la serpe sur le rond des bajoues, l’habit défait, de gros sabots aux pieds, l’air d’un alchimiste à la Rembrandt, et le tout bien calculé pour intriguer et faire jaser.
Toute cette friperie, crocodiles et mannequins, servait de mise en scène à un commerce mal défini où dominait la bouquinerie. Pour cela encore, il avait sa manière, bien à lui, de mener les affaires. Ses livres étaient répandus sur le trottoir en tas effondrés, bords à bords : le tas de deux sous, le tas de cinq sous, le tas de dix sous, le tas de vingt sous ; tout cela sans limites bien marquées, si bien que d’astucieux naïfs prenaient leur air le plus innocent pour payer cinquante centimes des bouquins choisis adroitement sur la pente du tas à un franc, mais fort dignes en réalité du tas à deux sous dont ils provenaient.
-Merci, mon brave.
L’amateur emportait sa trouvaille, détalait. A un autre. Ce spectacle de l’indélicatesse publique constamment renouvelé laissait le vieux libraire imperturbable. Il prenait une prise, donnait du « mon brave » à ses fripons imaginaires et, d’un œil endormi, surveillait sa boutique. » [1]

Le Père Rival de Béraud a-t-il vraiment existé ? Il est certain que oui. Pour les besoins de sa fiction, l'écrivain a dû néanmoins changer son nom. Ironie du sort, ce sont ces bouquinistes qui ont sauvé l'oeuvre de Béraud, ainsi que celles de tant d'auteurs ou de collections inaccessibles désormais dans les centres de distribution d'objets culturels non déterminés qui se trouvent partout en France sous les enseignes Fnac, Virgin ou autres.
[1]Henri Béraud, La gerbe d’Or,.
06:50 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : bouquinistes, quai de saône, lyon, livres, romans, littérature, béraud | 
vendredi, 26 décembre 2008
Le marchand-fabricant : un type littéraire lyonnais
« Ne lui demande rien ; il a mal à la main qui donne » « On ramasse pas des argents à regonfle sans les tirer de la poche de quelqu’un. » ; « Le fabricant mange quand il a faim, le canut quand il a pain. » : La première caractéristique du marchand fabricant, dûment consignée par la plaisante sagesse lyonnaise, [1] c’est tout simplement l’avarice. Une avarice chronique Si par hasard le marchand fabricant fait preuve de bonté, il convient donc de le consigner aussitôt dans des registres. Marcel Grancher relate dans des souvenirs de jeunesse [2] l’anecdote de ce patron qui, après avoir remis d’année en année l’augmentation de leur vieux fondé de pouvoir en alléguant tantôt la baisse des cours en Chine, tantôt les krachs américains, finirent par lui proposer, en guise de faveur susceptible de le faire patienter une année de plus, la clé des W.C. patronaux, qu’il pourrait utiliser désormais à sa convenance, au même titre qu’eux [3].
Deuxième caractéristique constitutive du personnage, il est triste et casanier. En publiant chez Grasset sous le pseudonyme de Jean Farmer une satire codée des milieux industriels lyonnais, Jean Duplan ouvre en 1911, avec Messieurs les Fabriciens, une porte dans laquelle beaucoup s’engouffreront par la suite :
« La gaieté est une attitude vulgaire qu’il faut laisser aux petites gens. Le pessimisme seul est comme il faut. Donnez à votre visage un aspect sévère et triste. C’est celui qui s’harmonise avec les murailles grises de nos maisons. »[4]
Le territoire du marchand-fabricant, demeure bien sûr Le quartier du Griffon où il vit depuis 1831 sous la terreur inavouée du pays des canuts qui le domine : La rue Terraille, où sont les entrepôts de M. Dax, « morne et terne », serrée « entre d’immenses maisons laides, gluantes d’humidité » ; la rue des Capucins où loge l’Adolphe Haudequin de Colette Yver[5] ; la place des Feuillants, siège de la redoutable maison Chambard-Giroud de Ciel de Suie : Au début de ce roman, la description qu’Henri Béraud fait de la caste est un morceau indépassable :
« Sur les pavés toujours gras, qui semblent renvoyer au ciel plus de clarté qu’ils n’en reçoivent, le jour plombe comme une pluie de cendres. Sans relâche, un relent de latrines s’exhale des cours et des impasses, où les gens glissent en silence, comme des noyés. C’est le Griffon. C’est le quartier des millionnaires.
L’étranger, que l’aventure égare en ces lieux se demande s’il ne rêve point. Il se frotte les yeux, il se bouche le nez : « Quoi ! Les plus riches commerçants de la terre vivraient là, dans cette ombre et ces odeurs ?- Ils y vivent. Et ils y meurent.
C’est au fond de ces taudis que, poursuivant de père en fils la tache séculaire, ils s’acharnent à la besogne. De génération en génération, l’usure des meubles leur a renvoyé le reflet de visages plus durs et plus tristes. Lyon leur appartient. Vingt mille immeubles leur suent des rentes ; leurs châteaux déserts règnent sur des lieues de vignes, de blés, d’étangs et de bois ; leurs coffres regorgent ; ils pourraient dominer le monde et vivre comme des princes, et ils sont là, chaque jour, souvent seuls, dès l’aube et tard dans la nuit, même le dimanche . Ils ignorent la joie. Ils se refusent le moindre plaisir. Une seule passion les dévore, la plus ardente et la plus opiniâtre, celle qui ferme dans l’effort d’une suprême convoitise les doigts crochus de leurs moribonds. »[6]
Troisième caractéristique, une discrétion toute matinée de patine provinciale : « Efforcez-vous d’être comme tout le monde, c’est une attitude lyonnaise », tel est le conseil de Calixte prodigué par Jean Dufourt dans son Introduction à la Vie Lyonnaise : Avarice, tristesse, discrétion, pour ne pas dire hypocrisie, bêtise : le marchand fabricant de naguère a finalement très mauvaise presse. Pourtant, comme celle du canut, sa légende possède un double versant. On peut, comme le suggère Henri Pansu dans l’étude qu’il consacre à l’un d’entre eux,[7] tenter de comprendre le caractère et de cerner ses paradoxes à l’aune des circonstances historiques qui l’ont modelé. Dans un monde en crise dont il ne maîtrise pas tous les enjeux, le marchand-fabricant est l’héritier contraint de la morale sévère de l’Ancien Régime. A la fois industriel et négociant, ce rude catholique s’est plus ou moins fait tout seul à force de patience et de ruse. Séduit par les libertés commerciales que lui présente la modernité, effrayé par les revendications sociales inévitables qu’elle occasionne, il fait au sens propre le grand écart entre l’église et la banque, tout en vivant le plus loin possible des modes parisiennes et des masses laborieuses, grâce à un emploi du temps bien rempli, qui constitue son meilleur refuge.
Du point de vue du marchand fabricant, l’avarice, qu’on ne s’y trompe pas, ne constitue pas tout à fait un vice, bien au contraire : elle est le symptôme de sa prévoyance, atteste la bonne tenue de son ménage, garantit la sage gestion de sa maison et relève de son éthique du travail, car « c’est l’argent qui fait l’argent », et « de rien il est difficile de faire quelque chose »[8] Son avarice est donc un signe de distinction, elle est le gage de sa moralité, de sa vertu, de sa religiosité : sans avarice au quotidien, en effet, pas d’affaires prospères et durables, pas non plus de charité possible. Or, bien qu’il pratique l’économie dans ses petits détails, il faut comprendre que le marchand fabricant, comme son épouse, est en réalité un être d'une extrême générosité :
« Tel d’entre nous dont les charités sont manifestes, publiques, éclatantes, ne donne à ses employés que des appointements de misère, et sa femme, quêteuse obstinée pour les pauvres, dispute avec ses domestiques sur une augmentation de gages de dix francs ».[9]
De même, son apparente mesquinerie masque de façon aussi singulière qu'oriçginale un idéal de beauté auquel, en pur esthète et en victime immolé, il sacrifie avec goût l’essentiel de son humanité :
« Tout sue la misère, et pourtant, c’est plein de soie là-dedans, -plein de soie, plein d’or ; -les balles, soigneusement emmaillotées de toile bise ou de paille, s’accumulent derrière ces fenêtres à grilles, s’empilent dans ces maisons lugubres, du plancher au plafond. On a logé la soie d’abord, les hommes ensuite ; les hommes n’ont pas besoin de beaucoup de place : ils n’ont guère à remuer, - rien qu’à travailler, immobiles, à travailler tout le jour, tous les jours. »[10]
Sa tristesse procède de la même logique : s’il a l’air si austère, c’est que sa joie ne saurait résider pas dans la poursuite des plaisirs, mais dans le fait, plutôt, de veiller sur une œuvre, d’être au monde, pleinement, par la seule énergie de son affaire : La seule passion à laquelle il reconnaît un intérêt, c’est donc de produire de la bonne et belle étoffe afin d’augmenter incessamment son obsédant chiffre d’affaires.
« Le grand-papa est l’homme de son pays qui a le plus travaillé et s’est donné le moins de récréation, c’est en partie pour cela qu’il est devenu riche, il nous faut le suivre sur le même chemin »[11]
Quant à sa discrétion, comment ne pas voir qu'elle atteste surtout de son goût pour l’indépendance ainsi que de sa grande prudence devant les soubresauts politiques et les mœurs du siècle ? Le marchand fabricant est donc, en profondeur, un incompris. Il ne s’en plaint d’ailleurs que rarement, en homme avisé de l'humaine nature, et à quelques intimes seulement :
« Quoique je ne sois pas en mauvaise position, ma maison de commerce, non seulement absorbe tous les capitaux qu’elle a, mais encore nous sommes sans cesse à court d’argent, nous allons en quantité d’affaires, souvent plus loin que nos forces nous le permettent, nous sentons que nous devrions les réduire pour nous trouver moins gênés. Je le sens presque tous les jours. Bon nombre de nos connaissances ne s’en doutent pas parce que je ne me plains pas et que je fais tous mes efforts pour payer avec régularité ce que nous devons. Il faut être chef pour savoir toute la peine qu’il y a à prendre pour faire face partout à tant de dépenses qui surgissent de tant de côtés. »[12]
Le « M. Dax » de « Mademoiselle Dax », l’« Armand Giroud » de Ciel de Suie, le « Calixte Paterin » de L’introduction à la vie lyonnaise, le « Charles Morande » de Vous êtes mon Lyon, « le Foitrasson » de Brumerives, le « Louis Goneret » du Sang de la Nuit, sans être interchangeables, sont tous modèles d’un même « patron ». Entre le caractère molieresque, le type balzacien, porteur de sa condition comme de sa croix, le marchand-fabricant est un personnage astucieusement kaléidoscopiques : selon le point de vue singulier de l’auteur, le modèle romanesque attire la sympathie ou l'antipathie du lecteur, selon qu'il sert ou dénonce l’idéologie qu'il incarne explicitement ; capitalisme, catholicisme, patriarcat. Pourtant, ni Farrère, ni Béraud, ni Dufourt, ni Giuliani, ni Chevallier, ni Daudet ne parvinrent à imposer vraiment à la Fabrique lyonnaise sur le déclin ce César Birotteau dont elle pourrait aujourd’hui s’enorgueillir.
C’est que la Comédie Lyonnaise eut le malheur de venir après la Comédie Humaine dont elle ne semblait présenter, avec plus d’un demi-siècle de retard, qu’une variante locale, lorsque d’autres figures moins romanesques se bousculaient au portillon des réussites pour lui faire la peau :
« D’autres changements l’amusaient : l’homme vedette de la soie n’était plus le seul à pontifier. On entourait surtout celui de l’automobile. De même, ne témoignait-on plus qu’une déférence modérée aux chefs de la banque et de la dorure, qui faisaient figure d’âmes en peine. En revanche, l’homme du ciment paradait. Et l’homme des produits chimiques avait le verbe haut. »
[1] Catherin Bugnard, La plaisante sagesse lyonnaise, Lyon, Audin,
[2] Marcel E. Grancher, Reflets sur le Rhône, Lyon, Rabelais, 1945
[3] La même anecdote se retrouve dans le roman Brumerives de Gabriel Chevallier, publié en 1968 et réédité par Danièle Pampuzac (Gens de Lyon, op. cit.), dont l’action est contemporaine de cette faillite de la soierie. Ce roman relate la folle liaison d’un soyeux nommé Foitrrasson avec une courtisane du nom de Loulou Biche, sur fond de crise mondiale et de faillites.
[4] Jean Farmer, Messieurs les Fabriciens, Paris, Grasset, 1911
[5] Colette Yver, Haudequin de Lyon, Paris Calmann Lévy, 1927
[6] Henri Béraud, Ciel de Suie, Paris, Ed. de France, 1933
[7] Henri Pansu, Claude-Joseph Bonnet, Lyon et Jujurieux 2003, op. cit.
[8] Henri Pansu, Claude-Joseph Bonnet, lettres de Bonnet p 93
[9] Jean Dufourt, Calixte, Introduction à la vie lyonnaise, Paris, Plon, 1926
[10] Claude Farrère, Mademoiselle Dax jeune fille, Paris, Flammarion, 1908
[11] Henri Pansu, Claude-Joseph Bonnet, lettres de Victor Bonnet p 278
[12] Henri Pansu, Claude-Joseph Bonnet, lettre de C-J. Bonnet, p 286
[13] Joseph Jolinon, L’Arbre sec, Paris, Rieder, 1933
01:52 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, lyon, marchand-fabricant, société, romans | 
dimanche, 19 octobre 2008
Médecin des pauvres.

Le personnage narrateur de deux excellents romans lyonnais, peut-être les deux meilleurs qui soient, est un médecin, et un médecin des pauvres. Qu'en faut-il en penser ? Est-ce un hasard ?
Ciel de Suie, le troisième volet de la série de La Conquête du Pain d'Henri Béraud parait aux Editions de France, en 1933. Le Passage de Jean Reverzy est publié chez Julliard, en 1954. Béraud n'a alors plus que quatre ans à vivre, puisqu'il s'est éteint à Saint-Clément les Baleines, le 24 octobre 1958. Et Reverzy plus que cinq, qui est mort brutalement le 9 juillet 1959.
Entre les deux, une indéniable unité de ton dans la mélodie.
Béraud, tout d'abord, puis Reverzy :
« Mon métier n'est pas d'écrire. Je suis médecin à la Croix-Rousse, médecin des canuts, une espèce de rebouteux en jaquette et chapeau melon. Mes clients sont mes amis. Ils m'appellent tantôt le Docteur comme s'ils n'en connaissaient point d'autre, et tantôt le Militant, à cause de mes opinions qui sont les leurs. Souvent, le soir, avant d'aller en vieux garçon que je suis vider un carafon de marc aux cafés de Bellecour, je m'attarde à trinquer avec eux. Ailleurs, on m'a fait la réputation d'un cynique, et même d'un méchant homme. Mes canuts trouvent que je suis trop franc :
- On vous l'a bien fait payer, disent-ils. Quand je ne suis pas là, ils ajoutent.
- S'il avait su se taire, il ne passerait pas sa vie à soigner les pauvres !... Les braves gens ! Ils connaissent, eux, le goût amer de la vérité. Je ne me plains pas. En agissant comme je l'ai fait, je savais que j'allais perdre. Qu'importent la quiétude et la douceur de la vie, s'il faut les payer du mépris de soi-même ? »
« J'étais un petit docteur attaché à une banlieue triste. Je savais un peu de médecine : la digitale ranime les cœurs, la morphine endort les douleurs, la pénicilline modère les fièvres. Quand je devinais un cancer, un peu attristé, je disais : vous entrerez à l'hôpital. (...) Fixé dans ma ville, j'étais devenu le médecin d'un quartier malheureux; j'avais accepté ce destin et un horizon de hautes maisons misérables. Des infiniment pauvres, des intouchables puis des ouvriers des employés chétifs avaient frappé à ma porte : tout le jour ils venaient s'étendre sur mon divan brûlé par leurs fièvres, verni par la sueur de leurs angoisses. Le soir, un cartable sous le bras comme les policiers, j'escaladais les exténuants escaliers de la misère : ces spirales semblent mener au ciel et finissent au corridor noir de l'enfer prolétarien. Je pensais que ces gens m'aimaient et comme quelque chose persistait en moi de cette bonté naïve de l'enfance, cela m'avait longtemps suffi. »
Ciel de Suie et Le Passage ont bien d'autres parentés :
- Le décor de la ville de Lyon, d'abord, de la ville de Lyon telle qu'elle était dans la première moitié du vingtième siècle. - La tristesse et la douceur des destins qu'ils narrent l'un et l'autre, ensuite :
Palabaud, l'interminable agonisant dont l'agonie finale éclaire la métaphore du titre, Patrice et Noëlle, les amants inavouables dont le sacrifice final entre soudain en résonance avec la suie d'un ciel ô combien béraldien. Une pudeur dans la narration, enfin, pudeur qui fait évidemment de Reverzy un des fils secrets d'Henri Béraud. Mais enfin, laquelle de ces filiations aurait pu être significative, si cette première - le narrateur-médecin des pauvres, avec toute la symbolique dont elle est chargée pour le lecteur - n'avait été d'abord rendue à ce point explicite.
Illustration "Médecin et son patient", tirage photo de Beato FELICE, 2ème moitié XIXème siècle.
09:46 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : béraud, reverzy, littérature, lyon, romans, ciel de suie, place des angoisses | 
jeudi, 10 juillet 2008
Le Bât d'Argent (Joseph Jolinon)
« Moins de dignité, un peu plus de fric » : La formule résume la triple crise, économique, morale et religieuse, qui cingle de plein fouet la bourgeoisie lyonnaise au cours des années trente, et dont témoigne le cycle des trois romans que le romancier Joseph Jolinon consacre à la décomposition d’une famille, les Debeaudemont. La question romanesque de la transmission (celle de l’argent, celles des sentiments, des comportements, des valeurs) est au centre crucial des enjeux sur lesquels reposent les intrigues entremêlées : Tout comme la mère, fille de financiers « apparentée à ce que Lyon compte de bourgeoisie ancienne restée pure de mésalliance », a tenté comme elle le pouvait, durant les deux premiers tomes, de concilier adultère et catholicisme, le fils va longtemps hésiter entre sa passion, qu'il croit sincère, pour une dactylo de la Guillotière et la dot, qu'il sait nécessaire, que lui tend un des partis les plus intéressants de la ville :
"Les heures se succèdent, sonnées avec lenteur par les églises de la ville ancienne, aux cloches différentes, éveillant les souvenirs de combien de générations retournées en poussière, parmi lesquelles combien de fils de familles tombés dans les bras de filles du peuple ! Pathétiques nuits lyonnaises au bord de la Saône au calme plat, fenêtres closes et feux éteints, toutes barques amarrées Nuits en mouvement perpétuel d'eau qui coule des collines et des brumes qui renaissent pour s'évanouir, vouées à la vie secrète"
Quant au père, on sait depuis la fin de L'Arbre sec qu'il a fini suicidé dans la Saône. A la fin de ce tome III (Le Bât d’Argent), son digne rejeton qui finit marié à une femme qu'il n'aime pas s’exclame : « ça m’est égal,, pourvu que ça dure autant que moi » : Moi ! Tel sera donc le mot de la fin de la trilogie, et on sait combien, dans un roman bien ficelé, ce dernier mot compte. Comment mieux mettre l’accent sur cette montée en puissance des divers individualismes qui structurent l’ensemble des conflits présents, conflits que ni l’époque ni la ville n’ont les moyens d’absorber ? La scène durant laquelle est estimée à son juste pesant d’or la valeur de l’héritage qui a survécu aux affres de quatorze-dix-huit, mille neuf cent dix-sept et mille neuf cent vingt-neuf est, à ce titre, éloquente :
« Emprunt de l’Etat Russe, à quatre et demi Obligations de cinq cent francs...
- Combien ?
- Cent soixante.
- Quatre-vingt mille francs qu’il a mis là ! Une part de la dot de ta mère Ca vaut quinze cents francs le tout, à l’heure actuelle. C’est quand même foutant ! Continue !
- Cinquante emprunts à Saint-Pétersbourg, 1912
- Même chose. Passons !
- Brazil Railway Company, six pour cent, 1913. Vingt obligations ...
- Ce n’est plus côté depuis cinq ans il y a un procès… »
Cela se poursuit durant des pages : moment pathétique durant lequel le Bât d’Argent, point encore absolument vide, se découvre tout de même pathétiquement bien entamé : « La génération qui borde le ciel de nuées tragiques n’est pas celle qui reçoit l’averse », en conclut le fils de famille à une autre page du roman. Belle formule, et comme vouée à être répétée fort amèrement par chaque génération qui suit l'autre : « Tout nous dit que nous ne vieillirons pas comme vous, derrière des banques et des frontières barbelées, jouissant à loisir du droit de cultiver les arts, de gominer nos phrases et nos cheveux blancs ». Tandis, donc, que le fils se console dans les bras de sa maîtresse, une fille du faubourg avec lequel il apprend durant quelques jours à regarder le monde d’en bas, et pour laquelle il vendra tout de même, avant qu'elle ne meure, "la moitié de son paquet de titres", sa digne mère - à qui tout le monde répète que le deuil lui va bien - contemple inlassablement des paysages : « Que de laideurs démocratiques », soupire tristement la dame de Lyon, sur le point d’arranger le mariage du dernier représentant des Debeaudemont du haut du fort de Loyasse, «que de laideurs », comme « une offense à sa jeunesse », «les jardins ouvriers » et «les habitations à bon marché » qui fleurissent et sur la colline et la défigurent...
Avec ce mariage final, chacun peut penser que tout va rentrer dans l’ordre, la loi voulant que 1934 suive harmonieusement 1933, lequel se serait en toute simplicité substitué à 31-32, avec la même allégresse qu'un pas de danse sur un parquet ciré ; le père aurait remplacé le fils et la dame de Lyon pourrait retourner prier à Fourvière en compagnie de sa bru, en toute tranquillité. Mais le romancier nous rappelle discrètement qu'entre 1931 et 1935, des événements se sont déroulés en Europe : mines qu'il dépose, en quelque sorte, les pas de personnages moins avertis qu'il ne l'est. On comprend que ce mariage sera le commencement d'une autre dégringolade.
Certes, Joseph Jolinon n'a pas ce style claironnant, parfois flamboyant qu'on reconnait - et moi le premier - à Henri Béraud. C'est un auteur au verbe plus neutre, qui décline son phrasé un ton en-dessous. Il a cependant une façon malicieuse de travailler le cliché, en artisan de la langue conscient et soucieux du bel ouvrage. Cliché, mis au service de la lucidité. La critique de l'époque l'a souvent comparé à Montherlant (en raison, sans doute, de son discours récurrent sur l'avènement du sport). Ce qui m'intéresse chez lui, c'est sa façon de tirer un parti romanesque de la crise insoluble que traverse la société bourgeoise des années trente. Avec cette trilogie qui mériterait une réédition, il brisait, pour ses contemporains qui se croyaient "à l'abri", une illusion très vivace dans la France de son temps - et qui l'est certainement dans celle du nôtre : celle qu’on pourrait, au nom du droit magique que confère la "mondanité", échapper aux violences des remous de l’Histoire, au nom des droits de l'homme et de ceux du chrétien, court-circuiter comme par enchantement ceux, toujours prégnants en littérature et ailleurs, du Destin.
19:32 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, jolinon, lyon, roman, romans, culture | 
mercredi, 09 juillet 2008
L'Arbre sec (Joseph Jolinon)
L'Arbre sec : Deuxième volet de la trilogie consacrée à la famille Debeaudemont, qui fait suite à Dame de Lyon. L'Arbre sec, c'est d'abord le nom d'une rue du centre-ville; d'après le dictionnaire des rues de Lyon de Brun de la Valette (qui reste la petite Bible en matière d'histoire locale des rues à Lyon), d'après lui, donc, l'appellation est attestée depuis le quatorzième siècle, ce qui fait un sacré bail. Allez savoir pourquoi cette rue, comme celle du Bât d'Argent, (dernier titre de la trilogie de Jolinon dont on parlera bientôt ici-même), a résisté à cette mode stupide inventée par le stupide dix-neuvième siècle, et qui consista à rebaptiser les rues avec des noms d'hommes célèbres, avec l'idée bien bourgeoise d'édifier et d'instruire le peuple de cette manière-là. C'est comme ça qu'ont disparu de nos plans des noms comme « la Truie qui fyle », « les Deux-Angles », « le Mont-sauvage », « Boucherie » et autre « Enfant qui pisse »
Le flâneur (comme l'habitant) connait-il mieux, pour autant, le nom des maires, conseillers d'arrondissements, professeurs, docteurs, avocats et députés de la Troisième, Quatrième (voire Cinquième) République encartés en bleu au coin d'la rue? C'est improbable...
Brun de la Valette, donc, je le cite : "Cette rue était principalement habitée jadis par des potiers, tuiliers, "tupiniers" Son nom provient d'une enseigne (alors au n° 15), évoquant probablement l'arbre toujours vert d'Ebron, qui se dessécha à la  mort du Christ". Vous verrez que ce détail a son importance dans l'affaire qui nous occupe, or donc, retenez-le bien L'érudit local rajoute dans son article des choses qui peuvent nous intéresser aussi, bien qu'elles ne concernent pas directement le livre de Jolinon : Comme par exemple que les Charly, dits Labé, cousins de Louise, y vécurent un temps. Ou bien qu'au dix-neuvième siècle, cette rue coupe-gorge non loin du quai Bon Rencontre était un repaire d'ouvriers tisseurs. Bon ! Passons à Jolinon.
mort du Christ". Vous verrez que ce détail a son importance dans l'affaire qui nous occupe, or donc, retenez-le bien L'érudit local rajoute dans son article des choses qui peuvent nous intéresser aussi, bien qu'elles ne concernent pas directement le livre de Jolinon : Comme par exemple que les Charly, dits Labé, cousins de Louise, y vécurent un temps. Ou bien qu'au dix-neuvième siècle, cette rue coupe-gorge non loin du quai Bon Rencontre était un repaire d'ouvriers tisseurs. Bon ! Passons à Jolinon.
Le premier volume s’était achevé par le renoncement à l’adultère d’Alice, le deuxième reprend la maille avec la rencontre qu’elle fait de son fils, le beau Jacques, au bras de sa meilleure amie d’enfance, dans une « maison de nuit » des Célestins, en compagnie de celui-là même qui faillit devenir son amant : « La distance qui l’éloignait de son fils et de son ami égalait celle qui la séparait de son mari ». Pour chasser ses démons, la « dame de Lyon » songe donc à s’occuper l’esprit en occupant un emploi. Mais que choisir ? La situation économique générale n’est pas rose :
« En dix ans de paix, les capitaines d’économies avaient si bien travaillé au bonheur du genre humain qu’il en résultait une crise sans précédent et que la plupart des entreprises d’un intérêt général, pour ne pas dire national, couraient à la faillite. » Jolinon observe la société du Rotary, et enregistre les mutations de son temps : « l’homme de la soie » n’est plus le seul à pontifier : « On entourait surtout celui de l’automobile De même ne témoignait-on plus qu’une déférence modérée aux chefs de la banque et de la dorure, qui faisaient figure d’âmes en peine. En revanche, l’homme du ciment paradait. Et l’homme des produits chimiques avait le verbe haut. » Pendant ce temps, une affaire criminelle empoisonne le quartier de la Guillotière : le mutilé de guerre (époux, on s'en souvient, de la femme de ménage du couple Debeaudemont), a été retrouvé assassiné dans son logis. C’est sa femme qu’on accuse. Comme désemparée par tout ce qui l'entoure, après tout un périple intérieur, Alice (qui ignore qu’elle est toujours filée par un détective payé par son mari) cède finalement aux avances pressantes du meilleur ami de son fils. Si, si ! Certain d’être cocu, Debeaudemont-père s’exclame en lisant le rapporrt de l'agence qui file tout :
« Alice est victime du monde moderne! Moi-même, parfois ! On a le sentiment de s’agiter en pure perte».
Quelque chapitre plus loin, on retrouve Alice face à un vieux médecin lui annonçant qu’elle est enceinte. Naïve malgré son âge, elle s'imagine un instant pouvoir faire le bonheur conjugal de son jeune amant, à qui elle avoue à demi-mots les choses. C'est une « bovaryque », pense d'elle son confesseur (joli trait d’époque) ... Evidemment, elle se fait rabrouer : «Il est selon moi infiniment risqué de faire des gosses à l’heure actuelle. Sans parler de la responsabilité qu’on encourt à mettre au monde un être peut-être bête, ou mal fichu, rachitique ou excité, voué en tout cas par le monde, la famille, les nourrices, les bonnes, les pions, les adjudants et autres militaires à des embêtements si exténuants que, de deux choses l’une : ou il se révoltera s’il a quelque vigueur, ou il moisira jusqu’à sa mort sans pouvoir se délivrer. » Voilà bientôt la « dame de Lyon » en train de quémander une adresse de confiance auprès de sa meilleure amie, maîtresse de son fils, dame pécheresse d'expérience.
Le roman s’achemine ainsi vers une fin toute tracée. Après un avortement réussi parce que, suggère cyniquement l’auteur, il ne fut pas «un avortement de de pauvres », Alice erre un temps de maison de repos en confessionnal, avant d’arriver à exercer une profession, dans un hôpital pour enfants, puis dans un asile d’aliénés, où elle tente, entre deux confesseurs, de se racheter une conduite. L’Arbre sec, dans tout cela, qu’en est-il de l’arbre sec ? Vous souvient-il de l'arbre toujours vert d'Ebron, lequel se dessecha à la mort du Christ ? Non ? C'est que vous êtes distrait. En tout cas, ce qui demeura vivant jusqu'alors cessa de l'être, et tel est le commencement de la dernière page du second tome de Jolinon :
« Sur le bas port, en amont du pont de la Guillotière, des mariniers se rassemblaient Un noyé attirait leur attention. Ils formaient le cercle en le voyant bien mis, frais, décoré de la Légion d’Honneur, et se gardaient de le toucher en attendant la police. Debeaudemont était de biais, près d’un tronc d’arbre, les jambes allongées, encore mobiles dans l’eau, le haut du corps raidi, la tête nue, l’œil droit fermé, l’œil gauche entrouvert, louchant vers son ruban. Il n’avait pas quitté son parapluie.»
Voila donc un roman (édité par Rieder, voir note précédente sur Dame de Lyon ) qui fit l'un des succès de l'été 1933 et qui est, il faut bien le reconnaitre, parfaitement oublié. Il y a là-dedans un peu d'injustice.
Par conséquent, si vous aimez chiner dans les vide-greniers ou les brocantes, si vous aimez les tapisseries d'alcôve à rayures et à fleurs (on n'en trouve de moins en moins - notez-le bien) ou bien les réveille-matin mécaniques en faux-marbre et leur clé qu'on remonte à la main, vous aimerez forcément l'ambiance un rien fané, un rien coquine, un rien tragique qui s'en dégage. C'est du Flaubert revisité par Colette et mis à la sauce andouillette, ce qui n'est pas rien ! C'est bien écrit et l'histoire est menée par un romancier qui connait son métier, même s'il n'est ni Proust, ni Céline.
00:44 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, nom de rues, arbre sec, lyon, jolinon, romans | 









