vendredi, 31 octobre 2008
Un temps de Toussaint...
20:21 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : léo ferré, chansons, actualité, météo, ostende, plue | 
lundi, 27 octobre 2008
W : Si la photo est bonne
Une simple lettre : Son nom, il le signe de la pointe de l'épée (comme Z). L'initiale, depuis K, a donc fait recette. Le titre du film d'Olivier Stone, sur le mode de celui consacré au président assassiné de Dallas (JFK), donne donc dans l'ellipse. Pas besoin de le voir, suffit de survoler quelques articles promotionnels pour comprendre de quoi il s'agit : l'homme le plus puissant du monde, réduit face à son père à prouver qu'il tient tout entier, dans une simple lettre de l'alphabet. Ce qui est bien, avec Stone, c'est qu'il est, comme on dit, franc du collier ; quand on lui demande ( cf. interview du Nouvel Obs) pour quelles raisons il a fait ce film et quel public il cherchait à toucher, il répond sans hésiter : "le plus grand public possible". Et ce propos assez terrifiant : "je veux que le film soit représenté dans des endroits où les gens n'ouvrent jamais un livre"...

Une fois de plus, nous voilà dans du pseudo cinéma-réalité. Et toujours ce même argument revendiqué, asséné :"on n'a rien inventé (...) la seule scène qui n'est pas historique est celle du rêve où Bush père accuse Bush fils d'avoir sali le renom de la famille..." Nous voici donc, une fois de plus, "entre les murs", non pas d'une classe de quatrième à Paris, mais de la Maison Blanche à Washington. Ce qui procède de la même imposture. (Notez cependant qu'un français comme Bégaudeau, moins décomplexé qu'un américain comme Stone à l'égard de sa propre nullité, prétendra avoir fait oeuvre pédagogique, sociologique, voire intellectuelle..., là où Stone prétend simplement remplir le maximum de salles). Un argument (un seul) en faveur de ce probable navet : la remarque du pauvre Josh Brolin, interprête de Bush : "Je n'ai pas essayé de ressembler à George W Bush, mais d'interpreter un rôle". Le fait est que le malheureux est perdu au milieu d'une distribution de sosies...
Nous ne sommes, il est vrai pas en reste, nous les frenchies, avec nos Piaf, Sagan, Mesrine, et autres Colufichets. Je me demandais, sur le blog de Kl loth (daily life), à quand un film sur Léon Zitrone. Celui-ci, j'irais sans doute le voir, si le sosie (acteur est un mot périmé, ne parlons pas non plus de ce terme antique de comédien) est bon. Si la photo est bonne, chantait, du temps où le cinéma était encore vaguement un art, Barbara. Une fois de plus, je parle d'un "film" que je n'ai pas vu, que je n'irai pas voir, et je revendique le droit de le critiquer quand même, pour avoir assisté d'un oeil distrait à sa promotion, qui tient dorénavant pour moi lieu de projection. Tiens, je pousserai même le culot jusqu'à critiquer des films qui n'ont pas encore été tournés, et je gage que si Stone conclut son entretien avec François Forestier en déclarant qu'il votera Obama, c'est que l'élection de ce dernier, plus spectaculaire que le serait celle de Mac Cain, lui assurerait un beau succès pour un prochain navet.
09:12 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : cinéma, bush, amérique, olivier stone, actualité | 
mardi, 14 octobre 2008
Louis Guilloux, L'esprit de fable

« J'ai toujours regretté de n'être plus un paroissien de la cathédrale comme je le devins, huit jour après ma naissance, puisque c'est là que je fus baptisé le 22 janvier 1899 », écrit Louis Guilloux au soir de sa vie, dans la nouvelle La Ville, un texte magnifique qu'on peut trouver dans Vingt ans ma belle âge (Gallimard, Paris 1988).
Il n'est pas anodin, cet autre titre choisi pour l'une des ultimes confidences: L'herbe d'oubli. Louis Guilloux n'y parle que de sa ville natale, Saint-Brieuc, du temps que la fausse lumière de l'électricité n'avait pas encore envahi toute la baie. Il évoque les processions religieuses, les légendes qui dorment :
« C'est en l'année 469 qu'un vieux moine venu d'Irlande et du pays de Galles avec quatre-vingts compagnons débarqua sur nos bords. Le vieux moine et ses compagnons n'étaient ni plus ni moins que des réfugiés fuyant leur île envahie par l'ennemi. En débarquant, ils ne trouvèrent que la forêt et les loups, un méchant baron dans son château de bois qui d'abord voulut les tuer tous, mais qui fut touché par la grâce, s’étant mis à prier. Avec ses compagnons, le vieux moine s'arrêta près d'une fontaine. Ils bâtirent là un oratoire. C'est alors que s'alluma la première lampe, que tinta la première cloche et que retentit le premier coup de hache des défricheurs. On dit aussi que le vieux moine et ses compagnons apportèrent avec eux l'esprit de fable... »
L'esprit de fable... Je retrouve, en lisant ces lignes, quelque accent du Renan des Souvenirs d'enfance et de Jeunesse, je perçois, derrière la stature un peu sec de Renan, l'ombre plus humide de celle de Chateaubriand : Combourg, Tréguier, Saint-Brieuc... Guilloux se veut tisseur de continuité, raccommodeur de déchirures, il se veut, se voit, se vit et se sait planté dans cette terre-là, faite de la tradition du vent, du langage et du sel. Au fond de la cathédrale de Saint-Brieuc, dans un coin de la chapelle Sainte-Anne, une pierre gravée rappelle qu'en effet, Saint-Brieuc (Brigomalos, du celte bri , dignité et mael, prince) ne s'est pas ému devant les loups :
"Un peu plus tard, Brieuc revenait d’une dépendance éloignée de son monastère. Assis dans son chariot, il chantait des psaumes ; les moines marchaient devant lui, entonnant les antiennes. Le soir tombait. Tout à coup, les moines se turent, puis se dispersèrent en fuyant avec épouvante ; à leur place le vénérable abbé vit se dresser, se former en cercle autour de lui une bande de loups menaçants, prêts à se ruer sur les bœufs attelés au charriot. Le saint, impassible leva la main ; les loups tombèrent et se prosternèrent devant lui comme pour demander grâce. Mais quand les moines, remis de leur panique voulurent pour rejoindre leur maître franchir la ligne formée par les fauves, ceux-ci leur refusèrent le passage et les tinrent en respect. Au matin, passèrent une troupe d’émigrants. Leur chef Conan s’arrêta afin d’admirer le prodige et, y voyant un signe du ciel réclama pour lui et ses hommes le baptême. Brieuc ordonna aux loups de s’éloigner et prescrivit à ses catéchumènes un jeûne de sept jours, pendant lesquels il les instruisit. Le huitième il les baptisa."

Saint-Brieuc, évêque et dompteur, Louis Guilloux, dansant avec les loups : sous les poutres de la cathédrale, les dalles sont humides, autant que l'air est marin. Les lourds piliers de pierres veillent sur l'esprit de fable qui hante une pénombre chargée de Magnificat et de Je vous salue Marie. Dans la cathédrale Saint-Etienne furent célébrés et le baptême et la messe d'enterrement de Louis Guilloux. La bâtisse grise et trapue aura été paradoxalement son Panthéon à lui, lui qui s'est souvent plaint d'avoir été oublié de Dieu. Elle n'est peut-être pas la plus belle église de Bretagne. Elle est, assurément, la plus enchantée.
09:24 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : louis guilloux, littérature, culture, actualité, l'herbe d'oubli, saint-brieuc | 
dimanche, 12 octobre 2008
Louis Guilloux, franc-tireur
« La trahison, ça commence de bonne heure, si on est capable de la ressentir" » C'est Louis Guilloux qui parle. Il aurait eu 109 ans dans deux jours, s'il n'était mort, le 14 octobre 1980. Sur le site de l'INA, je viens de retrouver l'émission Apostrophes que Pivot lui a entièrement consacrée, le 2 juin 1978. Un grand moment de bonheur. Il n'y a que trois écrivains dont je possède toute l'œuvre à la maison. Guilloux est de ceux-là. L'émission est enregistrée à propos de la parution de Coco Perdu; très vite, on parle de La Maison du Peuple. Puis de l'engagement politique. Puis de la littérature. Ce qui frappe dans le regard, le sourire à peine esquissé de cet homme âgé, c'est aussi ce qui frappe dans son écriture : la douceur. A propos de ce dernier roman, Coco Perdu, Guilloux déclare : 'j'ai voulu donner une signification à une quantité de français moyens qui subissent un dernier coup du sort dans ce qu'on appelle la retraite, et rien autour d'eux, qu'une société inerte, méchante, où ils ne trouvent aucune ressource."
« Littéraire ça veut dire mensonger, ça veut dire arrangé. », déclare-t-il un peu plus tard. Pivot feint de s'étonner. Toute la beauté du regard de Guilloux, soudain : dans cette envie de passer la rive qui l'a toujours séparé de Saint-Brieuc à Paris, de la retraite fertile en province aux honneurs de salons parisiens, d'une culture populaire qui fut celle de son cordonnier de père dans La Maison du Peuple, à cette culture littéraire que la bourgeoisie, en effet, a annexée, que Guilloux à la fois aime et se défend d'aimer : "Quand j'ai pris conscience de ma condition prolétarienne, je me suis rendu compte qu'on vivait dans un monde chrétien où personne n'était le frère de l'autre, républicain, où personne n'était l'égal de l'autre." Guilloux explique à petits mots brefs et saccadés, tout comme ses gestes, qu'il n'était pas à l'aise dans les partis, et qu'il n'est resté au parti socialiste qu'un seul jour : « J'étais à l'aise avec les manifestations des rues, avec les hommes, avec leurs idées mais pas dans les partis. » Pivot essaie de lui faire dire : « vous étiez un compagnon ». Il fait une moue. Lui-même s'accorde un seul titre : Franc-tireur :
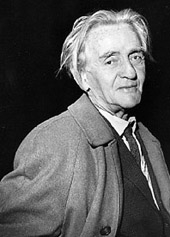
« J'ai toujours été dans une philosophie de gauche, socialisante, et même communisante, mais il y a un côté anarchisant, lié à l'écriture, qui est vraiment mien. »
- Le sang noir, est-ce un roman pamphlet contre la bourgeoisie ? demande Pivot.
« On l'a pris pour un livre communiste, ce qui n'est pas le cas, c'est plutôt anarchisant », avoue son auteur en regardant, narquois, le journaliste. On sent que ça l'amuse. « Nous avons juste bavardé », dira-t-il à la fin de l'entretien... Il explique alors que Gide avait trouvé "qu'il y avait de quoi perdre pied dans son livre" et l'avait invité à l'accompagner en URSS. Pivot s'excite un peu, flaire un scoop, mais à propos de ce fameux voyage, Guilloux rompt très vite : « On bouffait du caviar, on buvait de la vodka, on n'a pas désaoulé ! ». Même Gide ? risque Pivot. A l'époque, Guilloux avait refusé de raconter ce qu'il va peut-être raconter, et qu'il appelle à présent : André Gide aux bains... On sent que Guilloux méprise et respecte encore l'ainé et le bourgeois. Il n'en dit pas plus.
Quand Pivot lui demande ce qu'il pense de Staline, il répond :
« Je ne suis pas un politique. Si j'étais plus violent, je serais volontiers terroriste... »
Silence de Pivot. Guilloux s'explique :
« Tu n'es pas des nôtres : voilà ce que la bourgeoisie crie au prolétariat, davantage maintenant encore que quand j'étais jeune ... »
Pivot : « Qu'est ce que vous faites du progrès ? »
Guilloux lance, tout net : « Quel Progrès ? Le frigidaire, la voiture ? Ecoutez, Bernard, quand même ! Ce n'est pas sérieux ! Je ne crois pas au bonheur par la diffusion, la prolifération des commodités, des machines. Ce sont des échappatoires, des fuites. Il n' y a qu'une question qui nous intéresse, ce n'est pas ce qu'est la vie, mais ce que nous pouvons en faire ».
Guilloux avoue que, de moins en moins, il croit que l'écrivain a & aura d'influence sur la société. Pour tout dire, il sait que l'écrivain n'en a déjà plus aucune et regarde l'homme d'Apostrophes avec une sorte d'incrédulité à la fois paterne et jovial :
« On devrait se taire, se foutre en grève », dit-il à Pivot.
« On devrait dire à ceux qui aiment l'argent : Vous aimez l'argent : mangez le ! Des tartines de billets de mille balles, ça doit pas être mauvais, pour ceux qui aiment l'argent... »
Louis Guilloux avoue avoir partagé avec Albert Camus ce qu'il appelle une grande parenté d'esprit : »Sa mère, que j'ai connue était une femme de ménage illettrée. Une grande dame ! (il sourit) Elle avait toute la noblesse qu'on pouvait désirer. Ouais ! (Guilloux ponctue souvent ses phrases d'un de ces ouais, un ouais de ce genre, en rupture avec tout le reste de son phrasé, comme le serait un terme d'argot.) Un jour, Camus m'a raconté une anecdote très jolie. Il m'a dit, tu sais, j'ai dit à Maman : -j'ai été invité chez le Président de la République, à l'Elysée. Ah ! dit sa mère : Qu'est-ce qu'il t'a fait à manger ? - Ben je n'sais pas, parce que n'y suis pas allé... - Ah! réplique-t-elle... - Oui c'est pas des gens comme nous. C'était un homme charmant, rajoute Guilloux, je l'aimais spontanément. »
C'est Camus qui rédigea la préface de la ré-édition dans Les Cahiers Rouges de Grasset de La Maison du Peuple, récit grâce auquel Guilloux avait fait, en 1927, « son entrée dans le monde des lettres ».
A ce moment-là, Pivot lit la plus célèbre phrase de cette préface : « Voilà pourquoi j'admire et j'aime l'œuvre de Louis Guilloux, qui ne flatte ni ne méprise le peuple dont il parle et qui restitue la seule grandeur qu'on ne puisse lui arracher, celle de la vérité." »Guilloux le regarde, muet.
 Derrière eux, un mur tapissé d'exemplaires de la "blanche" de Gallimard, du temps de sa grandeur et de son rayonnement. Encore que... A propos du rayonnement des livres, Guilloux de se racler la gorge et de balancer, comme en s'excusant, à Pivot : « Je ne crois pas qu'un livre puisse changer quoi que ce soit... »
Derrière eux, un mur tapissé d'exemplaires de la "blanche" de Gallimard, du temps de sa grandeur et de son rayonnement. Encore que... A propos du rayonnement des livres, Guilloux de se racler la gorge et de balancer, comme en s'excusant, à Pivot : « Je ne crois pas qu'un livre puisse changer quoi que ce soit... »
Pivot relance la conversation : eMais alors, c'est avec Sartre et Aragon que vous auriez dû être amis, non ?e. Et Guilloux, en riant : eEh ben non ! ça parait bizarre, n’est-ce pas... (il s'attarde sur le cas Aragon) Je ne nie pas son talent, je ne nie pas son charme, grince-t-il. Mais enfin...On aurait pu être ami, on ne l'a pas été. » (Pour l'anecdote, de retour du Voyage en URSS en 1937, les deux hommes ont participé à la création d'un journal communiste, Ce soir. C'est alors qu’Aragon lui a demandé d'attaquer Gide, qui venait de publier son Retour en URSS. Guilloux refuse. Le 1er septembre, Guilloux rejoint Saint-Brieuc, où il préside en temps que "franc-tireur" un comité de soutien aux réfugiés espagnols.) Pivot, du coup, tente de revenir à Sartre; mais Louis Guilloux, d'un ton tranché : "Connais pas !" Pivot s'étonne,
« Mais vous aviez le même éditeur, vous auriez pu vous rencontrer dans un couloir...
- Je ne l'ai pas rencontré; il ne m'a pas rencontré non plus."
-Comme c'est dommage, insiste Pivot.
-Pourquoi ? -
Ce qui est bizarre c'est que ni vous ni lui n'ayez fait l'effort de rencontrer l'autre.
Un geste de la main :
-Ben non ! »
Louis Guilloux et Malraux : Et avec Malraux ? Là, le maître de Saint-Brieuc sourit, il hausse les sourcils, déroule une main : "Grand ami, de toujours !". Guilloux explique que l'amitié doit toujours transcender les idées politiques. Il prend le ton de la confidence heureuse :
« Je recevais des lettres de Malraux, quand il était ministre, ses lettres étaient signées d'un petit chat. »
Pivot, interloqué :
« - ça veut dire quoi, ça ?
- C'était le chat... Il aimait, il adorait les chats, et il signait les lettres à ses amis d'un chat, toujours…
- Mais quand il était ministre du Général De Gaulle, vous deviez être exaspéré? »
Guilloux s'énerve : « On parlait d'autre chose ». Pivot : « Vous ne lui en avez jamais voulu ? - Mais non», conclut Guilloux, d'un ton las et ferme.
Pivot n'insiste plus...
Lorsque sous la pioche des démolisseurs disparurent les maisons de la rue du Tonneau, à Saint-Brieuc, et l'ancienne échoppe de son père, si magnifiquement décrites dans le Pain des Rêves. Guilloux, qui jouait un rôle de plus en plus important dans la Résistance, se trouva de plus en plus déprimé par le cours des événements. Malgré ses nombreux doutes, il poursuivit néanmoins l'écriture très besogneuse du Jeu de Patience : une prémonition ?
« La reprise de ma Chronique du Temps Passé devenait de plus en plus difficile. Si la peinture que j'avais tentée d'un monde d'autrefois ne semblait plus rien rejoindre de notre monde actuel, à plus forte raison n'intéressait-il pas l'avenir. Les hommes nouveaux ne seraient pas des hommes du souvenir, et même, ils ne voudraient pas en avoir ».
« Une année », dira-t-il sans malice à Bernard Pivot, (deux auraient dit les puristes) « j'ai vécu une année dans le dix-neuvième siècle ! » Cela pouvait-il suffire à faire de lui un homme de ce siècle ? Pivot, avec le ton emprunté d'une fausse congratulation, avec l'arrogance inconsciente d'elle-même du moderne et du vivant fait :
« Mais non, vous êtes un homme du vingtième siècle, par vos engagements, par votre écriture… »
Louis Guilloux branle du chef :
Non, affirme-t-il. Non.
Et puis il résume très vite, avec une pointe de fierté dans la voix, son enfance passée dans la misère certes, mais surtout dans cette France d'avant Quatorze, dans ce monde que Stefan Zweig a génialement appelé Le Monde d'hier...
« Je suis, affirme-t-il sans le moindre équivoque, un homme du dix-neuvième siècle. »
Quand on voit, a-t-il écrit dans une page de ses Carnets, ce que les réalistes auront fait du vingtième siècle...
18:06 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : louis guilloux, littérature, actualité, culture, saint-brieuc, coco perdu | 
vendredi, 10 octobre 2008
Sully Nobel Prudhodommisé...
 Le prix Nobel (200 000) francs est acquis à Sully-Prudhomme, envisagé par les académiciens de Stockholm, luthériens dessalés et moralistes perspicaces, comme l'ouvrier de "la plus belle oeuvre idéaliste". Le patriotisme en personne est forcé d'en convenir, même à Paris, on n'est pas plus bête que ça. L'heureux vainqueur à déclaré son intention d'employer cette somme à venir en aide aux poètes pauvres, sans se réserver un centime ( Blague idéaliste, dont la dérision n'a pas tardé à éclater).
Le prix Nobel (200 000) francs est acquis à Sully-Prudhomme, envisagé par les académiciens de Stockholm, luthériens dessalés et moralistes perspicaces, comme l'ouvrier de "la plus belle oeuvre idéaliste". Le patriotisme en personne est forcé d'en convenir, même à Paris, on n'est pas plus bête que ça. L'heureux vainqueur à déclaré son intention d'employer cette somme à venir en aide aux poètes pauvres, sans se réserver un centime ( Blague idéaliste, dont la dérision n'a pas tardé à éclater).
D'après le Journal, Sully-Prudhomme fonde simplement un prix annuel de 1500 francs pour les jeunes poètes, à décerner par la Société des gens de lettres. C'est à cela que vient d'aboutir l'immense réclame d'immolation pour les pauvres. 1 500 francs, c'est à dire le quart du revenu de 200.000 à 3 pour 100 francs de bénef et le capital dans la profonde, sans préjudice d'une réputation d'holocauste. L'idéalisme est plutôt une bonne affaire.
( Léon Bloy, 18 décembre 1901 /5 mars 1902 - "Quatre ans de captivité à Cochons-sur-marne" (Journal, Bouquins, 1999)
PS. : Ci-dessus, on reconnait Sully, pas Léon. "La profonde", c'est la poche (ah! les ressources inépuisables de l'argot ... )
11:55 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : nobel, bloy, prudhomme, littérature, le clezio, actualité | 
jeudi, 09 octobre 2008
Oublier Le Clezio
La dernière fois que j'ai lu un Le Clezio, je l'ai même pas acheté. C'était il y a quelques années, à la Fnac. Son autobiographie. C'était si mal écrit, ou si pas écrit, ou écrit de façon si plate, que je me suis assis sur une chaise, j'ai commandé un petit café dans le coin buvette du centre de distribution d'objets culturels indéterminés et je l'ai -comme on dit d'une vitre quand on voit le jour à travers -, traversé. C'est la France qui va être contente : elle a pas eu les prochains Jeux Olympiques, on s'en souvient, c'est Londres qui a tiré le gros lot, ben elle a le Nobel de littérature. Remarquez, quand on pense que Pierre Perret est Chevalier des Arts et des Lettres, Le Clezio peut bien être labellisé, pardon javellisé, merde, je vais y arriver, nobélisé. Javellisé, il l'est déjà, depuis longtemps, bien propre sur soi et tout et tout, c'est pourquoi il a empôché le pâctole, le foutu cléziô. Il faudra que je retrouve ce soir en rentrant chez moi ce que Léon Bloy a écrit le jour où il a su que l'immortel Sully Prudhomme l'avait empoché, le premier Nobel de littérature. Je le retrouverai, promis.
En attendant, le français Yves Bonnefoy, qui a écrit une véritable œuvre littéraire, pour ne citer que lui, ne sera pas nobélisé. Une question : ce jury de Stockholm, il a appris à lire dans un cabinet d'expertise du genre de ceux qui font les classements des villes européennes, ou quoi ? Mais bon, on va pas s'indigner outre mesure, on va pas s'énerver pour autant. Louis Guilloux, qui a lui tout seul vaut quinze Le Clezio, n'a jamais eu le Nobel. Henri Béraud non plus. Je parle de ces deux-là, parce qu'ils sont tous les deux morts un mois d'octobre. L'un (Guilloux) fut président des écrivains anti-fascistes. L'autre (Béraud) fut le premier sur les listes des procès de l'épuration: La Gerbe d'Or, Le Sang Noir, Ciel de suie, Le Pain des Rêves, des livres de l'un, des livres de l'autre... Durant ce mois qui s'avance, de saines lectures, pour oublier Le Clezio...
20:37 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : nobel, le clezio, littérature, langue française, actualité | 
I live in a Very Important City
I live in a very important city. C'est moi qui suis fier. Pas peu fier ! Thank you to Gérard who made it possible, avec ses feuilles de route. Thank you Vincent Rocken , le journaliste du Progrès, sans qui on ne serait pas informé de l'importance qu'on a dans le monde. Thank you also to Jean Michel. Non, non, Jean Michel, ne t'en vas pas : tu as, tu as, toujours de beaux yeux... Thank you Juni, thank you Cris, Govou and Benzema. Thank you, thank you, thank you !!!! Il parait qu'une grève de footballeurs s'annonce. Les gars, déconnez pas. Cette putain de Coupe européenne, il nous la faut cette année, sur le bureau de l'Hôtel de Ville, nom de Dieu. Et les Marseillais, les Stéphanois, les Girondins, et tout et tout, faut les niquer. C'est nous, les champions. J'ai placé tout mon portefeuilles d'actions sur vous, si l'OL aussi suit le chemin des banques américaines, qu'allons-nous devenir ? On ne peut plus compter sur la parole de Nicolas Chauvin, bordel ? C'est un peu grâce à vous qu'on était passé, en 2007, au dix-septième rang européen, faut voir à le conserver, son rang !
Pauvre Nicolas ! Dix-sept blessures, trois doigts amputés ! Au joli temps de l'Empire, le chauvinisme était sans doute un sentiment encore assez simple : il n'y avait qu'une forme de chauvinisme, un chauvinisme un peu brut et paysan, franc du collier, made in mon clocher, le contraire du modèle citadin, bien plus tordu, lui, bien plus alambiqué. Ce chauvinisme rural avait peut-être encore un certain sens, remarquez bien. De la signification. En tous cas, il n'était pas un marché et personne n'aurait eu l'idée de le coter en bourse. Moi, tout ce qui a du sens, j'essaie de comprendre, je suis preneur. Le sens, c'est de l'histoire. Et l'histoire, c'est des hommes. Des siècles d'hommes. Le chauvinisme d'à présent, c'est plus compliqué. Un chauvinisme fabriqué en séries, un chauvinisme manufacturé à coup de hit-parades et de statistiques... Chacun a le sien : son club, sa marque, son genre, son label, sa cité. Du chauvinisme libéral. Toujours aussi identitaire, et donc toujours aussi bête. I live in a very important city. Du mauvais chauvinisme. Il fait mine de ne pas détruire le sentiment d'appartenir à un monde universel commun, rien qu'en surface. En profondeur, il brise les communautés, dissout les solidarités, place les particules en compétition, transforme chacun d'entre nous en une petite entreprise.
Quand, dans l'esprit des hommes, la Cité n'est plus qu'un label, comment s'étonner de la mort du politique ? Quand, dans le cœur des hommes, le sentiment de l'Universel vacille, qu'est-ce qui est le mieux, le pire : le trou, le bled, ou bien la marque, le style ? Sonia Rykiel, Calvin Klein ou Ploumschtroumpf les Bains, Montcalm les Jonquilles ?
08:24 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : europe, lyon, actualité, société, politique, chauvinisme | 
mercredi, 08 octobre 2008
COMMON DECENCY
Orwell est, décidément, fort à la mode. Après Jean Claude Michéa, Bruce Bégout lui consacre un essai que l'excellente maison Allia vient d'éditer. Le petit livre est tout entier consacré à l'analyse du concept (mieux vaudrait dire, d'ailleurs, la notion, car Orwell avait en horreur ces échafaudages intellectuels qui font le bonheur des conversations de salon) - de la notion, donc - de common decency. De la décence ordinaire : Tous ceux qui souhaitent se familiariser avec la pensée d'Orwell - complexe, sur cette question - trouveront là, pour 6,10 euros, un bon guide. « La décence ordinaire est le revers de l'apparente indécence publique » (citation de Bégout en quatrième de couverture). Mieux vaut, évidemment, lire directement les textes que Michea et Bégout commentent, à savoir les Essais, publiés par l'Encyclopédie des Nuisances. Et parmi eux ce très beau texte, au titre si évocateur : Tels étaient nos plaisirs. Je ne remets nullement en doute la probité des critiques et des commentateurs. Mais enfin, qu'une notion si longtemps méprisée comme la décence commune devienne peu à peu le concept phare d'une société qui érige aussi indécemment - et ce depuis tant d'années - l'opportuniste Noah, par exemple, en modèle national absolu, ou le trou du cul Bégaudeau (tiens, j'ai appris ce matin qu'avec les entrées de Entre les Murs, il songeait à racheter le FC Nantes en péril : n'est-il pas ce Bégaudeau, comme un parfait Zidane de la littérature, un héros décent, fort justement adapté, lui aussi, à l'époque ? ) - voilà de quoi méditer pour la journée !
07:35 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : orwell, littérature, bruce bégout, bégaudeau, actualité, common decency, allia | 
mardi, 07 octobre 2008
Débat de singes
"Le mot ne se négocie pas, il est simplement polysémique" : tel était le commentaire laissé par un anonyme "lexique en folie", à l'occasion de la première publication de ce texte, que je publie à nouveau, influencé (excédé ?) sans doute par ce que j'entends partout (radios - même dans le bus -on n'y échappe pas, c'est la crise, c'est la crise ! ..., TV, presse gratuite...). Si, hélas, les mots se négocient : Ils se vendent et s'achètent comme des putes, et ce depuis longtemps ; cela s'appelle lieux communs ( débités en campagnes de pub, de comm', et campagnes électorales) cela s'appelle rentrée littéraire, bande-annonce de films, clips, et bientôt dans certains cas, conversations du genre je t'aime moi non plus, savez ? ...) Si, hélas, bien sûr que le mot s'est vendu, et ce, je répète depuis longtemps. Ce n'est rien d'autre que ça, ce que de beaux esprits appellent "le déclin de la langue française". En rapport, sans doute, avec le déclin du signe monétaire. Crise des signes en pays de singes, donc, telle pourrait être la manchette du journal de Solko, ce matin :
Ils n’étaient que signes, et le savaient tous deux :
la lettre et le nombre,
la syntaxe et la monnaie,
la métaphore et le commerce.
Quand la valeur de l’or
Ne s’énonça plus que sur le papier,
Le mot fit remarquer à la monnaie :
Tu n’as fait qu'imiter mon arbitraire;
L'homme, c’est par moi qu’il lui revient de s'exprimer !
Sans broncher, la monnaie répondit :
"Ils sont bien trop nombreux, désormais ,
Pour entendre de ta bouche
Ce qui n’a que du sens :
J’ai moi de la valeur !
Quelles sont tes autres armes ?"
Le mot découvrit alors
L’éclatement sidéral de son être,
La signifiance, à l’infini,
A profusion, silence,parfum, musique,
Pensée, engagement, littérature...
Studieuse et très cynique,
La monnaie observait ce gueux tout en sueur.
"Ta parole n’est qu'une ruse,
Ricana-t-elle enfin :
Mon règne est ce qui vaut!"
Que dire, qu'écrire, que rire, depuis ?
Ce qui n’a plus, nulle part, de sens
Mendie sur les affiches un peu de sa valeur !
"C’est moi qui te possède!"
Déclare, souverainement prostituée,
Cette monnaie, singe fait signe,
A cette lettre, signe fait singe.
08:39 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : crise, monnaie, actualité, poésie, langue française, poèmes | 









